Sainte Jeanne-Françoise Frémyot
de Chantal
sa vie et ses Œuvres
Tome Premier
Mémoires sur la vie et les vertus
de sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal
Fondatrice de l’ordre de la Visitation
Sainte-Marie
par la mère
Françoise-Madeleine DE CHAUGY
secrétaire de la sainte et cinquième supérieure
du monastère d’Annecy
ÉDITION
AUTHENTIQUE
PUBLIÉE
PAR LES SOINS DES RELIGIEUSES DU PREMIER MONASTÈRE DE LA VISITATION
SAINTE-MARIE d'ANNECY
L'auteur et les éditeurs
déclarent réserver leurs droits de traduction et de reproduction à l'étranger.
Ce volume a été déposé au
Ministère de l'intérieur (section de la librairie) en octobre 1874.
PARIS.
-– TYPOGRAPHIE DE E. PLON ET Cie, 8, RUE GARANCIÈRE.
e. plon et cie imprimeurs-éditeurs
rue garancière, 10
1874
Tous
droits réservés
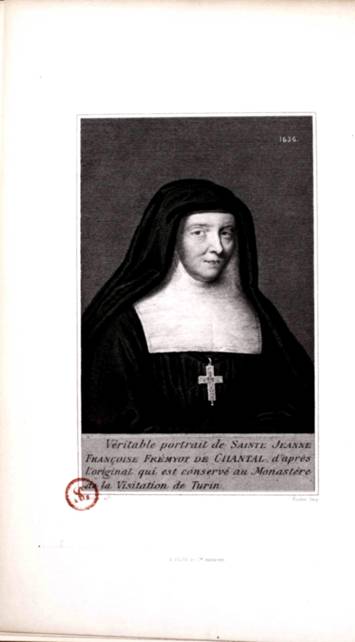
Lettre de Sainte Chantal, reproduite ci-dessous en fac-similé.[1]
Vive † Jésus !
Monsieur, je ne vous fais ce billet
que pour vous saluer de tout mon cœur, et par votre entremise les Révérends
Pères Recteur et Prédicateur, comme aussi ceux que vous savez à l'affection
desquels nous devons tant, et pour savoir si la maison est prête et s'il y a de
l'apparence d'y pouvoir mener les Religieuses sans leur faire courir fortune de
maladie à cause des blanchissages et de la rigueur du froid qui fait maintenant.
Nous attendrons votre avis sur cela, lequel je m'assure vous consulterez avec
les bons Pères et avec ces Messieurs qui nous font l'honneur d'affectionner
notre établissement.
Cependant, je vous salue et me
recommande à vos prières, étant pour jamais
Votre servante plus humble en Notre-Seigneur,
Sr J.
F. FRÉMYOT,
de la visitation sainte-marie,
dernier de l'an.
Dieu soit béni !
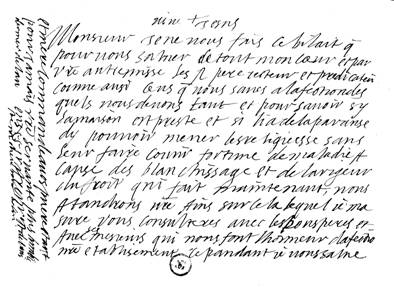

APPROBATION
de
s. g. mgr c. marie
magnin, évêque d'annecy
Il est des Saints dont les
vertus et la gloire sont connue un secret que Dieu semble avoir voulu se
réserver : ils ont vécu, ils sont morts ignorés ; seule l'Église a
inscrit leurs noms, et garde leur souvenir dans ses diptyques sacrés.
Il en est d'autres dont, au
contraire, Dieu veut faire connaître au monde entier les vertus et les
travaux ; Sainte Jeanne-Françoise de Chantal est de ce nombre. Sa vie
devait être le patrimoine et l'honneur d'une nombreuse famille de Saintes. Dieu
a voulu que cette famille pût contempler dans sa Mère un modèle accompli de la
perfection religieuse.
Saint François de Sales le tout
premier avait ébauché le portrait de cette femme héroïque, dans les conseils
qu'il lui adressait, et dont elle était l'application vivante ; et quand
il fut parti pour le ciel, la Providence eut soin de placer près de la Sainte
une jeune religieuse dont le nom restera immortel, Françoise-Madeleine de
Chaugy. Merveilleusement douée par la nature, son esprit élevé, son caractère
plein de fermeté et de grandeur se développèrent admirablement dans l'éducation
première qu'elle reçut au sein de sa famille. Devenue plus tard, dans la vie
religieuse, secrétaire de la sainte Fondatrice de la Visitation, elle s'éleva
sous sa direction aux plus hautes vertus ; elle acquit dans la pratique
des affaires ce tact, ce discernement, qui la rendirent propre aux plus grandes
choses et lui en facilitèrent le succès.
Dans cette position, elle
comprit ce qu'elle devait à la mémoire de Sainte Jeanne-Françoise de
Chantal ; elle écrivit sa vie, et elle [vi] mit à ce travail tout son cœur de fille d'une telle Mère, toute
son âme de religieuse exemplaire, tout son talent d'écrivain distingué.
C'est cette Vie que le premier monastère de la Visitation d'Annecy est
en voie de publier. Ce précieux ouvrage venant du grand siècle avec l'empreinte
de l'esprit de cette époque, à la fois religieux et littéraire, apparaît avec
une autorité que personne ne saurait lui donner de nos jours ; il apparaît
comme une grande lumière à une société penchant vers sa ruine et s'agitant dans
la confusion et le conflit des doctrines les plus contradictoires. Puisse-t-il
rendre à tous ceux qui cherchent sincèrement les doctrines de vérité et de vie,
le sentiment de ce qui manque généralement à notre époque : l'énergie et
l'empire sur soi ; énergie et empire que notre siècle sensuel et énervé
s'attache à détruire dans les âmes !
La Vie de Sainte Jeanne-Françoise, par la Mère de Chaugy, ne s'adresse
pas seulement aux âmes qui, dans la vie cachée du cloître, n'aspirent qu'à se
transformer sous l'œil et la main de Dieu pour les récompenses et les
splendeurs du ciel, elle s'adresse encore à toutes les personnes du monde qui
veulent chercher les traces qu'y a laissées la Sainte, et à toutes celles qui
se sentent élevées par la puissante influence et par l’action qu'exercent sur
elles les grandes âmes et le spectacle des grandes vertus.
La Vie de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal est suivie de ses Œuvres,
qui comprennent ses Entretiens
à ses filles, et ses Lettres, au nombre de plus de deux mille. On y
voit l’âme de la Sainte comme dans son sanctuaire ; on l'y voit montrant à
la fois, comme saint François de Sales, son guide et son modèle, aux uns les
voies de la perfection chrétienne, et aux autres celles qui conduisent à Dieu
les fidèles appelés à vivre dans le monde.
Tout promet à cette publication un véritable succès et des fruits que
nous prions Dieu de rendre abondants et permanents.
† C. MARIE, Évêque d'Annecy.
Annecy, fête de l'Assomption, 1874.
LETTRE
de s. g. mgr
mermillod, évêque d'hébron, vicaire apostolique de genève, à la supérieure de
la visitation d'annecy
Fernex, 12 août 1874, fête de sainte Claire.
Ma très-honorée Sœur,
La publication des douze volumes de l'Année sainte vous a valu les bénédictions du Souverain Pontife et
les suffrages des plus illustres membres de l'Épiscopat.
En mettant en lumière ces archives de votre famille de la Visitation,
cette histoire des grandes âmes qui se sont formées dans vos monastères, vous
avez, à votre insu, fait une admirable apologie de la vie religieuse et élevé
un monument littéraire.
Vous avez compris que cette œuvre devait se compléter. Ni les orages
qui désolent l'Église, ni les ruines qui se font au sein des sociétés ne vous
ont découragée : dans la paix et dans la lumière du cloître, vous avez
fait rechercher, vous avez fait étudier, et vous allez mettre au jour les Mémoires de la Mère Françoise-Madeleine de
Chaugy sur Sainte Jeanne-Françoise de Chantal.
La Mère de Chaugy fut, en plein dix-septième siècle, une religieuse
consommée dans la perfection spirituelle et un écrivain supérieur. Elle mena de
front le travail de sa sanctification, la Canonisation de saint François de
Sales, dont elle fut l'infatigable promotrice, et les Annales de votre Ordre,
quoique son existence fût livrée à de cruelles épreuves. On la dit : Nièce
et fille spirituelle de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal ; elle a, dans
la [VIII] grâce et dans
la naïveté de son style, quelque affinité d'esprit avec sa cousine, madame de
Sévigné. Ce ne sont pourtant pas les beautés littéraires qu'elle recherchait,
elle les cueillait naturellement ; elle n'avait d'autre but que de peindre
la femme forte qui fut la coopératrice de saint François de Sales :
ses Mémoires sont un chef-d'œuvre. On peut leur appliquer le mot de
saint Thomas sur saint Bonaventure écrivant l'histoire du pauvre d'Assise : C'est une Sainte
qui raconte l'histoire d'une Sainte. Aucun récit ne peut remplacer ces pages
élevées et attachantes, qui nous font pénétrer dans cette âme où Dieu s'est
complu à répandre l'abondance de ses trésors. Sainte Jeanne-Françoise de
Chantal ne peut être connue et appréciée, dans sa vie et dans son œuvre, que
par ces Mémoires, où s'unit toute l'impartialité d'un témoin
contemporain aux ardeurs de la piété filiale. Tour à tour, la jeune fille, la
femme, la veuve et la religieuse s'y montre avec le sens surnaturel qui la
distingue et la force héroïque qui fut son caractère principal. En les lisant,
on assiste à ces luttes sublimes où cette âme vigoureuse se laisse dompter et
transformer sous la main de Dieu qui multiplie ses souffrances ; on
contemple l'humble énergie avec laquelle elle se laisse tailler sous la
direction ferme et douce du grand Saint que le Seigneur lui donna pour guide et
pour père. La Mère de Chaugy ne saisit les faits extérieurs que comme des bijoux
dont elle se sert pour enchâsser l'âme de la Sainte. Là est son vrai mérite
chrétien et littéraire ; c'est plus qu'une biographie, c'est la peinture
d'une âme rendue visible, c'est l'étude du saint amour du Sauveur « qui
l'a fait persévérer jusqu'à la fin avec une fidélité toujours croissante au
service de Dieu ; fidélité admirable et qui ne se pourra connaître que
dans le ciel, parce que cette fidélité amoureuse a subsisté non-seulement dans
la douceur de la paix intérieure, mais dans l'effroi, dans l'horreur, dans la
violence et dans la longueur de la guerre spirituelle. »
Les volumes que vous publierez successivement compléteront l'étude de
la Mère de Chaugy. La Sainte se révèle par ses enseignements ; la doctrine
de la sainteté religieuse, que saint François de Sales lui a appris à puiser
dans le Cœur du Maître, jaillit en flots de [IX] lumière, de correction et de consolation ;
elle habite les sommets de la vie parfaite, et elle en parle comme d'un
spectacle qui lui est familier.
Sous votre inspiration, ma très-honorée
Sœur, les Lettres de Sainte Jeanne-Françoise ont été recueillies, classées avec
un soin délicat et fidèle. Grâce à vos volumes, il sera facile de suivre les
combats, les joies, les aridités spirituelles de la Sainte, et cela, mois par
mois, presque jour par jour, depuis 1615 jusqu'à sa mort.
Les hôtes des cloîtres, les
membres du clergé, les fidèles vivant dans le monde, se nourriront de ces
volumes substantiels dont plus que jamais les âmes ont besoin pour ne pas se
laisser affadir et énerver. Les hommes avides de curiosités littéraires y
trouveront des plaisirs intellectuels, et un parfum de cette époque qui a été
le berceau des gloires du dix-septième siècle.
Ces volumes formeront un
contraste avec une partie des livres modernes de piété : il circule dans
les écrits de la Mère de Chaugy une puissante sève théologique ; la foi
fut sa vie et la science de la foi était son atmosphère habituelle ; ils
nous transportent dans des régions lumineuses et vivantes.
Les Saintes Écritures nous ont
tracé le portrait de la femme
forte ; vos volumes en offrent un des types les plus accomplis
qui aient paru dans l'histoire de l'Église.
Il appartenait au premier
monastère de la Visitation, à celui qui est si bien nommé la sainte Source,
de verser ses trésors à notre époque desséchée et appauvrie. Vous avez par
là rempli un devoir sacré, rendu gloire à Dieu, honoré l'Église et servi les
âmes.
Recevez, ma très-honorée Mère,
l'assurance de mon respectueux et tendre dévouement en Notre-Seigneur.
† GASPARD,
évêque d'Hébron, Vicaire apostolique de Genève.
LETTRE DES RELIGIEUSE DE LA VISITATION D’ANNECY
VIVE
† JÉSUS
De notre 1er monastère d'Annecy, 16
juillet 1874.
A nos très-honorées et
très-chères Sœurs les Religieuses de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie.
nos très-honorées et très-chères sœurs,
Nous savons combien la mémoire de
notre sainte Fondatrice vous est chère, quel prix votre piété filiale attache à
tout ce qui émane de cette glorieuse Mère. Vous offrir, au moyen de la présente
publication, la vie de cette Sainte incomparable ; vous présenter les
Écrits qu'elle nous a laissés, les Exhortations qu'elle adressait à nos
premières Mères ; vous faire parvenir ses Lettres comme si elles avaient
été destinées à chacune de vous en particulier, c'est donc répondre au désir de
votre cœur, c'est en même temps combler une lacune dans les bibliothèques de
nos monastères.
Il est vrai, les Mémoires sur la
vie de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, ainsi que ses Écrits, ont été
édités plusieurs fois, mais ces éditions nous ont paru si défectueuses que nous
n'avons pas cru devoir nous y tenir. Osons même le dire en toute simplicité,
nous n'avons pas pu voir, sans en être peinées, la facilité avec laquelle on
s'est permis d'ajouter, de retrancher aux textes originaux, de les rajeunir, de
leur enlever leur couleur native. Le respect que nous devons à notre
Bienheureuse Fondatrice, ainsi qu'à toutes les parties de son précieux
héritage, d'une part, et, de l'autre, la sérieuse exactitude qui doit présider
à des publications de ce genre, nous imposaient l'obligation de faire
disparaître de sa Vie et de ses Œuvres ces remaniements qui les
déparent dans les précédentes éditions, de les ramener à leur beauté, à leur
physionomie première. Pour accomplir cette tâche importante, les pièces
authentiques ne [XI] nous manquaient
pas ; outre de nombreux manuscrits qui nous ont été communiqués par nos
monastères, nous avions sous la main les autographes et les copies que nous
conservons précieusement dans nos archives. À l'aide de ces ressources, il nous
a été facile de dégager les textes des éléments étrangers, de les rétablir dans
leur sincérité, de les restituer dans leur intégrité primitive. Et maintenant,
nos très-honorées et très-chères Sœurs, nous sommes heureuses de pouvoir vous
offrir, dans leur pureté, la Vie et les Œuvres de notre grande Sainte. Dans
cette publication vous verrez un monument élevé à sa gloire, monument d'autant
plus digne de cette héroïque Sainte, qu'elle en a fourni et taillé elle-même
toutes les pierres.
Qu'il nous soit permis d'exposer en quelques mots, à Vos Charités, sous
quelle inspiration nous avons commencé et poursuivi notre travail.
Nous avons le bonheur, assurément digne d'envie, de posséder, dans notre
église d'Annecy, le Corps à peu près entier de notre glorieuse Mère. Mais elle
nous a laissé, dans sa Vie et dans ses Écrits, d'autres restes
d'elle-même auxquels notre foi attache la plus haute valeur. En effet, les
nobles pensées, les sentiments sublimes qui animaient sa grande âme, la
générosité qu'elle déployait dans ses moindres actions, les prodiges de vertu
qui éclataient parfois dans sa conduite, tous ces souvenirs revêtent pour nous
le caractère de reliques spirituelles. Ces reliques, d'une nature différente
des autres, il nous est donné à toutes de les posséder en commun, de les
enchâsser dans notre mémoire, de les conserver au sanctuaire de notre cœur.
Le Seigneur qui avait appelé Sainte Jeanne-Françoise de Chantal à
établir, sous la direction de saint François de Sales, l'Ordre de la
Visitation, personnifia dans notre Bienheureuse Mère l'esprit propre à notre
Institut ; il la posa comme le type sur lequel toutes ses filles
spirituelles auraient à se modeler : sublime exemplaire qui nous est
montré sur la montagne de la perfection, resplendissant des vertus
caractéristiques de notre état, couronné de ces fleurs indigènes que nous
devons cultiver dans les jardins de l'Époux. Or, dans la réalité, [XIII] ce
modèle parfait, cette image de notre Mère, où la rencontrer, sinon dans ses
Écrits, qui reflètent sa grande âme ; sinon dans ces Mémoires de la
Mère Françoise-Madeleine de Chaugy, où la vie de la Sainte est reproduite
comme dans un miroir ?
La Vie et les Écrits de notre
sainte Fondatrice seront pour nous des ouvrages classiques de perfection
religieuse ; c'est là que nous trouverons, dans sa puissante énergie,
l'esprit qui doit nous animer ; laque nous pourrons étudier, pour les
faire passer en nous, ces airs de famille, ces traits de race qui doivent nous
distinguer : l'amour des croix, des humiliations, des souffrances, l'union
amoureuse avec Jésus caché, anéanti, crucifié. À lire ces magnifiques Écrits de
notre héroïque Mère, à la contempler sur les sommets qu'elle habite, nous nous
sentirons soulevées de terre, merveilleusement animées à la suivre dans la voie
qu'elle nous a ouverte, à nous élever à la hauteur de notre sublime vocation.
Suivant la comparaison de l'Écriture, sainte Jeanne-Françoise de Chantal sera
pour nous l'aigle qui, par ses cris et la hardiesse de son vol, provoque ses
aiglons à voler, à s'élancer vers le soleil. Par la force de ses paroles et la
vertu de ses exemples, ne semble-t-elle pas nous dire à toutes : Montez
plus haut ! plus haut sur la montagne de la perfection ! plus haut
sur le Calvaire ! Approchez-vous de Jésus ! plus près du Cœur de
Jésus ! plus avant dans le Cœur du très-humble et très-doux Sauveur !
C'est dans ce Cœur tout amour que
nous nous disons, avec le plus humble et cordial respect.
Nos très-honorées et bien-aimées
Sœurs,
Vos
très-humbles et indignes Sœurs
et servantes en Notre-Seigneur,
Les Sœurs de la Visitation Sainte-Marie
d'Annecy.
DIEU SOIT BENI !
PRÉFACE[2]
Les Mémoires de la Mère de Chaugy sur sainte Chantal sont placés
en tête de cette publication, comme le portique naturel du monument qu'élève le
premier monastère de la Visitation d'Annecy à la gloire de son illustre
Fondatrice. Ces Mémoires introduiront le lecteur aux Écrits de celle
dont ils retracent si bien le grand caractère et les héroïques vertus.
Les merveilles opérées par le Seigneur dans sa fidèle Servante devaient
être fidèlement conservées, autant pour l'édification de l'Ordre de la
Visitation que pour celle de l'Église entière. Dieu lui-même sembla tailler la
plume de celle qu'il destinait à réaliser cette œuvre. Il disposa les
événements de telle sorte, qu'à un chef-d'œuvre de sa grâce correspondît un
chef-d'œuvre de biographie religieuse. Sainte Chantal donna la main, sans le
savoir, à ce dessein du ciel, en prenant pour secrétaire celle-là même qui
devait nous transmettre le récit fidèle de sa sainte vie.
La Mère de Chaugy se trouva placée dans des conditions [XVIII] uniques
de caractère et de position pour connaître à fond Sainte Chantal et la faire
revivre dans une biographie. Admirablement douée du côté de l'esprit et du
cœur, elle avait reçu une éducation très-soignée. Sous cette heureuse
influence, se développa bientôt en elle un talent d'écrivain fort remarquable.
L'auteur des Mémoires avait vu le jour en Bourgogne, comme la
Sainte ; issue de parents nobles comme celle-ci, elle appartenait à la
même société, fréquentait le même monde. Bien plus, une alliance entre leurs
deux familles avait établi entre la baronne de Chantal et mademoiselle de
Chaugy les rapports de grand'tante à petite-nièce. Aux liens du sang vinrent
bientôt s'ajouter les nœuds sacrés de la religion ; la sainte tante et sa
petite-nièce vécurent plusieurs années ensemble dans le premier monastère
d'Annecy, soumises à la même règle, suivant les mêmes exercices.
Ce n'est pas tout : la jeune religieuse dut à son jugement, à sa
discrétion, et à sa merveilleuse facilité de rédaction, d'approcher aussi près
que possible de celle dont elle devait écrire la vie. Sainte Chantal, qui
n'avait pas été la dernière à remarquer les aptitudes de sa nièce, voulut en
tirer parti dans l'intérêt de son Ordre ; elle l'attacha donc à sa
personne en qualité de secrétaire. Par le fait même de sa nouvelle charge, la
Sœur Françoise-Madeleine se trouvait admise dans l'intimité de la Sainte ;
en dépit de son humilité, celle-ci était obligée de penser tout haut, d'agir au
grand jour devant son heureuse secrétaire.
De la sorte, la Mère de Chaugy assistait à la vie intérieure aussi bien
qu'à la vie extérieure de cette femme incomparable. L'attention tenue en éveil
par une sainte curiosité, le [XIX] regard
aiguisé par une admiration toujours croissante, ce témoin si perspicace, si
clairvoyant, saisissait tout, comprenait tout avec ce sens religieux, avec
cette exquise sensibilité que développe la vie du cloître.
Pour suppléer à ce qu'elle n'avait pas pu voir par elle-même, la Mère
de Chaugy avait, d'une part, les témoignages des premières Supérieures de
l'Institut, qui avaient été, elles aussi, des témoins attentifs aux moindres
actions de leur sainte Mère ; et, de l'autre, les renseignements que
pouvaient lui fournir les familles Frémyot, de Chantal et de Toulonjon.
Grâce à ces circonstances exceptionnelles, Sœur Françoise-Madeleine
était merveilleusement préparée à rédiger ses Mémoires sur la vie et les
vertus de Sainte Chantal. Le moment vint trop tôt pour elle, et pour ses
Sœurs, de quitter son rôle de secrétaire, pour remplir celui de biographe de la
vénérée Servante de Dieu.
Sainte Chantal venait de mourir, à Moulins, au grand regret des
personnages les plus éminents que possédaient alors la Savoie, la France et
l'Italie.
La Mère de Blonay, supérieure, à cette époque, du premier monastère
d'Annecy, chargea Sœur Françoise-Madeleine d'écrire la vie de la sainte
Fondatrice. La nièce de l'illustre défunte se mit à l'œuvre avec amour ;
elle retraça d'une plume pieuse ce qu'il lui avait été donné de voir et
d'entendre, et aussi tout ce qu'elle avait puisé aux meilleures sources sur la
femme forte, sur la religieuse, modèle incomparable que le ciel venait
d'enlever à la terre.
La Mère de Chaugy rédigea les Mémoires pour ses Sœurs de la
Visitation ; dans sa modestie, elle ne regardait pas [XX] plus loin, elle ne visait nullement à la
grande publicité. Ce trésor littéraire demeura donc, à l'état de manuscrit,
dans le demi-jour des monastères de l'Institut. La nièce de Sainte Chantal
entrait dans sa trente-deuxième année lorsqu'elle commença son œuvre. C'était
en 1642, Louis XIII n'avait plus qu'un an à vivre ; le grand siècle, déjà
à son aurore, allait s'ouvrir avec le règne de Louis XIV. Les Mémoires sur la
vie et les vertus de Sainte Chantal accusent bien cette date ; par leurs
qualités comme par leurs défauts, ils appartiennent à cette heure,
littérairement si intéressante, qui marque la transition entre la première et
la seconde moitié du dix-septième siècle. La langue de l'auteur des Mémoires
n'est pas en retard sur celle de ses contemporains. Il reste encore à ce
langage une légère couche d'archaïsme, une teinte caractéristique qu'il faut
bien se garder d'effacer : nous insistons sur ce point parce que la Mère
de Chaugy peut et doit figurer parmi les meilleurs biographes de son temps.
Comme écrivain, cette fille de saint François de Sales possède les
qualités maîtresses : avec une touche originale, elle a les grâces du
naturel, une noble simplicité, une imagination fertile, un goût exquis. Chez
elle, rien qui sente l'art ou l'effort, tout jaillit de source. Sa plume facile
se hâte, elle se précipite ; dans sa course, elle sème, comme en se
jouant, les mots et les tours heureux, les pensées saillantes, les souriantes
images, et, il faut bien le dire aussi, des incorrections que l'on distingue à
peine, effacées qu'elles sont par les beautés qui les entourent. On sent que,
pressée par le temps et les devoirs multiples de la vie religieuse, elle se
préoccupe assez peu de la forme pour s'attacher [XXI] scrupuleusement à l'exactitude des faits et à la
vérité des peintures. De là une franchise d'allures, une vivacité de style, un
aimable abandon qui charment, entraînent le lecteur, et ne lui permettent même
pas de remarquer les quelques négligences échappées à l'écrivain. La Mère de
Chaugy narre avec intérêt ; elle excelle à choisir et à grouper les faits
saillants, les circonstances qui captivent et édifient. Et cependant, sans
sortir du ton de la narration, elle ne se défend pas d'une chaleur pénétrante,
d'une admiration communicative pour sa Mère glorieuse et bien-aimée.
L'étude et la méditation l'avaient rendue très-familière avec
l'Écriture sainte. Elle s'en était nourrie, pénétrée de telle sorte, que son
style se teignait, à son insu, des couleurs employées parles auteurs sacrés.
Les passages tirés de cette source, les allusions, les applications abondent
sous sa plume, et, cela, avec un admirable à-propos. Souvent, un mot de
l'Écriture, jeté en passant, lui suffit ; quelquefois il lui arrive de
s'arrêter à un texte ou à un fait, de le commenter et de s'y complaire, comme
il sied à une religieuse qui écrit dans une cellule et pour les habitants du
cloître.
La Mère de Chaugy s'est appliquée à mettre en relief les traits caractéristiques
de Sainte Chantal, surtout à dévoiler les splendeurs intimes de sa grande âme,
à les faire rayonner au dehors. Pour atteindre ce but, le talent ne suffisait
pas ; il fallait y ajouter l'élévation, la sûreté, la finesse du coup
d’œil que donne seule une haute vertu. Pour nous révéler la grande Sainte, il
ne fallait rien moins qu'une parfaite religieuse ; l'auteur des Mémoires
était à la hauteur de cette tâche. Fortement trempée dans les eaux de la
grâce, coutumière [XXII] des
plus héroïques sacrifices, elle excellait à discerner les opérations divines,
les mystérieuses transformations par lesquelles l'Esprit-Saint fait passer les
âmes privilégiées. Aussi c'est merveille comme la Mère de Chaugy nous introduit
dans le cœur de Sainte Chantal ; elle nous en montre les ressorts les plus
secrets, les élans les plus sublimes, avec autant de facilité qu'elle déroule
la série de ses actions extérieures. Si le grand mérite d'une biographie
religieuse consiste à nous révéler l'âme d'un Saint, à nous dévoiler ses
sentiments intimes et ses vertus secrètes, pour l'édification de tous, et
spécialement pour l'usage pratique de quiconque aspire à la vie parfaite, les Mémoires
de la Mère de Chaugy peuvent être cités comme un modèle du genre.
La vie de Sainte Chantal a été écrite, d'une manière plus ou moins
développée, par plus de dix auteurs. Ceux qui ont le mieux réussi ont puisé à
larges mains dans les Mémoires de la Mère de Chaugy. Plusieurs, à
commencer par le P. Fichet et Mgr de Maupas, et à continuer par Marsollier et
autres, n'ont pas suffisamment compris la grande âme de Sainte Chantal ;
ils ont altéré la figure de cette vraie imitatrice de saint François de Sales,
et cela, pour n'avoir pas assez consulté son biographe le plus autorisé.
En 1842, M. l'abbé Boulangé publia, pour la première fois, d'après une
copie de l'original, les Mémoires de la Mère de Chaugy. Cette
publication fut parfaitement accueillie, comme le prouvent les éditions qui se
succédèrent assez rapidement. Mais la copie communiquée à M. l'abbé Boulangé
était fautive en quelques endroits, incomplète en d'autres ; de plus, le
texte original y avait été retouché et rajeuni. [XXIII]
L'édition que donne aujourd'hui au public le premier monastère de la
Visitation d'Annecy a été faite sur l'autographe de la Mère de Chaugy,
autographe conservé dans les archives de cette communauté. C'est la première
fois que le texte original des Mémoires sur la vie et les vertus de Sainte
Chantal est reproduit dans son intégrité et toute sa pureté.
Il convenait que la Sainte Source
d'Annecy répandît, dans leur fraîcheur native, ces précieux effluves sur
le jardin de l'Église. Puissent-ils y faire germer et fleurir, avec un éclat
toujours nouveau, les nobles et fortes vertus dont la Mère de Chaugy nous
montre en Sainte Chantal un si parfait modèle !
A. G.
AVANT-PROPOS
des mémoires de la
mère de chaugy.
C'est en la présence de Jésus, Marie et Joseph, de la sainte bonté
desquels j’implore le secours, que je proteste ne vouloir mettre en ces cahiers
que la très-pure vérité, selon que je l'ai apprise tant de la propre bouche de
notre Bienheureuse Mère Jeanne-Françoise de Chantal, que de plusieurs autres
personnes, et notamment de nos premières Mères Marie-Jacqueline Favre,
Jeanne-Charlotte de Bréchard et Péronne-Marie de Châtel, qui me firent faire
des mémoires sur leurs relations, l'année 1636.
C'est de ces mémoires que je vais tirer la plus grande partie de ce que
je dirai, y ajoutant ce que j'ai appris depuis, tant par la toute particulière
fréquentation que j'ai eue de notre Bienheureuse Mère, ayant eu la grâce d'être
sa secrétaire depuis l'an 1632,
que de ce que j'apprends de notre très-honorée Mère Aimée de Blonay, qui est
une des premières filles, et la dernière Mère supérieure de cette Bienheureuse.
Ainsi je commence., ce jour de la sainte Purification
de Notre-Dame, 2 février 1642, dans notre premier
monastère d'Annecy.
dieu soi béni !
PREMIÈRE PARTIE.
SES ANNÉES PASSÉES AU MONDE.
CHAPITRE PREMIER.
de la vertu des aïeux
et du père de notre bienheureuse mère.
Ce n'est pas pour faire parade des choses desquelles le monde fait
gloire, que nous voulons parler de la très-noble et vénérable race de notre
Bienheureuse Mère Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal ; mais c'est qu'il
nous semble raisonnable de chercher, un peu avant, la racine de l'arbre dont
nous avons goûté le doux fruit.
Cette très-heureuse Mère était issue de la noble race des Frémyot, et,
du côté maternel, de l'illustre maison de Berbisey, laquelle, depuis trois
cents ans, est l'honneur de sa province, tenant les premières charges de la
robe et de l'épée, et ayant une alliance quasi-universelle dans toutes les
bonnes maisons du duché. Les ancêtres paternels de cette Bienheureuse Mère [4]
furent des premiers fondateurs de l'auguste parlement de Dijon, ville très-ancienne,
capitale de la Bourgogne, et une des premières illustrée des sacrés rayons de
la foi catholique, par le glorieux saint Bénigne. C'est dans cette belle ville
où les prédécesseurs de notre Bienheureuse Mère ont été bénis de génération en
génération. Mais, pour ne nous engager pas dans un trop long discours, nous ne
ferons que dire un mot de ses aïeul et bisaïeul, qui se nommaient Jean et René
Frémyot, tous deux tenant les premières charges au parlement de Dijon.
Son bisaïeul fut nommé un exemplaire de toute justice et vertu, le père
des pauvres et le refuge des affligés ; il alla jusqu'en la
soixante-treizième année de son âge, et laissa, après une sainte mort, pour
héritier de sa maison et de ses vertus, René Frémyot, aïeul de notre
Bienheureuse. Celui-ci fut comme cet ancien juste, faisant ce qui est agréable
devant le Seigneur, et ne se détournant point de la bonne voie de son père.
L'une des grandes bénédictions que Dieu lui donna fut d'être père de Bénigne et
Claude Frémyot, père et oncle de notre Bienheureuse Mère. Ce sage politique mit
son principal soin à la bonne et dévote éducation de ses dignes enfants, et,
comme de son temps, Calvin et Luther, ainsi que de funestes lamies, tâchaient
de faire sucer aux Français le lait empesté de leur pernicieuse doctrine, ce
bon père de famille, sans y jamais manquer, tous les jours deux fois, le matin
et le soir, faisait un petit discours à ses enfants et domestiques, pour leur
servir d'antidote et de préservatif contre le venin des erreurs qui faisait
mourir spirituellement tant d'âmes. Non content de cela, il allait par les
compagnies et faisait des assemblées de ses amis pour parler avec un zèle et
une ferveur admirables de la vérité que l'Église romaine enseigne, et Dieu lui
fit la grâce d'empêcher plusieurs de tomber au précipice de l'hérésie.
Ce fidèle enfant de la sainte Église vécut saintement et vigoureusement
jusqu'en l'âge d'environ septante-cinq ou six ans. [5] Il eut révélation du
jour et de l'heure de son décès. La veille d'icelui il alla dire adieu à ses
amis et parents, leur disant, avec une sainte simplicité, qu'il était sur son
départ pour aller au voyage éternel. Ce même jour, il arriva une chose
véritablement merveilleuse : c'est que ce bon vieillard, voulant monter
sur sa petite mule pour aller prendre congé de ses amis, il ne le pouvait à
cause de sa débilité. Cette bête, comme si elle eût connu la nécessité de son
maître, étend ses quatre jambes, s'abaisse jusque quasi à loucher la terre avec
son ventre, et demeure dans cette posture jusqu'à ce que ce bon vieillard fut
bien agencé sur sa selle, que tout doucement elle se releva tirant ses pieds
l'un après l'autre, et au retour de ce petit voyage, elle se mit en la même
posture pour laisser descendre commodément son bon maître. Ce qui fut remarqué
de tous les assistants comme une merveille, et comme une petite récompense que
Dieu donnait au bon vieillard de sa parfaite soumission à l'Église
romaine ; car les créatures irraisonnables, dit un saint, se rendent
soumises à l'homme à mesure que l'homme raisonnable se rend soumis à Dieu.
Notre pieux et vénérable vieillard étant de retour de faire ses adieux,
se mit au lit et mit ordre que, le lendemain, il y eût un ecclésiastique prêt
pour dire messe en une petite chapelle de laquelle il la pouvait ouïr de son
lit, et dit ouvertement qu'avant que le Prêtre eût pris la dernière ablution,
sa vie devait finir. Il passa la nuit très-dévotement, quoique avec
douleur ; et le matin venu, se confessa derechef, communia, reçut
l'extrême-onction, pria que l'on lui dît sa messe, ajoutant ces belles
paroles : « D'autant, dit-il, qu'avant que la dernière ablution soit
prise je dois aller boire le nectar éternel au royaume de mon Dieu. » Il
ouït cette messe avec une admirable dévotion, et, à même temps que le prêtre
élevait le calice, ce saint vieillard, avec une grande ardeur de dévotion et un
visage angélique, éleva ses yeux vers les montagnes [6] éternelles, disant, en
latin, ce verset de David : Quando consolaberis me ? « O
Dieu ! quand me consolerez-vous ? » À même temps., il expira
devant toute l'assistance, laquelle n'eût pu se consoler en la perte d'un si
digne homme, qu'en le voyant revivre en la personne de ses dignes enfants, et
notamment en celle de Bénigne Frémyot, père de notre Bienheureuse Mère, lequel
augmenta infiniment la gloire de son illustre maison. L'on vit en lui, dès ses
jeunes ans, les fruits des saintes semences que son bon père avait jetées en
son âme.
Nous n'en dirons ici que ce seul trait : Il était jeune écolier à
Bourges, lorsque les Calvinistes prêchaient avec une fureur d'enfer leurs
mensonges. Ce jeune homme ne voulait point aller à ce prêche ; mais enfin,
une fois, contraint par l'importunité de ses compagnons, il y entra, et au
sortir d'icelui, il dit à ceux qui l'avaient mené là : « Nous sommes
venus entendre un discours de médisance, et non pas une prédication. Sachez que
l'Esprit de Dieu n'est point en cet homme ; au lieu d'enseigner à observer
la loi de Dieu, il déclame contre la Mère Église. Jamais il n'empoisonnera mon
cœur ni mes oreilles. » En effet, quelque instance que l'on lui fît par
après, l'on n'eut jamais le crédit de lui faire entendre un discours
d'hérétique, et il empêchait ses compagnons d'y aller, leur disant qu'aller au
prêche, c'était courir à l'école d'enfer, et que Lucifer en était précepteur.[3] Il s'en retourna à Dijon, et, après avoir
fini ses études, fut reçu avocat général, charge qu'il exerça si judicieusement
et avec tant de bonheur, que l'on a remarqué qu'il n'a jamais pris conclusion
que ses juges n'aient suivie ; et son mérite le fit parvenir à l'honorable
charge de second président en ce parlement très-auguste de Dijon.
CHAPITRE II.
de la naissance de
notre bienheureuse mère, et de la fidélité du président frémyot, son père, à
l'église et au roi.
Étant lié au monde par les liens de si honorables charges, il s'y lia
encore par celui du saint mariage avec mademoiselle Marguerite de Berbisey,[4] digne compagne de sa vertu. Dieu les bénit
de trois enfants, à savoir : Marguerite, depuis baronne des Francs,
laquelle donna au monde deux très-généreux seigneurs, qui ont consumé leur vie
au service du Roi, et Monseigneur de Châlons, qui vit encore aujourd'hui en
réputation d'un bon et très-vertueux prélat ; la seconde fut
Jeanne-Françoise Frémyot, depuis baronne de Chantal, et notre bienheureuse
Fondatrice ; le dernier fut André Frémyot, archevêque de Bourges, et
patriarche d'Aquitaine. Quant à notre Bienheureuse Mère, saint Jean l'Aumônier,
encore plus charitable au Ciel qu'il n'était sur la terre, voyant que le monde
avait besoin d'une femme forte, obtint de Dieu de faire cette charité à la
terre, et que notre Bienheureuse Mère naquit le jour que l'Église fait la fête
de ce grand aumônier, le 23 janvier. Ce fut dans la ville de Dijon, entre les
sept et huit heures du matin, un mardi, l’an 1572, que cette Bienheureuse vint
au monde, pour en être un ornement glorieux. Grégoire XIII, Boulonnais, tenait
[8] alors le Saint-Siège apostolique, et la couronne de France était portée par
Charles (IX) Maximilien. Notre chère petite fut soudain régénérée par les eaux
sacrées du baptême, et nommée Jeanne, et à la confirmation, Françoise. Elle
n'avait que dix-huit mois quand Dieu la rendit orpheline de mère ; la
sienne mourant en couche, après avoir mis au monde Mgr André Frémyot, archevêque
de Bourges. La petite orpheline ne laissa pas d'être élevée avec un très-grand
soin et non guère moins que si elle eût été au sein de sa défunte mère. Dès son
jeune âge, l'on remarqua en elle des indices particuliers de la grâce divine,
et entre autres une modestie fort majestueuse et une aversion si incomparable
aux hérétiques, que si quelqu'un d'eux la voulait toucher ou porter entre ses
bras, elle ne cessait de crier qu'il ne l'eût posée. Elle apprenait avec une
grande souplesse et vivacité d'esprit tout ce qu'on lui enseignait, et on
l'instruisait de tout ce qui est convenable à une demoiselle de sa condition et
de son bon esprit : à lire, écrire, danser, sonner des instruments,
chanter en musique, faire des ouvrages, etc. Et tandis qu'elle passera ses
premières années d'adolescence dans ces exercices, arrêtons-nous à considérer
les généreuses actions èsquelles M. le président Frémyot, son père, s'occupera.
À peine Charles IX avait atteint le vingt-cinquième de son âge, que la mort,
avec sa faux hardie qui ne respecte personne, lui abattit le sceptre de la main
et la couronne de la tête ; et, par la révolution des années, Henri III
fut sacré Roi de France, lequel, dans quelque temps vit son royaume presque
tout révolté contre lui, par les menées de quelques princes et principaux
seigneurs de sa Cour, qui voulaient s'emparer de sa couronne, et lui donner
pour palais un cloître et pour collier un froc de moine. La Bourgogne, entre
toutes les provinces de la monarchie, fut la plus contraire au Roi, à cause de
son gouverneur qui était propre frère de celui qui prétendait à la couronne.
Sous ce mauvais chef, la ville de Dijon, comme autrefois celle [9] de Jérusalem
sous Hérode, fut troublée et quasi renversée par le vent de cette tempête. Le
gouverneur, qui avait tiré à sa cordelle la plupart des officiers du parlement,
n'oublia rien pour attirer à son parti le président Frémyot, mais ce fut en
vain ; au contraire, voyant qu'il ne pouvait faire mieux, celui-ci gagna
une douzaine, tant des conseillers, avocats et greffiers du parlement, et
abandonnant son bien, sa maison et ses propres enfants, les mena et maintint à
Flavigny et à Semur, « afin, dit-il, qu'il y ait un lieu en cette province
de Bourgogne qui fasse justice sous l'obéissance de son Roi. » Non content
de cela, il gagna encore la noblesse des environs, et, à ses propres dépens,
leva des gens de guerre pour maintenir la campagne dans le parti du Roi. Ce
qu'il ne fit pas seulement pour quelques mois, mais pour quelques années que
ces guerres civiles durèrent, ne se souciant point de s'appauvrir, inculquant à
ceux qui s'étaient rangés à lui, que la grande richesse d'un politique et d'un
homme d'épée est la gloire de s'appauvrir pour garder fidélité, et servir sa
patrie et son Prince légitime. Durant le temps de ces ligues, notre fidèle
président eut de grandes attaques ; la principale desquelles fut que l'on
fit prisonnier son fils unique, et l'on lui écrivit audacieusement que, s'il ne
se rangeait du parti révolté, on lui enverrait pour payement de ses peines la
tête de son fils. Ce grand courage, sans s'étonner en façon quelconque, fit
réponse qu'il s'estimerait heureux d'immoler à Dieu un si cher fils pour une si
bonne cause ; qu'il valait mieux que le fils mourût innocent, que le père
se rendît coupable par une perfidie, péchant contre Dieu et contre son Roi. Ses
ennemis, voyant cela, aimèrent mieux engraisser leurs mains de pistoles, que de
les souiller du sang innocent de ce jeune seigneur, lequel son bon père racheta
par une très-grosse rançon.
Parmi tous ces troubles, le Roi Henri III fut tué, ce qui fit faire des
feux de joie dans le cœur de ses ennemis ; mais celui [10] du fidèle
président fut atteint d'une si vive douleur, qu'en une nuit il devint tout
blanc du côté sur lequel il était couché. Toutefois, sans se laisser emporter
aux troubles et inquiétudes coutumières à ceux qui n'ont pas leur volonté
ajustée à celle de Dieu, d'un esprit tranquille quoique affligé, il fit
incontinent des dépêches à toute la noblesse des environs, fit dresser de nouvelles
troupes pour garder ces deux petites places de Flavigny et de Semur, afin que
dès que Henri IV, auquel la couronne tombait légitimement, aurait embrassé la
pureté de la foi orthodoxe et serait sacré Roi, il trouvât en ce petit coin de
la Bourgogne une troupe fidèle. Après le sacre de ce grand Roi, et que les
troubles furent pacifiés, le président Frémyot revint victorieux dans Dijon,
sans se soucier ni se plaindre des pertes et des dégâts que l'on avait faits à
ses biens et à sa maison. Il ne pensait qu'à faire du bien à la république par
le rétablissement du bon ordre.
Peu de temps après, le Roi Henri IV alla à Dijon faire la visite de ses
États, et départit ses caresses royales avec profusion au fidèle président
Frémyot, confirma et donna autorité à tout ce qui s'était fait en son petit
parlement de Flavigny et Semur, et en même temps déclara nul, invalide et sans
effet tout ce qui s'était passé en son absence au parlement de Dijon, et
dit : « Monsieur Frémyot, vous avez si heureusement été le premier
président à Flavigny, que je désire que vous soyez ici le premier. » Ce
bon président lui répondit : « Sire, à Dieu ne plaise que je m'ingère
jamais à la place d'un homme vivant ; M. le premier président est bon
catholique, il servira bien Votre Majesté. » Le Roi admira cette grande
vertu, et ordonna pourtant que les postes vinssent descendre chez M. Frémyot,
et que toutes les dépêches royales lui fussent remises. Il usa si modestement
de cette faveur, que jamais il n'ouvrit les paquets sans le premier président,
auquel il les portait dès qu'il les avait reçus. Le Roi ne borna pas à cela ses
faveurs, car sachant que[11] ce bon président avait dessein, après avoir fait
tant de généreuses actions pour son Prince terrestre, de se dédier uniquement,
le reste de ses jours, au service du Prince du ciel, en l'état ecclésiastique,
Sa Majesté lui donna l'archevêché de Bourges, la grande abbaye de Saint-Etienne
de Dijon, et des provisions pour le prieuré de Nantua.
Il arriva une chose qui fit plus admirer la vertu de M. Frémyot que
tout ce que nous avons dit. Un certain du parlement avait été son principal
persécuteur durant la Ligue, (même ce fut lui qui fit mettre son fils à
rançon) ; icelui fut accusé vers le Roi de quantité de perfidies. Le Roi
dit soudain qu'il lui fallait faire trancher la tête ; et appelant M. le
président Frémyot, qui était en une autre chambre, lui en demanda son
avis ; ce fut avec étonnement de toute la compagnie de voir que ce bon
président se rendit l'avocat de son ennemi, et demanda sa grâce au Roi avec
tant de solides raisons et de zèle, que ce grand Roi, qui savait ce que
l'accusé avait fait contre M. Frémyot, plia les épaules et dit :
« Président, je vois bien qu'il faut que ma clémence se joigne à votre
douceur ; vous voulez la vie de votre ennemi, je vous la donne. »
Il arriva encore une chose fort agréable, c'est que le Roi se récréant
une fois avec plusieurs seigneurs, et parlant des affaires passées, le
président Frémyot lui dit : « Sire, je vous confesse que si Votre
Majesté n'eût crié de bon cœur : Vive l'Église romaine ! je
n'aurais jamais crié : Vive le Roi Henri IV ! » Ce grand
monarque aima si fort cette chrétienne franchise, qu'il s'en prit à rire de bon
cœur, et dit à un maréchal de France, son favori : « Si vous voulez
faire quelques fourbes, cherchez pour vous aider quelque autre que notre
président Frémyot. » Sa Majesté lui présenta de grandes charges à Paris,
mais il était si affectionné au bien de sa patrie, qu'il ne voulut pas quitter
le parlement de Dijon. Or, il ne se put pas faire prêtre, d'autant qu'il avait
eu deux femmes, et la dernière était veuve quand il [12] l'épousa ; et ne
voulant pas garder les biens de l'Église, il remit tous ses bénéfices à son
fils, lequel Dieu appela à l'état ecclésiastique ; et le bon président
demeura exerçant sa charge avec toute justice et sincérité de conscience.
CHAPITRE III.
comme elle se
comporta en son état de fille, et son mariage avec le baron de chantal.
Durant tous ces troubles, notre Bienheureuse Mère avait beaucoup crû en
toutes façons, et bien que M. le président son père souhaitât fort de la garder
auprès de soi, il s'en dépouilla néanmoins pour le contentement de sa fille
aînée, Marguerite Frémyot, qu'il avait mariée à M. de Neufchèze, baron des
Francs, laquelle désira passionnément de la mener en Poitou avec elle, et Dieu
le permit pour faire voir la force et la vertu de cette jeune demoiselle ;
car ce fut ici où son innocence fut puissamment attaquée, et où sa vertu eût
fait naufrage, si ce bon Dieu, qui se l'était choisie, ne l'eût assistée d'une
grâce toute particulière. Elle trouva une vieille demoiselle qui servait chez
le baron des Francs, laquelle n'oublia rien pour flétrir par ses artifices
cette belle fleur croissante. Elle lui voulait apprendre des fards et des choses
encore bien plus pernicieuses ; car on la soupçonnait d'user
d'enchantement, et l'on a eu de grands indices de le croire. Comme elle vit que
cette jeune demoiselle ne voulait point adhérer aux choses qu'elle lui
proposait, et que d'ailleurs elle connaissait en elle un courage fort haut et
généreux, elle dressa sa batterie d'un autre côté, et lui promit, si elle la
voulait croire, qu'elle viendrait à bout de lui faire épouser un très-grand
seigneur et des premiers du Poitou.
Ce fut ici véritablement que notre Bienheureuse eut un [14] besoin
particulier de la grâce céleste. Elle avait souvent recours à la très-sainte
Vierge, qu'elle avait prise pour sa Mère dès son enfance, et elle a cru toute
sa vie que c'était par l'aide de cette divine Mère des orphelins qu'elle avait
échappé des filets de cette mauvaise créature, laquelle elle avait en
très-grande aversion ; aussi fit-elle tout son possible pour faire que
Madame la baronne des Francs, sa sœur, la congédiât ; mais elle avait plus
d'artifices pour se maintenir là dedans, que la jeune fille de force pour l'en
faire sortir, quoiqu'à la fin l'on se repentît de ne pas l'avoir crue. Cette
créature fit une fin très-malheureuse, après avoir mené une vie artificieuse et
méchante et grandement nuisible à plusieurs filles qui, n'ayant pas été si
sages que notre Bienheureuse, se laissèrent enchanter par cette mauvaise
sirène.
II lui arriva une autre chose chez Monsieur son beau-frère, crû elle
fit paraître son grand amour à l'Église. Ce fut la recherche importune d'un jeune
seigneur huguenot, lequel était ami juré du baron des Francs, et croyait par sa
faveur épouser cette aimable fille ; et comme il la voyait fort pieuse et
zélée pour la foi, il feignit d'être catholique pour venir à bout de son
dessein. Mais la sacrée Vierge n'abandonna pas sa chère fille, et lui obtint de
Dieu une telle lumière, qu'il lui semblait lire au cœur de ce jeune
gentilhomme, qu'il n'avait pas la vraie foi romaine ; et, quoiqu'il fût
bien fait en toutes les grâces et perfections extérieures qui rendent un homme
de condition accompli, elle ne put jamais avoir que de l'aversion à sa
recherche, aversion causée par la vue que Dieu lui donnait, que le cœur de ce
poursuivant était dans l'erreur. Cette même aversion s'augmentait toujours,
voyant par le Poitou tant de monastères, d'églises et de chapelles ruinées,
profanées et brûlées par les huguenots. Cette Bienheureuse nous a dit souvent,
avec une grande simplicité, « qu'elle avait un tel regret de voir ces
églises en ce piteux état, qu'elle ne pouvait s'empêcher de [15] pleurer en les
voyant, et que parfois elle n'osait ôter son masque, parce que l'on connaissait
qu'elle avait pleuré ; et l'on faisait des enquêtes, quel mécontentement
elle pouvait avoir chez Monsieur son beau-frère », auquel elle n'en donna
jamais autre que le refus absolu d'épouser ce jeune seigneur, disant ingénument
à M. des Francs, « qu'elle élirait plutôt une prison perpétuelle que le
logis d'un huguenot pour son séjour, et plutôt mille morts l'une après l'autre,
que de se voir liée par le mariage à un ennemi de l'Église. » Fermeté qui
la faisait beaucoup souffrir ; mais elle le faisait toujours avec beaucoup
de sagesse et de retenue. Enfin, ce jeune seigneur n'ayant plus d'espérance de
pouvoir ébranler la constance de cette aimable fille, leva le masque de son
hypocrisie, et déclara ouvertement qu'il était hérétique et des plus obstinés.
Il tardait à notre Bienheureuse Mère de retourner à Dijon, à cause des
importunités et recherches que l'on faisait d'elle, qui étaient agréées de
Monsieur le baron, son beau-frère, et qu'elle voyait bien ne devoir pas l'être
de Monsieur le président son père, lequel, par une heureuse rencontre, la fit
revenir chez lui lorsqu'elle s'y attendait le moins. Elles se séparèrent,
madame la baronne des Francs et elle, avec de grands ressentiments, ayant vécu
ensemble dans une si grande union et bonne intelligence, qu'elles n'avaient
jamais eu une parole de travers ni de conteste ; aussi, notre Bienheureuse
Mère la regardant comme sa sœur aînée, lui obéissait ainsi qu'elle eût fait à
sa propre mère. Étant de retour à Dijon, dans toutes les honnêtes libertés et
divertissements permis aux demoiselles de sa condition, elle fut beaucoup
recherchée en mariage, et se comporta avec tant de sagesse et de modestie envers
ses poursuivants, qu'elle parut sans volonté que celle de Monsieur son père,
dans l'esprit duquel le baron de Chantal s'était insinué, et avait gagné sa
bienveillance et son estime, du temps [16] de la Ligue, par son extraordinaire
vaillance et fidélité au Roi.[5]
Ce fut à ce brave seigneur que notre Bienheureuse Mère fut donnée en
mariage, étant âgée d'environ vingt ans, et le baron de Chantal de vingt-sept à
vingt-huit, et ce fut l'un des plus accomplis mariages qui aient été vus, l'un
et l'autre partis étant parfaitement doués de corps et d'esprit, des plus
aimables qualités, recommandable en la noblesse.[6] Quant à notre Bienheureuse Mère, elle était
de riche taille, d'un port généreux et majestueux, sa face ornée de grâces, et
d'une beauté naturelle fort attrayante, sans artifice et sans mollesse ;
son humeur vive et gaie, son esprit clair, prompt et net, son jugement
solide ; il n'y avait rien en elle de changeant ni de léger. Bref, elle
était telle qu'on la surnomma la dame parfaite ; et ce fut avec regret
universel qu'on la vit sortir de Dijon pour aller demeurer à Bourbilly,[7] qui est le château où résidait d'ordinaire
le baron de Chantal.
CHAPITRE IV.
de sa demeure à la
campagne, ou elle prend le soin de son ménage.
Après toutes les bienvenues et réjouissances, le baron de Chantal, qui
avait donné son cœur à sa chère épouse, voulut aussi lui donner tout le soin de
sa maison, où il n'y avait pas peu de besogne. Elle y eut une extrême
répugnance, car elle n'avait jamais su ce que c'était que soucis, sinon par
ouï-dire ; et il lui fâchait extrêmement de sacrifier sa liberté innocente
aux tracas embarrassants du soin d'un ménage. Le baron de Chantal, qui avait
l'esprit fort sage, lui dit un jour fort sérieusement, « qu'il fallait
qu'elle se résolût à porter ce fardeau, que la femme sage édifie sa maison, et
que celles qui méprisent ce soin détruisent les plus riches. » Pour
l'engager à se résoudre au soin de la maison, il lui donna l'exemple de feu la
baronne de Chantal, sa mère, femme d'incomparable vertu [18] et constance, et
ce serait faire tort à la générosité de ses actions de les laisser ensevelies
avec elle. C'était une demoiselle de très-bon lieu, qui avait été élevée à la
suite d'une des premières princesses de France, et, par conséquent, dans des exercices
bien éloignés des soins domestiques ; néanmoins, quand elle eut épousé M.
de Chantal, père du mari de notre Bienheureuse, voyant qu'elle entrait dans une
maison fort embrouillée d'affaires, elle en prit le soin avec tant de
vigilance, que dans peu de temps elle y mit un bon ordre. Cette dame était un
modèle de vertu qui n'avait retenu de la cour que l'honneur et la civilité.
Dieu la voulant rendre un exemplaire de patience, permit qu'il lui vînt un
cancer au sein, mais si malin qu'il lui mangea toute la poitrine, et même
descendit le bras jusqu'au défaut des côtes. Le respect qu'elle portait à son
mari fit que jamais elle ne dit mot de son mal, et trouva invention, sous
prétexte de quelque mal d'estomac, de porter toujours la nuit des brassières bien
jointes et lassées devant. Tous les matins, sa demoiselle lui donnait de petits
linges blancs, sans qu'elle retirât jamais les sales, car cette vertueuse dame
passait seule en son cabinet, et se pansait elle-même, mettant d'ordinaire de
petites tranches de viande fraîche sur son cancer, afin que ce mal impiteux
dévorât cette chair étrangère au lieu de la sienne ; ainsi elle entretint
son mal plusieurs années avec tant de soumission à la volonté de Dieu, de
courage et d'adresse, que créature du monde ne s'en aperçut. Il est vrai que
souvent l'on connaissait qu'elle avait pleuré, sans que l'on en sût la
cause ; ce qui fit un jour hasarder le baron de Chantal, son fils, de lui
dire : « Madame, jusqu'à quand serai-je si malheureux que de vous
voir affligée sans savoir le sujet de vos douleurs ? » Elle lui
répondit : « Ha ! mon fils, que voulez-vous que je vous
dise ? je suis une charogne vivante, mais Dieu le veut. » Jamais
depuis il n'osa l'interroger du sujet de sa tristesse.
Or, enfin voyant que ce mal dévorait jusqu'aux flancs, un jour [19] que
M. de Chantal, son mari, était parti pour aller en voyage, elle fit venir les
médecins et chirurgiens, et leur découvrit le mal qu'elle ne pouvait plus
celer, les priant que, s'ils y pouvaient apporter du remède, ils expédiassent.
Ils furent émerveillés de la patience de cette dame, quand ils virent cet
effroyable mal, la cure duquel ils ne voulurent point entreprendre sans le
consentement de M. de Chantal, lequel on envoya quérir. Quand il fut arrivé,
jamais homme ne fut plus étonné ni femme plus assurée : « Monsieur,
lui dit-elle, je vous demande pardon de vous avoir celé mon mal ; j'ai cru
jusqu'ici bien faire, pratiquant la patience chrétienne, souffrant entre Dieu
et moi ; mais j'ai eu crainte enfin d'être homicide de moi-même si je n'y
faisais apporter quelque remède. » M. de Chantal, blâmant avec larmes son
silence, la voulait mener à Paris pour la mettre entre les mains des médecins
du Roi. « Non, Monsieur, dit-elle, il faut seulement que vous permettiez
aux médecins d'ici qu'ils fassent ce qu'ils pourront ; après,
Notre-Seigneur fera ce qu'il voudra. »
On la voulait lier en son lit pour lui appliquer le feu et le
fer ; mais elle ne voulut point, disant que « la raison et la crainte
de Dieu sont les plus fortes ligatures qu'une femme chrétienne puisse
avoir ; que l’on ne craignît rien, qu'elle était tout accoutumée à la
souffrance par le regard du crucifix. » Le chirurgien commença donc
à faire son office, coupa toute la chair corrompue et gâtée, allant jusqu'à la
chair vive ; puis on appliqua le feu partout. Tandis qu'on faisait celle
douloureuse opération, cette généreuse dame, tenant ses yeux au ciel, ne se
recula jamais, ni ne dit un seul mot qui témoignât qu'elle ressentît ces
cuisantes douleurs. Après cette cure, la chair revint, et elle crut d'être
entièrement guérie. Mais, comme les chirurgiens avaient laissé du cancer aussi
gros qu'une demi-noisette au bout d'une côte qu'ils n'avaient osé couper,
crainte d'offenser les parties intérieures ; quand tout le reste du mal
[20] fut guéri, ce bout de côte commença à pulluler, et, en un an, emmena cette
dévote dame en l'autre vie, plusieurs années avant que son cher fils fût marié.
Notre Bienheureuse fut si touchée du récit de la vertu de cette belle-mère,
que, dans le regret de n'avoir pas joui de sa conduite et de sa douce présence,
elle se résolut, dès ce jour-là même, de se rendre son imitatrice, et, sans
plus disputer, se chargea des affaires et des soins de la maison.
CHAPITRE V.
comme elle se
comportait en son ménage, et le bon ordre qu'elle mit en sa maison.
Elle ceignit ses reins de force et fortifia son bras pour entreprendre
la charge de cette maison, où, comme dans un ménage de garçon, elle trouva
toutes choses fort mal réglées ; car il est à noter que M. de Chantal, le
père, faisait ménage à part, à Montelon, et son fils à Bourbilly, et brûlait
ainsi la chandelle par les deux bouts. Cette femme diligente fut une couronne à
son mari, le cœur duquel se fiant en elle, elle entreprit avec joie et
générosité de régler sa maison.
La première chose qu'elle ordonna, fut que la messe de fondation qui
est en la chapelle du château, et laquelle par négligence ne se disait presque
plus, se dirait tous les jours. Après, elle mit ordre à l'ordinaire et aux
gages des serviteurs et servantes, le tout avec un esprit si raisonnable que
chacun était content. Elle ordonna que tous les grangers, sujets, receveurs et
autres, avec lesquels on aurait à traiter, s'adresseraient immédiatement à elle
pour toutes les affaires.[8]
Si elle régla sa famille, ainsi fit-elle de sa personne ; car se
voyant aux champs, et dans une maison de grandes affaires et dépens, elle ne
voulut pas, comme les dames mondaines, chercher nouvelle parade d'or et de
soie, ains comme la femme [22] forte, elle se contenta du lin et de la laine,
ne faisant plus faire d'habits de soie ; les fêtes, quand il fallait
paraître, elle se servait des siens de fille et de ceux de ses noces. Hors de
là, elle ne portait que du camelot et de l'étamine, et cela avec tant de propreté,
de grâce et de bienséance, qu'elle paraissait cent fois plus que plusieurs
autres qui ruinent leurs maisons pour porter des affiquets ; aussi
n'avait-elle point de nécessité de mendier son lustre des curiosités du
vêtement. Dès le jour qu'elle prit le soin de sa maison, elle s'accoutuma à se
lever de grand matin, et avait déjà mis ordre au ménage, et envoyé ses gens au
labeur, quand son mari se levait. Tous les jours, elle et la plupart de ceux de
sa famille entendaient messe en la chapelle du château ; mais les fêtes et
dimanches, à cause de l'édification du voisinage, elle allait à la paroisse,
bien qu'elle fût éloignée de demi-lieue. Quelquefois son mari la voulait
retenir, lui disant « qu'elle satisfaisait aussi bien au commandement de l'Église,
oyant messe en sa chapelle, que d'aller si loin » ; mais elle lui
répliquait « que la noblesse doit donner exemple aux paysans, de
fréquenter les églises et assister au divin service, outre qu'elle disait avoir
une particulière satisfaction d'adorer Dieu avec tout le peuple. » Ainsi
non-seulement elle ne se laissait pas divertir, mais elle engageait
insensiblement et M. de Chantal et les compagnies qui étaient d'ordinaire chez
elle, d'aller à la paroisse. Quand M. de Chantal voulait aller à la chasse de
grand matin l'été, les jours de fête, elle avait une vigilance non pareille de
lui faire ouïr messe avant de partir, et de même à tous ceux de sa suite, ayant
toujours été singulière en cette inclination de veiller que personne, tant qui
se pouvait, ne perdît la sainte messe, non pas même les jours d'œuvre. A partir
de là, elle ne paraissait pas des plus dévotes, et nous a quelquefois dit en se
plaignant de son indévotion, qu'elle ne pensait qu'à observer les Commandements
de Dieu et de l'Église, à contenter son mari, et aux affaires de sa maison. Sa
lecture ordinaire [23] était la Vie des Saints, quelquefois et
d'ordinaire les Annales de France, ou quelque autre histoire moralement
bonne ; car, quant aux mauvais livres, elles ne les a jamais lus, ni voulu
souffrir dans sa maison, en ayant brûlé plusieurs qu'elle y trouva.
L'œuvre de piété où elle parut la plus attentive durant le temps de son
mariage, fut la miséricorde envers les pauvres ; et a dit en confiance,
« qu'elle demandait d'ordinaire ses nécessités avec plus de liberté à
Notre-Seigneur, quand, pour l'amour de lui, elle avait donné l'aumône à un
pauvre. » L'année de la grande famine, sa charité éclata tout à fait,
donnant tous les jours une aumône générale de potage et de pain à tous ceux qui
se présentaient, qui étaient en très-grand nombre ; les pauvres venant de
six et sept lieues à la ronde chercher leur pain quotidien vers cette soigneuse
ménagère, qui voulait faire tous les jours cette distribution elle-même. Et
afin que cela se fit avec plus d'ordre, elle ordonna que dans sa basse-cour
l'on fit une seconde porte, faisant entrer les pauvres par l'une et sortir par
l'autre, quand ils avaient reçu l'aumône. Quelques-uns, après avoir pris leur
prébende et après être sortis, faisaient promptement le tour du château, et
retournaient à la porte de l'entrée, prenant par ce moyen jusqu'à deux et trois
fois l'aumône, consécutivement ; leur bienfaitrice connaissait fort
clairement cette tromperie, mais elle n'avait jamais le courage de leur en
faire confusion ni de les éconduire, et disait par après qu'elle pensait en
elle-même : « Mon Dieu, à tout moment je mendie à la porte de votre
miséricorde ; voudrais-je bien à la seconde ou troisième fois être
rechassée ! Mille et mille fois vous souffrez bénignement mon importunité ;
n'endurerais-je pas celle de votre créature ? » Elle prenait
elle-même les écuelles des pauvres, et les remplissait de potage, leur donnant
à même temps le pain qui était coupé dans des corbeilles, à l'avantage. Outre
cette charité commune et publique, elle pourvut à la nécessité de plusieurs
familles honorables qui avaient honte d'aller aux [24] portes, leur envoyant
tous les jours en secret un pain entier d'une certaine grosseur, ou un
demi-pain, selon le nombre de ceux qui étaient là dedans.
Quand cette pieuse nourrice des pauvres eut longuement froissé son pain
aux faméliques, et donné nourriture aux petits, d'autant qu'elle n'avait que la
provision ordinaire de blé, elle voulut visiter ses greniers, pour voir si elle
pourrait continuer sa charité (car l'on faisait quatre fois la semaine au four
pour les pauvres). Elle trouva qu'il ne restait plus qu'un seul tonneau de
farine de froment et fort peu de seigle, qui est très-bon en l'Auxois. Elle ne
s'étonna point, mais fut inspirée de se confier en Dieu, lequel pourvut à son
besoin, et la farine de froment et le peu de seigle furent multipliés six mois,
durant que la famine continua, et que l'on persévéra à faire l'aumône. Et quand
Dieu eut ramené le bon temps, les domestiques allaient voir, par merveille, ce
petit monceau de blé auquel il ne semblait pas qu'on eût touché depuis la
visite que leur bonne maîtresse en avait faite. Nous l'avons ouï raconter,
comme un vrai miracle, à quelques-uns d'entre eux ; et ayant conjuré notre
Bienheureuse Mère de nous dire comme cela s'était passé, elle nous le raconta
tout comme nous le venons de déduire, ajoutant par son humilité qu'elle avait
toujours attribué cette grâce à la grande vertu et dévotion d'une sienne
servante, nommée dame Jeanne, aux prières de laquelle elle se confiait
grandement[9]... [25]
Elle était sévère à bannir le vice de sa maison, mais extrêmement
bénigne pour ceux desquels les fautes n'étaient pas malicieuses, et avait des
adresses toutes particulières pour adoucir l'esprit de son mari, quand elle
voyait qu'il se fâchait contre quelqu'un, ou voulait faire quelque châtiment
par promptitude, ce qui faisait que M. de Chantal lui disait souvent :
« Si je suis trop prompt, vous êtes trop charitable. » Quelquefois il
faisait mettre des paysans dans la prison du château, qui était malsaine, à
cause de son humidité ; quand c'était pour des sujets qu'elle jugeait trop
minces, après que tous ceux du logis étaient retirés, elle faisait sortir le
prisonnier et coucher dans un lit, et le lendemain, de grand matin, pour ne pas
déplaire à son mari, elle remettait le prisonnier dans la prison, et en allant
donner le bonjour à M. de Chantal, elle lui demandait si amiablement congé
d'ouvrir à ces pauvres gens, et les mettre en liberté, que quasi toujours elle
l'obtenait.
C'est une grande marque de sa prudence et douce conduite, qu'en huit
ans qu'elle a demeuré mariée, et neuf ans au monde après son veuvage, elle n'a
presque point changé de serviteurs ni de servantes, excepté deux qu'elle
congédia pour ne les pouvoir faire amender de quelques vices auxquels ils
étaient adonnés. Elle n'était point crieuse, ni maussade parmi ses
domestiques ; sa vertu la faisait également craindre et aimer.
Bref, sa maison était le logis de la paix, de l'honneur, de la civilité et
piété chrétienne, et d'une joie vraiment noble et innocente.
CHAPITRE VI.
combien vertueusement
elle se comportait en l'absence de son mari.
Il est vrai que la joie de notre Bienheureuse Mère était souvent
interrompue par les longs séjours que le baron de Chantal faisait à la cour, et
parmi les armées.[10] Quand il s'en allait, notre sage Léodamie
lui laissait emporter tous ses plaisirs, et n'en pouvait quasi prendre aucun
hors de sa conversation, Dieu ayant rendu leurs chastes amitiés si sincères, si
véritables et si réciproques, qu'il n'y eut jamais entre eux deux,
non-seulement aucun débat, mais pas même de volontés contraires, ainsi que
l'ont assuré les domestiques et notre Bienheureuse elle-même. Quand ce cher
mari était absent, notre Bienheureuse Mère ne sortait point de son logis pour
aller en aucune visite, sinon de quelque proche voisine. Elle ne prenait plus
de soin de s'habiller, coiffer et agencer comme elle faisait d'ordinaire, parce
que son mari le voulait ; et quand on lui en faisait la guerre : [27]
« Ne me parlez pas de cela, disait-elle ; les yeux à qui je dois
plaire sont à cent lieues d'ici ; ce serait inutilement que je
m'agencerais. »
Bourbilly était un château de toutes sortes d'honnêtes passe-temps, de
jeux, de chasses, de promenades, si bien que c'était le rendez-vous de toute la
noblesse des environs et des meilleures compagnies de la ville de Semur. Quand
M. de Chantal était absent, il ne se parlait plus chez lui ni de jeux, ni de
chasses, ni de compagnies superflues ; si quelque honorable visite
arrivait, on était reçu de notre Bienheureuse avec toute civilité, mais avec
tant de modestie et de réserve, surtout envers les jeunes gens, que cela seul
leur faisait connaître qu'il n'était pas temps d'aller chercher là dedans des
passe-temps et divertissements. Elle était sagement et saintement incivile en
cet endroit ; en voici un exemple : Il y avait un jeune seigneur,
grand ami de M. de Chantal, mais que le démon rendait passionné de notre
Bienheureuse, et avait entrepris de la poursuivre jusqu'au non plus, quoique la
rare modestie de cette jeune dame le tînt en telle captivité, qu'il n'osait
déclarer son infâme passion que par des subtilités ; quand M. de Chantal
était chez lui, ce jeune seigneur n'en bougeait, sous prétexte de la chasse.
Une fois qu'il était parti pour aller en voyage, ce pauvre passionné voulut
tenter fortune, et alla visiter notre Bienheureuse, laquelle le reçut en
qualité d'ami du baron de Chantal ; le soir s'approchant, et voyant qu'il
se jetait sur des discours à sa louange, par une sainte finesse, sans lui faire
seulement connaître qu'elle connaissait la passion qui le poussait, elle lui
dit qu'elle était marrie que le baron de Chantal ne fût chez lui pour
l'entretenir et divertir ; que pour elle, comme femme absente de son mari,
elle n'avait aucune joie ; c'est pourquoi il ne perdrait que de
l'importunité si elle s'absentait ; qu'il fallait qu'elle allât pour
quelque affaire chez une demoiselle sa voisine ; qu'elle laissait des gens
au logis pour le servir [28] ce soir-là, et là-dessus monte à cheval pour aller
coucher ailleurs. Le pauvre gentilhomme, d'autre côté, monta à cheval si confus
et si étourdi en son esprit de l'éclat de cette grande vertu, que jamais depuis
il n'osa aborder cette vertueuse dame en l'absence de son mari.
Cette Bienheureuse Mère a dit elle-même en confiance,
« qu'aussitôt que M. de Chantal s'absentait, son cœur et toutes ses
affections se tournaient vers Notre-Seigneur » ; aussi en ce
temps-là, elle paraissait fort dévote : « Dès que je ne voyais pas M.
de Chantal, dit-elle, je sentais en mon cœur de grands attraits d'être toute à
Dieu ; mais, hélas ! je n'en savais pas profiter, ni reconnaître la
grâce que Dieu me présentait, et je faisais quasi aboutir toutes mes pensées et
mes prières pour la conservation et retour de M. de Chantal. » Quand ce
cher mari était de retour, la parfaite complaisance que notre Bienheureuse
avait pour lui faisait qu'elle oubliait ses dévotions précédentes, ne prenant
plus tant de temps pour prier Dieu ; tout le train et les compagnies
revenaient, et parmi ses distractions elle se trouvait comme auparavant, et
alla ainsi roulant jusques en l'année 1601, qu'en l'absence de ce cher mari,
elle fit de grandes promesses à Dieu, qu'à son retour elle se tiendrait ferme à
sa dévotion, comme il arriva ainsi que nous dirons ci-après.
M. de Chantal, au commencement de l'année susdite 1601, se retira de la
cour, pour n'être pas contraint d'obéir en une chose, laquelle il croyait
injuste. En partant, ce brave seigneur, qui avait une veine excellente à la
poésie, fit une chanson d'adieu aux dames de la cour ; nous l'avons
vue : il protestait au dernier couplet que la seule pensée des vertus de
sa chère moitié gravait dans son âme le mépris des vanités et grandeurs de la cour.
En effet, s'il eût voulu demeurer, l'on était prêt à le faire maréchal de
France, étant dans la haute faveur, tant pour son propre mérite qu'à la
considération de M. le président [29] Frémyot, son beau-père ; mais Dieu
avait d'autres desseins. Ce brave baron revint chez lui malade d'une
dyssenterie ; celle qui l'aimait si sincèrement en santé, témoigna combien
elle le chérissait fortement en cette maladie, qui fut grande. Toute sa
promenade était de sa chapelle au chevet du lit de son malade. Presque tous les
jours, ces deux âmes colombines s'entretenaient longuement du mépris de cette
vie et du grand bonheur de servir Dieu hors du tracas du monde. Le malade,
comme plus proche de sa fin, quoiqu'il ne le crût pas et qu'il n'y prît pas
garde, avait des sentiments plus pressants de l'éternité, et voulait qu'ils se
fissent une promesse réciproque, que le premier libre par la mort de l'autre
consacrerait le reste de ses jours au service de Dieu. Le cœur de notre
Bienheureuse ne pouvait ouïr parler de division, et détournait ce propos de la
mort, dès qu'il était entamé. Cependant le malade, après avoir tenu chambre
cinq ou six mois, reprit sa pristine santé ; l'appétit et le sommeil lui
étaient revenus, quand voici qu'une nuit, prenant un paisible repos, il songea
que, par certaine rencontre inopinée, l'on teignait son habit en pourpre, et se
voyait vêtu comme un cardinal ; le matin, il raconta son songe à notre
Bienheureuse Mère, ajoutant, selon son esprit martial, « que cela voulait
dire qu'il serait blessé en quelque bataille, et que son sang teindrait ses
habits. » Elle, qui avait l'esprit généreux et au-dessus des fantaisies
vulgaires qui s'amusent aux songes, ne fit que s'en rire. « Vraiment,
dit-elle, et moi j'ai songé que j'étais affublée d'un grand crêpe noir, comme
une veuve ; mais je vois bien que cela m'est provenu des longues
appréhensions que j'ai eues de l'issue de votre mal ; c'est pourquoi je
n'y fais point de fondement. » Le baron, que Dieu disposait à son prochain
départ de cette vie, ne lui répondit que par une dévote œillade vers le ciel.
De jour en jour il se portait mieux, si bien qu'on le croyait à cent lieues du
tombeau, et il le touchait du bout du doigt, sans le savoir lui-même.
CHAPITRE VII.
comme le baron de
chantal fut blessé à la chasse, et de son heureuse mort.
Nous pouvons quasi dire que la bonne santé du baron de Chantal fut
cause de sa mort, car un sien allié, son parfait et intime ami l'étant allé
féliciter de sa convalescence, lui persuada très-innocemment d'aller un peu à
la chasse, dans un petit bois voisin, pour se récréer et prendre l'air. Le bon
seigneur, qui aimait passionnément cet exercice, s'y accorda volontiers. Ils
allèrent à pied à une petite chasse qui s'appelle, en France, le traquet ;
comme ils étaient prêts à se poser pour attendre au détroit la bête fauve, ils
portaient leurs arquebuses bandées, amorcées, et le chien abattu. Le baron de
Chantal dit à l'autre qu'il prît garde qu'une branche des broussailles lui
pourrait bien faire quelque mauvais coup. Or, l'on ne sait pas si, à cause
d'une casaque de chasse, de couleur de biche, que le baron de Chantal portait,
l'autre le coucha en joue par méprise, le voyant passer à travers d'un hallier,
ou si en effet une branche, le trahissant, fit lâcher son arquebuse ; mais
voilà un coup fatal qui blesse à mort le pauvre baron de Chantal, lequel se vit
par cet accident vêtu de la pourpre de son sang. Ce funeste coup lui rompit la
cuisse, et lui enfonça des balles et des dragées dans les hanches :
« Je suis mort, dit-il, mon cousin, mon ami. Je te pardonne de tout mon
cœur, tu as fais ce mauvais coup par imprudence. » Après ce pardon si
généreux et si tranquille, il envoya quatre de ses serviteurs en quatre
diverses [31] paroisses, afin que, s'ils ne trouvaient pas le curé en l'une, ils
le trouvassent en l'autre pour le venir confesser et lui administrer les
derniers sacrements ; il en envoya un cinquième vers sa chère femme, mais
« hélas ! dit-il, ne lui faites pas savoir que je suis blessé à mort,
dites seulement que je suis frappé à la cuisse. » Ce messager trouva la
pauvre baronne qui était au lit, n'étant accouchée de sa dernière fille que
depuis quinze jours. Dès qu'en lui eut fait ce douloureux message :
« Ha ! dit-elle, on me dore la pilule, » et se levant promptement,
court vers le cher blessé, lequel on avait porté en une maison du village
voisin, et mis au lit. Dès qu'il la vit : « Ma mie, lui dit-il,
l'arrêt du ciel est juste ; il le faut aimer, il faut mourir... — Non,
non, dit-elle, il faut chercher guérison. — Ce sera en vain », dit le
malade. Elle voulut dire quelques paroles sur l'imprudence de celui qui avait
fait ce funeste coup : « Ha ! lui dit le malade, honorons la
céleste Providence, regardons ce coup de plus haut !... » Ce généreux
seigneur, d'un esprit tranquille et résigné, s'enquit si le prêtre n'était
point encore venu ; il en arriva un qui le confessa. C'est chose admirable
de la constance de ces grands cœurs !... Ce malade parlait de sa blessure
et de son prochain trépas, comme si cela eût touché un autre que lui. Il vit de
loin celui qui l'avait blessé, lequel allait d'un côté et d'autre comme
désespéré ; il haussa la voix et lui cria : « Cousin, mon cher
ami, ce coup m'est lâché du ciel, premier que de ta main ; je te prie, ne
pèche point en te détestant pour une action où tu n'as point péché ;
souviens-toi de Dieu, et que tu es chrétien !... » L'on a assuré que,
sans cet encouragement, cet infortuné gentilhomme allait plonger son épée dans
son propre sein, pour venger lui-même sur lui-même, par sa tragique mort, celle
de son ami. Les médecins que l'on avait envoyés quérir arrivèrent assez
promptement ; la pauvre baronne affligée leur dit sans glose :
« Messieurs, absolument il faut guérir M. de Chantal. » Le patient
entendit cela de son lit [32] et répliqua en souriant : « S'il ne
plaît au médecin du ciel, ceux-ci ne feront rien. » On le porta chez lui,
où l'on n'épargna rien pour sa guérison. Notre Bienheureuse, l'affligeant par
trop, pressait avec tant d'instance les médecins pour sa guérison, qu'ils
entrèrent en appréhension de sa mort, et n'osèrent, crainte de quelque
accident, lui faire une incision aux flancs pour arracher les balles,
lesquelles s'enfoncèrent et infectèrent les parties nobles ; après quoi il
n'y eut plus d'espoir de guérison. Le malade était tout résigné entre les mains
de Dieu, et exhortait sa chère épouse à la même résignation, lui disant souvent
que la volonté de Dieu est le seul bien de l'homme chrétien, et si elle ne
voulait pas recevoir avec paix et soumission le coup de sa mort, La douleur de
cette femme affligée était si grande, qu'elle ne put jamais faire venir son
cœur jusqu'à prononcer le oui de cette résignation, mais se dérobait de
la chambre du malade, et allait crier tout haut en certain lieu écarté :
« Seigneur, prenez tout ce que j'ai au monde, parents, biens et enfants,
mais laissez-moi ce cher époux que vous m'avez donné. » Elle offrait à
Dieu l'accessoire, et gardait le principal, mais la céleste Providence avait
conclu de faire autrement le partage. Ce brave et vertueux cavalier mourut à la
plus belle fleur de son âge, et neuf jours après sa blessure, après avoir fait
tous les actes de piété que l'on saurait désirer d'un religieux, étant muni de
tous ses sacrements ; il pria par diverses fois que l'on ne fît jamais
aucune poursuite contre celui qui l'avait blessé, et dit cette belle
parole : « C'est sans répugnance quelconque que je lui pardonne, à
lui, dis-je, qui a fait ce coup par imprudence, et moi, par la malice de mes
péchés, j'ai frappé Jésus-Christ à mort. » Il exhorta derechef sa chère
épouse à modérer ses regrets, et à pardonner à son innocent meurtrier[11] ; et [33] mit dans son testament qu'il
déshériterait celui de ses enfants qui voudrait venger sa mort.[12]
À même temps que ce brave seigneur expira, son père, qui était malade à
douze lieues de Bourbilly, vit passer dans sa chambre une grande troupe de
jeunes jouvenceaux fort gracieux et vêtus à l'angélique, qui menaient en
certaine contrée fort éloignée le baron de Chantal, lequel s'approchant de lui,
lui donna un petit coup sur l'épaule, comme lui disant adieu ; le bon
vieillard s'éveilla en pleurant et dit : « Mon fils de Chantal est
mort. » L'on fit promptement partir un homme, lequel en trouva un autre en
chemin qui venait annoncer cette nouvelle, et ayant diligemment supputé l'heure
du décès, l'on trouva que c'était justement alors que le père avait eu cette
vision.
Nous n'entreprenons pas ici de servir d'écho, et répéter les regrets et
soupirs de celle qui demeurait veuve, âgée seulement de vingt-huit ans, n'ayant
gardé ce digne seigneur que huit ans ; elle en avait eu six enfants, dont
quatre lui restaient petits sur les bras. Elle rendit les devoirs funèbres à
son cher défunt avec beaucoup d'honneur et de courage, mais avec des déluges de
larmes incomparables.[13] Elle porta le deuil austèrement, et [34]
connut bien en se vêtant du grand crêpe, que ce n'avait point été un simple
songe, mais un avertissement céleste pour préparer son cœur à cette croix, je
dis croix ; car dès lors elle fut crucifiée au monde, et le monde lui fut
crucifié.
CHAPITRE VIII.
de la grandeur de son
affliction, et comme elle se comportait en son veuvage.
Toutes les actions de cette veuve affligée criaient à haute voix :
Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant a rempli mon cœur d'amertume. Les
larmes qui coulaient le long de ses joues ne tombaient pas à terre, mais
montaient et étaient reçues au ciel, et Dieu s'empara tellement de son cœur,
qu'au moment même de sa viduité, ce cœur se tourna puissamment à Dieu et lui
consacra toutes ses affections ; elle reçut une lumière quasi
imperceptible en la suprême pointe de son esprit, qui lui montrait que ce bon
Dieu ne l'avait blessée que pour la guérir, et elle avait souvent au cœur et en
la bouche cette parole : « Dieu fait tout en sa miséricorde. »
Ainsi son esprit supérieur était fort accoisé en la volonté de Dieu, et,
quoique son amère amertume fût accompagnée de paix, elle lui était néanmoins
très-amère ; si elle avait quelque contentement, c'était de s'aller
promener seule dans un petit bois, proche de son séjour, pour répandre à
souhait son cœur et ses larmes devant Dieu, qui, l'ayant destinée comme une
autre Judith, pour couper la tête à l'Holopherne du monde, lui inspira des
mêmes affections, car soudain elle fit vœu de chasteté, et se tenait au plus qu'elle
pouvait en un cabinet secret pour faire prière au Seigneur.
Nos premières Mères et Sœurs ayant beaucoup prié cette Bienheureuse de
leur découvrir par quelle manière Dieu l'avait adirée [36] à lui et détachée du
monde, après plusieurs instances elle satisfit à leurs désirs et l'écrivit en
ces propres paroles : « Quand il plut à la souveraine providence de
Dieu, dit-elle, de rompre le lien qui me tenait attachée, à même temps elle me
départit beaucoup de lumières du néant de cette vie, et de grands désirs de me
consacrer toute à Dieu ; dès lors, je fis vœu de chasteté ; voire
même quelque temps auparavant ma viduité, Dieu m'attirait fort à le servir,
tant par de bonnes affections que par diverses tentations et tribulations qui
me faisaient retourner à lui. Or, néanmoins tout cela ne me portait à ce
commencement qu'à vivre chrétiennement dans ma viduité, élevant vertueusement
mes enfants ; mais, quelques mois après, outre l'affliction très-grande
que je souffrais pour ma viduité, il plut à Dieu de permettre que mon esprit
fût agité de tant de diverses et violentes tentations, que, si sa bonté n'eût
eu pitié de moi, je fusse sans doute périe dans la fureur de cette tempête, qui
ne me donnait quasi aucun relâche, et me dessécha de telle sorte, que je n'étais
presque plus connaissable. Parmi ces travaux, Notre-Seigneur augmenta en moi le
désir de le servir ; les attraits que je recevais de Dieu étaient si
grands, que j'eusse voulu quitter tout et m'en aller dans un désert pour le
faire plus entièrement et parfaitement, et hors de tous les obstacles
extérieurs, et je crois que si le lien de mes quatre petits enfants ne m'eût
retenue par obligation de conscience, je m'en fusse enfuie, inconnue, dans la
Terre sainte, pour y finir mes jours. Je sentais des affections inexplicables
de connaître la volonté de Dieu et de la suivre, quoiqu'il en dût arriver, et
me semble que ce désir était si grand, qu'il me consumait et dévorait au
dedans. Mon cœur, par une certaine clameur intérieure, requérait à tous moments
(d'une manière que je ne sais pas exprimer) la volonté de Dieu de se manifester
à moi. Tout cela ne m'allégeait point dans mes tentations ; au contraire,
ces attraits intérieurs [37] me les rendaient plus intolérables, m'étant avis
qu'elles m'empêchaient d'aimer et de servir Dieu selon les pressants et
continuels désirs qu'il m'en donnait. »
Jusqu'ici sont les propres paroles de notre Bienheureuse.
Ceux qui étaient autour d'elle, en la voyant amaigrir, toujours plongée
dans une perpétuelle solitude, silence et larmes, ne sachant pas ce qui se
passait en son intérieur, croyaient que ce fut toujours le regret de sa perte
qui la tenait en cet état ; et, bien que les douleurs de sa viduité
fussent grandes, ce n'était plus que la moindre partie de son tourment, qui,
n'étant connu que de Dieu, les créatures lui apportaient des remèdes tous
contraires à son mal ; on lâchait de ne la point laisser seule, de lui
parler et de la divertir, ce qui l'importunait extrêmement. Toutes les dames
ses voisines, qui l'aimaient parfaitement, se rendaient soigneuses de la
visiter ; ses tantes et cousines de Dijon venaient tour à tour demeurer
avec elle, à Bourbilly, pensant faire grande charité de la divertir, et elles
en auraient beaucoup fait de la laisser avec Notre-Seigneur. Le soir, quand
cette chaste tourterelle était retirée en sa chambre : « Hélas !
disait-elle quelquefois à ses filles, que ne me laisse-t-on pleurer à mon
aise ! on croit me soulager et l'on me martyrise... » Elle se mettait
en prière dans son oratoire, versait des déluges de larmes devant Dieu, et
s'attachait tellement à l'oraison, qu'elle oubliait de se coucher, si ses
filles ne l'en eussent souvenue ; même quelquefois, quand toutes étaient
retirées, elle se levait et passait partie de la nuit en prière ; de quoi
celles qui la servaient s'étant aperçues, elles veillaient tour à tour, pour
faire recoucher leur bonne maîtresse, qui ne trouvait plaisir sur la terre que
de crier à Dieu, comme une hirondelle affamée de la perfection, et méditer en
sa présence comme une paisible colombe.
CHAPITRE IX.
du véhément désir
qu'elle avait d'être dirigée à la perfection, demandant un conducteur à dieu.
Quelques mois après le décès de M. de Chantal, sa dévote veuve
distribua aux paroisses voisines tous ses habits et les siens, pour l'ornement
des autels, ne voulant plus de robes nuptiales que celle qui est requise pour
entrer au festin évangélique et aux noces de l'Agneau. Elle congédia aussi avec
d'honnêtes récompenses les serviteurs de son mari, ne réservant, pour elle et
ses quatre enfants, qu'un petit train modestement vidual et conforme à la vie
qu'elle voulait mener. Elle destina aussi l'occupation de ses journées ;
et les temps et heures qu'elle avait accoutumé, pour complaire à son mari, de
donner à là chasse, au jeu et compagnies, elle les employait à la prière, à la
lecture et aux bonnes œuvres.
Un jour, comme elle était en oraison, Dieu lui donna un si pressant
désir d'avoir un conducteur qui lui enseignât la perfection et la volonté de
Dieu, qu'elle le demandait incessamment. « Hélas ! dit-elle, écrivant
à nos premières Mères, je désirais un directeur, et demandais ce que je ne
savais pas ; car encore que j'eusse été élevée par des personnes
vertueuses, et que mes conversations ne fussent qu'honnêtes, néanmoins je
n'avais jamais ouï parler de directeur, de maître spirituel, ni de rien qui
approchât de cela ; néanmoins, Dieu mit ce désir si avant dans mon cœur,
et l'inspiration de lui demander ce directeur était si forte, que je faisais
cette pétition avec une [39] contention et force non pareilles ; je
parlais à Dieu comme si je l'eusse vu de mes yeux corporels, tant la foi et mon
désir véhément me donnaient d'espérance que j'étais ouïe : je représentais
à Dieu la fidélité de ses paroles, qui promettent de ne point donner une pierre
à qui lui demanderait du pain, et d'ouvrir à ceux qui heurteraient à la porte
de sa miséricorde, et semblables paroles que je ne savais d'où elles me
venaient ; mais je sentais bien par après que Dieu lui-même m'enseignait
les paroles par lesquelles il voulait que je lui demandasse ce que sa bonté
désirait de me donner. Je m'allais promener toute seule, et, comme transportée,
je disais tout haut à Notre-Seigneur ces mêmes paroles, ce me semble :
« Mon Dieu, je vous conjure, par la vérité et fidélité de vos promesses,
de me donner un homme pour me guider spirituellement, qui soit vraiment saint
et votre serviteur, qui m'enseigne votre volonté, et tout ce que vous désirez
de moi, et je vous promets et jure en votre face que je ferai tout ce
qu'il me dira de votre part. » Enfin, tout ce qu'un cœur outré de douleur
et pressé d'ardents désirs peut inventer, je le disais à Notre-Seigneur pour
l'incliner à m'octroyer ma requête, lui répétant toujours la promesse que je
lui faisais de bien obéir à ce saint homme que je lui demandais avec tant de
larmes et d'instances. » Jusqu'ici sont les propres paroles de notre
Bienheureuse Mère, laquelle non-seulement priait et jeûnait de son côté[14] ; mais faisait prier plusieurs pauvres,
veuves et orphelins auxquels elle faisait des aumônes à cette intention.
CHAPITRE X.
de diverses visions
sacrées qu'elle eut, tant de notre bienheureux père, que des desseins que dieu
avait sur elle.
Durant le temps de ses plus ardentes prières, notre Bienheureuse Mère
allant un jour aux champs, à cheval, priant toujours Notre-Seigneur au fond de
son cœur de lui montrer ce guide fidèle qui la devait conduire à lui, passant
par un grand chemin au-dessous d'un pré, dans une belle et grande plaine, elle
vit, tout à coup, au bas d'une petite colline, non guère loin d'elle, un homme
de la vraie taille et ressemblance de notre Bienheureux Père François de Sales,
évêque de Genève, vêtu d'une soutane noire, du rochet et le bonnet en tête,
tout comme il était la première fois qu'elle le vit dans Dijon, comme nous
dirons ci-après.
Cette vision répandit dans son âme une grande consolation et certitude
que Dieu l'avait exaucée ; à même temps qu'elle regardait à loisir ce
prélat admirable, elle ouït une voix qui lui dit : Voilà l'homme
bien-aimé de Dieu et des hommes, entre les mains duquel tu dois reposer ta
conscience. Ce qu'étant dit, la vision disparut aux yeux du corps, mais
demeura si empreinte dans cette sainte âme, qu'environ trente-cinq ans après,
elle dit en confiance à une personne, qu'elle lui était aussi récente dans
l'esprit que le jour qu'elle reçut cette faveur céleste, qui fut suivie de
plusieurs autres. Voici celles qui sont venues à notre connaissance : Un
matin, étant au lit, un peu assoupie, [41] elle se vit dans un chariot avec une
troupe de gens qui allaient en voyage, et lui semblait que le chariot passait
devant une église où elle vit quantité de personnes qui louaient Dieu avec
grande jubilation et gravité : « Je voulus, dit-elle, parlant de
cela, m'élancer pour m'aller joindre à cette bénite troupe, et entrer par la
grande porte de l'église qui m'était ouverte ; mais je fus repoussée et
j'ouïs distinctement une voix qui me dit : Il faut passer outre, et
aller plus loin ; jamais tu n'entreras au sacré repos des enfants de Dieu
que par la porte de Saint-Claude. J'étais si peu dévote,
ajouta-t-elle, que je n'avais jamais fait attention à ce bénit saint, duquel la
dévotion me fut alors imprimée au cœur, et cette vue me donna derechef un grand
allégement. En sorte que quand mes désirs et travaux me violentaient plus
rudement, je disais à mon âme pour la consoler : Patiente, mon âme, Dieu
t'a promis que tu entrerais au sacré repos de ses enfants par la porte de
Saint-Claude. »
« Quelques mois après cette vue ici, il m'arriva un jour d'être
surprise d'un grand attrait du ciel qui attirait à lui tout mon être ; je
fus un long temps dans ce saisissement, toute arrêtée, et me semblait au retour
d'icelui que je revenais d'un autre monde, où je n'avais appris que cette seule
parole que Dieu avait dite à mon âme : Comme mon fils Jésus a été
obéissant, je vous destine à être obéissante. »
« Une autre fois, dans le petit bois proche du château de mon
beau-père, à Montelon, je fus fortement saisie de l'attrait intérieur et
arrêtée en oraison, sans que j'y pusse résister, car j'avais envie de me
retirer à l'église qui était tout proche. » La, il me fut montré que
l'amour céleste voulait consumer en moi tout ce qui m'était propre, et que
j'aurais des travaux intérieurs et extérieurs en grand nombre ; tout mon
corps frémissait et tremblait quand je fus revenue à moi ; mais mon cœur
demeura dans une grande joie avec Dieu, parce que le [42] pâtir pour Dieu me
semblait la nourriture de l'amour en la terre, comme le jouir de Dieu l'est au
ciel. »
« Une autre fois, dans la chapelle de Bourbilly, Dieu me montra
une troupe innombrable de filles et de veuves qui venaient à moi et
m'environnaient, et il me fut dit : Mon vrai serviteur et vous,
aurez cette génération ; ce me
sera une troupe élue, mais je veux
qu elle soit sainte. Je ne savais ce que cela me signifiait, car depuis
que Dieu m'eut dit qu'il me destinait à être obéissante, je n'eusse pas voulu
souffrir en mon âme le désir de faire aucun choix moi-même, et attendais
toujours que Dieu m'envoyât le saint homme qu'il m'avait fait voir, résolue de
faire tout ce qu'il ordonnerait de moi. » Ces faveurs divines passaient,
quant à la suavité ; mais les tentations continuaient à traverser cette
Bienheureuse Mère, laquelle s'avançait au désir de la perfection, sans autre guide
que de Dieu, étant en lieu champêtre, et ne pouvant conférer avec personne ni
de ses biens ni de ses maux intérieurs.
Il faut remarquer que presque à même temps que Notre-Seigneur, par ses
sacrées visions, montrait à sa fidèle servante celui qu'il lui avait destiné
pour conducteur, d'autre côté sa divine Majesté découvrait à notre Bienheureux
Père, en un ravissement, dans la chapelle du château de Sales, les principes de
notre Congrégation, et lui fit voir en esprit celle qu'il avait choisie pour première
pierre fondamentale d'icelle ; en sorte que ces deux saintes âmes se
voyant à Dijon pour la première fois de leur vie, se reconnurent l'une et
l'autre, comme nous dirons ci-après.
CHAPITRE XI.
comme elle se mit
sous la direction d'un personnage qui n'était pas celui que dieu lui avait
choisi.
M. le président Frémyot pensant donner du divertissement à sa chère
fille, dès que l'année de son premier deuil fut expirée, l'envoya quérir pour
la tenir à Dijon, proche de lui. Cette vertueuse veuve versa derechef des
ruisseaux de larmes sur les genoux de ce bon père, auquel elle n'osait
découvrir la principale cause de ses pleurs, qui était ces puissantes aversions
du monde, et ce cuisant désir de Dieu et de l'obéissance, par laquelle elle
souhaitait de diriger sa vie.
Le principal divertissement qu'elle chercha dans Dijon fut de visiter
les lieux de dévotion, qui sont en grand nombre, tant dans la ville qu'aux
environs ; partout elle demandait à Dieu ce saint homme pour la conduite
de son âme. Un jour, entre autres, étant allée à Notre-Dame-de-1'Étang, qui est
une église de grande dévotion, distante de deux petites lieues de Dijon, elle y
trouva un bon religieux et quelques âmes dévotes ; elle s'accosta d'eux
avec témoignage de contentement singulier, d'autant qu'elle était déjà en
réputation de grande vertu. Ces personnes, qui étaient des enfants spirituels
de ce bon père, la pressèrent fort de communiquer de son âme avec lui, à quoi
elle se soumit pour leur condescendre, et fut tout étonnée qu'il l'engageât à le
prendre pour directeur, « Je voyais clairement, dit-elle, que ce n'était
pas celui qui m'avait été montré ; néanmoins, pressée de la
nécessité de quelque secours à [44] cause de mes tentations, et fort persuadée
de part et d'autre, je me laissai engager, même qu'il me vînt de grandes
craintes d'être trompée, et que ma vision ne fût qu'une imagination. »
Ainsi, cette Bienheureuse Mère, comme une humble brebis, croyant que c'était la
volonté du souverain Maître, se laissa lier par ce berger, lequel étant bien
aise d'avoir cette sainte brebis entre ses mains, l'attacha à sa direction par
quatre vœux : le premier, qu'elle lui obéirait ; le second, qu'elle
ne le changerait jamais ; le troisième, de lui garder la fidélité du
secret en ce qu'il lui dirait ; le quatrième, de ne conférer de son
intérieur qu'avec lui. Par ces liens, cette bénite âme n'était pas attachée au
joug doux et léger de Notre-Seigneur, ains c'étaient des filets importuns qui
tenaient son âme comme empigée, contrainte et sans liberté ; elle trouvait
de grandes difficultés à la conduite de ce bon père, et une traverse intérieure
qui ne la quittait point et lui était causée par la pensée continuelle que ce
n'était pas celui que Dieu lui avait montré. Son esprit qui avait reçu, par un
effet divin, l'impression de la vérité, ne pouvait se soumettre à cette
déception ; mais poussée du grand désir qu'elle avait d'être dirigée, elle
se persuadait que ce dégoût provenait de son peu de vertu. Son âme était plutôt
inquiétée que dirigée par la voix de ce pasteur ; car, quoiqu'il fût docte
et vertueux, il ne connut pas les voies de Dieu sur cette grande âme ; si
bien que, la voulant mener par ses voies propres, il la tenait en une anxiété
perpétuelle, et lui faisait boire l'eau de Mara avec sa naturelle amertume,
sans avoir la lumière d'y jeter le bois adoucissant de la cordiale et intime
dévotion, et la faisait marcher par un âpre désert, sans lui donner moyen d'y
cueillir la manne intérieure.
Chose admirable ! cette vraie obéissante était comme une statue entre
les mains de ce conducteur, sans résistance et sans propre volonté. Elle ne se
départait d'aucun de ses conseils, bien qu'elle les sentit contraires aux
attraits et dispositions de [45] son cœur. Il chargea son esprit de quantité de
prières, méditations, spéculations, actions, méthodes, pratiques et observances
diverses, de considérations et ratiocinations extrêmement laborieuses. Il lui
ordonna aussi des prières au milieu de la nuit, des jeûnes, disciplines et
autres macérations en quantité. Elle était si soumise et respectueuse envers ce
bon père, qu'elle n'eût pas voulu manquer à un iota de tout ce qu'il lui
ordonnait, et vécut dans ce martyre deux ans et quelques mois, toujours
languissante dans ce cuisant désir de Dieu, qu'elle ne trouvait point, ne
tenant pas le chemin par lequel il se voulait communiquer à son âme. D'où elle
apprit, comme elle a dit depuis, combien il est nécessaire que ceux qui servent
et conduisent les âmes, les mènent dans les voies de Dieu, et non dans celles
de l'homme, selon la lumière de l'esprit de Dieu, et non selon l'obscure clarté
de l'entendement humain ; et qu'enfin les voies de Notre-Seigneur sont
aussi différentes sur les âmes que ses desseins divers sur chaque créature.
CHAPITRE XII.
de l'admirable
patience qu'elle pratiquait chez son beau-père.
Le séjour de notre Bienheureuse Mère à Dijon ne put pas être d'aussi
longue durée qu'elle aurait souhaité ; car, étant chargée de la tutelle de
ses enfants, il fallait penser à leurs affaires. Elle retourna donc à
Bourbilly, où, dès qu'elle fut arrivée, M. de Chantal, son beau-père, homme
sévère et chagrin, âgé de près de soixante-quinze ans, lui écrivit qu'il
voulait qu'elle allât demeurer avec lui, qu'autrement il se remarierait et
déshériterait ses enfants. La vertueuse veuve reçut par manière d'obéissance ce
commandement de son beau-père, et joignant son cœur à cette croix, alla
demeurer chez lui avec ses quatre enfants, pour y faire un purgatoire d'environ
sept ans et demi.[15] Elle, qui avait un si grand et rare esprit
pour la conduite d'une maison et toutes sortes d'affaires, n'eut là dedans la
connaissance ni le maniement d'aucune chose ; elle n'en [47] tirait que sa
nourriture et son petit train ; le reste de l'entretien se prenait sur les
revenus de Bourbilly.
Le bon vieillard avait une servante qui ne bougeait d'auprès de lui
pour le service de sa personne, et à laquelle il avait entièrement remis le
maniement de sa maison et de ses biens. Et certes, comme rien n'est plus
insupportable qu'une servante qui devient maîtresse, cette femme ici était
haute à la main, et faisait si bien valoir sa surintendance, que l'humble
belle-fille n'eût osé faire donner un verre de vin à un messager sans son
ordonnance. Il fallait que notre Bienheureuse Mère endurât que cette servante
tînt là dedans à pot et à feu cinq de ses enfants, qui allaient de pair avec
ceux de cette Bienheureuse. Souvent la servante excitait l'esprit du bon
vieillard contre sa belle-fille. Elle en est venue quelquefois jusques aux
reproches et injures ; de quoi cette fidèle servante de Dieu, pour vaincre
le mal par le bien, ne se plaignait jamais[16] ; et pour se venger à la façon
évangélique, elle prenait occasion de rendre de bons offices à celle qui lui en
rendait de si mauvais ; même cette Bienheureuse se rendait la maîtresse
d'école et la servante des enfants de cette femme, leur apprenant à lire, les
peignant et les habillant quelquefois de ses propres mains. C'était une chose
bien dure à notre Bienheureuse, de voir que cette femme dissipait le bien de la
maison, faisant des libéralités indiscrètes, et agissait comme maîtresse
absolue. Elle essaya d'y apporter du remède ; mais elle vit que c'était
exciter de nouveaux troubles, et fâcher son beau-père, qui voulait toujours
avoir grand train et que le tout fût conduit par la servante. Elle se résolut à
une [48] profonde patience dans laquelle elle possédait son âme, et ne se
réserva aucune autorité dans cette maison-là que celle de servir les pauvres,
ayant à cet effet une petite chambre écartée, où, en forme de boutique, elle
tenait des eaux, onguents et remèdes pour les pauvres et malades, qui avaient
recours à elle de toutes parts.
Après avoir rendu à son beau-père tous les respects et devoirs filiaux,
elle se retirait le plus qu'elle pouvait des compagnies et du tracas, et
vaquait en son particulier aux affaires de ses enfants, à les instruire
elle-même, et à travailler pour l'église ou pour les pauvres, ayant fait vœu
que tout son travail serait employé à ces deux usages ; ce qu'elle
observait avec tant de rigueur, que si c'était nécessité de faire quelque
petite chose pour elle ou pour ses enfants, elle faisait, durant ce temps-là,
travailler sa femme de chambre, à son ouvrage, regardant tous les moments de sa
vie, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur, consacrés à Dieu et hors de sa
propre puissance. Dès son veuvage, jamais on ne la trouvait désoccupée ;
même entretenant les compagnies qui arrivaient fréquemment chez son beau-père,
c'était toujours avec l'ouvrage en main. Sa femme de chambre la priant une fois
de relâcher cette grande assiduité à l'ouvrage, elle lui répondit :
« Si je perdais du temps inutilement, je croirais faire un larcin à
l'église et aux pauvres à qui je l'ai destiné. » Par sa prudence et
douceur, elle obtint de son beau-père, que, tant qui se pourrait, elle eût tous
les jours messe, transférant pour cela la fondation de celle de Bourbilly (où
il ne demeurait plus que des receveurs) à Montelon.
Depuis son veuvage, les années qu'elle n'allait pas passer le carême à
Dijon, pour ouïr les sermons, elle se levait de bon matin, montait à cheval
pour l'aller ouïr à Autun, qui est à trois petites lieues de Montelon ;
et, soudain après le sermon, remontait à cheval et s'en allait à jeun au grand
trot, pour [49] arriver à l'heure que son beau-père avait accoutumé de se
mettre à table, tâchant en tout de ne pas donner l'ombre d'un sujet de
fâcherie : elle avait trouvé moyen de passer par certaines petites rues
secrètes pour n'être point vue ni arrêtée, et s'en retournait souvent de la
ville sans avoir parlé à personne, se contentant d'ouïr la parole de Dieu et la
cacher en son cœur, pour la réduire en pratique.[17]
CHAPITRE XIII.
des premières
conférences qu'elle eut avec notre bienheureux père, et comme ces deux saintes
âmes se connurent sans s'être jamais vues.
Cette bénite âme attendait en silence le secours de Dieu, pour ses
travaux intérieurs, quand la divine bonté commença à faire paraître l'astre qui
la devait éclairer parmi tant d'obscurités.
L'année 1604, messieurs les échevins de Dijon supplièrent notre
Bienheureux Père de faire l'honneur à leur ville d'y prêcher le carême :
ce débonnaire Prélat s'y accorda, bien qu'il semblait que le monde et l'enfer
s'étaient bandés pour l'empêcher par des raisons d'état ; et ce
Bienheureux écrivit que son âme était secrètement forcée à pénétrer un si grand
succès de ce voyage, qu'il ne put jamais regarder les choses en leur face
naturelle. M. Frémyot avertit sa chère fille de venir passer le carême chez
lui, pour ouïr les sermons de ce saint Prélat ; elle ne manqua pas, avec
l'agrément de son beau-père, de se rendre à Dijon, où elle n'arriva que le
premier vendredi du carême,[18] jour auquel elle vit en chaire ce saint
homme, et [51] connut, au premier regard qu'elle jeta sur lui, que c'était
celui-là même que Dieu lui avait montré pour directeur. Tous les jours elle
faisait mettre son siège à l'opposite de la chaire du prédicateur, pour le voir
et ouïr plus à souhait. Le saint Prélat, de son côté, bien qu'attentif à son
discours, remarquait cette veuve par-dessus toutes les autres dames, et avait
un doux souvenir de sa vision au château de Sales. Il est vrai que l'action et
l'attention du sermon le lui rendaient presque insensible ; néanmoins,
comme il avait fort bien reconnu celle que Dieu lui avait autrefois montrée, il
eut une sainte curiosité de savoir qui elle était, et, par une agréable
rencontre, s'adressa à Monseigneur de Bourges pour le savoir, lui disant :
« Dites-moi, je vous supplie, quelle est cette jeune dame, claire-brune,
vêtue en veuve, qui se met à mon opposite au sermon, et qui écoute si
attentivement la parole de vérité ? » Monseigneur de Bourges, se
souriant, sut bien répondre qui elle était ; et notre Bienheureux Père fut
extrêmement aise de savoir qu'elle était sa sœur, ces deux grands Prélats ayant
déjà commencé de contracter ensemble une grande et sainte amitié.
Notre Bienheureux Père allait fort souvent manger chez M. le président
Frémyot, ou chez Monseigneur de Bourges. Notre chère Mère le suivait partout,
tant qu'elle pouvait, et concevait une si grande estime de ce saint homme,
qu'elle dit elle-même : « J'admirais tout ce qu'il faisait et disait,
et le regardais comme un Ange du Seigneur ; mais je m'étais si
scrupuleusement attachée à la conduite de mon premier directeur, que je ne
communiquais à personne d'aucune chose un peu particulière, qu'en grande
crainte, bien que la sainte débonnaireté du Bienheureux m'invitât quelquefois à
ce faire, et que d'ailleurs j'en mourais d'envie. » Quoique par trop de
contrainte elle n'osât d'abord lui découvrir son âme, elle était tellement
sollicitée de lui obéir, qu'elle en eût voulu chercher toutes les occasions
possibles. Dieu lui en fournit [52] quelques-unes qui ne sont pas, ce semble,
de grande considération, mais elles sont bien à notre avis de particulière
édification.
Une fois le saint Prélat lui demanda si elle avait dessein de se
remarier, elle lui dit que non. « Hé bien, lui répliqua-t-il, il faudrait
mettre à bas l'enseigne. » Elle entendit bien ce qu'il voulait dire, c'est
qu'elle portait encore certaines parures et gentillesses permises aux dames de
qualité, après leur second deuil ; dès le lendemain, elle ôta tout
cela : souplesse qui plut extrêmement à notre Bienheureux Père, lequel, en
dînant, remarqua encore des petites dentelles de soie à son attifet de
crêpe ; il lui dit : « Madame, si ces dentelles n'étaient pas
là, laisseriez-vous d'être propre ? » Ce fut assez dit ; le soir
même, en se déshabillant, elle les décousit elle-même. Une autre fois, voyant
des glands au cordon de son collet, il lui dit, toujours dans sa sainte
suavité : « Madame, votre collet lairrait-il d'être bien attaché, si
cette invention n'était pas au bout du cordon ? » Au même temps, elle
prit ses ciseaux et coupa ces glands.
Son conducteur avait si grande crainte que quelque autre lui ravît la
conduite de cette belle âme, qu'étant allé pour quelques affaires hors de
Dijon, il lui donna une de ses filles spirituelles pour surveillante, à
laquelle il avait commandé, par obéissance, de ne point la quitter, ce qui eût
tenu notre Bienheureuse Mère en grande contrainte, si la crainte de faillir ne
l'eût plus gênée que tout le reste. Notre-Seigneur, qui voulait mettre cette
digne âme en la liberté de ses enfants, le mercredi saint, lui envoya une si
furieuse attaque de tentation, que son conducteur étant absent, elle fut
absolument nécessitée de chercher quelque calme vers notre Bienheureux Père, et
pour cela trouva une invention de faire absenter sa surveillante ; et
Monseigneur de Bourges gardait la porte de la salle, afin que personne
n'entrât, tandis que sa chère sœur découvrait son âme au saint Prélat, d'auprès
duquel elle sortit tellement rassérénée [53] qu'il lui semblait qu'un Ange lui
avait parlé ; « et si, néanmoins, dit-elle, le scrupule de mon vœu,
de ne parler de mon intérieur qu'à mon premier directeur, me serrait de si près
que je ne parlais qu'à moitié à ce Bienheureux Prélat. » Le lendemain, qui
était le jeudi saint, notre Bienheureux Père, qui avait assisté Monseigneur de
Bourges à sa première messe, dîna chez lui ; notre chère Mère était assise
à table proche de lui, en sorte qu'il entendit qu'elle disait à une dame proche
d'elle qu'elle voulait aller à Saint-Claude : le Bienheureux se tourna et
lui dit que, si elle l'avertissait du temps, qu'il ferait en sorte de s'y
trouver avec madame sa mère, qui y devait aller rendre un vœu. Notre
Bienheureuse Mère sentit une grande joie de cette espérance.
La semaine d'après Pâques, elle dit à notre Bienheureux Père qu'elle
désirait grandement de recevoir les saints Sacrements par lui. Ce Bienheureux y
fit un peu de résistance, quant à la confession, pour l'éprouver, lui disant
que les femmes avaient souvent des curiosités inutiles ; néanmoins il le
lui accorda, et Dieu lui donna dans cette confession de si grands sentiments et
lumières pour le bien et la conduite de sa pénitente, et sentit loger cette âme
si intimement dans la sienne, que lui-même en entrait en profonde
considération, ainsi qu'il dit par après. Elle, de son côté, resta grandement
calmée et désireuse de suivre les avis de ce saint Prélat, « sans
toutefois, dit-elle, que j'osasse penser à me dégager de mon premier
conducteur, sous la conduite duquel ce Bienheureux sembla m'affermir, me
disant, par un trait de son incomparable prudence, qu'ils s'accommoderaient
bien eux deux pour une chose si importante que la disposition de ma vie et la
direction de mon âme. En cela, je trouvais mon compte de pouvoir prendre et
suivre les conseils de ce saint homme, sans scrupule de ma part, ni fâcherie de
celle de mon directeur, qui m'avait attachée par tant de vœux. »
CHAPITRE XIV.
comme cette
bienheureuse fut consolée par deux grands serviteurs de dieu, sur la peine
quelle avait de changer de directeur.
Le lendemain de Quasimodo, notre Bienheureux Père fit ses adieux pour
partir de Dijon ; après plusieurs saintes et cordiales paroles dites à
notre vertueuse veuve, il ajouta celles-ci : « Madame, Dieu me force
de vous parler en confiance ; sa bonté m'a fait cette grâce, que, dès que
j'ai le visage tourné du côté de l'autel pour célébrer la sainte messe, je n'ai
plus de pensées de distraction ; mais depuis quelque temps vous me venez
toujours autour de l'esprit, non pas pour me distraire, ains pour me plus
attacher à Dieu ; je ne sais ce qu'il me veut faire entendre par là. »
Il lui dit plusieurs autres choses d'une façon profondément attentive à Dieu,
et fort sérieuse ; et à la première dînée qu'il fit au partir de Dijon, il
lui écrivit un petit billet de cette teneur : « Dieu, ce me semble,
m'a donné à vous, je m'en assure toutes les heures plus fort ; c'est tout
ce que je vous puis dire. Recommandez-moi à votre bon Ange. » Elle reçut
chèrement ce billet, et gardait, ruminait et conférait toutes ces choses en son
cœur avec une grande paix et désir de s'abandonner totalement à Dieu, entre les
mains duquel elle se livrait incessamment pour faire sa sainte volonté.
La veille de la Pentecôte, quarante jours après le départ de notre
Bienheureux Père, elle se trouva tout à coup saisie d'une nouvelle tempête et
affliction d'esprit, par le combat qui se [55] faisait en son âme, entre un
puissant désir de se ranger totalement sous la conduite du saint évêque, et une
puissante crainte de quitter son premier conducteur. Elle s'est déclarée de
cette peine en ces propres termes : « Je craignais effroyablement,
dit-elle, de manquer de fidélité à la divine volonté que je voulais suivre au
péril de toutes choses, et ne sachant de quel côté elle était plus, je
souffrais, ce me semble, un martyre qui dura environ trente-six heures, durant
lesquelles je ne pris ni sommeil ni nourriture, et dans le susdit temps, je fus
délivrée de toutes mes autres tentations, et avais une grande clarté aux choses
de la sainte foi ; je m'en émerveillais, car c'était ma plus grande peine.
Or, pressée de cette angoisse, je ne faisais que prier Notre-Seigneur, qu'il
lui plût me faire connaître clairement sa sainte volonté, protestant que je ne
voulais que la suivre et lui obéir fidèlement. Je sentais que mon âme ne
voulait que cela, et n'avait autre attache qu'à ce divin vouloir. »
Le saint jour de la Pentecôte, sur le soir, elle envoya prier le
révérend Père de Villars, recteur des Jésuites et son confesseur, de venir
jusques en son logis, car elle n'en pouvait plus, tant son esprit était agité.
Elle lui raconta toute sa peine, et que son désir de connaître la volonté de
Dieu et la suivre était si pressant, que dès qu'elle prononçait ce mot volonté de Dieu, c'était comme un
brandon qui enflammait son âme, et que ne sachant où était cette volonté pour
elle, elle entrait dans un tourment inexplicable. « Ce bon Père, dit-elle,
qui était un homme profond en science, et d'une éminente piété et religion,
ayant ouï le récit que je lui fis des convulsions de mon esprit, me répondit
sérieusement et fortement, avec des sentiments de Dieu extraordinaires :
C'est la volonté de Dieu que vous vous rangiez sous la conduite de Monseigneur
de Genève ; elle vous est convenable, et non celle que vous suivez
maintenant : il a l'esprit de Dieu et de l'Église, et la [56] divine
Providence veut quelque chose de grand de vous, vous donnant ce Séraphin
terrestre pour votre conduite. »
Chose admirable des effets qu'opèrent les avis des bonnes âmes, qui,
sans intérêt propre, ne cherchent qu'à faire connaître la volonté du
Maître ! À l'instant que le révérend Père de Villars eut tenu ce discours
à notre Bienheureuse Mère, elle sentit son âme tout accoisée. « Il me
semblait, dit-elle, que l'on m'ôtait une montagne de dessus le cœur, qui
l'oppressait et l'opprimait, et je demeurai en une grande paix, clarté et assurance,
que ce qu'il me disait était la volonté de Dieu, ce qui redoublait mon courage
et mes désirs. » D'autre part, Dieu faisait si clairement connaître au
révérend Père de Villars que sa bonté voulait que cette grande âme fût sous la
conduite de notre Bienheureux Père, qu'il lui en écrivit, après notre
établissement, les paroles suivantes (ainsi que l'on pourra plus amplement voir
en sa lettre fidèlement rapportée en la fondation de ce Monastère) :
« Sachez, Monseigneur, dit-il, que Dieu me donnait des mouvements si vifs
d'assurer madame de Chantal, que sa divine bonté lui voulait donner l'eau de la
Samaritaine, par le canal de vos lèvres, que, si les Anges, troupes à troupes,
fussent venus pour m'en dissuader, je ne pense pas qu'ils l'eussent pu faire, parce
que l'impression était faite en mon âme par le Roi des Anges. »
Parmi toutes ces entrefaites, le premier conducteur de notre
Bienheureuse Mère, qui avait été absent jusques alors, retourna, et ne manqua
pas de savoir que sa vertueuse disciple avait conféré avec notre Bienheureux
Père, car elle en eut du scrupule, à cause de son vœu, et le lui dit tout
candidement. Il lui en donna de grands remords de conscience, ce qui la mit
dans de nouvelles afflictions intérieures, et bien qu'elle se fit d'extrêmes violences
à elle-même, pour se soumettre aux avis de ce directeur, son esprit n'y
trouvait assurance ni correspondance intérieure aucune, ce qui la tenait en une
perplexité étrange. Le [57] bon Père de Villars l'assurait toujours de la
volonté de Dieu, qu'elle se mît du tout sous la conduite de notre Bienheureux
Père ; mais les prétendus devoirs et obligations à ce Père spirituel la
tenaient toujours dans la gène intérieure. Ne sachant plus que faire, elle se
résolut d'écrire à notre Bienheureux Père tout ce qui se passait entre son
directeur et elle, les agitations de sa conscience, et le calme qu'y apportait
le révérend Père recteur. Et c'est ici où nous commençons à regretter la perte
que nous avons faite de toutes les lettres que cette digne Mère avait écrites à
notre Bienheureux Père, lequel les avait toutes cotées de sa sainte main, pour
servir un jour à sa vie, où elles feront un éternel besoin. Mais, après le
décès de ce Bienheureux, cette âme vraiment humble, ayant retiré toutes ses
lettres des mains de feu Monseigneur de Genève, successeur de notre Bienheureux
Père, elle les jeta au feu ; il est vrai qu'il nous reste cette
consolation que, par la date des lettres que ce Bienheureux lui écrivait en
réponse des siennes, nous voyons la suite de son état intérieur, et pouvons
juger du mal par la médecine, et de la cause par l'effet.
En la première lettre que ce saint Prélat écrivit à sa chère fille
spirituelle en réponse des siennes, il lui disait qu'il fallait prendre temps
pour prier Dieu, et connaître si c'était sa sainte volonté qu'il se chargeât du
soin de son âme ; qu'il ne voulait point chose aucune, sinon que le divin
bon plaisir eût part en cette résolution. Il se fit grand nombre de prières à
cette intention : la vertueuse veuve employait toutes les personnes
qu'elle croyait qui avaient du crédit vers Notre-Seigneur ; entre autres,
elle eut recours à un Père Capucin, que l'on estimait un saint homme. Un jour,
comme il offrait à Dieu le saint sacrifice de la messe à cette intention, il
eut une vision, dans laquelle Dieu montra les desseins qu'il avait sur notre
Bienheureuse Mère, à laquelle, après sa messe, il dit ces mêmes mots :
« Madame, ne dilayez plus, rangez-vous sous la conduite de Monseigneur de
[58] Genève ; si Dieu vous envoyait par une façon miraculeuse son propre
esprit pour vous guider, il ne le ferait pas plus sûrement que par ce digne
Prélat. Il a la plénitude de l'esprit de Dieu par une participation et
communication admirable que Dieu lui fait de soi-même. »
Une autre fois, ce même Père Capucin lui dit encore :
« Madame, depuis que Dieu m'a fait connaître le bonheur auquel il vous
destine, sous la conduite de Monseigneur de Genève, je vous honore et chéris
tout extraordinairement. »
Ces assurances mettaient notre Bienheureuse en grande paix ; mais
elle y demeurait peu par les importunités du premier directeur, lequel,
s'apercevant bien que cette grande âme sortirait de son domaine, en voulait
éviter le coup, et lui commanda de renouveler le vœu qu'elle avait fait de
demeurer sous sa conduite, ce qu'elle fit pour obéir, et en donna soudain avis
à notre Bienheureux Père, qui lui fit réponse, le 24 juin de la susdite année
1604, par où il lui dit qu'il est bien d'accord qu'il ne faut avoir qu'un
directeur ; mais que l'unité d'un père spirituel ne forclôt pas la
confiance à un autre : « Ne vous mettez point en peine, dit-il, en
quel rang vous me pouvez tenir, pourvu que vous sachiez quelle est mon âme en
votre endroit, et que je sache quelle est la vôtre au mien ; je sais que
vous avez une entière et parfaite confiance en mon affection ; sachez
aussi que j'ai une vive et extraordinaire volonté de servir votre esprit de
toute l'étendue de mes forces. Je ne vous saurais pas exprimer ni la candeur ni
la qualité de cette affection que j'ai à votre service spirituel, mais je vous
dirai bien que je pense qu'elle est de Dieu ; que pour cela je la
nourrirai chèrement, et que tous les jours je la vois croître et s'augmenter
notablement. Maintenant, Madame, vous voyez clairement la mesure avec laquelle
vous me pouvez employer ; usez de tout ce que Dieu m'a donné pour le
service de votre esprit, sans autre liaison qui porte obligation que celle de
la [59] vraie charité et amitié chrétienne. Obéissez à votre premier directeur
filialement et librement, et servez-vous de moi charitablement et franchement.
Vous avez eu, me dites-vous, du scrupule et crainte de tomber en quelque
duplicité, disant que vous m'avez communiqué votre esprit et demandé quelques
avis ; je suis consolé que vous ayez en horreur la finesse et
duplicité ; il n'y a guère de vices qui soient plus contraires à
l'embonpoint de l'esprit, mais si est-ce que ce n'eût pas été duplicité,
puisque si en cela vous aviez fait quelque faute, à cause du scrupule que vous
aviez, m'ouvrant votre cœur, vous l'aviez suffisamment effacée par après, pour
n'être plus obligée de le dire à personne ; néanmoins, je loue votre
candeur, mais une autre fois tenez pour non dit, et totalement tu, ce qui est
couvert du voile sacramental. Or, Dieu soit béni ! j'aime mieux que vous
excédiez en naïveté que si vous y manquiez. J'ai repris la plume plus de douze
fois pour vous écrire ceci, et semblait que l'ennemi me procurait des
distractions pour m'empêcher de le faire. Je loue la divine bonté du respect
religieux que vous portez à votre conducteur ; s'il vous donne licence,
écrivez-moi quelquefois. »
Je me suis un peu étendue à rapporter les propres paroles de notre
Bienheureux Père, parce qu'elles font voir combien ce saint Prélat procédait
sagement, et s'il faut ainsi dire, lentement, pour mieux connaître la volonté
de Dieu, avant que de se charger de la conduite de cette grande âme, qui se
trouvant derechef dans de grands troubles intérieurs, elle s'en déclara, pour
la seconde fois, au révérend Père de Villars, lequel, dit-elle, me répondit
alors avec une grande autorité et fermeté : « Je ne vous dis pas
seulement que vous vous dépreniez de cette première conduite, et que vous vous
rangiez totalement sous celle de Monseigneur de Genève ; mais je vous dis
de la part de Dieu que si vous ne le faites, vous résistez au
Saint-Esprit. » Elle reçut ces paroles de son [60] confesseur comme un
commandement du ciel, et derechef, elles accoisèrent son esprit et soulagèrent
ses travaux intérieurs. Ce qu'elle écrivit à notre Bienheureux Père, qui lui
fit réponse qu'il faisait faire plusieurs prières, et qu'absolument il fallait
qu'ils se vissent, avant de résoudre s'il prendrait sa conduite, et il lui
assigna Thonon ou Gex[19] ; mais Dieu en disposa autrement, comme
nous allons voir.
CHAPITRE XV.
du voyage de
saint-claude, ou notre bienheureux père accepta la charge spirituelle de cette
bienheureuse.
Quand elle fut toute prête à partir pour se rendre à Thonon, elle reçut
un billet de notre Bienheureux Père qui lui donnait assignation à Saint-Claude.[20] Comme c'était la veille de son départ, elle
alla à Saint-Bernard, auquel elle avait une dévotion singulière, pour lui
recommander le succès de son voyage. Quand elle fut dans cette église, sa
vision de la porte de Saint-Claude lui revint en l'esprit avec une certaine
clarté et consolation fort particulière et extraordinaire et partit avec une
grande allégresse intérieure.
Le jour de saint Barthélemy, 1604, il arriva à Saint-Claude une noble
compagnie, tant de Savoie que de Dijon,[21] quasi après le premier salut, notre
Bienheureux Père laissa madame de Boisy, sa mère, avec madame la première
présidente Bruslart, et quant [62] à lui, il prit sa chère fille spirituelle,
et lui fit raconter tout ce qui s'était passé en elle ; ce qu'elle fit
avec une si grande clarté, simplicité et candeur, qu'elle n'oublia rien. Le
saint Prélat l'écouta attentivement, sans lui répondre un seul mot là-dessus,
et se séparèrent ainsi. Le lendemain, assez matin, il l'alla trouver ; il
paraissait tout las et abattu : « Asseyons-nous, lui dit-il, je suis
tout las et n'ai point dormi, j'ai travaillé toute la nuit à votre affaire. Il
est fort vrai que c'est la volonté de Dieu que je me charge de votre conduite
spirituelle, et que vous suiviez mes avis. » Après cela, ce saint homme demeura
un peu en silence, puis dit, jetant les yeux au ciel : « Madame, vous
le dirai-je ? il le faut dire, puisque c'est la volonté de Dieu ;
tous ces quatre vœux précédents ne valent rien qu'à détruire la paix d'une
conscience ; ne vous étonnez pas si j'ai tant retardé à vous donner une
résolution, je voulais bien connaître la volonté de Dieu, et qu'il n'y eût rien
de fait en cette affaire que ce que sa main ferait. J'écoutais, dit notre
Bienheureuse Mère, le saint Prélat, comme si une voix du ciel m'eût parlé ;
il semblait être dans un ravissement, tant il était recueilli, et allait quérir
ses paroles l'une après l'autre, comme ayant peine à parler. » Le même
matin, elle fit sa confession générale vers notre Bienheureux Père, lequel
après icelle lui donna un billet signé de sa main, portant ces mots :
« J'accepte au nom de Dieu, la charge de votre conduite spirituelle, pour
m'y employer avec tout le soin et fidélité qui me sera possible, et autant que
ma qualité et mes devoirs précédents me le peuvent permettre. »
Chacun sait avec quelle fidélité et utilité ce Bienheureux a accompli
sa promesse, et avec quelle obéissance, soumission et persévérance cette digne
Mère a suivi sa direction.[22] Elle fit [63] alors vœu de lui obéir, et le
lui envoya par écrit, comme nous dirons ci-après, Notre Bienheureux Père lui
écrivit de sa main une méthode nouvelle pour passer dévotement la journée,
laquelle est un crayon du Directoire spirituel que ce Bienheureux Père a dressé
puis après pour notre Congrégation. Il lui donna encore une méthode pour entrer
chaque jour de la semaine dans une des plaies sacrées de Notre-Seigneur. Il lui
changea sa manière d'oraison qui était contrainte et gênée, et la mit en
liberté de suivre l'attrait de Dieu.
« O Dieu ! dit notre Bienheureuse Mère, que ce jour me fut
heureux ! il me sembla que mon âme changeait de face et sortait de la
captivité intérieure, où les avis de mon premier directeur m'avaient tenue
jusques alors. » Dès ce jour-là, qui [64] fut le jour de saint Louis, elle
commença à entrer au repos intérieur des enfants de Dieu, dans une grande
liberté intérieure, et fut attirée à une sorte d'oraison toute cordiale et
intime, qui porte une sainte et respectueuse familiarité de l'âme avec l'Époux
céleste, et pouvait bien dire : » J'ai trouvé celui que mon âme a
tant désiré ; je m'assois en repos à son ombre, et son fruit est doux à ma
bouche. »
Par certaine rencontre de récréation, notre Bienheureux Père entendit
que la femme de chambre de notre Bienheureuse Mère racontait qu'à quelque heure
de la nuit qu'elle s'éveillât, elle s'habillait, afin que quand sa maîtresse,
qui se levait de grand matin pour faire son oraison, l'appellerait, elle pût
être à elle plus promptement. Ce Bienheureux l'en reprit fort, lui donna
plusieurs petites pratiques intérieures de mortification, et lui dit :
« Il nous faut avoir une dévotion si douce envers Dieu, et si débonnaire
envers le prochain, que personne n'en soit importuné ni incommodé ; il est
raisonnable que, puisque vous voulez aller chercher Dieu en l'oraison,
vous vous leviez seule pour le mieux trouver, sans donner de la peine superflue
à ceux qui vous servent. » Elle observa fidèlement cet avis, et dès lors
tous les matins se levait seule, allumait sa chandelle, quand c'était l'hiver,
pour lire son point de méditation, après laquelle elle éveillait ses filles.
Cette fidèle Servante de Notre-Seigneur ayant écrit par amour, ès
tablettes de son cœur, les avis de ce saint et nouveau Directeur, et les ayant
attachés à ses doigts pour les pratiquer incessamment, le 28 du mois d'août
elle s'en retourna à Dijon, et le saint Prélat en Savoie.
CHAPITRE XVI.
comme elle fit vœu
d'obéissance à notre bienheureux père, et de ses tentations.
Jamais une chaste et innocente abeille ne retourna si contente en sa
ruche, après avoir cueilli la rosée du ciel sur les fleurs, que cette vraie
veuve revint de son bénit voyage. Le lendemain de son arrivée, elle en alla
rendre grâce à la sainte Vierge, dans l'église de Notre-Dame-de-1'Étang. Là,
elle écrivit et signa de sa main ses vœux en cette sorte : « Seigneur
tout-puissant et éternel, je, Jeanne-Françoise Frémyot, combien que
très-indigne de votre divine présence, me confiant toutefois en votre bonté et
miséricorde infinie, fais vœu à votre Divine Majesté, en présence de la glorieuse
Vierge Marie, et de toute votre cour céleste et triomphante, de perpétuelle
chasteté, et d'obéissance à Monseigneur l'évêque de Genève, sauf l'autorité de
tous légitimes supérieurs. Suppliant très-humblement votre immense bonté et
clémence, par le précieux sang de Jésus-Christ, qu'il vous plaise recevoir cet
holocauste en odeur de suavité, et comme il vous a plu me donner la grâce pour
le désirer et offrir, il vous plaise, aussi me la donner abondante pour
l'accomplir. Amen. Écrit à Notre-Dame-de-l'Etang, ce 2 de septembre 1604 »
Après avoir rendu la très-sainte Vierge protectrice et gardienne de ce
sien vœu, elle l'envoya à notre Bienheureux Père, et l'avertissait comment ce
lion rugissant qui va toujours tournoyant autour de nous, pour nous surprendre,
lui livrait de nouveaux assauts, tant sur le choix de son directeur que contre
[66] notre sainte foi. À quoi notre Bienheureux Père fit réponse, le 14 octobre
de cette même année 1604 : « Le choix, dit-il, que vous avez fait de
moi, a toutes les marques d'une bonne et légitime élection ; de cela, n'en
doutez plus. Ce grand mouvement d'esprit qui vous a portée presque par force et
avec consolation, la considération que j'y ai apportée avant que d'y consentir,
ce que ni vous ni moi ne nous en sommes pas fiés à nous-mêmes, mais y avons
appliqué le jugement de votre confesseur, bon, docte et pieux ; ce que
nous avons donné le loisir aux premières agitations de votre conscience de se
refroidir si elle eût été mal fondée ; ce que les prières, non d'un jour, mais
de plusieurs mois, ont précédé, sont des marques infaillibles que c'était là la
volonté de Dieu. » Et plus bas, il ajoute : « Arrêtez là, je
vous supplie, et ne disputez point avec l'ennemi sur ce sujet ; dites-lui
hardiment que c'est Dieu qui l'a voulu et qui l'a fait. Vous me demandez des
remèdes contre les tentations de la foi qui vous travaillent ; ne disputez
point, faites comme les enfants d'Israël qui ne s'essayaient nullement de
rompre les os de l'agneau pascal, ains les jetaient au feu. » Avec cet
avis et plusieurs autres que ce saint évêque lui donna, quoiqu'elle fût
violemment travaillée de ses tentations, elle ne faisait pas semblant de voir
son ennemi, et par un absolu dédain de ses suggestions, elle n'y répondait pas
un mot, non plus que si elle ne l'eût pas ouï. La tentation de la foi allait
incessamment attaquer son entendement, pour l'attirer à la dispute ; mais
comme bien apprise en cette guerre spirituelle par son saint Directeur, tandis
que son adversaire s'amusait à vouloir escalader l'intellect, elle sortait par
la porte de la volonté, et faisait une bonne charge sur lui ; puis elle se
jetait aux pieds de Notre-Seigneur sans pouvoir dire une seule parole, mais
bien assurée que sa bonté entendait seulement par son humble contenance qu'elle
réclamait son divin secours. « Oh ! (lui écrivit notre Bienheureux
Père), ma [67] chère sœur, que c'est bon signe que l'ennemi crie tant au
dehors ! c'est signe qu'il n'est pas au dedans. »
Outre les exercices spirituels que ce Bienheureux lui avait tracés à
Saint-Claude, elle désira encore qu'il lui marquât l'emploi de toutes les
heures du jour, et il ajouta au bas de la lettre : « Voici la règle
générale de notre obéissance : il faut tout faire par amour, et rien par
force ; il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance. Je
vous laisse la liberté d'esprit, et veux que s'il vous advient quelque occasion
juste et charitable de laisser vos exercices, ce vous soit une espèce
d'obéissance et que ce manquement soit suppléé par l'amour. Souvenez-vous du
jour du glorieux saint Louis, jour auquel, à Saint-Claude, vous ôtâtes derechef
et de nouveau la couronne à votre propre cœur, pour la mettre aux pieds du Roi
Jésus ; jour auquel vous renouvelâtes votre jeunesse comme l'aigle, vous
plongeant en la mer de la pénitence ; jour fourrier du jour éternel pour
votre âme. Ressouvenez-vous que sur ces grandes résolutions que vous fîtes
d'être toute à Dieu, de cœur, d'âme et d'esprit, je dis, Amen, de la
part de l'Église, notre Mère ; et à même temps la sainte Vierge et tous
les anges firent retentir au ciel leur grand Alléluia. » Plus bas,
ce Bienheureux dit encore : « Je vous prie de bénir Dieu avec moi des
effets du voyage de Saint-Claude ; je ne vous les puis dire, mais ils sont
grands. »
L'année 1604 finit ; mais notre Bienheureuse Mère ne vit pas finir
avec elle ses peines et tentations. Au contraire, il semblait qu'elles
recommençassent avec l'année 1605, surtout celle de la foi, suivie de celle-ci,
que son âme, voyant la beauté de la vie parfaite, avait une multitude de désirs
qui faisaient des obstructions en son esprit. Cette âme généreuse voyant la
beauté, la clarté et l'excellence des résolutions qu'elle avait faites pour la
perfection, courait à la proie avec trop d'ardeur et multiplication de désirs ;
le voisinage du bien lui excitait [68] l'appétit, et l'appétit, l'empressement
à s'y lancer, mais pour néant ; car le maître la tenait comme attachée sur
la perche, et ne lui voulait donner sitôt l'usage de ses ailes spirituelles.
Cependant elle amaigrissait et perdait ses forces corporelles par un continuel
mouvement et pantèlement de cœur, sur quoi notre Bienheureux Père lui donna
d'admirables avis, qu'il conclut ainsi : « Vous me faites ressouvenir
du saint homme Moïse, qui vit et n'entra jamais dans la Terre promise. Or sus,
s'il fallait mourir sans boire de l'eau de la Samaritaine, qu'en serait-ce pour
cela, pourvu que votre âme fût reçue à boire de l'éternelle source de
vie ? »
Cette Bienheureuse Mère, parlant de la peine qu'elle souffrait alors,
l'exprime ainsi : « Lorsque je croyais être un peu en paix, tout à
coup je me trouvais dans une nouvelle bataille et pressée d'afflictions
intérieures ; mes puissances et facultés étaient privées de tout ce qui me
pouvait alléger, et accablées de la représentation vive de tout ce qui pouvait
accroître mon travail, lequel était tel que je disais sans difficulté : Mon
âme est triste jusques à la mort. Je prononçais quelquefois ces
paroles : Mon Père, que ce calice passe, mais sitôt que je l'avais
dit, je sentais une avidité ardente de le boire jusques à la dernière goutte,
et retournais dire à Notre-Seigneur : Mon Dieu, faites-moi cette
miséricorde que ce calice ne passe point que je ne l'aie bu. » Après
plusieurs et diverses lettres que notre Bienheureux Père et elle s'écrivirent
sur le commencement de cette année 1605, il fut conclu qu'elle suivrait
l'inspiration que Dieu lui donnait de faire un voyage en Savoie, pour
s'aboucher avec son Bienheureux Conducteur, qui lui assigna de se trouver à
Sales,[23] les fêtes de Pentecôte. Elle en obtint [69]
les permissions de ses père et beau-père assez difficilement, et avant de
partir, alla prendre la bénédiction de Mgr l'évêque d'Autun, et la
permission de se prévaloir des indulgences en Savoie.
CHAPITRE XVII.
comme en son premier
voyage en savoie elle fit sa confession générale à notre bienheureux père.
Elle arriva à Sales le 21 de mai, et y trouva notre Bienheureux Père.
Ce fut ici où ces deux grandes âmes conférèrent tout à loisir ensemble des
choses qui pouvaient avancer le royaume de Dieu en eux.
Notre très-digne Mère refit une confession générale, et fit une
reddition de compte très-exacte de toute sa vie, avec tant de lumières et
d'extraordinaires sentiments de Dieu, que le saint Prélat en était tout ravi de
joie ; et une fois, dans un de leurs entretiens, ce Bienheureux voyant des
yeux de l'esprit que cette belle âme était non-seulement lavée d'hysope, et
rendue plus blanche que neige, mais que le fleuve impétueusement doux de la
grâce d'en haut réjouissait cette cité de Dieu, il lui dit : « O ma
fille, ma fille, il tombe bien de l'eau ; » entendant parler de celle
de la grâce. Notre Bienheureuse Mère, qui était saintement enivrée au cellier à
vin de l'Époux céleste, ne prenant pas garde que le temps était clair et
serein, crut qu'il était pluvieux, et répondit : « Laissons pleuvoir,
mon Père, laissons pleuvoir. » Le Bienheureux se mit à sourire, sans
qu'elle s'en prît garde, poursuivant son discours avec une ardeur
admirable ; et pour conclusion, elle renouvela ses vœux, et notre
Bienheureux Père et elle firent ce petit colloque, que nous avons appris de sa
propre bouche : » C'est donc tout de bon, dit notre Bienheureux Père,
que vous voulez servir à Jésus-Christ ? — [71] Tout de bon, dit-elle. — Donc,
vous vous dédiez toute au pur amour. — Toute, répliqua-t-elle, afin qu'il me
consume et qu'il me transforme en soi. — Est-ce sans réserve que vous vous y
consacrez ? — Oui, sans réserve, je m'y consacre. — Méprisez-vous donc,
lui dit le saint Prélat, tout le monde comme fiente et ordure, pour avoir
Jésus-Christ et sa bonne grâce ? — Je le méprise, dit-elle, de toute mon
âme ; et il m'est en horreur. — Pour conclusion, ma fille, vous ne voulez
donc que Dieu ? — Non, répliqua-t-elle, je ne veux que lui, pour le temps
et l'éternité.
La voix de cette chaste tourterelle fut sans doute fort agréable aux
oreilles du divin Époux, qui, dès lors, la fit entrer toujours plus avant ès
pertuis de la pierre, et au trou de la caverne de la vie parfaite et
intérieure. Notre Bienheureux Père lui dit qu'il avait eu de hautes pensées sur
sa venue, en l'espace de trois heures qu'il demeura seul dans une grange où il
se retira, lui étant allé au-devant, pour l'attendre au passage. Ce Bienheureux
lui dit encore une autre fois : « Il y a quelques années que Dieu m'a
communiqué quelque chose pour une manière de vie ; mais je ne vous le veux
dire d'un an. » Elle demeura soumise et ne demanda jamais que cela voulait
dire. Seulement, un jour, parlant à ce saint Prélat des véhéments désirs
qu'elle avait de servir Dieu sans obstacles, elle lui dit : « O mon
Dieu ! mon Père, hé ! ne m'arracherez-vous point au monde et à
moi-même ? » Il lui fit une réponse tardive, grave et sérieuse :
« Oui, dit-il, un jour vous quitterez toutes choses, vous viendrez à moi,
et je vous mettrai dans un total dépouillement et nudité de tout pour
Dieu. »
Notre Bienheureuse Mère, parlant de ce voyage, dit un jour les paroles
suivantes : « Le peu de jours que je demeurai avec cet homme de Dieu
me furent de grandes bénédictions ; il me renvoya avec cette
recommandation, de ne penser qu'à demeurer dans ma condition viduale, parce que
j'avais souvent [72] des désirs d'être religieuse ; mais toutefois mon âme
en son intime ne sentait point de désir qui lui fût volontaire que celui
d'obéir à la volonté de Dieu, que je voulais uniquement apprendre par la voix
du saint homme qu'il m'avait donné pour ma conduite. Parmi toutes mes
tentations, Dieu me laissait souvent une petite satisfaction intérieure de
sentir mon cœur si attaché aux avis de mon saint Directeur, et lorsqu'il me
semblait que notre bon Dieu me punissait et m'abandonnait, je lui disais
promptement : Mon Souverain, je ne mérite pas que vous me parliez, mais je
crois fermement qu'en écoutant votre Serviteur, je vous écoute, et que c'est
vous qui me parlez par ce saint organe. »
Une autre fois, parlant de l'estime que Dieu lui imprimait au cœur, de
notre Bienheureux Père, elle dit les paroles suivantes : « Je voyais
Dieu habiter en ce saint Pasteur, avec une telle plénitude, que je ne le
regardais jamais, que je sache, sans quelques mouvements de la divine présence,
et eusse tenu à félicité d'abandonner toutes les choses de ce monde, pour être
quelque petite personne de service en sa maison, afin de rassasier mon âme des
paroles de vie qu'il proférait à toutes heures. » De cette grande estime
naissait une très-grande obéissance à tout ce que notre Bienheureux Père lui
ordonnait, et pour ne s'en point oublier, ou elle l'écrivait elle-même, ou elle
lui faisait écrire en un petit livret de papier blanc, qu'elle avait fait
relier tout exprès.[24] [73]
Après avoir séjourné dix jours à Sales, et conféré tout à loisir avec
ce Bienheureux, elle s'en retourna à Montelon, en Bourgogne, où, parmi le
tracas des affaires qui lui survinrent à la foule, pour les biens de ses
enfants, on vit reluire en elle une sainte liberté d'esprit toute nouvelle,
accompagnée de grandes suavités ; ses dévotions n'étaient plus ennuyeuses
à personne, ce qui faisait donner de grandes bénédictions à notre Bienheureux
Père, reconnaissant que Dieu avait suscité ce saint homme en ce temps pour
rendre la dévotion amiable, facile et accostable à tout le monde. Les
domestiques de cette sainte veuve disaient par proverbe entre eux, ainsi que
nous l'avons appris de leur propre bouche : « Le premier Conducteur
de Madame, disaient-ils, ne la faisait prier que trois fois le jour, et nous en
étions tous ennuyés ; mais Monseigneur de Genève la fait prier à toutes
les heures du jour, et cela n'incommode personne. » Ce qu'ils disaient,
parce que l'on voyait qu'elle avait en usage continuel les aspirations, retours
à Dieu, et saint recueillement intérieur.
Deux jours après l'arrivée de cette sainte veuve chez son beau-père,
elle commença à régler ses exercices, selon que son saint Conducteur lui avait
ordonné. Premièrement, elle se levait à cinq heures, et l'été un peu plus
matin, et était aussi prompte au son de son réveil qu'une religieuse au signe
de l'obéissance ; elle se levait seule, allumait sa chandelle, quand elle
en avait besoin, entrait en son oratoire, faisait une heure d'oraison mentale
et ses prières quotidiennes, après lesquelles elle allait se peigner et
habiller seule et sans feu, quelque hiver qu'il fît. Quand ses enfants étaient
levés, elle leur apprenait à prier Dieu, leur faisait faire l'exercice du
matin, que le Bienheureux lui [74] avait enseigné, lequel elle faisait même
pratiquer par ses servantes. Elle allait donner le bonjour à son beau-père, et
le servir, l'aidant à s'habiller quand il le voulait souffrir, car il n'en
était pas toujours d'humeur. Tous les jours elle oyait messe, et tous les
samedis elle en faisait dire une particulière qu'elle avait vouée à la
très-sainte Vierge. Durant le repas, elle procurait que l'on ne parlât que de
choses bonnes et de vertus ; quelque compagnie qu'il y eût, on lui
apportait toujours son ouvrage avec le tapis. Tous les jours elle employait
quelque temps à apprendre à lire à ses enfants, et même à ceux de la servante
dont nous avons déjà parlé. A l'heure du jour qui lui était la plus commode,
elle faisait le catéchisme à ses enfants, à ceux de la servante, et aux
domestiques de la maison qui s'y pouvaient trouver. Elle lisait, en son
particulier, environ demi-heure par jour. Avant le souper, elle faisait une
petite collation spirituelle, rentrant plus spécialement dans une des plaies de
Notre-Seigneur où elle faisait chaque jour sa retraite, puis elle disait son
chapelet, lequel elle a dit toute sa vie, en ayant fait vœu. Le soir, après
souper, quand il n'y avait pas compagnie, et que son beau-père l'agréait, elle
faisait assembler toute la famille, et lisait quelque bonne instruction pour
l'observance des Commandements de Dieu et de l'Église, et pour la pratique des
bonnes mœurs et de la piété chrétienne. Quand elle était retirée en sa chambre,
elle disait avec ses enfants et sa petite suite, les Litanies de Notre-Dame et
un De profundis, pour feu le baron son mari ; puis, chacun faisait
l'examen, prenait la bénédiction du bon Ange, disait tout haut, et tous
ensemble, l’in manus tuas, etc., puis elle donnait de l'eau bénite, et
sa bénédiction à ses enfants, et les faisait coucher chacun à part dans un
petit lit, et non jamais ensemble ; elle demeurait encore demi-heure en
prière, et toujours avant que se mettre au lit, elle lisait quelques points des
avis que son saint Conducteur lui écrivait, et son point de méditation pour le
lendemain. [75]
Son occupation intérieure, pour lors, était la méditation de Dieu
humanisé, et à force de demeurer auprès de ce divin Sauveur, elle apprit, comme
dit notre Bienheureux Père, l'imitation de ses divines vertus ; elle ne se
présentait devant le Père Éternel, qu'appuyée sur les mérites infinis de son
bien-aimé Fils, avec lequel elle commençait, acheminait et finissait toutes ses
prières. Tous les matins, elle faisait une prière particulière pour visiter en
esprit toute la sainte Église, Épouse de Jésus-Christ, dont l'une des parties
triomphe au ciel, et celle-là, elle la saluait avec congratulation et
conjouissance de son heureuse félicité ; l'autre milite en la terre, et
elle suppliait l'Époux de la rendre victorieuse de ses ennemis, d'accroître le
nombre des fidèles, et de lui faire la grâce de mourir bonne fille d'une si
sainte Mère. La troisième partie est au Purgatoire ; ici elle appliquait
les suffrages, prières et indulgences. Elle avait pour cabinet de retraite,
ainsi que nous avons déjà dit, une des plaies du Sauveur : le dimanche,
elle se retirait dans la plaie du côté ; le lundi, dans celle du pied
gauche ; le mardi, dans celle du pied droit ; le mercredi, dans celle
de la main gauche ; le jeudi dans celle de la main droite ; le
vendredi, dans les cicatrices de son adorable chef ; le samedi, elle
rentrait dans celle du côté, pour finir la semaine par où elle l'avait commencée.[25] Ce fut dans cet exercice des plaies du
Sauveur, ainsi qu'elle a dit par après, qu'il lui fut donné une présence de
Dieu qu'elle a gardée toute sa vie, qui était une vue spirituelle de Dieu en
toutes choses, qui tenait son âme dans une sainte indifférence, l'âme trouvant
son bien unique dans toute la diversité des créatures, des affaires et des
événements.
Pour mieux concevoir les maximes du saint Évangile, sa lecture
quotidienne était pour lors l'exposition des Évangiles, par [76] le Père
Ludolphe, autrement nommée le Grand Vita Christi.[26] Sa plus chère récréation était de chanter des chansons
spirituelles : surtout elle aimait les Psaumes de David, mis en vers par
M. Philippe Desportes, abbé de Tiron.[27] Elle avait toujours ce livre avec elle, même
quand elle allait par les champs ; elle le faisait pendre dans un petit
sac à l'arçon de sa selle, afin de chanter et louer Dieu le long du chemin.
CHAPITRE XVIII.
du règlement qu'elle
observait en sa personne, et de ses emplois de charité.
Cette fidèle amante ne se contentait pas de suivre son Bien-aimé dans
la douceur des encens de la vie spirituelle de ses exercices, si elle ne
moissonnait avec lui la myrrhe élue de la mortification dont elle avait
tellement parfumé ses mains que tout ressentait en elle la mortification.
Elle avait une grande austérité sur elle-même, et ne donnait à son
corps que ce que la discrétion lui défendait de retrancher ; elle se
servait absolument elle-même pour tout ce qui était requis à sa personne, et
ses femmes de chambre ne purent point gagner sur elle qu'elle leur permît au
moins de faire son lit et de lui mettre une toilette ; même elle balayait
elle-même son cabinet ; elle réduisit son habit dans la plus grande
simplicité qu'elle put, pour montrer qu'elle ne prétendait plus rien au monde,
et que, comme la fille jadis étrangère, elle voulait épouser le vrai
Israélite ; elle se coupa les cheveux qu'elle avait fort beaux, et parce
qu'elle les avait autrefois frisés et poudrés, et y avait de l'attache, pour se
venger de sa vanité, elle les jeta au feu. Elle prit une coiffure sans façon,
des nages noires ; un bandeau de crêpe et une coiffe de taffetas
noir ; son collet fort petit, joignant au cou, de toile épaisse sans
empois, et des manchettes basses, larges de deux doigts ; sa robe d'étamine
si simple, qu'elle ne voulut pas seulement y souffrir un galon ; sa jupe
de sergette noire, et ne voulut jamais user de bas de soie. [78]
La mortification de son vêtement était accompagnée de celle de son
vivre ; comme elle avait été nourrie fort délicatement, elle ne s'était
pas accoutumée à l'usage de plusieurs viandes ; mais pour pratiquer une
totale indifférence au choix d'icelles, voyant que l'on ne lui permettait pas,
à cause de sa délicate complexion, de faire des grands jeûnes, comme sa ferveur
lui faisait désirer, elle commanda à une très-honnête femme, qui avait le soin
de ses enfants, de la servir à table : cette bonne femme servait à son
propre appétit sa vertueuse maîtresse, et Dieu permettait que ce fût des choses
dont elle avait plus d'aversion naturelle, sans qu'elle lui en dît mot, ni
qu'elle manquât de manger ce qu'elle lui avait mis devant elle, pratiquant
ainsi le plus haut point de la sainte abstinence que Notre-Seigneur a
recommandée à ses disciples, tournant son goût à toutes mains ; ce qu'elle
observait avec une si simple dissimulation, que ceux qui mangeaient à la table
de son beau-père avec elle ne s'en apercevaient pas, ayant une de ses femmes de
chambre, affidée à sa dévotion, qui de temps en temps venait lui changer son
assiette, et serrait pour les pauvres la venaison et la volaille que la
compagnie servait à sa dévote maîtresse. Elle jeûnait d'ordinaire le vendredi
et le samedi ; la discipline et la ceinture lui étaient en fréquent usage,
surtout quand elle était pressée de ses tentations. Ses autres mortifications
des sens ne semblent comme rien auprès de ce grand domaine que cette
Bienheureuse Mère prit sur ses passions, étant dans la journalière pratique de
vaincre le mal par le bien, n'opposant que douceurs aux aigreurs de la servante
de laquelle nous avons parlé ci-dessus, qui lui faisait mille niches, selon
l'incivilité naturelle de sa rustique naissance. Il y eut quelques personnes
qui dirent une fois, que dès que M. de Chantal, beau-père de notre
Bienheureuse, serait mort, elles couperaient le nez à cette servante, et la
traîneraient aux fossés. Cette vraie patiente répondit fortement :
« Non, je me rendrai sa sauvegarde ; si Dieu se sert [79] d'elle pour
m'imposer une croix, pourquoi lui en voudrais-je du mal ? » Elle ne
permettait point à ses enfants, ni à celles qui étaient à son service, de lui
faire aucun rapport de tout ce que la servante faisait et disait contre elle,
et lorsqu'on lui voulait faire trouver mauvais que cette femme eût toute la
conduite des affaires de la maison de son beau-père, elle répondait :
« Dieu l'ordonne ainsi pour mon mieux, afin que j'aie du temps pour vaquer
à quelque œuvre de piété. » C'était à quoi elle occupait tout son loisir.
Et cette sainte veuve n'eut pas plutôt donné tout son cœur à Dieu pour l'aimer
ardemment, qu'elle se donna toute au prochain pour le servir charitablement.
Dès la seconde année de son veuvage, jusqu'à ce que notre Congrégation eût la
clôture, elle fut véritablement la servante des pauvres, et l'on ne saurait
dépeindre la millième partie de ce qu'elle a pratiqué en cet exercice.
La dextre du Souverain Maître fit une telle mutation au cœur de cette
jeune et délicate veuve par la douce violence de ses divins attraits, que
d'abord elle eut en horreur ce que le monde prise, et ne prisait rien tant que
ce que le monde hait et répudie. Divorce admirable, mais très-véritable :
toutes les délices extérieures de cette vertueuse dame étaient le service des
pauvres chancreux, ladres et autres affligés de semblables misères. Ses muscs
et civettes étaient des pots d'onguents qu'elle faisait elle-même avec un soin
égal à la vue intérieure qu'elle avait, que, servant les pauvres, elle servait
Jésus-Christ, et ruminait souvent cette parole : « J'ai été
malade, et vous m'avez secouru, etc. » Elle avait, comme nous avons
dit, une petite chambre où elle
tenait tout ce qui lui servait pour le soulagement et service des
pauvres. Tout cela était si net et si bien rangé, que l'on prit au pays par
proverbe, lorsqu'on voulait louer la propreté de quelque maison :
« Cela, disait-on, est propre et bien rangé comme la boutique de madame de
Chantal. » Tous ceux qui avaient quelques plaies ou autre mal, [80] de
gale, chancre et autres semblables, venaient de bien loin à elle, et étaient
reçus cordialement et servis bien soigneusement, et comme elle confessa une
fois : le jour qui lui était le plus long et ennuyeux, était celui auquel
elle trouvait moins d'occasion d'exercer la charité envers les pauvres. Elle
lavait toujours les plaies de ses propres mains, ôtait le pus et la chair
pourrie, et l'accommodait avec soin et dévotion, faisant quelquefois cette
charité à genoux. Des personnes qui étaient alors à son service, nous ont
assuré qu'elles lui avaient vu souvent baiser les plaies des pauvres, et
appliquer ses bénites lèvres sur des plaies si horribles, qu'elles frémissaient
d'y appliquer leurs regards. Tous les jours, elle allait faire le lit et
nettoyer les immondices des malades du village plus voisin du lieu de sa
demeure. Le monde, dont les yeux chassieux s'éblouissent des plus vives
lumières, se mit à blâmer hautement ce procédé, disant qu'elle eût mieux fait
de demeurer vers son beau-père ; mais elle répondait humblement qu'elle
n'ôtait point du temps que légitimement elle devait à son beau-père, « et
outre cela, disait-elle, il a des serviteurs et servantes pour le servir ;
mais ce pauvre de Jésus-Christ n'aura personne, si je le quitte » ;
après cela, méprisant humblement les mépris et censures du monde, elle
poursuivait généreusement son dessein. Tous les dimanches et fêtes, un peu
après le dîner, elle prenait congé de son beau-père, et allait, à pied, avec
deux de ses servantes, par les maisons de la paroisse, visiter les malades, non
certes sans grande mortification, lassitude et incommodité ; car, soit
dans les excessives chaleurs de l’été, ou dans les extrêmes froideurs de
l'hiver, cela allait toujours son train ; cette fidèle Servante de
Notre-Seigneur ayant toujours été admirable en la persévérance, en quoi que ce
soit qu'elle ait entrepris.
Allant ainsi visiter les malades, elle disait en partant à ses
suivantes : « Nous allons faire un petit pèlerinage, nous allons [81]
visiter Notre-Seigneur sur le Mont du Calvaire, au Jardin des Olives, ou au
Sépulcre » ; diversifiant ainsi les stations et sujets de
s'entretenir spirituellement ; pour l'ordinaire, elle y allait en silence,
ou pour le moins en lisant et chantant quelques Psaumes de David, selon la
version de l'abbé de Tiron, Philippe Desportes. Quand elle était arrivée chez
ces bons villageois, elle consolait leurs esprits de saintes paroles, et
soulageait leurs corps des remèdes et petites douceurs qu'elle leur apportait.
Avant de partir, elle les essuyait, si c'était des fébricitants qui fussent en
l'ardeur de la fièvre, ou elle faisait leurs lits. Dès qu'il tombait quelqu'un
malade ès environs de son séjour, on la venait avertir selon l'ordonnance
qu'elle en avait faite, si bien qu'elle savait tous les alités et les qualités
du mal de chacun, où elle tâchait d'apporter les remèdes convenables. Le courage
charitable du saint homme Tobie avait, ce semble, repris une nouvelle naissance
en cette généreuse dame ; car de ses propres mains elle lavait et
ensevelissait les corps morts de tous ceux qui décédaient en sa paroisse ;
elle demeurait autant qu'elle pouvait auprès des moribonds ; mais quand
ils décédaient en son absence, on l'allait promptement quérir ; aucun de
la maison n'eût osé ensevelir la personne défunte, et disait, par
respect : c'est le droit de Madame la sainte baronne, leur ayant demandé cette
grâce, en échange du soin qu'elle prenait des malades durant leurs maladies.
Pour finir le discours des offices généraux et quotidiens que cette
vraie veuve rendait aux pauvres, il faut encore dire ce mot : elle avait
des habits de réserve pour les pauvres, et quand il en venait à elle de tout
misérables, drilleux et pleins de vermine, elle leur faisait mettre des habits
qu'elle tenait tout faits, et prenant les haillons que les pauvres posaient,
elle les faisait bouillir dans de l'eau pour en ôter la vermine, et de ses
propres mains elle les recousait et rapiéçait. Quand les habits des pauvres
n'avaient point de vermine, mais que seulement [82] ils étaient déchirés, on
l'a vue souvent, avec dés fausses manches et un tablier blanc devant elle,
étendre ces habits sur sa table et les vergeter, faisant encore de même, après
les avoir raccommodés pour les rendre plus propres aux pauvres.
CHAPITRE XIX.
deux exemples
notables de son incomparable charité à servir les malades.
Non-seulement cette Thabita de nos jours avait donné commission qu'on
l'avertît de ceux qui tombaient malades dans les maisons, mais avait donné
charge expresse qu'on lui amenât les pauvres que l'on trouverait par les champs
et le long des buissons, ayant une compassion toute particulière pour ces
créatures délaissées qui servent de jouet à la misère. Les paysans étaient fort
fidèles à lui obéir en cela, et, trouvant quelque pauvre misérable, ils le lui
amenaient aussi franchement qu'on amènerait un fils chez son père, et elle le
recevait avec plus de joie véritable qu'un avaricieux ne recevrait son
trésor ; aussi était-ce celui de son cœur de servir Dieu ès choses les
plus répugnantes à la nature.
Une fois, entre autres, un bon paysan, revenant du marché d'Autun,
trouva auprès d'un buisson un pauvre garçon tout ladre, et lequel, ayant la
haute rache, était abandonné de tous ; le bonhomme met pied à terre et le
charge sur sa monture pour en faire un présent à la fervente baronne, laquelle,
avec une joie extraordinaire, mit ce pauvre garçon dans un lit qu'elle avait
toujours prêt pour les pauvres au lieu où elle les servait ; et, ayant
fait un paquet de ses haillons pour les nettoyer de la vermine, prit des
ciseaux, et, de ses propres mains, tondit et huila cette tête racheuse, lui mit
un bonnet bien blanc, et alla elle-même brûler ses cheveux, sans vouloir
permettre [84] qu'aucurie de ses servantes les touchât. Le long temps que ce
pauvre garçon avait demeuré sans manger était cause qu'il lui en fallait donner
peu et souvent ; cette charitable nourrice des pauvres s'y assujettissait,
et le paissait de sa propre main ; d'ordinaire, elle allait le visiter
trois ou quatre fois le jour, engraissant au moins deux fois le jour, sans y
manquer, sa tête racheuse, et nettoyant sa ladrerie.
Quand il arrivait que des justes devoirs la retenaient proche de son
beau-père, ou dans l'entretien de quelque compagnie si honorable et digne de
respect qu'elle ne se pût dégager sans incivilité, elle envoyait une de ses
servantes porter le repas à ce pauvre garçon ; la fille, qui n'était pas
duite à la mortification comme sa maîtresse, posait promptement vers le malade
ce qu'elle lui portait, et se retirait sur-le-champ, se bouchant le nez ;
nous l'avons appris, de la propre bouche de cette fille, qui nous disait que ce
pauvre se mettait à pleurer et disait : « Quand Madame vient, elle ne
se bouche jamais le nez, elle s'assied proche de moi et m'instruit pour mon
salut ; mais, quand elle ne peut venir, tous les autres
m'abandonnent. » Après qu'elle eut rendu ses fidèles services à ce pauvre,
plusieurs mois durant, il plut à Dieu de l'appeler pour être un ami de
réception à sa bienfaitrice dans les Tabernacles éternels, Elle le veilla les
nuits, entières, lui fit recevoir les derniers sacrements. Quand il voulut
expirer, il se tourna contre elle, les mains jointes, lui demandant sa
bénédiction ; elle la lui donna, et l'embrassant, lui dit ces propres
paroles : « Va, mon enfant, avec confiance en Dieu : tu seras
porté, avec plus d'avantage que le Lazare, par les mains des anges, au lieu du
repos. » Non contente de l'avoir servi vivant, elle se mit en devoir de le
laver et ensevelir ; ce que voyant, un cousin de M. de Chantal l'en voulut
empêcher, et lui dit, entre autres choses, qu'en l'ancienne Loi, celui qui touchait
un ladre était immonde, et que véritablement celle loi-là n'était point abolie
entre les personnes sages, [85] ajoutant plusieurs paroles de colère et de
mépris de lui voir faire cette action. Elle fit semblant de n'ouïr point ce qui
la tançait si âprement, et, reprenant simplement ce qu'il avait dit de
l'ancienne Loi, elle l'assura que depuis qu'elle avait su que l'Écriture dit de
Notre-Seigneur, qu'il avait été vu en sa Passion comme un lépreux, elle n'avait
plus eu d'horreur d'autre lèpre que de celle du péché, lequel n'a point d'autre
remède que l'application du sang du Sauveur. Après cette sage réponse, elle
continua, sans se laisser divertir, de laver ce pauvre corps, l'ensevelit,
assista à son enterrement et fit faire des prières pour le repos de son âme. En
telle rencontre, elle était profondément arrêtée à ruminer ce verset de
David : Que Dieu élève le pauvre de la fiente, et le fait asseoir parmi
les princes de son peuple au royaume céleste.
À peine notre sainte veuve avait rendu les derniers devoirs chrétiens à
ce pauvre ladre, que Dieu lui fournit une autre occasion d'exercer sa longanime
charité. Il y avait, proche de Montelon, une honnête et fort jolie femme,
laquelle, pour complaire à son mari, coupa une verrue qu'elle avait sur le
nez ; mais la coupa si mal à propos que soudain il lui vint un cancer,
lequel, en peu de temps, lui mangea le bout du nez, et la rendit si laide, que
son mari, infidèle aux promesses conjugales, fit divorce avec elle. Quand cette
pauvre femme se vit délaissée, elle eut recours à l'asile ordinaire où tous les
misérables trouvaient un refuge charitable. Soudain la dévote baronne se mit à
panser ce cancer qui mangeait avec une grande activité ce pauvre visage,
allant, sans y manquer, trois fois le jour dans la petite chambre de cette
femme ; mais, comme le cancer était malin, elle ne put empêcher que, se
jetant aux joues et au front, il ne décharnât tellement ce visage que c'était
une chose effroyable à voir et insupportable à sentir ; aussi la pauvre
femme était séquestrée dans une méchante petite chambre où personne ne voulait
entrer que la charitable baronne, qui lui continua [86] son service journalier
près de trois ans et demi, durant lesquels le cancer, ayant tout à fait
décharné les joues, les dents, les mâchoires, monta jusqu'aux oreilles et
descendit jusqu'au-dessous du menton, lui mangeant tout au long du cou ;
en sorte que le visage de cette femme n'avait non plus de forme humaine qu'une
tête de mort, excepté les yeux, qui lui roulaient dans la tête et qui la rendaient
plus effroyable.
Il n'est pas croyable les inventions que les parents de feu le baron de
Chantal trouvèrent pour détourner cette sainte veuve du service de cette femme,
sans en pouvoir venir à bout ; ils en avertirent M. le président Frémyot,
son père, la taxant d'une grande imprudence. Ce bon père qui, en tout autre
sujet, n'avait jamais eu que débonnaireté pour sa chère fille, cette fois ici
lui écrivit une lettre de correction fort pressante, lui disant que sa dévotion
était non-seulement indiscrète, mais déshonorable à ses parents et
préjudiciable à ses enfants, et finissait sa lettre par ces mots :
« En vertu de toute l'autorité et le pouvoir qu'un père a sur sa fille, je
vous défends de ne plus toucher cette femme chancreuse ; que si vous ne
vous souciez pas de vous-même, ayez pitié de ces quatre beaux enfants que Dieu
vous a laissés et desquels il vous fera rendre compte. » Ce commandement
toucha fort la vertueuse veuve, laquelle, comme elle avait commencé et
persévéré si longtemps à servir cette pauvre créature par dévotion véritable et
non opiniâtre, elle discontinua par abnégation et obéissance filiale, bien
qu'elle ne laissât pas de préparer toujours, trois fois le jour, ce qu'il
fallait pour panser sa malade, et le lui portait en sa chambre, s'abstenant
seulement de la toucher, Monsieur son père ne lui ayant spécifié que cela en sa
défense.
Cette pauvre femme, depuis que la sainte veuve ne lui appliqua plus les
remèdes de sa propre main, ne vécut qu'environ trois semaines ; il est
vrai qu'elle ne pouvait naturellement aller guère plus loin. Sa misère était
parvenue jusqu'à ce point que [87] le chancre lui détachait les mâchoires, et
lui avait fait un trou au gosier par lequel elle prenait un peu d'aliment que
la vertueuse dame lui distillait par là, dans l'estomac, avec un biberon. Elle
ne pouvait plus former ses paroles, parce que son souffle lui sortait par ce
trou du gosier avec un bruit pitoyable ; par où l'on voit s'il ne fallait
pas une force plus qu'humaine pour persévérer si longtemps à servir cette
pauvre créature, laquelle, se voyant mourir, avait un extrême regret que ce fût
sans communier ; mais la charitable mère de son corps le fut encore de son
âme, trouvant invention et obtenant du curé qu'il lui portât, par ce trou du
gosier, une petite particule de la sainte hostie, avec des pincettes d'argent
qu'elle fit faire exprès. Ce qui étant fait, la bonne femme décéda doucement et
chrétiennement, environ demi-quart d'heure après cette heureuse communion. À
peine cette bonne femme fut-elle ensevelie, que l'on amena à notre Bienheureuse
Mère un pauvre vieux homme tout couvert de gale et de furoncles, qu'elle garda
et pansa pendant dix mois, et enfin, l'ensevelit de ses propres mains.
Il est à noter qu'elle a été huit ans entiers, c'est-à-dire depuis la
fin de sa première année de veuvage, jusqu'à son entrée pour commencer notre
Congrégation, que, outre les pauvres qui la venaient trouver pour être pansés,
et ceux qu'elle allait chercher dans leurs maisons, elle en avait toujours un
en son petit département, chez son beau-père, pour l'exercice continuel de sa
charité. Et ne se peut dire le tendre amour qu'elle témoignait pour les
pauvres, depuis le jour de la fête de la très-sainte Trinité, 1604, que, se
promenant sur le soir proche du château, il vint à elle trois grands jeunes
hommes de fort bonne mine lui demander l'aumône pour l'amour de Dieu ; ne
se trouvant rien sur elle propre à leur donner, qu'une petite bague qu'elle
avait ôtée du petit doigt de M. le baron de Chantal, son mari, après sa mort,
et qu'elle aimait fort pour l'amour du défunt, elle s'en dépouilla et la bailla
au premier de ces pauvres, [88] le priant que ce fût pour tous trois ; ils
lui dirent fort courtoisement qu'oui, qu'ils étaient bons amis, qu'il suffisait
qu'elle eût donné l'aumône à l'un pour tous. À même temps qu'ils parlaient,
elle fut saisie d'un grand mouvement de la divine présence, et se jetant à
leurs pieds, elle les leur baisa à tous trois ; ils la laissèrent faire.
S'étant relevée, ils prirent congé d'elle, qui ne sut jamais discerner de quel
côté ils avaient tiré, mais demeura tellement amoureuse des pauvres, que,
sur-le-champ, elle fit vœu à Dieu de ne jamais refuser l'aumône quand on la lui
demanderait pour l'amour de Dieu, duquel l'infinie bonté n'a point sa main
libérale raccourcie, et pourrait bien avoir fait à sa dévote servante, en la
personne de ces trois pauvres, la même faveur qu'il fit à Abraham en la
personne de ces trois pèlerins en la bonne vallée de Mambré.
CHAPITRE XX.
comme elle voulut,
par révérence, filer les habits de notre bienheureux père, et comme elle fut
guérie d'une maladie.
Non-seulement cette grande servante de Dieu s'occupait aux choses
hautes et fortes, mais ses doigts tournaient le fuseau ; car, outre le
travail qu'elle prenait autour des pauvres et pour l'ornement des autels des
églises de son voisinage, elle fut inspirée de filer une pièce de serge pour
faire un habit à notre Bienheureux Père, espérant qu'à l'avenir elle lui
filerait tous ceux qu'il userait. L'année 1606, elle lui envoya pour étrennes
une pièce de serge qu'elle avait filée et fait teindre en violet, avec prière
instante à ce saint Prélat de donner aux pauvres la valeur de son ouvrage. Sur
quoi le Bienheureux lui fit réponse : « Oui, ma très-chère fille,
j'approuve que vous fassiez des ouvrages de vos mains, quand rien de plus grand
ne vous occupe, et que votre travail soit destiné aux autels ou aux pauvres,
mais non pas que ce soit avec si grande rigueur que, s'il vous advient de faire
quelque chose pour vous ou les vôtres, vous vouliez pour cela vous contraindre
de donner aux pauvres la valeur ; il faut partout que la sainte liberté
d'esprit règne. Or sus, j'ai ri, mais de bon cœur, voyant votre dessein que
votre serge serve à mon usage et que je donne sa valeur aux pauvres ;
mais, qui me l'estimera en sa juste valeur ? car si je voulais donner aux
pauvres son prix, selon ce que je l'estimerais, je n'aurais pas cela vaillant,
je vous en assure ; jamais vêtement ne me tint si chaud que celui-là, dont
la chaleur [90] passera jusqu'au cœur, et ne penserai pas qu'il soit violet,
mais pourprin et écarlatin, puisqu'il sera, ce me semble, teint en charité. Or
sus donc, soit fait pour une fois ; car, sachez que je ne fais pas tous
les ans des habits, ains seulement selon la nécessité ; pour les autres
années, nous trouverons moyen d'employer vos travaux selon votre désir. »
Après cela, ce Bienheureux Prélat enseigne à cette sainte ouvrière à
travailler à une quenouille mystique, lui faisant mettre, comme à la sacrée
bergère du Cantique, la croix de Notre-Seigneur à son côté gauche, et
considérer que la laine de l'innocent Agneau Jésus y est précieusement
liée ; c'est-à-dire ses mérites, ses exemples et les mystères de sa sainte
croix. Elle filait continuellement à cette sainte quenouille, par
considérations, aspirations et bons exercices, et par une imitation soigneuse
du Fils de Dieu, elle tirait dans le fuseau de son cœur toute cette blanche et
délicate laine ; et, comme lui avait prédit le Bienheureux, elle s'en est
fait un drap qui l'a couverte, et l'a gardée du froid des neiges et des frimas,
de mille tentations durant sa vie et de confusion au jour de son décès.
« Filez, filez votre quenouille, lui écrivait le saint Prélat, non point
avec ces grands et gros fuseaux, car vos doigts ne les sauraient manier, mais
seulement selon votre portée, la patience, l'abjection, la douceur de cœur, la
résignation, la simplicité, la charité des pauvres malades, le support des
fâcheux. » Commençant tout de nouveau à filer la laine du divin Agneau,
notre Bienheureux Père lui permit aussi de manger plus souvent sa divine chair,
la faisant communier, dès cette année susdite, 1606, tous les jeudis, outre les
dimanches et fêtes commandées.
Les vendanges de cette année-là étant venues, notre sainte ménagère se
retira en son château de Bourbilly pour les faire faire. La dyssenterie se mit
presque par toutes les maisons de ce lieu-là. Notre brave vendangeuse remit le
soin de ses [91] vendanges à ses gens, ne se réservant quasi pour elle que
celui de cueillir le raisin cyprin, allant chercher ce cher Époux chez les
pauvres malades, étant la plus contente du monde, se voyant en liberté avec son
petit train de veuve. Jamais sœur de l'hôpital ne fut plus saintement
embesognée. Tous les matins, devant le lever de l'aurore, et après avoir fait
son heure d'oraison mentale, elle s'en allait porter par les maisons du village
ce qui était requis aux malades et nettoyer leurs immondices ; avant que
cela fût fait, il était temps d'ouïr messe, et de prendre un peu de réfection,
après laquelle elle allait servir et consoler les malades des maisons plus
écartées. Le soir venu, elle faisait derechef une visite des malades du
village, d'où étant revenue, elle oyait le récit que l'homme qui avait charge
de ses affaires lui faisait, ayant l'œil à tout ; et jamais ses dévotions
ne la rendirent moins vigilante à conserver et accroître les biens de ses
enfants. Il lui est arrivé souvent, en ce temps-là, qu'étant retirée le soir en
son oratoire, on la venait appeler pour assister des moribonds, et elle passait
une partie de la nuit à genoux proche de leurs lits, soit à dire des prières
pour eux, soit à les exhorter et servir. En sept semaines qu'elle demeura à
Bourbilly, ceux qui étaient avec elle ont assuré qu'il ne se passait jour qu'elle
ne lavât et ensevelit deux et quelquefois trois ou quatre corps morts ;
cette maladie les emportant fort promptement et en grand nombre.
L'esprit de cette sainte veuve était prompt, mais la chair faible et
infirme, et, succombant enfin sous le faix, après avoir bien servi les autres,
elle fut elle-même atteinte de la dyssenterie et d'une fièvre continue, et
malade en telle extrémité qu'elle crut de mourir de cette maladie ; dans
cette pensée, elle se força d'écrire à son beau-père, pour lui demander pardon,
et lui recommander ses orphelins. Le bon vieillard s'affligea si extrêmement de
cette nouvelle, et toute la famille fut si fort troublée de l'appréhension de
cette perte, que personne n'était [92] capable de consoler son compagnon ou sa
compagne ; car, bien que notre Bienheureuse Mère souffrît beaucoup en la
maison de son beau-père, ce n'était que par les menées et audaces d'une seule
personne ; tout le reste la regardait comme une sainte ; mais la
divine Providence est admirable de permettre qu'il y ait toujours quelque Sémeï
pour persécuter ceux qui sont selon son cœur.
Comme notre malade était une nuit dans la dernière extrémité de sa
maladie, il lui semblait qu'elle fût inspirée de faire un vœu à la sainte
Vierge, ce qu'elle fit ; et le matin se trouva saine et si parfaitement
guérie, que, mettant promptement ordre aux affaires qui lui restaient, elle
monta à cheval et s'en alla au grand pas à Montelon, pour ôter son beau-père de
peine, et consoler ses enfants qui n'avaient fait que pleurer depuis cette
triste nouvelle. Elle fut reçue avec une grande jubilation et comme une
personne ressuscitée.
En venant de Bourbilly à Montelon, elle avait trouvé une pauvre
demoiselle, laquelle, avec son fils déjà grandelet, allait demandant l'aumône
par le malheur de quelque désastre ; elle les emmena avec elle, et demanda
congé à son beau-père de les garder au logis, ce qu'il lui accordait quasi
toujours en semblable rencontre, bien que parfois ce fût avec des paroles
fâcheuses, selon l'assiette où la servante avait mis son esprit. Elle logea
cette pauvre demoiselle qui était sur le penchant du précipice de l'hérésie,
d'où elle la retira, et obtint encore de son beau-père de garder l'enfant à la
maison.
CHAPITRE XXI,
de son second voyage
en savoie, où notre bienheureux père lui donna résolution à quel genre de vie
dieu la destinait.
Quoique cette fidèle servante de Notre-Seigneur ne cessât de faire des
choses signalées pour le service de Dieu et du prochain, tout cela ne lui
semblait rien, si elle ne se donnait elle-même à Dieu, dans une vie toute
retirée et hors du monde ; et, parce que notre Bienheureux Père lui avait
commandé de ne penser qu'à vivre saintement dans sa condition viduale, elle eut
du scrupule de voir cette pensée et ce désir de la vie religieuse continuellement
en son esprit ; elle l'écrivit à notre Bienheureux Père, ajoutant ces
mots : « Mais, mon Père, pensez-vous pas que je quitte un jour, tout
à fait et tout à plat, toutes les choses de ce monde, pour suivre notre bon
Dieu : hé ! ne me le celez pas ; mais, au moins, laissez-moi
cette chère espérance. » Le Bienheureux lui fit réponse en ces
termes : « Vous trouvant plongée dans l'espérance d'entrer en
religion, vous avez eu peur d'avoir contrevenu à l'obéissance ; mais non,
je ne vous avais pas dit que vous n'en eussiez nulle espérance, ni nulle
pensée, mais que vous ne vous y amusassiez pas, n'y ayant rien qui nous empêche
tant de nous perfectionner en notre vocation que d'aspirer à une autre ;
les enfants d'Israël ne purent chanter en Babylone, parce qu'ils pensaient en
leur pays. Mais moi, je voudrais que nous chantassions partout ; je vois
votre désir d'être religieuse toujours plus grand. O doux Jésus ! que vous
dirai-je, ma très-chère fille ? Sa bonté [94] sait que j'ai souvent imploré sa grâce au
saint sacrifice et ailleurs, et, non-seulement cela, mais j'y ai employé la
dévotion et les prières des autres meilleurs que moi ; et qu'ai-je appris,
jusqu'à présent ? qu'un jour, ma fille, vous devez tout quitter ;
c'est-à-dire, afin que vous n'entendiez pas autrement que moi, j'ai appris que
je vous dois conseiller un jour de tout quitter ; je dit tout, mais que ce
soit pour entrer dans une religion, c'est grand cas ; il ne m'est point
encore arrivé d'en être d'avis, et ne vois rien devant mes yeux qui me convie à
le désirer ; et sachez qu'en cette enquête, je me suis tellement mis en
indifférence de ma propre inclination, pour chercher la volonté de Dieu, que
jamais je ne le fis si fort ; néanmoins, jamais le oui ne s'est pu
arrêter en mon cœur, et le non s'y trouve avec beaucoup de
fermeté ; néanmoins, la chose étant fort importante, donnez-moi du loisir
pour prier et faire prier, et encore faudra-t-il, avant que se résoudre, nous
parler à souhait. »
Notre Bienheureuse Mère, parlant en confiance sur le sujet de ces
paroles de notre saint Fondateur, dit : « L'espérance que ce
Bienheureux me donna, qu'un jour je quitterais le monde, me consola fort, et je
m'essayais de disposer mon cœur selon ses sacrés avis, au mieux qu'il m'était
possible, quoique mes tentations ne passassent point ; je demeurais comme
mon saint Conducteur m'avait enseigné, résignée ès mains de Dieu, lui offrant
souvent le reste de mes jours, et le suppliais qu'il les employât au genre de
vie qui lui serait plus agréable, ne laissant plus occuper mon esprit des
vaines promesses de tranquillité, de goût et de mérite de la vie
religieuse ; mais je tâchais de lui offrir mon cœur tout vide de toute
autre affection, que de son pur et chaste amour et d'obéir. »
Comme notre Bienheureux lui avait écrit qu'il fallait encore se voir,
avant que prendre une résolution finale, environ les [95] fêtes de Pentecôte,
de l'année 1607, elle se rendit à Annecy,[28] pour recevoir le Saint-Esprit par les mains
de ce grand et apostolique Pasteur, le Bienheureux François de Sales. Parlant
de ce voyage à une personne de confiance, elle dit : « J'allai
trouver ce Bienheureux Prélat avec la plus grande indifférence qui me fut
possible, sans aucun désir que d'embrasser fidèlement ce que Dieu m'ordonnerait
par son entremise, avec une ferme confiance que ce serait selon la divine
volonté, à laquelle seule j'avais toujours mon affection. J'arrivai vers ce
saint Père de mon âme quatre ou cinq jours avant la Pentecôte, pendant lequel
temps il me parla beaucoup, me fit rendre compte de tout ce qui s'était passé
et se passait en mon âme, sans rien me déclarer de ses desseins, mais seulement
me disait de bien prier Dieu, et me remettre entièrement entre ses bénites
mains ; ce que je tâchais de faire incessamment. »
Ce Bienheureux Père la laissa en cet état jusqu'au lendemain de la
Pentecôte, que voyant le vaisseau du cœur de cette vraie veuve vide dès si
longtemps de toutes autres affections que de celle d'être toute à Dieu, il le
voulut remplir de l'huile salutaire d'une douce consolation, et, l'ayant
retirée après la sainte messe, avec un visage grave et sérieux, et une façon de
personne tout engloutie en Dieu, il lui dit : « Hé bien ! ma
fille, je suis résolu de ce que je veux faire de vous. — Et moi, dit-elle,
Monseigneur et mon Père, je suis résolue d'obéir. » Sur cela, elle se mit
à genoux. Le Bienheureux l'y laissa, et se tint debout à deux pas d'elle :
« Oui-dà, lui répondit-il ; or sus, il faut entrer à Sainte-Claire. —
Mon Père, dit-elle, je suis [96] toute prête ; — Non, dit-il, vous n'êtes
pas assez robuste, il faut être sœur de l'hôpital de Beaune. — Tout ce qu'il
vous plaira. — Ce n'est pas encore ce que je veux, dit-il, il faut être
Carmélite. — Je suis prête d'obéir », répondit-elle. Ensuite il lui
proposa diverses autres conditions pour l'éprouver, et il trouva que c'était
une cire amollie par la chaleur divine, et disposée à recevoir toutes les
formes d'une vie religieuse telle qu'il lui plairait de lui imposer. Enfin, il
lui dit que ce n'était point en toutes ces manières de vie, dont il lui avait
parlé, que Dieu la voulait, et là-dessus lui déclara fort amplement le dessein
qu'il avait de notre cher Institut. « À cette proposition, dit notre
Bienheureuse Mère, je sentis soudain une grande correspondance intérieure, avec
une douce satisfaction et lumière, qui m'assurait que cela était la volonté de
Dieu, ce que je n'avais point senti aux autres propositions, quoique mon âme y
fût entièrement soumise. »
Or, notre Bienheureux Père était si ferme en ce dessein du commencement
de notre petite Congrégation, que sa résolution en était inébranlable, par la
certitude que Dieu lui avait donnée, que c'était le dessein et l'œuvre de sa
seule Majesté, et disait à notre Bienheureuse Mère et Fondatrice :
« Ma fille, courage ! toutes choses concourent à affermir ce projet
en mon âme ; j'y vois de grandes difficultés pour l'exécution, et n'y vois
goutte pour les démêler ; mais je m'assure que la divine Providence le
fera par des moyens inconnus aux créatures. »
Deux choses semblaient difficiles à ce saint Prélat par-dessus toutes
les autres ; l'une de déprendre notre Bienheureuse Mère de tant de mains
qui la tenaient arrêtée au monde, auprès d'un père et d'un beau-père, tous deux
fort âgés, et à la tutelle de quatre enfants fort jeunes ; l'autre, de
faire la première maison de l'Institut en cette ville d'Annecy, où Dieu lui
avait fait voir la source d'une fontaine d'eau douce, petite en son
commencement, mais qui produisit plusieurs beaux et grands ruisseaux. [97]
« Certes, dit notre Bienheureuse Mère, j'étais bien du sentiment
de notre saint Fondateur, qu'il y aurait de la difficulté de m'arracher d'entre
mes proches, mais je voyais une totale nécessité que cette nouvelle vigne,
étant plantée au terroir de l'Église, fût proche de son bienheureux plantateur,
afin que sa soigneuse main pût venir tous les jours en icelle planter et
arracher ce que le divin Père de famille lui ferait connaître pour le mieux, et
ce Bienheureux me dit un jour, en nous promenant ensemble dans sa salle :
Ma fille, plus je pense, et plus je suis ferme en cette résolution ; il
faut planter dans notre petit Annecy le germe de notre Congrégation, car ce
sera un arbre qui étendra ses branches par tout le monde ; il sera
très-bon que sa racine soit plantée bien bas entre nos montagnes. »
Ce saint Prélat avait des grands desseins pour cette œuvre, mais il en
laissait le soin à la céleste Providence, se tenant en paix et sans
empressement, attendant l'ordre que sa divine sagesse ordonnerait que l'on tînt
pour cela ; aussi y pourvut-elle par un expédient bien éloigné de la
prévoyance humaine, ainsi que nous allons voir au chapitre suivant.
CHAPITRE XXII.
proposition du
mariage de mademoiselle de chantal avec m. le baron de thorens, et de la mort
de la jeune sœur de notre bienheureux père.
Nos saints Fondateur et Fondatrice ne pensaient pas exécuter le dessein
de notre Institut au moins de six ou sept ans, à cause du bas âge des trois
filles de notre Bienheureuse Mère ; mais il arriva que le jour de la
Fête-Dieu, cette sainte veuve revenant de la procession du
Très-Saint-Sacrement, et se trouvant fort lasse, elle voulut monter en la
chambre où elle couchait, pour reprendre un peu d'haleine, attendant que notre
Bienheureux Père, qui avait porté le Saint-Sacrement par la ville, fût prêt
pour dîner : comme l'on vit qu'elle montait l'escalier, plusieurs
gentilshommes qui étaient là s'avancèrent pour lui aider ; elle les
remercia ; mais voyant que M. le baron de Thorens, frère de notre
Bienheureux Père, ne laissait pas de la suivre : « Vraiment, dit-elle
en souriant, je veux bien celui-ci pour mon partage. » Ce qu'elle dit tout
simplement sans aucune pensée ni dessein que l'agrément universel qu'elle avait
pour tous ceux qui appartenaient à notre Bienheureux Père. Néanmoins ces paroles
furent recueillies et rapportées à madame de Boisy, mère de notre Bienheureux
Père, laquelle pria instamment son saint fils de faire expliquer notre
Bienheureuse Mère, et entra dans une telle passion que le baron de Thorens, son
fils, épousât mademoiselle de Chantal, fille aînée de notre Bienheureuse Mère,
qu'elle ne donna cesse à notre Bienheureux Père qu'il [99] ne lui en eût porté
les paroles, et mit ordre qu'après le repas ils fussent laissés eux trois tous
seuls pour mettre le discours sur le tapis.
Notre Bienheureux Père avait de la répugnance de parler de telles
affaires ; mais d'éconduire sa bonne mère, c'eût été la mettre en
inquiétude ; il commença donc à dire sur quoi cette bonne dame avait bâti
ce puissant désir : « Jamais, dit notre Bienheureuse Mère, je ne me
trouvai en un tel étonnement qu'à cette proposition, se présentant d'abord à
mon esprit des difficultés impossibles à vaincre pour ce mariage. »
Néanmoins, elle ne fit point paraître son étonnement ; au contraire,
témoigna toute sorte de gratitude et de reconnaissance à la bonne dame de
Boisy, qui la voulut d'abord engager de paroles ; mais elle se tenait fort
humblement sur ses gardes, prévoyant combien il fâcherait aux deux grands-pères
de cette petite de la voir sortir de France.
Durant le séjour que notre sainte veuve faisait chez notre Bienheureux
Père, quantité de dames, filles spirituelles de ce Bienheureux, la venaient
visiter, et s'en retournaient pleines d'édification. D'autres y venaient par
curiosité, sachant que c'était une dame de qualité. Envers celles qui étaient
mondaines, elle se tenait avec plus de réserve, et parlait avec tant d'efficace
du malheur où conduit la mondanité, que plusieurs, au sortir de son entretien,
allaient se vêtir avec plus de décence et modestie, ce qu'elles ont toujours
fait depuis. D'autres ôtèrent leurs pendants d'oreilles, et de-puis,
non-seulement n'en portèrent plus, mais nous savons qu'il y en eut qui ne
permirent pas même depuis à leurs filles d'en porter, ni de se poudrer les
cheveux, ni même d'aller au bal, tant le discours de cette sainte veuve les
avait solidement et efficacement touchées.
Ce voyage ici fut plus long que les autres, et aussi plus utile et de
plus grande consolation, laquelle il fallait interrompre ; après l'octave
du Saint-Sacrement, notre Bienheureuse Mère [100] s'en retourna toute contente
de savoir à quelle vocation le ciel la destinait. Elle s'en était retournée
avec dessein de prendre au Puy d'Orbe la plus jeune sœur de notre Bienheureux
Père, qui y était ; mais il fallut attendre encore quelques mois, ne la
pouvant sitôt dégager ; ce qui fâchait bien madame de Boisy, laquelle
avait ardent désir que sa fille fût avec notre Bienheureuse Mère, où enfin elle
alla, et, après quelques mois de séjour, mourut. Cette jeune demoiselle était
grandement accomplie de corps et d'esprit ; c'était la première créature
que notre Bienheureux Père eût baptisée ; il était son père spirituel, et
l'aimait uniquement, disant qu'il espérait d'en faire quelque chose de bien bon
pour le service de Dieu, tout cela la rendait infiniment chère à notre
Bienheureuse Mère ; elle l'honorait comme sa sœur, et la chérissait comme
son propre enfant. Dieu, qui se plaît à mortifier pour vivifier, frappa la
jeune demoiselle d'une fièvre et d'une dyssenterie ; il serait superflu de
dire avec quel soin notre Bienheureuse Mère la fit servir, et la servit
elle-même, étant sa principale infirmière ; tous ses soins ne purent
reculer la jeune demoiselle du tombeau. Elle décéda le 8 octobre 1607, âgée
d'environ quinze ans.
Au même moment de ce décès, qui affligeait plus qu'il ne se peut dire
notre Bienheureuse Mère, Dieu lui inspira de faire vœu de donner une de ses
filles à la maison de Sales, à la place de la défunte, devant le corps de
laquelle se mettant à genoux, elle fit son vœu. « Pendant que je le
prononçai, dit-elle, la divine Bonté me consola, et m'y fit voir que de donner
une de mes filles à la maison de Sales, c'était le moyen que la Providence
avait choisi pour faciliter ma retraite en Savoie, et m'y servir de planche et
de prétexte. » Elle lava le corps innocent de cette jeune trépassée,
autant de l'eau de ses larmes que d'autres, et après lui avoir rendu les
derniers devoirs, elle avertit notre Bienheureux Père de ce décès ; et il
lui écrivit une très-belle lettre sur icelui ; entre autres choses, il
[101] la reprend de ce qu'elle avait offert à Dieu sa vie, et celle de
quelqu'un de ses enfants en échange de celle de la défunte : « Ma
fille, lui dit-il, il ne faut pas seulement agréer que Dieu nous frappe, mais
il faut acquiescer que ce soit sur l'endroit qu'il lui plaira. David offrait sa
vie pour celle de son Absalon ; mais c'est parce qu'il mourait
perdu ; je vous vois avec votre cœur vigoureux qui aime et qui veut
puissamment, et je lui en sais bon gré, car ces cœurs à demi morts, à quoi
sont-ils bons ? Il faut que vous fassiez toutes les semaines, une fois, un
exercice particulier d'aimer la volonté de Dieu plus que nulle autre chose, et
cela, non-seulement aux occasions supportables, mais aux plus insupportables. »
Dès que notre Bienheureuse Mère eut reçu cet avis, elle entreprit
l'exercice de l'amour à la volonté de Dieu, et avait écrit les paroles
suivantes sur son livret, pour les lire tous les jours, soir et matin :
« 0 Seigneur Jésus ! je ne veux plus de choix, » touchez quelle
corde de mon luth qu'il vous plaira, à jamais « et pour jamais il ne
sonnera que cette seule harmonie. Oui, "Seigneur Jésus ! sans si,
sans mais, sans exception, votre » volonté soit faite sur père, sur
enfants, sur toutes choses et » sur moi-même. » Or, comme elle avait
connu que c'était la volonté de Dieu qu'elle donnât une de ses filles à la
maison de Sales, elle ne différa guère à en donner ouverture à Messieurs ses
parents, et alla elle-même à Dijon pour dire finalement à Monsieur le président
son père, comme dans la douleur extrême qu'elle avait eue de la mort de
mademoiselle de Sales, elle avait fait vœu de donner une de ses filles à cette
maison-là. « Mon bon père, dit-elle, fut fort surpris de cette nouvelle,
et m'apporta beaucoup de raisons pour anéantir ma proposition ; néanmoins,
Dieu me fit la grâce de tenir si ferme sur le point de ma conscience qui était
engagée, qu'il s'y accorda, et pesa avec grand respect l'honneur et bonheur que
c'était à nos maisons, d'être alliées à notre Bienheureux Père, qu'il [102]
honorait comme un vrai homme de Dieu. » Cette prudente femme, pour mieux
nouer son affaire, fit tant qu'elle tira une lettre du président son père au
saint Prélat, par laquelle il lui témoignait combien il était content du vœu
qu'avait fait notre Bienheureuse Mère, ajoutant au bas de sa lettre ces
paroles : « Mais il faut que je confesse, Monseigneur, que jamais
d'autres forces que celles que Dieu a données à la baronne de Chantal, ma
fille, n'eussent su tirer cette petite de dessus mes genoux, d'entre mes bras,
ni de devant mes yeux. »
Quand M. le président Frémyot fut gagné, tout ne fut pas fait. Les
parents du côté paternel furent d'autant plus difficiles qu'ils n'avaient pas
si particulière connaissance de notre Bienheureux Père, et refusaient tout à
fait de mettre cette chère fille en Savoie, et de faire une alliance si loin.
Néanmoins, Dieu donna tant d'efficace aux paroles de sa fidèle servante, que
petit à petit avec une longue patience elle les gagna tous. Je dis avec une
longue patience, d'autant qu'il s'écoula près de deux ans à traiter ce
mariage ; il est vrai qu'elle attendait aussi que sa fille eût onze ans,
pour la faire épouser. Ce retardement était si pénible à madame de Boisy, que
notre Bienheureux Père écrivait une fois à notre Bienheureuse Mère :
« Je vous assure que ma mère est dans une telle impatience d'être mère
d'une fille que vous lui avez donnée, que les continuelles presses qu'elle m'en
fait, me bailleraient avec elle de l'inquiétude, si je ne me souvenais de
l'édifice auquel je travaille, qui est de bien établir mon âme dans une
constante paix ; Dieu m'est à témoin combien je désire cette belle-sœur,
et comme elle me sera chère ; non, je ne penserai point que ce soit ma
belle-sœur, elle me sera plus que sœur et plus que fille, mais pour cela se
faut-il empresser ? »
Au mois d'octobre 1608, notre Bienheureux Père et M. de Thorens
allèrent en Bourgogne pour voir mademoiselle de Chantal, et être vus des
parents qui, tous, furent ravis de joie de cette [103] alliance, et le mois de
février d'après, le contrat de mariage fut passé, ce qui donnait une grande
joie à notre Bienheureuse Mère ; mais Dieu qui voulait que toutes ces
douceurs fussent entremêlées de quelque amertume, permit qu'après ce bon succès
l'ennemi l'attaquât de violentes tentations, contre le choix que notre
Bienheureux Père avait fait de sa vocation. « O Dieu, dit-elle une fois,
que cette secousse me fut rude ! je n'y appliquais aucun remède que de
prendre la croix de Notre-Seigneur, et me disais à moi-même : Fille de peu
de foi, que crains-tu ? qu'appréhendes-tu ? Je marche sur les vents
et les flots, mais c'est avec Jésus-Christ. » Elle écrivit sa peine et son
remède à notre Bienheureux Père, qui lui fit réponse qu'elle ne craignit point,
que tandis qu'elle aurait ainsi la croix entre ses bras, l'ennemi était sous
ses pieds.
CHAPITRE XXIII.
de son troisième
voyage en savoie, et de ses résistances à s'engager au monde.
Il arrive souvent que, par la malice des méchants, la bonté des justes
est plus clairement reconnue. La servante qui tenait le dessus chez le
beau-père de notre Bienheureuse, envenimée de ce qu'elle mariait sa fille aînée
si jeune, parce qu'elle n'avait pu tenir la promesse qu'elle avait faite à un
gentilhomme du pays, de le favoriser auprès du grand-père, et que le contrat
était passé avec M. de Thorens, pour se venger, renversa tellement l'esprit du
bon vieillard contre sa sainte belle-fille, par des faux rapports, qu'il envoya
un homme exprès à Dijon, pour faire ses plaintes à Monsieur le président, son
père, lequel ayant écrit à cette chère fille les plaintes que l'on faisait
d'elle, elle crut être obligée de lui découvrir quelque chose de ce qu'elle
souffrait là dedans depuis environ sept ans. Le bon président en fut tellement
touché, et ravi de la vertu de sa fille qui ne lui avait jamais donné le
moindre signe de sa longue souffrance, qu'il en passa la nuit sans dormir, et
dès l'aube du jour lui envoya un homme exprès avec une lettre la plus
amoureusement paternelle qu'il était possible, tant pour la blâmer de lui avoir
celé ses douleurs, que pour lui dire qu'absolument il voulait la retirer de là,
dont elle s'excusa modestement, mais prit toutefois cette occasion favorable
pour obtenir ses permissions, tant de ce bon père que de son beau-père, pour
venir passer à Annecy le carême qui était tout proche, prenant pour prétexte
l'ardent désir que madame de Boisy avait [105] de voir sa fille promise au
baron de Thorens ; mais il est vrai que sa principale intention était de
venir conclure le temps de notre établissement, et ouïr les sermons de notre
Bienheureux Père, qui prêchait le carême à son cher peuple d'Annecy.
Elle arriva donc en cette ville, la première semaine de carême 1609,
amenant avec elle sa fille aînée promise au baron de Thorens, et sa
seconde ; on les trouvait si aimables, si bien nourries et si modestes,
que l'on se pressait dans les églises et dans les maisons pour les voir.
Surtout la bonne dame de Boisy était si embesognée de sa belle-fille prétendue,
qu'elle eût voulu la garder dès lors, mais il n'était pas expédient. Le séjour
du carême que notre Bienheureuse Mère fit dans cette ville d'Annecy, la mit en
grande réputation, et fut très-utile aux dames, filles spirituelles de notre
Bienheureux Père. Elle assistait assidûment à tous les offices de la
cathédrale, et eût voulu, comme une autre sainte Monique, être toujours dans
l'église de ce grand et doux Ambroise de ce siècle. De dire qu'elle ne perdait
point de ses sermons publics, ni des exhortations particulières, ce serait
chose superflue ; de même, elle était assidue aux exercices, stations et
autres dévotions de toutes les confréries de la ville, qui sont en fort grand
nombre. Le Jeudi saint, elle se vêtit de blanc, et le visage voilé comme les
autres sœurs pénitentes de la Sainte-Croix, et assista à la procession générale
qui se fait par toutes les églises de la ville, pour visiter le Saint-Sacrement
qui y est exposé. Elle se commence sur les dix heures du soir, après un sermon.
La sainte veuve, pour suivre le Sauveur en cette nuit douloureuse, avec peine
aussi bien qu'avec dévotion, en mettant son habit de pénitence, se mit
secrètement nu-pieds, et alla comme cela par toute la ville. Le lendemain, elle
reconfirma ses vœux entre les mains de notre Bienheureux Père, et écrivit sa
reconfirmation en cette sorte : « Ce jour de la mort de mon Sauveur,
1609, je renouvelle mes vœux avec une nouvelle et toute incomparable affection,
voulant pour jamais mourir à [106] moi-même et à toutes choses, pour vivre en l'obéissance
de la divine volonté, à laquelle je me consacre absolument et sans réserve,
pour lui obéir en la personne de Monseigneur de Genève, mon très-bon Père
spirituel ; ainsi mon Sauveur m'aide de sa grâce, et me reçoive, comme de
tout mon cœur je me donne à lui. Amen. Jeanne-Françoise Frémyot. »
Les fêtes étant passées, et le saint Pasteur ayant donné à son peuple
le bouquet de dévotion, la sainte veuve le mit au vase de son cœur, et toutes
les résolutions finales étant prises, tant pour le mariage de mademoiselle de
Chantal, que pour notre établissement, il fallut reprendre le chemin de
Bourgogne, et dire le dernier adieu à la bonne dame de Boisy, laquelle mourut
quelque temps après, avant que le mariage qu'elle avait tant souhaité fût fait.
Notre Bienheureuse Mère arrivant à Dijon, fut reçue avec une joie
nonpareille du président son bon père, lequel, honorant notre saint Fondateur
comme un saint, ne se pouvait lasser d'en ouïr parler et lui écrivait ces
mots : « C'est ma délicieuse suavité de m'entretenir avec ma fille de
Chantal, car elle ne nourrit mon âme que du miel céleste qu'elle a cueilli
auprès de vous. » Elle séjourna quelques mois à Dijon avec un tel éclat de
vertu, que sa conversation en attirait plusieurs à la vie dévote ; elle ne
se mêlait d'aucune affaire temporelle que de celles de ses enfants et de celles
des pauvres gens du village, desquels elle était la solliciteuse ; et
avait d'ordinaire avec elle quelques sacs de papiers de ces bons villageois,
pour faire consulter au bon président son père, ce qu'il faisait avec grande
bénignité. Elle ne jouit pas longtemps de la tranquillité auprès de ce bon
père, car tous les parents et d'elle et de feu son mari commencèrent derechef à
la solliciter importunément d'épouser un gentilhomme, auquel elle avait donné
cent et cent fois congé, et qui, appuyé de l'autorité des parents, faisait ses
recherches avec une nouvelle contention. Il était grand seigneur, extrêmement
riche, et était veuf, [107] l'on proposait de faire des mariages entre ses enfants
et ceux de notre Bienheureuse Mère, qui eussent mis sa maison dans une opulente
richesse.
Ceux auxquels l'or et la pompe mondaine éblouissaient les yeux, voyant
que cette chaste veuve refusait tout à fait ces propositions, et qu'elle les
assurait qu'elle avait juré un divorce éternel avec le monde, la blâmaient
hautement comme indiscrète et sans naturel pour ses enfants, ajoutant d'autres
calomnies si malicieuses, que je n'en ose noircir ce papier, et que notre
généreuse veuve méprisa avec humilité. Elle écrivit à notre Bienheureux Père la
persécution qu'elle supportait, et il lui fit réponse : « O ma fille,
qui sont ces téméraires qui veulent rompre et briser cette blanche colonne,
l'amour à la viduité ? ne craignent-ils point les Chérubins qui la tiennent
deçà et delà, comme sous l'ombre de leurs ailes ? Hélas ! l'on me
tourmente, me dites-vous, pour donner du contentement à mon bon Père. Or sus,
laissez faire, et vous verrez que Dieu gardera bien le père sans perdre la
fille ; vraiment, c'est bien dit ; sainte Agathe, sainte Thècle,
sainte Agnès, ont souffert la mort plutôt que de perdre le lis de leur
chasteté ; et l'on nous veut étonner avec des fantômes, mais tout cela
n'est rien à votre ferme courage. »
Cette Bienheureuse Mère, parlant de ce temps-là, dit les paroles
suivantes : « Voyant ce bon seigneur si opiniâtre en ses désirs, je
souffrais un martyre, parce qu'il était grand ami de mon père qui s'offensait
du moindre rebut que je lui faisais ; j'eusse bien voulu être chez mon
beau-père ; toutes les petites persécutions que j'y avais souffertes me
semblaient des roses auprès de ces épines. Tant que je pouvais, je me tenais
serrée à l'arbre de la sainte Croix, crainte que tant de voix charmeresses ne
fissent endormir mon cœur en quelques complaisances mondaines. »
Il y avait près de huit ans que l'ennemi était, avec mille [108]
malicieuses tentations, à tenir le siège devant cette ferme tour de David. Mais
en ce rencontre, se sentant fortifié par les ennemis domestiques, les parents,
qu'il semblait avoir attirés à son secours, il redoubla tellement ses assauts
et ses furieuses tentations, qu'il semblait au pauvre cœur de cette sainte
veuve qu'elle allait être déconfite en cette rude guerre ; mais comme une
généreuse Sulamite, voulant donner la fuite à son ennemi et le dernier choc au
monde, elle éleva un merveilleux signe au donjon de sa forteresse. Ce fut que,
de sa propre main, elle grava le saint nom de Jésus sur son cœur.[29] Nous ne savons pas avec quel instrument,
mais la couture y est demeurée toute sa vie, de l'épaisseur d'un teston, et
cela si profondément, qu'elle ne pouvait étancher le sang qui sortait de cette
heureuse plaie, plaie d'un amour vraiment solide et fidèle s'il en fut
jamais ; du sang qui sortait de cette amoureuse plaie, elle en écrivit des
nouveaux vœux et promesses à Dieu, se consacrant uniquement à l'unique amour de
sa Majesté.[30]
Cet ancien affligé et tenté demandait que ses paroles fussent sur une
lame de plomb ; mais cette généreuse veuve, au fort de ses plus âpres
tentations, écrivit sur sa propre chair le nom de son unique amour, Jésus, et son cœur, cacheté de ce divin
sceau, se trouva avec des forces toutes nouvelles pour résister aux furies du
monde et de l'enfer. [109]
Notre Bienheureux Père lui écrivait souvent, et lui disait entre autres
choses, sur l'occasion des importunités du monde : « O ma
fille ! la petite sorte de vie que nous avons choisie me semble tous les
jours plus désirable, et que Notre-Seigneur en sera grandement servi ! Je
vois bien toujours de grandes difficultés, mais, croyant que Dieu le veut, cela
ne me donne aucune crainte. Non, que le monde fasse toutes ses recherches et
ses efforts tant qu'il lui plaira, je ne suis plus en peine de vous, je vous ai
une bonne fois enfantée, comme Bala sur les genoux de la belle Rachel notre
Dame ; elle vous a prise à soi : pour moi, je n'en ai plus le soin
principal. »
CHAPITRE XXIV.
comme elle déclara sa
résolution de quitter le monde au président son père.
Cette fidèle Israélite n'aspirait qu'à sortir hors de l'Égypte du monde
qui la tyrannisait sans cesse ; elle allait tous les jours, épiant l'heure
commode de pouvoir parler seule à monsieur le président son père, pour lui
déclarer son dessein. Le glorieux saint Jean lui en fournit l'occasion le jour
de sa fête, chacun étant aller voir les fanfares et feux de joie qui se font ce
jour-là : « Quand je vis mon bon père seul, dit-elle, il me semblait
d'entrer dans la torture que d'entrer dans sa chambre, sachant bien dans quelle
douleur le mettrait la chose que j'avais à lui proposer ; je me mis à
genoux, et invoquai de grand cœur le secours divin. »
Elle alla, préparant de loin en loin, disposant l'esprit de ce bon
père, lui disant premièrement : « Qu'il lui fâchait fort d'élever ses
filles chez son beau-père, parce que cette maison n'était pas conduite comme
elle eût désiré. » Le sage président prit promptement la parole, lui
disant : « Que cela ne la devait point mettre en peine ; que son
aînée, dès qu'elle serait épousée au baron de Thorens, on ne pouvait dénier de
la donner à madame de Boisy, qui la désirait si fortement ; les deux
cadettes, qu'il était temps de les mettre chez les Ursulines, et préparer un
cloître pour leurs cœurs, si Dieu disposait leurs cœurs pour un cloître ;
que quant au baron de Chantal son fils, il s'en était déjà chargé. »
« La céleste [111] Providence, dit notre Bienheureuse Mère, ayant fait
ainsi parler mon bon père, je lui dis avec grand battement de cœur :
Monsieur, mon très-bon père, ne trouvez pas mauvais si je vous dis que par
cette bonne disposition je me vois libre poursuivre la divine vocation de Dieu
qui m'appelle, il y a longtemps, à me retirer du monde, et à me consacrer
entièrement au divin service. »
Le vénérable vieillard, qui excédait l'âge de soixante et onze ans,
n'eut pas sitôt ouï cette nouvelle, qu'il se mit à pleurer si chaudement, et à
faire des remontrances si paternellement tendres à sa chère fille, que si Dieu
n'eût affermi son courage, il l'eût sans doute amolli, et, comme elle dit
elle-même, la douleur de ce cher père lui était un martyre, et, pour apaiser sa
douleur, elle lui dit « que c'était une inspiration qu'elle lui
communiquait, comme à son bon père, en parfaite confiance ; qu'il n'y
avait encore rien de fait, mais qu'elle avait cru être obligée en conscience de
manifester, à ceux qui la pouvaient mieux conseiller, les choses esquelles elle
se sentait inspirée. » Cela satisfit et accoisa un peu ce cher père ;
ce que voyant, elle ajouta qu'elle avait déjà conféré avec Monseigneur de
Genève de cette inspiration, et qu'il lui avait dit qu'elle était d'en haut, et
qu'il fallait, en fait de véritable inspiration, prendre garde à la conscience.
À cela, ce bon père se ramassa un peu auprès de Notre-Seigneur, puis il dit à
sa chère fille : « Il faut confesser que Monseigneur de Genève a
l'esprit de Dieu ; d'une chose je vous prie, que vous ne résolviez rien
avec lui que je ne lui aie parlé. » Elle le lui promit, et de plus,
qu'elle avait telle confiance en Dieu que, dès que sa volonté leur serait
connue, qu'elle s'arrêterait plus à ce que Monseigneur de Genève et lui en
ordonneraient, qu'à ses propres sentiments auxquels elle n'avait point
d'attache ; cette démission ravit d'aise ce bon père, et ils demeurèrent
aussi satisfaits que devant. La sainte veuve était toutefois bien joyeuse
d'avoir donné ce premier coup, [112]
après lequel elle disposa de son
retour à Montelon, vers son beau-père, où, dès qu'elle fut arrivée, sans faire
semblant de rien, elle se mit à gagner, par une sainte et charitable prudence,
ceux qu'elle prévoyait qui s'opposeraient le plus à sa retraite, et à mettre
ordre à toutes ses affaires ; et l'on ne pourrait bonnement s'imaginer le
soin et le travail qu'elle prit en ces neuf ans qu'elle fut au monde, depuis
son veuvage, à calmer les procès, payer les dettes, et éclaircir le bien de ses
enfants. Elle avait souvent avec elle des prétendantes des carmélites, et
singulièrement depuis l'année 1607, notre très-honorée Sœur et Mère,
Jeanne-Charlotte de Bréchard, demeurait assez souvent avec elle. Depuis son
retour de ce dernier voyage de Savoie, toutes ses filles dévotes et elle
s'accoutumaient ensemble aux exercices religieux, comme silence, psalmodie et
semblables. Elle faisait prier de toutes parts, afin qu'il plût à
Notre-Seigneur de disposer messieurs ses parents d'agréer sa retraite, et,
sachant que Monsieur le président son père et Monseigneur l'archevêque de
Bourges, son frère, allaient passer les vacances à Totes, qui est une de leurs
seigneuries en l'Auxois, elle les y alla trouver. Monseigneur de Bourges, qui
l'aimait uniquement, lui dit sans préface, que jamais au grand jamais, elle ne
devait penser à se retirer d'avec eux ; Monsieur le Président son père
l'entretint plus à loisir, et avec des tendresses paternelles incomparables,
lui dit « qu'il avait beaucoup ruminé la proposition qu'elle lui avait
faite ; que, pour conclusion, il lui disait qu'elle ne devait point penser
à d'autre vie plus retirée que celle qu'elle faisait, et qu'elle était obligée
de se contenter de la liberté qu'on lui laissait de vivre tant dévotement qu'il
lui plairait dans sa condition viduale. » Elle écouta toutes ces raisons
sans faire de l'étonnée ni de la pressante, disant seulement à ce cher père,
avec une humble soumission, qu'elle ne cherchait en tout cela qu'à obéir ;
qu'elle ne pouvait moins faire que d'exposer ses inspirations à ceux qui en
devaient juger et lui aider à les suivre. [113]
Cette Bienheureuse Mère, parlant un jour de ceci, dit les paroles
suivantes : « L'amour que mon si bon père me portait, me livrait de
grands assauts, et le soin où je le voyais de m'éprouver par des raisons de
l'Écriture qu'il ajustait à son désir, me travaillait fort, et cela fut cause
que de plus grande affection je priais Notre-Seigneur, et, un matin, il plut à
sa bonté de me faire connaître, par une lumière surnaturelle, que la malice du
diable se servait beaucoup de la bonté paternelle, et se mêlait bien avant dans
ce jeu, donnant à mon père des tendresses sensibles et des paroles affectives
pour moi, plus qu'il n'en avait jamais eu ; et à moi de même, de grandes
tendretés d'amour pour mon père et pour mes enfants. En même temps, ce bon Dieu
me donna pour armes défensives ces paroles : Si je plaisais aux hommes,
je ne serais » pas servante de Jésus-Christ ; or, plutôt
que de ne pas servir Jésus-Christ, j'eusse voulu perdre le ciel, la terre, les
hommes, les Anges, moi-même et toutes choses, tant je voulais ardemment Dieu,
en ma partie supérieure, et ce désir de Dieu et de sa volonté tenait mon âme de
si près, que je ne pouvais plus dissimuler. Mon père, s'en apercevant bien,
commanda à Monseigneur de Bourges de me divertir de mes desseins, ce qu'il
entreprit de bon cœur ; mais, comme j'osais lui parler en sœur et non en
fille, je lui dis nettement que je ne pouvais pas trahir mon âme, lui faisant
accroire que c'était imagination, ce que je sentais bien venir vraiment de
Dieu ; que je ne pouvais pas prendre la voix du Pasteur pour celle du
mercenaire ; qu'enfin, je ne cherchais que la volonté de Dieu ; que,
quoique je désirasse ma retraite, si Monseigneur de Genève m'ordonnait de
demeurer au monde dans ma condition viduale, je le ferais ; voire même,
s'il me commandait de me planter sur une colonne, pour le reste de mes jours,
comme saint Siméon Stylite, je serais contente ; que je ne cherchais ni
condition, ni genre de vie, mais [114] l'obéissance à la volonté de
Dieu. » Cette manière de parler toucha fort le bon Monseigneur de
Bourges ; il en fit le récit à mon père, qui en entra aussi en
considération, et ne me parlèrent plus sur ce sujet-là, ni l'un ni l'autre, ni
moi à eux ; chacun, de son côté, attendait notre Bienheureux Père qui
devait bientôt arriver.
CHAPITRE XXV.
comme notre
bienheureux père bénit le mariage de m. le baron de thorens et de mademoiselle
de chantal, et tira le consentement des parents de notre bienheureuse mère,
pour sa retraite.
Le 13 octobre 1609, l'assemblée des parents s'étant faite à Montelon,
où notre Bienheureux Père était venu, il bénit le lien conjugal de M. le baron
de Thorens, son frère, avec mademoiselle de Chantal, laquelle n'était âgée que
de onze à douze ans. Sa bonne mère, qui brûlait de désir de prendre un époux
qui fût de condition immortelle, procura que, le surlendemain des noces, notre
Bienheureux Père, M. Frémyot et Monseigneur de Bourges fussent laissés seuls,
afin qu'ils conférassent sur le sujet de sa retraite ; ce qu'ils tirent
fort longuement et durant tout ce temps-là, elle était en oraison, priant Dieu
à chaudes larmes, qu'il lui plût rendre les cœurs de son père et de son frère
susceptibles des saintes raisons que notre Bienheureux Père leur dirait, et sa
prière fut exaucée. Après leur longue conférence, ils la firent appeler ;
elle alla avec un courage très-grand comparaître devant ses juges, qui devaient
donner la sentence définitive de l'emploi du reste de ses jours. MM. Frémyot et
de Bourges lui firent quantité d'interrogats et remontrances, à quoi elle
répondit et les satisfit avec une si sainte résolution, qu'ils virent bien que
cette juste ne pouvait être ébranlée éternellement, et que sa bouche parlait la
sapience ; elle leur dit, entre autres choses : « Que lorsque,
comme elle, ils ne [116] regarderaient que Dieu seul, ils trouveraient des
abîmes de raisons pour approuver son dessein, » et leur fit ensuite un
récit fort ample des attraits que Dieu lui avait donnés pour ce sujet, et comme
elle s'y était gouvernée depuis le premier jour de sa viduité. Durant tout ce
discours, notre Bienheureux Père ne dit pas une parole, mais admirait la
sagesse et générosité de cette sainte femme, laquelle après avoir satisfait à
tout ce que l'on lui objecta, fit un narré de l'état auquel elle avait mis le
bien de ses enfants, et comme elle les laisserait sans procès, sans
brouilleries et sans dettes, et que de plus sa fille était mariée depuis deux
jours. Monsieur le président son père, oyant cela, ne se put tenir de
dire : « Cette femme a considéré tous les sentiers de sa maison, et
n'a point mangé son pain en oisiveté. » Monseigneur de Bourges ne savait
que répliquer ; tous deux conclurent que c'était une œuvre de Dieu, et ne
dirent plus aucune parole de résistance. Notre Bienheureux Père, qui était bien
aise de voir les effets de la grâce dans les cœurs de ce bon père et de ce bon
frère, qui se rangeaient aux volontés de Dieu, ne sonnait mot, se tenant fort
recueilli en soi-même, tandis qu'ils parlaient entre eux.
Il restait une difficulté que l'on n'avait point encore mise sur le
tapis, et qui n'était pas des moindres, à savoir en quel lieu et en quelle
ville cette sainte veuve commencerait sa Congrégation. M. Frémyot voulait que
ce fût à Dijon, Monseigneur de Bourges souhaitait que ce fût à Autun, pour être
plus proche du bien de ses enfants, ou en sa ville de Bourges ; et certes,
ce fut ici où Notre-Seigneur assista sa servante ; car, prenant la parole,
elle leur dit : « Que voyant sa petite baronne si jeunette, elle
pensait être obligée de faire sa retraite auprès d'elle, c'est-à-dire, à
Annecy ; que sa présence lui était nécessaire pour l'acheminer à la
conduite qu'elle devait tenir en sa condition et en son ménage ; qu'au
reste, la sorte de vie qu'elle embrassait, lui lairrait pour quelque temps
assez de liberté pour [117] avoir un soin général du bien de ses enfants, et
qu'outre cela, elle élèverait ses deux jeunes filles proche d'elle. » M. Frémyot
et Monseigneur de Bourges témoignèrent d'agréer fort cette proposition. Notre
Bienheureux Père, se voyant en si beau chemin, leur fit un petit récit de tout
le projet de notre Congrégation, leur promettant que, pour quelques années,
celle qu'il offrait à Dieu, pour être la première Mère de cette petite
Congrégation, pourrait faire quelques voyages en Bourgogne, s'il était
nécessaire, pour le bien de ses enfants. Cela les ravit d'aise, et voyant que
le saint Prélat suivait les traces de Notre-Seigneur et disposait toutes
choses, non-seulement avec une généreuse force, mais aussi avec une débonnaire
suavité, ils donnèrent un absolu consentement à ses propositions, et se
séparèrent bénissant Dieu d'une si sainte entreprise.
Le lendemain de cette heureuse conclusion, notre Bienheureuse Mère
voulant battre le fer tandis qu'il était chaud, supplia qu'on lui préfigeàt le
temps de l'exécution de ses désirs ; il fut jugé que de là à six semaines
ou deux mois, elle pourrait se retirer, tant ses affaires étaient toutes en bon
ordre ; ce qui la consola plus qu'il ne se peut dire. Elle pria Monsieur
le président son père d'en porter la parole à M. de Chantal son
beau-père ; ce qu'il fit. Ce bon vieillard, qui excédait l'âge de
quatre-vingt et tant d'années, se mit à faire des cris et des lamentations
accompagnées d'une si grande abondance de larmes, que M. Frémyot en fut touché,
et alla dire à sa fille qu'absolument il fallait retarder sa retraite pour un
an ou deux ; qu'il ne pouvait souffrir qu'elle affligeât de la sorte ce vénérable
gentilhomme. Elle lui répondit : « Mon cher père, les résolutions
prises pour le service de la gloire de Dieu ne peuvent souffrir du
dilayment ; je prendrai soin de gagner mon beau-père, » ce qu'elle
fit fort sagement et heureusement. Le dimanche étant venu, elle mit ordre que
tous ceux de la maison, et une partie des sujets, se confessassent vers notre
Bienheureux Père, et communiassent de sa main [118] procurant qu'il dît la
messe paroissiale, à la fin de laquelle elle le pria de faire une exhortation à
tout ce bon peuple ; ce qu'il fît, et il en réussit la conversion
véritable d'un jeune débauché que l'on tenait pour athée, lequel depuis se fit
capucin. Ce même jour, notre très-honorée Sœur et Mère Jeanne-Charlotte de
Bréchard, voisine de notre Bienheureuse Mère, et marraine de sa dernière fille,
conféra avec notre Bienheureux Père, des grands désirs qu'elle avait d'être
religieuse, comme elle n'avait pu entrer aux carmélites ; lui disant
ensuite deux songes fort mystérieux qu'elle avait faits, dès lesquels le saint
Pasteur connut que Dieu lui avait montré une idée de la Congrégation qu'il
voulait ériger ; c'est pourquoi il lui dit, après l'avoir confessée :
« Ma fille, serez-vous contente de courir même fortune que madame de Chantal ?
Elle lui répondit, toute ravie de joie, que c'était son plus grand
désir » ; dès lors, le Bienheureux la prit pour sa fille, lui donna
sa place, et notre chère Fondatrice ne la regarda plus que comme la compagne de
son bonheur.
Notre Bienheureux Père, partant de Montelon pour s'en retourner en
Savoie, ne recommanda rien à notre Bienheureuse Mère, sinon la parfaite
humilité ; lui disant que, comme la première pierre fondamentale de ce
nouvel édifice, il voulait qu'elle fût si profondément basse et humble, que par
ce moyen d'humilité tout l'édifice s'élevât en une très-sainte grandeur et dans
une fermeté plus durable que les siècles ; lui répétant plusieurs fois
qu'il voulait qu'elle s'offrît à Dieu pour la plus petite de toutes les
conditions de l'Église, sans prétention que de glorifier Dieu par l'humilité.
CHAPITRE XXVI.
comme dieu appela nos
premières mères et sœurs pour commencer l'institut, et de quelques autres
points notables sur ce sujet.
Il semble que Notre-Seigneur voulut faire en quelque façon, pour le
commencement de notre petit Institut, comme pour le commencement de la
très-illustre et sainte Compagnie de Jésus, choisissant des sujets en diverses
contrées pour les unir en même prétention et manière de vie, et pour n'avoir
qu'une âme et un cœur en Dieu.
La première fille que Dieu destina pour notre Congrégation, après notre
Bienheureuse Mère Fondatrice, fut notre honorée Sœur et Mère Marie-Jacqueline
Favre, laquelle dansant à Chambéry, au milieu d'un grand bal, où toute
l'assistance avait les yeux sur elle, Dieu la regarda si favorablement, qu'il
lui fit voir efficacement la vanité de son action, et la confusion
qu'elle en aurait à l'heure de la mort. Elle eut prou peine à tenir contenance
le reste du bal, et détournant ses yeux de cette vanité, son cœur fit de cette
salle de bal un lieu d'oraison, et retirée en son intérieur, détesta le monde,
et fit vœu à Dieu de s'en retirer, et étant de retour à Annecy, se mit sous la
conduite de notre Bienheureux Père, lui laissant faire le choix de la manière
de vie à laquelle elle devait servir Notre-Seigneur le reste de ses jours.
Tandis que la céleste Providence disposait celle-ci en Savoie, elle en
appelait une autre en France pour lui être compagne, ce fut notre très-honorée
Sœur et Mère Jeanne-Charlotte de [120] Bréchard, demoiselle de bon lieu, à
laquelle Dieu montra, ainsi que nous avons dit au petit recueil de sa vie, un
crayon de l'Institut ; entre autres, elle vit au coin de l'autel d'une
petite chapelle notre Bienheureuse Fondatrice, chantant les louanges de Dieu,
sur un air et avec des cérémonies extraordinaires ; car il lui semblait
qu'elle sonnait d'une trompette, ou cornet de chasse, pour assembler des filles
de toutes parts, et que se tournant vers elle, elle lui dit : « En
voulez vous être ? » elle lui dit que oui ; sur quoi elle lui
mit en main une branche de fleur bleue, qui fut la parole fidèle qu'elle
l'acceptait, pour être de la Congrégation.
Notre chère Mère Jeanne-Charlotte était en Bourgogne, et notre
très-honorée Mère Péronne-Marie de Châtel, demoiselle savoisienne était en
Allemagne, où elle reçut une vocation du ciel toute particulière, ainsi qu'il
est dit au recueil de sa vie, et où elle donna à la Sainte Vierge, dans la
célèbre chapelle de Notre-Dame-des-Ermites, une bague qui lui était fort chère,
afin qu'elle l'épousât avec son divin Fils, en quelque Congrégation qui fût
toute dédiée à cette sainte Mère de Dieu. Après celle-ci, notre très-chère Sœur
Marie-Adrienne Fichet, demoiselle du Faucigny (Savoie), fut disposée de Dieu à
notre manière de vie, aussi par un appel tout particulier. Dieu lui fît voir
trois étoiles, dont celle qui faisait le dessus du triangle était beaucoup plus
grosse et éclatante que les deux autres, et toutes trois étaient arrêtées sur
la ville d'Annecy, d'où il lui semblait de voir un chemin tout étoilé qui
venait jusqu'à elle, pour la convier de se joindre à celles qui étaient
arrêtées sur la ville d'Annecy. Dès qu'elle ouït parler du commencement de
notre Congrégation, elle connut que c'était ce que Dieu lui avait fait voir et
où il voulait être servi d'elle.
Notre très-honorée Mère Marie-Aimée de Blonay était au Chablais, où
plus de deux ans avant le commencement de notre Congrégation, elle découvrit à
notre Bienheureux Père que Dieu [121] l'attirait à être religieuse, et comme
elle ne connaissait point d'autre religion réformée que Sainte-Claire, elle y
aspirait ; mais notre Bienheureux Père lui défendit d'en parler à personne
du monde, à quoi elle obéit. Et ce Bienheureux écrivit, de là à quelque temps,
à notre Bienheureuse Mère, « que mademoiselle Favre était toute prête pour
son dessein, et qu'étant au Chablais, mademoiselle de Blonay lui avait dit
qu'elle aspirait à Sainte-Claire, mais que Dieu l'avait marquée pour être de la
Congrégation. Je lui ai dit de me laisser gouverner son secret, et je me veux
rendre bien soigneux de servir cette âme en son inspiration ; Dieu m'a
donné quelques mouvements particuliers là-dessus. Je tiens déjà cette fille
pour vôtre et pour mienne. » En un autre billet, il disait :
« Il est tout vrai que Dieu nous a donné la fille de M. de Blonay ;
vous verrez que vous l'aimerez quand vous la verrez ; je serais le plus
trompé du monde, ou Dieu la dispose à quelque chose de bien grand, et de bien
bon selon notre dessein. »
Au commencement de l'année 1610, ce Bienheureux sachant que la
Congrégation se devait commencer, il en avertit notre très-honorée Mère de
Blonay, lui promettant et assurant sa place, mais elle fut retardée par le
décès de Monsieur son frère. La Providence céleste eut soin, jusqu'à disposer à
l'avantage une tourière pour ce commencement. Ce fut notre très-bonne Sœur
Anne-Jacqueline Coste, sainte paysanne qui servait en cette ville, et comme
notre Bienheureux Père était également à toutes ses brebis, il était le
confesseur de cette dévote servante, laquelle lui découvrit que depuis
plusieurs années elle était inspirée de servir à quelque maison
religieuse ; notre Bienheureux Père en fut extrêmement aise, et l'écrivit
tout joyeux à notre Bienheureuse Mère que Dieu leur envoyait une Sœur servante
qui était une vraie sainte, et ce débonnaire Pasteur prenait un soin
extraordinaire de l'instruction de cette bonne fille.
Ce fut une providence de Notre-Seigneur qui permit que le [122] temps
que l'on avait destiné pour le commencement de la Congrégation fût retardé, car
l'on croyait commencer à Noël de l'année 1609, et M. Frémyot obtint que ce fût
seulement au printemps de l'année suivante 1610. Ce retardement fut cause que
le dessein de la Congrégation se divulgua extrêmement en France et en Savoie,
chacun en parlait selon sa fantaisie ; les bons le louaient et
approuvaient, et Dieu en donna des connaissances surnaturelles à quelques bons
serviteurs de sa Majesté, entre autres, au révérend Père Jacques de Bonivard,
jésuite, homme de sainte vie, lequel avait la grâce de voir son bon Ange, et
celle d'être lié d'un étroit lien de sainte amitié avec notre Bienheureux Père,
lequel lui disant qu'il avait quelques bonnes âmes entre les mains pour les
employer au service de Dieu, ce bon Père lui répondit, comme si déjà il eût su
tout ce que le saint Prélat devait faire. Les révérends Pères de Villars et
Fournier, tous deux de la sainte Compagnie de Jésus, avaient aussi de grands
sentiments de cette œuvre. De même, une carmélite (la Mère de la Trinité), que
l'on tient maintenant pour sainte, eut des vues particulières de Dieu, du
commencement de notre Congrégation, plus de quatre ans avant notre
établissement. Notre Bienheureuse Mère lui ayant dit qu'il lui venait souvent
des envies d'être carmélite, elle lui répondit : « Madame, quand vous
aurez satisfait à ce que Dieu désire de vous, par l'entremise de Mgr de Genève,
nous penserons à ce que nous aurons à vous répondre sur vos désirs. » Une
autre fois, lui parlant sur le même sujet, elle lui dit : « Non, non,
Madame, sainte Thérèse ne vous aura pas pour fille : Dieu vous veut Mère
de tant de filles, que vous serez compagne. » Un révérend Père Jésuite
nous a prêché que le saint abbé Joachim,[31] qui a prophétisé tous les Ordres qui sont en
l'Église [123] de Dieu, a parlé de notre petite Compagnie en ces termes :
« Il s'élèvera, dit-il, un homme qui sera grand et fidèle serviteur de
Dieu ; il assemblera un peuple qui ne sera point de sa gente, ains du
second sexe faible et infirme, mais il le rendra fort en Dieu ; il sera,
ce peuple, plein de lumière, et aura une dévotion entière et très-grande à la
très-adorable Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Au Père, par une révérence
et confiance filiale ; au Fils, par une sainte imitation de ses vertus
sacrées, comme de l'humilité, douceur, débonnaireté, charité et
dilection ; au Saint-Esprit, par une ample possession de ses dons. Ce
peuple tournera son cœur entièrement vers la Sainte Vierge, Mère de Dieu, sous
la protection de laquelle il marchera, vivra et obtiendra le royaume des Cieux.
Ce peuple servira Dieu d'un cœur loyal et fidèle ; il pratiquera une
obéissance entière ; une pauvreté mystique, mais parfaite ; une
pureté angélique ; une simplicité de colombe ; une douceur
cordiale ; une humilité très-profonde, fondée sur la connaissance de sa
faiblesse ; une force d'esprit admirable ; une très-haute charité,
tant envers Dieu qu'envers le prochain. Ce peuple cheminera en la présence de
Dieu, et sa prétention sera de se crucifier soi-même, et monter sur le mont de
Calvaire, où il acquerra une très-haute perfection et union avec Dieu et le
prochain. Ce peuple sera conduit par la voie d'amour et de supportation, par la
raison et discrétion. Ce peuple ne rejettera point de parmi soi les faibles et
infirmes ; tout sera accueilli d'icelui. Tel sera son commencement et sa
fin, [124] nonobstant toute prudence humaine ; et ce grand homme fera plus
qu'il n'avait pensé. » Voilà la prophétie que le révérend Père Petit
rapporta en un sermon, laquelle je me suis un peu étendue à la rapporter au
long, parce que c'est un tableau raccourci de ce que nous devons être, et de ce
qu'était celle que Dieu avait choisie pour première Mère et conductrice de ce
nouveau peuple.
Quelques années avant que notre Institut commençât, il y avait un saint
abbé, à Grenoble, nommé de Saint-Antoine ; il était aveugle, et,
néanmoins, on eût dit qu'il voyait les légèretés et vanités de chacun en
particulier, si bien il disait le fait à tous, en prêchant surtout contre les
nouveautés et curiosités des modes d'habits des dames. Il disait souvent aux
demoiselles : « Je ne vous presse pas de quitter le monde, vous
auriez des excuses ; mais le temps s'approche que Dieu donnera à son
Église une vie médiocre et parfaite. » Il faisait beaucoup prier Dieu à
ses enfants spirituels, afin que Dieu fît naître une Religion où les filles de
petite complexion fussent reçues.
CHAPITRE XXVII.
comme l'une des plus
jeunes filles de notre bienheureuse mourut, et comme elle sortit de chez son
père.
Le commencement de l'année 1610 renouvela toutes les ardeurs de notre
Bienheureuse Mère, de se retirer du monde le plus tôt qu'elle pourrait. Or, il
y avait en Savoie un gentilhomme fort vertueux, lequel ayant ouï parler du
dessein de notre Congrégation, désirant se faire capucin, et Madame sa femme
religieuse, voulait qu'elle établit quelque maison de piété à Annecy. Il pria
notre Bienheureux Père qu'il fit joindre le dessein de notre Bienheureuse Mère
à celui de sa femme ; le Bienheureux s'y accorda avec un peu de
peine ; néanmoins, croyant que c'était possible un secours temporel à quoi
il n'avait point pensé, il laissa acheter une maison à ce bon gentilhomme et
faire des préparatifs ; mais Dieu fit voir, comme nous avons amplement
décrit en notre fondation de ce monastère, que tous ces projets-là n'étaient
pas siens, aussi se dissipèrent-ils. Cependant notre Bienheureux Père préparait
le spirituel de son dessein, lequel, comme il dit, n'était autre chose que de
dresser une petite Congrégation de femmes et de filles, vivant ensemble par
manière d'essai, sous des petites constitutions pieuses, afin que cet Institut
fût un doux et gracieux refuge aux infirmes, et que, sans beaucoup d'austérités
corporelles, l'on y pratiquât toutes les vertus essentielles de la dévotion.
L'on pourra voir la belle épître que ce Bienheureux écrivit à un révérend Père
de la sainte Compagnie de Jésus [126] sur ce sujet-là, et à la fin de laquelle
il ajoute : « Comme le révérend Père Recteur vous a dit, la pierre
fondamentale que Dieu nous donne pour cet édifice, est une âme d'excellente
vertu et piété, ce qui me fait tant plus croire que la chose réussira
heureusement. »
Sur la fin du mois de janvier, Notre-Seigneur retira à soi la plus
jeune des filles de notre Bienheureuse Mère, nommée Charlotte ; elle la
pleura en vraie mère, l'aimant d'une singulière affection, car c'était une
enfant qui était douée de rares qualités et d'un riche naturel pour la piété,
en sorte que sa bonne mère espérait que ce serait son Eustochium. À peine
avait-elle essuyé ses larmes maternelles, que madame de Boisy, mère de notre
Bienheureux Père, était décédée. Ce coup ici la toucha bien vivement, voyant sa
petite et jeune baronne de Thorens, privée de la bonne conduite d'une si
vertueuse belle-mère ; mais, d'autre part, ce fut une ordonnance favorable
de la divine Providence, qui fit un peu taire les enfants du monde, qui
médisaient hautement de la retraite de notre Bienheureuse Mère ; car alors
ils virent que cette jeune dame étant privée de belle-mère, il était
raisonnable que sa mère fût proche d'elle.
Le jour de son départ de Montelon fut arrêté au jour des Brandons. M.
le baron de Thorens, son beau-fils, l'était venu quérir ; tout le
voisinage et les sujets s'assemblèrent pour faire cet adieu, et avaient investi
cette généreuse femme. Les pauvres, d'autre part, faisaient un escadron si
lamentable, qu'ils arrachaient des larmes des plus assurées, criant à haute
voix ; aussi, certes, chacun d'eux perdait sa bonne et charitable
mère ; ceux du logis faisaient des cris si haut, que des capucins, qui
étaient présents, avaient prou à faire aller de part et d'autre, tâcher à les
faire taire, afin que l'on se puisse ouïr. Il vint, en ces entrefaites, un
enfant d'un pauvre, qui dit de son propre mouvement, et en pleurant bien fort,
s'adressant à ceux qui avaient été contraires à cette digne Mère :
« La Lumière vous [127] est ôtée, parce que vous avez voulu
l'éteindre ; faites pénitence. » Cela pensa faire fondre de pleurs
toute l'assistance ; mais, ce qui toucha nonpareillement de pitié, ce fut
le pauvre beau-père, qui vint faire son adieu, avec tant de larmes qu'il pâmait
presque. Sa vertueuse belle-fille se jeta à genoux à ses pieds, et lui demanda
pardon des mécontentements qu'elle pouvait lui avoir donnés, et, d'un visage
constant et allègre, lui recommanda le jeune baron son fils, avec une
contenance tellement rabaissée que chacun l'admirait. Le bon vieillard âgé de
plus de quatre-vingts ans, ne lui pouvait répondre que par des cris si
pitoyables, qu'ils faisaient renouveler les sanglots de toute l'assistance.
Cette généreuse femme les caressa tous les uns après les autres, leur
recommandant la crainte de Dieu ; spécialement elle embrassa les pauvres,
les conjurant fort de bien prier Notre-Seigneur pour elle ; puis monta en
carrosse, et alla dîner à Autun, où elle fut suivie d'une grande foule de
peuple, et entre autres d'un religieux du tiers ordre de saint François, lequel
elle renvoya à son beau-père, suppliant ce bon religieux de ne le point
abandonner jusqu'à la mort, et de l'aider au salut de son âme ; ce qu'il
fit soigneusement.
Avant de partir d'Autun, elle alla visiter tous les lieux de dévotion,
qui sont en très-grand nombre, cette ville ayant eu la grâce d'être arrosée du
sang de quantité de martyrs. Après cela elle alla prendre congé des révérends
Pères capucins, faire des aumônes et services à l'hôpital, où elle alla aussi
faire ses adieux, puis en deux jours se rendit à Dijon.
CHAPITRE XXVIII.
avec quelle
générosité notre bienheureuse mère quitta son pays et ses parents pour aller où
dieu l'appelait.
Cette Bienheureuse femme, ayant si vaillamment mis la main à la
charrue, n'avait garde de retourner en arrière. Étant arrivée au lieu de sa
naissance pour dire ses derniers adieux, la première chose qu'elle fit fut de
manger le Pain de vie, afin qu'avec la force d'icelui, elle pût parvenir
jusques en ces heureuses montagnes de Savoie ; car véritablement, il lui
restait un grand chemin à faire, à cause du grand et réciproque amour qui était
entre elle et ses proches. Elle demeura plusieurs jours avec eux, les consolant
tous de sa présence. Elle n'oublia aucun lieu de dévotion autour de Dijon
qu'elle ne visitât ; offrit des vœux à saint-Bernard et à
Notre-Dame-de-Létang, qui étaient les deux églises où elle avait accoutumé de
faire ses plus ardentes dévotions.
Le 29 de mars, jour assigné pour son départ, tous ses plus proches
s'assemblèrent chez Monsieur le président son père ; cette noble et
vénérable assemblée fondait en larmes, quoique les douleurs de tous ensemble
n'eussent su accroître celle que M. Frémyot ressentait. Il se retira en son
cabinet, crainte que ses larmes, qu'il ne pouvait retenir, ne donnassent
licence aux autres de faire des lamentations immodérées, car tous pleuraient
amèrement, hormis cette vraie Paule de nos jours, qui les embrassa tous l'un
après l'autre, avec une constance digne de sa généreuse vertu, sans témoigner
aucune mollesse, quoique l'on vît [129] ses yeux nager dans l'eau par le
ressentiment de compassion qu'elle avait de la douleur de tant de bons et chers
parents.
Après tous les autres, le jeune baron son fils, âgé d'environ quinze
ans, qu'elle aimait, si jamais mère aima amoureusement son fils unique, se vint
jeter à ses pieds, et fut un sujet de pitié à toute cette noble compagnie. Il
fit un discours si sensible, qu'on eût dit que c'était une harangue étudiée, et
sa sainte mère lui répondit avec une force admirable, tandis que la compagnie
redoublait ses larmes et ses sanglots, d'entendre ce discours filial et
maternel si douloureusement amoureux ; la vaillante mère voulant passer
outre, pour aller dire adieu à M. Frémyot, le jeune gentilhomme, avec des
pleurs et une grâce nonpareille, s'alla coucher sur le seuil de la porte de la
salle : « Hé bien ! dit-il, ma mère, je suis trop faible et trop
infortuné pour vous retenir, mais au moins sera-t-il dit que vous aurez foulé
votre enfant aux pieds ! » L'action de cet aimable fils pensa faire
éclater de douleur cette aimante mère, laquelle, suivant l'avis de saint
Jérôme, passa sur ce cher fils, et s'arrêtant un peu, elle jeta quelques
larmes. M. Robert, très-vertueux et docte ecclésiastique, précepteur de MM. des
Francs, ses neveux, et depuis grand vicaire de l'évêché de Châlons, ayant
admiré sa constance jusqu'alors, touché d'une sainte jalousie de lui voir
continuer sa magnanimité, s'approchant d'elle lui dit : « Madame, eh
quoi ! les larmes d'un jeune homme pourraient-elles faire brèche à votre
constance ? — Nullement, lui dit-elle en souriant, mais que
voulez-vous ? je suis mère !... » Elle sut fort bon gré à ce
pieux personnage de lui avoir donné cet avis, et se mit, de plus grande
ferveur, à réclamer le secours du Ciel, voyant venir à elle son si cher père,
dont la blanche vieillesse et les larmes lui faisaient grande pitié. Ils se
parlèrent assez longtemps avec abondance de pleurs de part et d'autre ;
enfin, s'étant mise à genoux, pour recevoir la bénédiction d'un si cher père,
il leva ses mains, [130] ses yeux et son cœur au Ciel, et dit tout haut ces
paroles : « Il ne m'appartient pas, ô mon Dieu de trouver à redire à
ce que votre Providence a conclu en son décret éternel ; j'y acquiesce de
tout mon cœur, et consacre de mes propres mains, sur l'autel de votre volonté,
cette unique fille, qui m'est aussi chère qu'Isaac était à votre serviteur
Abraham. » Sur cela, il fit lever cette chère fille, et lui donnant le
dernier baiser de paix : « Allez donc, dit-il, ma chère fille, où
Dieu vous appelle, et arrêtons tous deux le cours de nos justes larmes, pour
faire plus d'hommage à la divine volonté, et encore afin que le monde ne pense
point que notre constance soit ébranlée. » Avec cet avis et bénédiction
paternelle, elle se mit en chemin si allègre, qu'au sortir des portes de Dijon,
elle se mit à chanter avec notre chère Mère et Sœur de Bréchard, le Psalme Lœtatus
sum in his et le Quant dilecta tabernacula. Elles répétèrent
plusieurs fois les versets, où le chantre royal fait comparaison de sa liberté,
à celle d'un oiseau échappé des filets des chasseurs, Anima nostra sicut
passer. Arrivant en quelques bourgades ou logis, notre Bienheureuse Mère
s'enquérait s'il y avait des malades, et les allait servir, consoler et
nettoyer, et le matin, avant que partir, elle retournait faire leurs lits, et
se recommander à leurs prières.
Il fallut passer par Genève ; or, d'autant qu'un proche parent de
feu M. de Chantal avait fait des faveurs signalées à ceux de cette ville-là,
notre Bienheureuse Mère eut crainte que si elle se nommait on lui fit quelque
honneur particulier, comme on avait fait à quelques autres de ses
parentes ; c'est pourquoi elle ne voulut point que l'on dît que c'était la
baronne de Chantal, prenant le nom d'une autre terre.
Notre Bienheureux Père, et environ vingt-cinq personnes, tant seigneurs
que dames, montèrent à cheval pour aller au-devant de celle qui venait vraiment
au nom de Notre-Seigneur, et qui entra en cette ville d'Annecy avec une
universelle [131]réjouissance, le jour des Rameaux.[32] Elle amenait avec elle madame de Thorens et
mademoiselle de Chantal, sa seconde fille, pour l'élever avec elle ; le
ciel avait retiré la troisième. La Sainte Semaine se passa toute en dévotions
et saintes conférences. Notre très-honorée Sœur et Mère Marie-Jacqueline Favre,
qui connaissait notre Bienheureuse Mère dès les autres voyages qu'elle avait
faits en Savoie, dès qu'elle y fut arrivée cette dernière fois ici, se donna
totalement à elle, et ne se quittèrent plus ; notre chère Mère de Bréchard
et elles étaient quasi ensemble sans intervalle, à s'encourager en leur sainte
entreprise.
Notre Bienheureuse Mère mena madame de Thorens en son ménage, où elle
mit parfaitement bon ordre, et y demeura quelque temps ; mais comme elle
était si jeune, on lui pourvut de séjour et de personnes convenables pour sa
conduite.
CHAPITRE XXIX.
les dernières
résolutions et assignations du temps pour commencer notre institut de
sainte-marie.
Les fêtes de Pentecôte s'approchant, notre Bienheureux Père désirait de
commencer la Congrégation ce jour-là, « afin, disait-il, que nos filles,
enfermées comme dans un petit cénacle, reçoivent le Saint-Esprit, soient
enivrées de ce moût divin, qui ne leur fasse pas seulement parler d'un nouveau
langage, mais vivre d'une nouvelle vie. » Toutefois, Dieu, qui avait
conclu que ce sacrifice se fit un autre jour, permit des retardements. La femme
du gentilhomme dont nous avons parlé ci-dessus, qui avait acheté une maison,
soit qu'elle s'épouvantât de la grandeur de l'entreprise, ou, comme il est plus
certain, que Notre-Seigneur ne l'avait pas destinée, elle se dédit de toutes
les propositions susdites ; ce qui causa une grande parlementerie par tout
le pays.[33] Nos Bienheureux Fondateur et Fondatrice ne
s'étonnèrent nullement de cela, au contraire, ils bénirent Dieu qui les
laissait plus libres, pour commencer la Congrégation dans une entière pauvreté
et simplicité. Notre saint Fondateur entra dans le marché de la maison que le
gentilhomme avait achetée hors de la ville, au faubourg de la Perrière. Ce
Bienheureux s'obligea partout où il fallait, et [133] revenant de passer le
contrat, il dit, tout joyeux : « Je ne fus jamais plus content que
maintenant, que j'ai trouvé une ruche pour mes pauvres abeilles, ou plutôt une
agréable cage pour mes petites colombes. » L'on se mit à préparer cette
maison et à dresser un petit oratoire. Et notre saint Fondateur disposait
quelques règlements pour le commencement du spirituel ; ce qui était à
quoi il visait le plus, et la seule chose à quoi notre Bienheureuse Mère
pensait ; en sorte que notre Bienheureux Père avait accoutumé de dire,
parlant de notre commencement, que la céleste Providence avait fait la
Visitation comme l'univers, de rien du tout.
Nos Mères Favre et de Bréchard attendaient de bon cœur l'heureux jour
de leur retraite, et ne pensaient point d'attirer d'autres compagnes, quand la
divine Bonté amena en cette ville notre très-bonne Mère Péronne-Marie de
Châtel, avec madame la baronne de Villette, qui venaient voir, comme toutes les
autres dames du voisinage, notre Bienheureuse Mère, avant qu'elle s'enfermât.
Notre très-honorée Mère de Châtel, qui avait fait ses vœux à la Sainte Vierge,
afin qu'elle lui montrât le lieu où elle voulait qu'elle servît son divin Fils,
dès qu'elle envisagea notre Bienheureuse, elle sentit et crut que c'était
celle-là que la Sainte Vierge lui donnait pour Mère. Se confessant le lendemain
à notre Bienheureux Père, et lui découvrant tout son cœur, le Bienheureux lui
donna sa place dans sa nouvelle Congrégation, et dès lors la donna pour fille à
notre Bienheureuse Mère, qui l'accepta d'une très-grande et cordiale affection.
L'ennemi de notre bonheur voyant que tous ses efforts étaient vains, et
que son infernale puissance était renversée par la grâce divine, et les
obstacles au commencement de la Congrégation réduits à néant, voulut encore
livrer un assaut à notre Bienheureuse Mère. La veille de la très-adorable
Trinité, il assiégea son cœur d'une tentation si furieuse, qu'elle dit par
après ces paroles : « Mon âme était comme dans les détresses [134] de
la mort, je me sentais environnée de toutes parts, et ne savais par où
sortir ; je fus dépouillée en un instant de la joie cordiale de ma
retraite, qui avait accoutumé d'être mon soulagement parmi mes autres
travaux ; cette colonne de constance, qui avait accoutumé de tenir
toujours ferme en ma partie supérieure, était, ce me semblait, tombée en bas en
cent pièces ; il me semblait de voir mon père et mon beau-père, chargés de
douleurs et d'années, qui criaient vengeance devant Dieu contre moi, et d'un
autre côté mes enfants qui faisaient de même ; il m'était avis que
multitude de voix parlaient à mon esprit, me remontrant que j'avais fait une
grande faute, et ce qui m'était plus douloureux, ce fut un reproche tiré des
saintes Lettres, que dans l'Église de Dieu je passerais pour une infidèle,
d'avoir quitté mes enfants, et que sans doute j'avais déçu l'esprit du saint
évêque, et que, par conséquent, le conseil qu'il m'avait donné de quitter mes
proches était contre la volonté de Dieu. Si j'eusse cru cela, j'eusse voulu
boire la confusion de tout le monde, et m'en retourner trouver mes père et
beau-père, et il se présentait à mon esprit de beaux expédients pour en venir
honorablement à l'exécution. » Elle fut environ trois heures dans ce
martyre, lequel sera mieux entendu de ceux qui savent ce que c'est des travaux
intérieurs, qu'il ne se peut exprimer. Elle était tellement pressée de la
violence de cette tentation, qu'elle fut plusieurs fois en train de se lever
pour faire appeler notre Bienheureux Père, mais la modestie du silence de la
nuit la retint, et s'étant avisée de mettre, en signe de fidélité, sa main sur
le saint nom de Jésus, qu'elle s'était gravé sur le cœur, comme nous l'avons
dit, la clarté commença à revenir dans son esprit, et, se jetant à
genoux : « Ah ! dit-elle à son ennemi irraisonnable, je ne puis
te vaincre par raison, tu ne sais ce que c'est ; puis disant trois fois le
Deus in adjutorium, elle fit un acte d'abandonnement parfait
d'elle-même, et de toutes choses, entre les mains de Dieu. « Je [135] me
souviens fort bien, dit-elle une fois, en parlant de cette tentation, que j'en
fus guérie en proférant ces paroles : Mon Dieu, jetez les yeux de votre
miséricorde sur ce néant, je m'abandonne à jamais à votre Providence ; que
mes parents, mes enfants et moi périssions, si vous l'avez ordonné, cela ne
m'en importe ; mon seul intérêt, au temps et en l'éternité, est de vous
obéir et de servir à votre seule Majesté. » Ces paroles étant proférées
d'un cœur sincère et amoureux, notre Bienheureuse Mère demeura non-seulement
dans sa première tranquillité, mais dans une joie et force toute nouvelle, étant
comme un autre Josué, forte, robuste et vaillante, pour conduire son petit
peuple en la terre promise que le vrai Moyse de nos jours lui avait montrée. Et
ici je finis le discours de ce que nous avons pu ramasser de notre Bienheureuse
Mère, jusqu'à son entrée en Religion, que je prends pour la terre promise.
DEUXIÈME PARTIE.
LES ACTIONS DE SA VIE RELIGIEUSE.
CHAPITRE PREMIER.
commencements de la
visitation.
Les fondements étaient creusés, la pierre fondamentale toute taillée
par la main du céleste ouvrier, les matériaux prêts ; il ne restait plus
qu'à commencer l'édifice de notre petite Congrégation, au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit.
Le sixième juin, jour auquel se rencontra, avec le dimanche de la
très-adorable Trinité, la fête du glorieux saint Claude, notre Bienheureuse
Fondatrice et ses deux chères premières filles ayant communié, notre
Bienheureux Père les avertit de rendre joyeusement grâces à Notre-Seigneur, que
c'était le jour de leur délivrance du monde ; ce qu'elles firent toutes trois
avec grande ferveur, et tout ce saint jour fut employé à la visite des églises
de la ville, et avec les filles spirituelles de notre Bienheureux Père, qui
s'étaient assemblées en grand nombre.
Environ les sept à huit heures du soir, notre digne Mère et [138] ses
deux chères compagnes allèrent l'une après l'autre prendre la bénédiction de
notre Bienheureux Père, qui voyant ces trois bénites âmes avec leurs robes
nuptiales et les lampes ardentes en leurs mains pour aller au-devant de
l'Époux, et aux chastes noces de son banquet évangélique, il leur dit à toutes
trois ensemble : « Vous êtes bien heureuses, vous que le Seigneur a
sauvées ; ayez un grand et très-humble courage, Dieu sera votre Dieu, et,
en sa divine force, vous marcherez victorieuses, sur le cou de vos
ennemis. » Après cela, il mit entre les mains de notre Bienheureuse Mère
un abrégé de nos constitutions écrites de sa sainte main : « Suivez
ce chemin, lui dit-il, ma très-chère fille, et le faites suivre à toutes celles
que le Ciel a destinées pour suivre vos traces ; » puis, levant les
yeux au Ciel, il les bénit derechef toutes trois, au nom du Père tout-puissant
qui les attirait, du Fils, éternelle sagesse, qui les régissait, et du
Saint-Esprit, qui les animait de ses amoureuses flammes.
Bien qu'on eût tâché de tenir le jour et l'heure de leur retraite fort
secrets, le peuple, qui s'en doutait, était tout hors des maisons en attente,
quand ces trois victimes, couronnées de la joie et de l'allégresse avec
laquelle elles allaient au sacrifice, sortirent de chez notre Bienheureux Père,
pour aller dans leur petite maison, au faubourg. M. le baron de Thorens menait
sa sainte belle-mère, M. de Boisy, depuis digne successeur de son saint frère
en cet évêché, menait notre Mère Favre, et notre Mère de Bréchard était
conduite par M. de la Thuille, aujourd'hui comte de Sales, tous trois Frères de
notre saint fondateur. Tout le reste de la noblesse et du peuple suivait avec
un si grand concours, que depuis le logis de notre Bienheureux Père, jusqu'en
la petite maison de ces nouvelles épouses de Notre-Seigneur, la presse était
telle, qu'à peine la pouvait-on fendre. L'air retentissait des louanges que
tout le monde, et singulièrement les enfants donnaient à Notre-Seigneur et à
ses fidèles servantes, lesquelles eurent grand'peine d'entrer dans leur petite
chapelle, où quantité des principales dames s'étaient assemblées pour avoir la
consolation de les embrasser encore une fois. Il tardait fort à nos chères
Mères que tout le monde fût retiré, à quoi la nuit les contraignit, et elles
entrèrent dans leur pauvre mais très-aimable et désirée retraite. « Voici,
dit notre Bienheureuse Mère, le lieu de nos délices et notre repos. »
La première chose qu'elles firent fut de se mettre à genoux pour rendre
grâces à Dieu, disant trois fois le Gloria Patri, et demandant à Dieu la
grâce de faire ce pourquoi elles s'assemblaient. Après cela, elles
s'embrassèrent cordialement ; nos deux chères Mères Favre et de Bréchard
promirent à notre Bienheureuse Fondatrice leur filiale obéissance, et entre
elles, une éternelle et sainte dilection ; elles caressèrent aussi fort
amiablement la bonne sœur Anne-Jacqueline Coste, tourière, qui les était allé
attendre ; demeurant ainsi elles trois, Notre-Seigneur n'ayant pas voulu
augmenter ce beau nombre, permit que nos très-honorées Mères de Châtel et de
Blonay qui avaient leurs places, fussent retardées par Messieurs leurs parents.
La première chose que fit notre Bienheureuse Mère, après sa prière et
le salut à ses deux chères premières filles, fut de leur faire lecture des
règlements que notre Bienheureux Père lui avait mis en mains, disant à ses
filles que, pour elle, elle promettait à Dieu d'être très-fidèle en cette
observance, et dès lors le petit volume de cette grande loi ne bougea de sa
poche ; elle méditait en icelui, afin de le garder et faire garder
très-soigneusement et amoureusement. Il était déjà assez tard, c'est pourquoi
elles firent leur examen, et dirent les Litanies de la Sainte Vierge, conjurant
avec une humble instance cette divine Reine de les prendre sous sa maternelle
protection. L'on ne saurait exprimer avec quelle consolation elles se
dévêtaient de leur habit du monde, quoique très-modeste, pour en avoir un plus
[140] simple encore. Notre chère sœur et Mère de Bréchard, ôtant son moule et
sa houppe qui étaient certains attifets que les demoiselles portaient alors,
elle les foula aux pieds avec grande ferveur. Dès ce soir, elles commencèrent à
observer le grand silence, et avaient accoutumé de dire, par après, que jamais
elles n'avaient pris un repos si doux, si suave, ni si calme, que celui de
cette première nuit de leur retraite. Quant à notre Bienheureuse Mère, son cœur
fut tellement occupé toute cette nuit d'un doux sentiment de la divine présence
et d'une reconnaissance amoureuse envers sa bonté, de la grâce, qu'il lui avait
faite, qu'elle ne sommeilla que fort peu. L'ennemi qui l'avait toujours
poursuivie lui voulut faire connaître qu'il reprenait de nouvelles forces
contre elle, et qu'il avait licence d'entrer dans les solitudes plus retirées,
pour persécuter les amis de Dieu. Environ les deux heures après minuit, qu'elle
commençait à s'endormir de son premier sommeil, il l'éveilla brusquement et en
sursaut, et comme il avait fait naguère, il environna son intérieur de ténèbres,
et lui représentait mille et mille difficultés, et ensuite des impossibilités
sans nombre de réussir dans son entreprise ; lui donnant, en la partie
inférieure, du repentir de s'y être engagée si avant, et lui parlant comme à
une téméraire, qui tentait Dieu de s'être chargée de la conduite d'une famille
sans fonds temporels, où elle pensait prendre de quoi l'entretenir, et mille
autres bagatelles. Ce choc ici dura environ deux heures, et notre Bienheureuse
Mère ne répondait pas un mot à tous les divers mouvements que l'ennemi excitait
en elle, que par actes positifs d'abandonnement d'elle-même entre les mains de
Dieu, ne répondant pas un mot à son persécuteur qui s'enfuit, se voyant
méprisé ; et le cœur de cette fidèle Épouse demeura dans sa sainte, joyeuse
et amoureuse paix, et Notre-Seigneur lui donna de grandes lumières des soins
admirables que sa divine Providence voulait avoir de la Congrégation, si l'on
se reposait pleinement et avec une [141] amoureuse confiance en son soin
paternel ; de quoi, ce matin-là, elle fit un exercice particulier, se
dédiant, et elle et sa Congrégation, à honorer à jamais la céleste Providence
par une parfaite et filiale remise de tout. Cinq heures ayant sonné, notre
Bienheureuse Mère se leva la première, et alla éveiller ses deux filles, que le
changement de lit n'avait point empêché de dormir toute la nuit. Elles
s'habillèrent toutes de leur habit du noviciat, notre Bienheureux Père ne
voulant pas que l'on fit aucune cérémonie pour cela, n'étant pas un habit
nouveau de Religion, mais seulement un habit commun, mais ravallé à l'extrémité
de la modestie et humilité chrétienne, ainsi que nous l'avons dit par le menu
dans notre fondation.
Toutes joyeuses de se voir dans cet habit simple, elles se donnèrent le
saint baiser de paix, et allèrent dans leur petit chœur, pour faire leur
oraison mentale, se présentant comme des Épouses parées au gré de leur Époux.
La divine Bonté fit voir qu'elles avaient trouvé grâce devant ses yeux, et les
combla toutes trois d'une admirable suavité et d'un courage incroyable pour
poursuivre fermement cette heureuse sorte de vie qu'elles commençaient. Sur les
huit heures, notre Bienheureux Père vint dire messe et communier cette petite
Communauté. Après la messe, il leur donna la clôture pour toute cette première
année de leur noviciat. Elles quittèrent le nom de dames et autres alliances du
monde ; nos deux premières sœurs donnèrent le nom de Mère à notre
Bienheureuse Fondatrice, et prirent, entre elles, celui de Sœur. Dès ce
jour-là, elles commencèrent à étudier le petit Office de Notre-Dame, qu'elles
commencèrent quelques jours après à dire en public- et ne se peut dire la peine
que notre Bienheureuse Mère prenait pour s'habituer à la bonne prononciation du
latin, y ayant une extrême difficulté.
M. de Boisy, frère de notre Bienheureux Père, alors chantre en la
cathédrale de Genève, et depuis évêque, venait tous les [142] jours apprendre à
nos premières Mères les cérémonies de l'Office que nous tenons encore
aujourd'hui, à quoi notre Bienheureuse Fondatrice avait une si grande
affection, que l'on ne sait ce qu'elle n'eût voulu faire pour éviter la moindre
faute en ce divin Office.
CHAPITRE II.
de la ferveur et des
accroissements de la petite congrégation.
Notre-Seigneur qui voulait être lui-même l'héritage, la possession et
le possesseur de ses chastes Épouses, voulut qu'elles entrassent à sa suite,
nues des biens de ce monde, notre Bienheureux Père n'ayant pas voulu que notre
Bienheureuse apportât quant et soi, non-seulement du bien de ses enfants, mais
non pas même du sien propre, lui commandant de se contenter d'une pension
viagère, que Mgr de Bourges, son frère, l'avait priée d'accepter par aumône, et
laquelle il lui a toujours continuée tandis qu'elle a vécu.[34] La richesse de cette sainte troupe était l'amour
cordial de leur sainte pauvreté, et avaient toutes trois le cœur si détaché des
soucis de la vie et du soin des commodités, qu'elles s'enfermèrent dans leur
petite maison, sans qu'il y eût ni pain, ni vin, ni provisions de chose
quelconque ; ce qu'une bonne âme admirait, considérant que s'il leur fût
arrivé quelque chose la nuit, elles n'avaient pas de quoi allumer un bout de
chandelle. On leur donna un petit baril de vin par aumône, lequel, comme nous
avons dit en la Fondation, leur dura depuis le six juin 1610 jusqu'aux
vendanges de l'année suivante 1611, qu'elles [144] pensèrent à faire provision
de vin ; dès qu'elles en eurent, il n'y eut plus rien du tout dans leur
petit baril, qui demeura si sec, que l'on s'en étonnait fort, et notre Bienheureuse
Mère disait « qu'elle pensait que si on n'eût point pensé à faire des
provisions de vin, ce petit baril aurait toujours duré, et qu'elle avait
toujours de la consolation à penser comme la pauvreté de notre commencement
était remarquable, et reluisait en tout : au réfectoire, à la roberie, et
même à l'église. » Nous en avons parlé si particulièrement dans notre
Fondation, que je ne rappellerai pas les petites particularités ; dirai-je
seulement que cette sainte veuve, se confiant parfaitement en Dieu, n'eut pas,
nonobstant toute sa pauvreté, disette d'huile et de farine pour subvenir
petitement à la juste nécessité de sa famille, parce qu'elle était parfaitement
obéissante à l'homme de Dieu, notre Bienheureux Père, qui disait que, « si
ou eût voulu dépeindre au naïf la véritable pauvreté évangélique, et le total
oubli des choses de la terre, et à cela joindre une protection visible de la
Providence céleste, il n'y avait qu'à regarder la première naissance de la
maison de la Visitation de Sainte-Marie. »
L'heure étant venue que Dieu voulait accroître le nombre de ses
amantes, il inspirait des filles attirées par l'odeur des vertus de ces trois
nouvelles cloîtrières, pour se venir joindre à elles, et courir ensemble à la
suite des parfums du divin Époux. Six semaines après l'établissement, notre
chère Sœur Claude-Françoise Roget fut reçue ; c'était une très-vertueuse
fille, des plus honorables familles de cette ville, petite âme tout innocente
que Dieu retira du monde, avant que la malice d'icelui eût aucunement perverti
son cœur tout pur et virginal. Trois jours après, notre très-honorée Mère
Péronne-Marie de Châtel fut reçue, le jour de la glorieuse sainte Anne ;
elle fut suivie de notre chère Sœur Marie-Marguerite Milletot, fille d'un
conseiller de Dijon, et celle-ci, de notre très-chère Sœur Marie-Adrienne
Fichel, demoiselle savoisienne, appelée à la Congrégation, comme nous [145]
avons dit, par une vocation tout extraordinaire. Et bientôt après elle, entra
notre chère Sœur Claude-Marie Thiollier de Chambéry ; à peine celle-là fut
reçue, que notre chère Sœur Claude-Agnès de la Roche fit ses poursuites pour
entrer, et fut suivie immédiatement de notre très-honorée Mère Marie-Aimée de
Blonay, toutes deux demoiselles savoisiennes, l'une du Genevois, l'autre du Chablais,
et celle-ci fut justement la dixième de l'Institut, auquel, à présent, elle
possède dignement le gouvernement de cette première maison d'icelui. Or,
d'autant qu'entre ces dix premières, à peine y en avait-il deux qui ne fussent
de fort petite complexion et infirmes, le monde commença fort à murmurer de
telles réceptions, à quoi notre saint Fondateur ne répondait rien autre avec sa
bénignité ordinaire, sinon : « Que voulez-vous ? je suis le
partisan des infirmes. »
Le révérend Père Ignace Armand, de la sainte Compagnie de Jésus,
écrivant une fois à notre Bienheureux Père sur ce sujet, lui disait les paroles
suivantes, qui sont tellement à notre propos, que je ne craindrai point la
prolixité blâmable de les rapporter un peu au long. « Monseigneur, dit-il,
diverses personnes parlent de votre dessein, il est vrai, et puisque votre
humilité veut savoir les pensées de son très-humble serviteur, je ferai voir à
Votre Seigneurie que je suis autant obéissant qu'affectionné. Il est vrai
encore un coup, l'on dit que vous dresserez un hôpital plutôt qu'une assemblée
dévote, mais qui ne rirait avec vous, mon très-honoré seigneur, des folles
cervelles des enfants du monde ? De moi, je ne puis m'empêcher de dire
avec le Sauveur : Génération perverse, à quoi vous comparerai-je ?
à ces enfants qui disent parmi les rues : nous avons chanté, et
vous n’avez pas dansé ; nous avons fait des complaintes et vous n’avez pas
lamenté. Jean est venu ne buvant ni mangeant, vous dites qu'il est un
endiablé. Le Fils de l'homme est venu buvant et mangeant, et vous dites
qu'il est Samaritain. Il est venu par ci-devant plusieurs [146]
religieuses menant une vie fort austère, qui les oblige à ne point recevoir les
filles infirmes et de petite complexion ; le monde se plaint de ce
qu'elles ne veulent que les saines et robustes, et les taxe d'une indiscrète
rigueur. Vous avez, Monseigneur, commencé à ériger un séminaire des spéciales
imitatrices de la bénignité du Verbe humanisé, qui ne rejetait personne, vous
avez trouvé le nœud et le secret en votre Visitation, qui n'est point trop
douce pour les fortes, ni trop âpre pour les faibles, les enfants du monde
censurent cela, et disent que l'on dresse un hôpital ou une vie trop molle.
Cerveaux vides des maximes du crucifix, qui ne savent pas ce que coûte à la
nature l'effet de cette parole : mourir à soi pour vivre à Dieu,
renoncer à soi-même pour porter sa croix. Souffrez, Monseigneur, que je
dise une imagination que je faisais dernièrement : il m'était avis,
considérant la lettre que Votre Illustrissime Seigneurie a daigné écrire à
notre Père de Villars, que, dressant ce refuge aux imbéciles, vous dites comme
Notre-Seigneur disait au regard des petits enfants : Laissez venir à moi
ces faibles, ces infirmes et maladives, car à telles appartient le royaume des
Cieux. Hélas ! qui n'aurait pitié d'une vierge, laquelle ayant sa lampe
ardente en main, pleine de bonne huile, ne peut néanmoins entrer dans un
cloître, pour célébrer les noces de l'Agneau, faute d'avoir les épaules assez
fortes pour porter une robe tissue de poils de chameau, comme celle du grand
Baptiste, ni l'estomac assez robuste pour jeûner la moitié de l'année, et ne
digérer que des racines ? Pour moi, Monseigneur, je crois que vos chères
filles seront les vraies épouses de Jésus ; car il se vêtait non point de
robe délicate, cela étant pour les cours des rois de la terre, mais d'une robe
sans couture, pour nous signifier qu'elle ne blessait pas. Ce bon Seigneur
vivait chez sainte Marthe, et ne refusait pas d'aller au festin. Votre Compagnie
s'élève pour imiter la vie cachée, la vie contemplative, et la vie bénigne de
Jésus. L'on trouve dans le [147] dessein de Votre Seigneurie, la pauvreté et
les mortifications de Bethléem, et les raisonnables commodités de Nazareth la
solitude du désert, et la douce conversation de Béthanie. L'on voit dans le
visage de votre excellente première fille, madame de Chantal, qu'elle suit
vraiment le Sauveur pauvre doux bénin, cordial, caché, retiré, priant,
conversant, aimant la solitude, servant au prochain, bref, glorifié au Thabor,
crucifié au Calvaire. » Jusqu'ici sont les propres paroles du témoignage
que le révérend Père Ignace Armand rendait de notre petite Congrégation et de
notre Bienheureuse Fondatrice Ce révérend Père était un grand serviteur de
Dieu, qui a beaucoup servi sa sainte Compagnie en la charge de Provincial, et
est décédé en grande estime de vertu.
CHAPITRE III.
de la préparation et
de l'amour que notre bienheureuse fondatrice et ses compagnes apportèrent à la
profession religieuse.
L'ennemi voyant les heureux progrès de notre petite Congrégation,
honteux des résistances que notre Bienheureuse Mère avait faites neuf ans
durant à ses furies, dont elle était toujours restée victorieuse, demanda
permission de la toucher de bien près en sa propre personne, pensant par les
maladies corporelles (ainsi que Dieu le fit connaître à une sainte âme)
interrompre ou ralentir la vigueur de sa course au service de Dieu. Elle fut
affligée d'une maladie violente, dans laquelle, soit faute de connaître sa délicate
complexion, ou que Dieu le permît, on lui donna des médicaments si forts,
qu'elle en pensa mourir, et fut plusieurs années dans les accidents de maladies
inconnues qui lui commencèrent l'année de son noviciat, desquelles nous dirons
tantôt un mot.
Le temps de ce cher noviciat de nos trois premières Mères étant écoulé,
notre Bienheureuse Fondatrice avertit ses deux chères filles que rien ne devait
être offert à Dieu qui ne fût bien purifié ; à quoi elles travaillaient
avec une ferveur toujours nouvelle, singulièrement notre Bienheureuse Mère, à
laquelle Notre-Seigneur redonna un peu de santé pour faire ses exercices
spirituels avec plus d'assiduité, et se préparer plus à l'aise. Elle était dans
une si grande ardeur d'esprit en l'attente de sa profession, qu'elle disait à
notre Bienheureux Père, par un petit billet, ces mots : « Quand
viendra ce jour heureux, où je ferai [149] et referai l'irrévocable offrande de
moi-même à mon Dieu ? Sa bonté m'a remplie d'un sentiment si
extraordinaire et puissant de la grâce qu'il y a d'être toute sienne, que si le
sentiment dure dans sa vigueur, il me consumera. Jamais je n'eus des désirs ni
des affections si ardentes de la perfection évangélique ; il m'est
impossible d'exprimer ce que je sens, ni la grandeur de la perfection où Dieu
nous appelle. Hélas, à mesure que je me résous d'être bien fidèle à l'amour de
ce divin Sauveur, il me semble que c'est chose impossible de pouvoir
correspondre à toute la grandeur de l'attrait de ce même amour. Oh ! que
c'est chose pénible en l'amour que cette barrière de notre impuissance !
Mais qu'est-ce que je dis ? J'abaisse, ce me semble, le don de Dieu par
mes paroles, et ne saurais exprimer ce sentiment d'amour qui me sollicite à
vivre en pauvreté parfaite, en humble obéissance, et en très-pure
pureté. »
Notre Bienheureux Père vint pour examiner ses trois dignes novices, et
les trouva non-seulement disposées à faire leur oblation, mais qu'elles étaient
déjà dans la perfection d'icelle. Après cet examen, l'on se mit à discourir
quel voile l'on donnerait à ces professes prétendues : l'on proposa à
notre Bienheureux Père du crêpe, mais il dit que cela était trop riche et
délicat pour les filles de la Visitation, qui devaient faire profession de si
grande simplicité et pauvreté, et qu'il les fallait faire d'étamine, ce que
l'on fit promptement, se servant pour cela des lais de la robe que notre
Bienheureuse Mère portait quand elle se retira du monde, n'ayant pas de quoi en
acheter de neufs. Notre Bienheureux Père et notre Bienheureuse Mère agencèrent
eux-mêmes ce bénit voile sur la tête d'une Sœur, pour voir en quelle façon l'on
s'ajusterait, et trouvèrent celle dont nous usons maintenant la plus simple et
moins façonnée. Après cela nos bonnes Sœurs commencèrent à penser à l'ornement
de leur autel, pour le jour de leur profession. M. le président Favre avait
promis à [150] sa fille un présent d'autel ; mais ne l'ayant pu encore
donner, les chères Sœurs Favre et de Bréchard, sachant qu'il y avait au coffre
à trois clefs quatre ou cinq pièces d'or que notre Bienheureux Père avait
données, avec défense toutefois qu'on ne les employât que pour les nécessités
et soulagements des malades, elles vinrent toutes deux environner l'esprit de
notre Bienheureuse Mère de mille raisons, « que ce ne serait point manquer
à l'obéissance de prendre ces pièces d'or pour acheter un parement, puisqu'on
les replacerait dès que M. le président Favre aurait payé. » Elles firent
tant d'instances et de prières, que notre bonne Mère leur condescendit et leur
permit d'employer cette petite somme. Quand cela fut fait, ce petit grain de
sable commença à troubler grandement l'œil clair et net de la conscience de
notre digne Mère, qui, dès ce soir-là, avertit notre Bienheureux Père par un
petit billet. Le Bienheureux, qui ne savait pas la raison des filles, ni les
instances qu'elles avaient faites, fut fort touché de ce défaut, et dès le
lendemain matin alla au monastère pour en faire la correction ; en
l'abordant, notre innocente coupable se jeta à genoux avec grande abondance de larmes,
s'accusant de sa faute. Le Bienheureux lui dit d'une façon grave et d'une voix
puissante : « Ma fille, voilà la première désobéissance que vous
m'avez faite ; j'en ai eu une mauvaise nuit, tant j'en ai eu de
déplaisir. » Cela donna un si grand regret à notre Bienheureuse Mère, que
le saint Prélat eût prou peine à la consoler, et elle nous a quelquefois dit
« qu'elle fut longtemps qu'au souvenir de cette faute elle avait toujours
les larmes aux yeux. »
La veille de cette sainte oblation, cinquième juin 1611, notre
Bienheureux Père vint recevoir la confession annuelle de ses trois chères
filles. Notre Bienheureuse Mère, à la fin de la sienne, fit le renouvellement
de ses vœux en cette sorte, ainsi que nous l'avons trouvé écrit de sa main dans
les papiers de notre Bienheureux Père : « Je renouvelle et reconfirme
mes vœux de [151] perpétuelle chasteté et obéissance à votre divine Majesté, en
la personne de Messire François de Sales, votre bien-aimé et très-digne évêque
de Genève, mon unique seigneur et très-cher Père en ce monde. Mon Dieu, mon
Sauveur, je m'abandonne très-irrévocablement et sans réserve à votre divine
volonté et sainte Providence ; gouvernez-moi, et m'employez à tout ce
qu'il vous plaira, par l'entremise de ce grand Père de mon âme que vous m'avez
donné, et m'octroyez la grâce de parfait amour à l'obéissance. » Après,
elle invoque le secours du ciel sur sa faiblesse par l'intercession de
plusieurs saints, et entre autres du saint Père Abraham, lequel elle supplie
d'offrir à Dieu son sacrifice.
Le lendemain, jour de saint Claude, notre Bienheureux Père vint
recevoir l'oblation de nos trois premières Mères. Ce n'étaient que vœux
simples, parce que ce Bienheureux voulait que le seul amour de l'Époux servit
de lien aux filles de la Visitation, et qu'elles observassent autant exactement
l'obéissance, la pauvreté et la sainte pureté, que si elles eussent eu
l'obligation des vœux solennels, et enfin il voulait que leur plus grande
profession fût comme celle de saint Pierre, au jour que Notre-Seigneur lui fit
faire ses trois protestations d'amour.
Je crois avoir parlé amplement, dans notre Fondation, de toute la
cérémonie de cette profession, et comme la tapisserie de l'église n'était que
de nappes et linceuls bien blancs, tous couverts de petits bouquets de fleurs
champêtres qui y étaient attachés avec des épingles. Par un hasard sans
préméditation, après la profession, notre Bienheureuse entonna par trois
diverses fois ce verset : Hœc requies mea, in sœculum sœculi, que
le chœur releva ; de là est venue la coutume de le chanter en nos
professions, car on ne faisait pas encore, en ce commencement, toutes les
cérémonies que nous observons à présent.
L'on remarquait en cette célèbre action notre Bienheureuse Mère avec un
visage tout enflammé, et une majesté toute sainte ; [152] aussi Dieu
l'avait ointe d'une huile de liesse par-dessus ses compagnes ; ce que
connaissant bien, notre saint Fondateur dit à la compagnie qui voulait demeurer
après l'action : « Retirons-nous, laissons ces épouses goûter en
silence le don de Dieu. »
CHAPITRE IV.
de la mort de m, le
président frémyot ; du voyage de notre bienheureuse à dijon, et de
quelques grâces qu'elle reçut en chemin.
La divine Providence, qui voulait donnera notre Bienheureuse Mère de
bonnes occasions de mettre en pratique ses saintes résolutions, retira à soi M.
le président Frémyot, son père, lequel était âgé d'environ soixante-treize ans.
Notre Bienheureux Père alla porter cette nouvelle à notre très-digne Mère, la
résignation de laquelle il savait assez sans qu'il eût besoin de faire de
grandes préparations pour lui donner cette nouvelle, qu'elle reçut avec une
très-pure vertu ne s'enquérant d'autre chose sinon comme quoi ce cher père
avait fini sa belle vie, et sachant que ç'avait été très-vertueusement, et que
Monseigneur de Bourges avait été Père spirituel de son cher père, et que sa fin
avait été toute chrétienne ; cela lui suffit pour lui donner un saint
soulagement, quoiqu'elle demeurât très-attendrie. Mais l'ennemi, qui ne perdait
point d'occasion d'attaquer cette âme si forte, lui livra de grands assauts
d'ennui sur le décès d'un si cher père ; « que sa retraite du monde
avait avancé sa mort ; que si au moins elle eût attendu un an, elle aurait
rendu les derniers devoirs à ce bon père ; que ferait son fils, duquel le
défunt était chargé ? » À tous ces nouveaux troubles elle n'apporta
autre remède que celui qui lui servait à l'ordinaire, d'un total acte
d'abandonnement d'elle-même et de toutes choses à la conduite de Dieu. [154]
Le décès du vertueux président fit prendre résolution qu'il fallait que
notre Bienheureuse Mère fît un voyage en Bourgogne, selon que notre saint
Fondateur avait promis pour les affaires du bien de ses enfants ; à quoi
elle se disposa six semaines après l'oblation dans laquelle nos premières Mères
ne faisaient pas vœu de pauvreté. Cette Bienheureuse Mère le fit en particulier
entre les mains de notre saint Fondateur, avant que de partir pour aller
négocier les affaires de Messieurs ses enfants, et l'écrivit en ces
termes : « Ce 22 août 1611, je, Jeanne-Françoise Frémyot, après avoir
renouvelé mes vœux d'obéissance et chasteté, pressée du désir d'une vie toute
parfaite, je fais vœu de pauvreté et soumets à l'obéissance et disposition de
Monseigneur de Genève, François de Sales, mon très-unique Père, tous mes biens
présents et à venir, non-seulement quant à l'usage et usufruit, mais aussi
quant à la propriété et disposition, pour vivre en vraie pauvre évangélique, et
ainsi je le proteste et voue au Père Éternel, au nom de Jésus-Christ son fils,
mon seul Seigneur et très-cher Sauveur, moyennant la grâce de son Saint-Esprit,
en la présence de la sacrée Vierge, mère de mon Seigneur Jésus-Christ, de saint
Joseph, de mon bon Ange, de mon saint père Abraham, des sacrés Apôtres, de ma
chère pénitente sainte Madeleine, de mon bien-aimé saint Bernard et de toute la
Cour céleste. Amen. »
Après ces vœux faits et renouvelés, et avoir reçu à l'oblation nos
très-honorées Sœurs et Mères Roget et de Châtel, elle partit pour s'acheminer à
Dijon, accompagnée de notre Mère Marie-Jacqueline Favre, et conduite par M. le
baron de Thorens, son beau-fils. De dire quelle consolation reçurent de sa
visite tous ses bons parents de Dijon, ce serait chose superflue ; elle
fut visitée généralement de quasi toute la ville, car pour elle, elle ne
sortait que par nécessité et pour aller aux églises. Elle demeura quatre mois
tant à Dijon qu'à Montelon [155] et Bourbilly, mettant ordre aux affaires de la
maison, consolant son beau-père et ses sujets, enfin édifiant tous ceux qui la
voyaient. Les parents de M. de Chantal, son feu mari, firent faire devant elle
une assemblée de gens doctes, même des religieux, pour lui persuader, par des
raisons de doctrine et de conscience, disaient-ils, qu'elle devait demeurer en
son pays pour pourvoir aux biens de ses enfants, puisqu'elle n'était pas
religieuse de clôture ; qu'elle se devait contenter de vivre parmi les
siens comme font en plusieurs lieux celles du tiers-ordre de saint
François. » Notre Bienheureuse Mère était trop bien fondée dans les
maximes de la sainte folie de la croix, pour se laisser ébranler par la folle
sagesse du monde. Il y eut une dame de ses parentes qui, voyant sa constance,
et qu'elle ne pouvait être retenue par douceur, voulait que ses proches
usassent d'autorité et de violence, lui dit en colère, « que c'était une
honte de la voir cachée sous deux aunes d'étamine ; que l'on devrait
mettre ce voile en mille pièces. » Notre Bienheureuse Mère ne répondit
rien autre, sinon qu'elle dit en souriant : « Qui aime mieux sa
couronne que sa tête ne perdra point, s'il peut, l'une sans l'autre »,
témoignant que ce voile était sa couronne, et qu'elle préférait cet état
religieux à la conservation de sa vie.
M. de Thorens admirait la sagesse de ses déportements, de ses paroles,
et de son soin à expédier bien promptement les affaires, pour s'en retourner en
sa chère Savoie, lui semblant d'être étrangère parmi son propre peuple, n'ayant
plus de pays qu'elle estimât véritablement sien que la cité permanente du Ciel,
ni de séjour agréable que celui de sa petite Visitation. Les parents firent des
instances incroyables pour la faire demeurer un an entier au pays, mais jamais
elle n'y voulut entendre. Dieu lui faisant voir qu'il y avait en cela du
stratagème de Satan, qui voulait retarder le progrès de la Congrégation, de
laquelle il n'avait su empêcher le commencement. Ainsi elle se diligenta [156]
de se retirer, ne perdant point de temps après qu'elle eut fait ce qui était
véritablement nécessaire pour le bien de ses enfants ; cette seconde
séparation fut aussi sensible que la première aux parents et sujets, mais rien
n'émouvait cette généreuse femme que ce qui la pouvait aider à sa sainte
entreprise.
Le divin Époux qui avait mené sa bien-aimée aux champs, lui donna ses
mamelles, meilleures que le vin, pendant ce voyage de Bourgogne. Elle entra
dans une petite chapelle d'une paroisse pour ouïr messe ; dès qu'elle fut
à genoux, elle fut saisie d'un sacré ravissement qui lui ôta tellement l'usage
des sens, qu'elle ne s'aperçut point quand le Prêtre se mit à l'autel ni que la
messe se dit. Assez longtemps après icelle, M. de Thorens, voyant que notre
Bienheureuse Mère demeurait en prière, s'en alla mettre ordre au dîner, puis
revint pour la quérir et demanda à notre chère Sœur Favre si notre Mère voulait
encore prier longtemps, qu'il se faisait tard ; elle lui répondit qu'elle
ne bougeait point, et qu'elle n'avait osé lui dire mot ; il fut plus
hardi, et alla réveiller cette Épouse, qui fut fort surprise. Il lui fallut du
temps pour revenir à soi, et elle demanda si l'on ne voulait pas qu'elle ouït
messe ; on lui dit qu'elle était dite il y avait longtemps ; elle ne
répondit mot, mais s'en alla, et était tellement absorbée, qu'elle ne savait
bonnement ce qu'elle faisait et ne put dîner : ce qui faisait par après
dire à M. de Thorens, quand on disait que notre Bienheureuse Mère se trouvait
mal, qu'il ne la voulait point plaindre, et que c'était Notre-Seigneur qui lui
était l'appétit. Notre Bienheureuse Mère conféra de la grâce qu'elle avait reçue
en cette petite église avec le révérend Père Granger, jésuite, et dit que
c'était l'une des grandes qu'elle eût reçues jusqu'alors ; et l'année
1635, parlant de ce voyage avec nos très-honorées Mères Favre et de Châtel,
elle leur dit, ensuite des instantes prières qu'elles lui en firent, « que
la principale lumière qu'elle reçut alors de Dieu fut du plaisir que Dieu prend
dans l'âme pure et parfaite, [157] et qu'alors elle avait eu l'inspiration du
vœu de faire toujours ce qui serait le plus parfait et le plus agréable à Dieu,
quand elle le pourrait connaître et discerner » ; lequel vœu elle fit
après qu'elle en eut obtenu le congé de notre Bienheureux Père, ainsi que nous
dirons ci-après.
CHAPITRE V.
de son incomparable
charité au service et visite des malades.
Elle fut de retour de ce voyage justement la veille de Noël, et alla
premièrement descendre chez notre Bienheureux Père, lequel elle entretint une
partie du jour du succès de son voyage, puis se retira vers ses chères filles,
lesquelles elle trouva que Dieu avait visitées en son absence de plusieurs
maladies corporelles, et comblées de beaucoup de grâces surnaturelles. Je ne
sais si jamais fêtes de Noël se passèrent avec une plus sainte et plus dévote
joie ; quoique notre Bienheureuse Mère revînt d'un assez long voyage fait
à cheval dans une saison rigoureuse, et qu'elle fût fort lasse, elle ne voulut
point de plus doux rafraîchissements que d'officier à l'Office de la nuit, où
elle assista tout au long. Les saints jours de Noël et de saint Etienne, elle
put un peu parler à notre Bienheureux Père, et lui déclara l'inspiration
qu'elle avait reçue de vouer de faire toujours ce qu'elle connaîtrait être le
plus parfait et agréable à Dieu ; il le trouva bon, et le lendemain, jour
de saint Jean l'Évangéliste, ce Bienheureux vint dire la messe de la
Communauté, pendant laquelle notre Bienheureuse Mère fit ce vœu de
très-excellente perfection.
Le dernier jour de cette année 1611, notre Bienheureuse Mère commença à
tenir le chapitre annuel, faire nomination des nouvelles officières et donner
des aides, comme il se pratique aujourd'hui. Ces changements étant faits, notre
très-honorée Sœur et Mère Favre se mit à genoux et dit : « Ma Mère,
nous [159] demandons l'obédience pour visiter les malades. » Le tout se passa
comme nous avons marqué en notre Fondation. Le lendemain, premier jour de l'an
1612, notre Bienheureuse Mère, accompagnée de notre très-honorée Sœur et Mère
Favre, sortit pour la première fois, pour aller par la ville servir les pauvres
et consoler les malades. Cette digne Mère était toujours des premières en ces
offices de charité ; on la voyait gracieusement amiable parmi les pauvres.
Pour grands que fussent leurs maux, sa charité était encore bien plus grande.
Elle allait toujours par la ville, le voile baissé sur le visage, et
accompagnée d'une religieuse, ne sortant jamais qu'elles ne fussent deux.[35] [160] Quelquefois elle trouvait des pauvres
créatures couchées dans des granges, et comme enterrées dans leurs misère et
saletés jusqu'aux épaules, faute d'avoir quelqu'un qui leur tendît la main d'un
charitable secours. Elle les nettoyait sans faire le moindre signe d'en
recevoir aucune incommodité, ains rendait ce service à ces pauvres créatures
avec un visage doux, recueilli en Dieu, affable et joyeux. Une fois, une de ses
religieuses, qui l'accompagnait souvent en telle œuvre de charité, lui demanda
comme elle pouvait faire pour ne donner jamais aucun signe de la résistance que
la nature ressent en des rencontres si mortifiantes ; elle lui répondit :
« Ma chère Fille, il ne m'est point encore tombé en la pensée que je serve
aux créatures ; j'ai toujours cru qu'en la personne de ces pauvres
j'essuie les plaies de Jésus-Christ, lorsqu'on le vit navré pour nos péchés, et
couvert d'autant de plaies que s'il eût été atteint d'une lèpre
universelle. »
C'était une chose d'édification merveilleuse de voir passer cette
sainte dame par la ville avec une ou deux de ses religieuses, le visage
couvert, portant l'une des potages, bouillon, orge, juleps aux malades, l'autre
des oreillers, couvertes, linceuls blancs, bref, tout ce qui était requis pour
le soulagement des pauvres, lesquels elle faisait voir au médecin de la maison
qui avait gage pour cela, et suivait son ordonnance autant qu'elle le pouvait.
Ce n'est pas une petite remarque de l'assistance divine, qu'en plusieurs années
que ces œuvres de charité ont duré dans les pauvretés du commencement de notre
Compagnie, jamais on ne trouva des manquements en ce qui était requis pour le
vivre et les remèdes des pauvres, quelque nombre que l'on eût à traiter. Quand
notre Bienheureuse Mère n'y pouvait pas aller, empêchée de maladie ou
d'affaires, deux [161] des plus anciennes, après avoir pris sa bénédiction,
allaient faire cette charité.
Je sais bien que ce serait m'engager dans un trop long discours de
vouloir dire par le menu les pratiques d'insignes mortifications que notre
Bienheureuse Mère faisait en cet exercice de charité, qui était son occupation
quotidienne et les délices de sa ferveur. Le saint amour de Jésus la pressait
de servir ces pauvres, et la dévotion l'empêchait de s'y empresser. Je me
contenterai de rapporter deux exemples qui feront juger du reste, la
persévérance étant la vertu qui emporte le prix des palmes les plus glorieuses.
Il y avait au faubourg d'Annecy une pauvre femme impotente de tout son
corps, qui avait un cours de ventre et dyssenterie étrange ; elle ne se
pouvait lever de son pauvre lit, non pas même se tourner seule d'un côté sur
l'autre. Tous les matins, ou peu s'en fallait, notre Bienheureuse Mère l'allait
nettoyer ; sa compagne tenait cette pauvre créature soulevée entre ses
bras, tandis que notre digne Mère lui changeait de linges, et faisait un paquet
de ceux qu'elle tirait de dessous elle, qu'elle emportait à la maison pour les
nettoyer et laver. Elle persévéra plus de quatre ou cinq mois à faire cette
charité, après lesquels cette femme étant guérie de ce cours de ventre, il lui
vint une autre incommodité, que tous les matins notre digne Mère la trouvait
toute mouillée, et séchait ses linceuls au feu avec sa compagne, à laquelle
elle commandait de détourner son visage pour ne pas recevoir la puante fumée
qui sortait de ces linges ; mais pour elle, elle ne détournait nullement
le sien, et, quand on le lui disait, elle répondait : « Je suis faite
à cela. »
Il arriva qu'une pauvre misérable fille, toute perdue de chancre et de
vérole, tomba malade à l'extrémité, et, comme elle avait abandonné Dieu, les
créatures l'abandonnèrent. Quelques dames de la ville, qui avaient charge
d'avertir notre Bienheureuse Mère des malades, lui dirent qu'il y avait en
certaine [162] grange cette misérable, ajoutant : « Mais quelle
apparence d'aller servir cette abandonnée qui a tant fait de maux ! »
« Au contraire, dit notre digne Mère, il n'y a point d'apparence de
l'abandonner ; puisqu'elle a tant fait de mal, il lui faut aider à
retourner au bien. » Soudain elle alla trouver cette pauvre créature
qu'elle trouva dans une effroyable misère, si pleine de chancre et de vermine
que cela faisait pitié ; elle avait une fièvre ardente et un gros rhume,
mais comme elle était extrêmement affaiblie, elle ne pouvait cracher. Notre
charitable Mère, avec un linge blanc, lui allait prendre les phlegmes dans la
bouche, sans se soucier du danger qu'il y a de recevoir l'haleine et de toucher
la salive de telles personnes ; elle la tondit de ses propres mains, la
peignant tous les jours pour la nettoyer de sa vermine (ce qu'elle faisait
souvent aux autres pauvres), et enfin la servit si vigilamment et
charitablement, qu'elle la guérit au corps et en l'âme, ce qui remplit la ville
d'une grande édification.
Une pauvre femme étrangère, ne sachant où se retirer, s'alla jeter dans
une étable, derrière le bétail, où elle accoucha seule, sans espoir de secours
humain ; mais Dieu en eut pitié, et donna dès le matin un grand mouvement
d'esprit à notre Bienheureuse Mère, d'aller chercher en cette étable qui était
assez reculée, et qu'elle y devait trouver une bonne besogne. En effet, elle
rencontra cette pauvre femme et son enfant, tous deux bien proches de la mort,
et prit promptement l'enfant entre ses bras, et s'étant mise à genoux, elle
l'ondoya crainte qu'il ne mourût ; puis le fit baptiser, rendit tous les
offices de charité à cette pauvre femme, lui fit apporter un lit, la servit tout
au long de ses couches et d'une grande maladie qu'elle fit par après. Dans
cette pratique de charité ici, Notre-Seigneur donna à sa fidèle Servante des
lumières particulières de sa sainte naissance dans une étable, et disait
qu'elle ne pouvait regarder cette étable où elle avait servi cette femme, sans
dévotion et reconnaissance des biens que Dieu lui avait faits en icelle. [163]
Elle avait un soin nonpareil que les pauvres qu'elle servait fussent en
bon état avec Dieu, les faisant soigneusement confesser dès le commencement de
leur mal, et n'avait pas moins de vigilance quand ils déclinaient, de leur
faire recevoir les derniers sacrements. Elle portait et faisait porter des
linceuls blancs pour mettre sur le lit des pauvres, même quelquefois sur les crèches,
quand ils étaient es granges et étables, et l'été faisait fleurir le lieu où
l'on devait porter le Saint-Sacrement, lequel elle accompagnait quand elle
pouvait avec grande dévotion ; et quand les pauvres étaient décédés, elle
les lavait et ensevelissait.
CHAPITRE VI.
de la petitesse et de
l'humilité où se tinrent nos premières mères.
Notre petite Visitation, comme une vigne nouvelle, allait tous les
jours se multipliant, et donnait une grande suavité à notre Bienheureux Père,
qui était souvent le confesseur ordinaire de cette chère Communauté, de
laquelle notre Bienheureuse Mère était Supérieure et Maîtresse des novices,
jusqu'à ce que le nombre des novices s'accrût si fort qu'elle ne put satisfaire
à tous les deux devoirs. Parmi ces douces occupations, elle avait un
contentement nonpareil, et en parlant un jour, elle disait : « Je ne
méritais pas tant de grâces que de vivre parmi ces âmes si pures et si bonnes,
desquelles je dois rendre ce témoignage, qu'il n'y avait point d'émulation
parmi elles, sinon à qui serait plus abaissée en emplois devant les yeux des
créatures, et plus relevée en ferveur, et encore je ne sais si l'on pourrait
jamais trouver une plus parfaite simplicité que celle que ces chères âmes
pratiquaient, ni plus d'amour à l'anéantissement et mortification ; leur
conversation était vraiment dévote, innocente et sans replis ni méfiance
quelconque ; elles avaient une telle exactitude, qu'elles se faisaient
conscience des moindres manquements.[36]« [165]
Notre Bienheureux Père avait désiré, pour plus d'humilité, que tour à
tour les Sœurs fissent la cuisine et les offices domestiques, afin que toutes
fussent égales. Notre Bienheureuse Mère ne se dispensait jamais, que par
maladie, d'être cuisinière à son tour, et disait que cette semaine de servir
les Sœurs était sa bonne semaine, prévoyant à l'avantage les affaires qu'elle
pouvait avoir, « afin, disait-elle, que je ne sois point divertie, s'il se
peut, de faire tout à fait ma bonne semaine. »
À cause que la maison où notre Institut se commença avait un grand
verger, et que l'on avait souvent besoin de lait pour les petits enfants des
pauvres, notre digne Mère voulut qu'on eût une vache dans l'enclos, laquelle
les Sœurs allaient garder tour à tour, afin qu'elle ne gâtât les petits
arbres ; cette digne Mère y allait fort soigneusement en son rang, et
avait beaucoup de suavité en ces exercices bas et domestiques, quand elle en
pouvait prendre le temps sans préjudice de celui qu'elle devait donner au
service spirituel de ses chères filles et novices, et de celui qu'elle
employait journellement à assister et consoler les pauvres. [166]
Il est très-vrai que son principal soin et ses plus chères affections
étaient de bien fonder ses filles à la vraie vie intérieure et de l'esprit, à
quoi toutes étaient fort attirées, en sorte qu'elles ne cherchaient que
mortification, récollection, silence et retraite en Dieu, duquel l'immense
bonté gratifiait ces chères âmes de faveurs du tout surnaturelles. Par la grâce
divine, plusieurs eurent en fort peu de temps des oraisons de quiétude, de
sommeil amoureux, d'union très-haute ; d'autres, des lumières
extraordinaires des mystères divins, où elles étaient saintement
absorbées ; quelques autres, de fréquents ravissements et saintes sorties
hors d'elle-même, pour être heureusement toutes arrêtées et prises en Dieu, où
elles recevaient de grands dons et grâces de sa divine libéralité ; et
notre Bienheureux Père, parlant, dans sa préface, de l'Amour de Dieu,
dit : « que ce saint livre est une partie des communications qu'il a
eues avec nos premières Mères et Sœurs, et que leur pureté et piété l'a obligé
à leur parler des points plus délicats de la spiritualité, passant au delà de
ce qu'il avait dit à Philothée. »
Notre Bienheureuse Mère, parlant des grâces de ce commencement de
l'Institut, dit un jour ces paroles : « Voyant ces chères âmes si
gratifiées de Dieu, et que cela allait dedans l'éclat et donnait de
l'admiration, je fus fort excitée à prier Dieu qu'il nous tînt dans notre
petitesse, ayant quasi jour et nuit ces paroles dans l'esprit : Votre
vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu, lesquelles notre Bienheureux Père
m'avait dit qu'il voulait ajouter au cérémonial de la profession qu'il
commençait à dresser. Je ruminais ces paroles avec grand sentiment de cœur, et
ayant communiqué avec notre Bienheureux Père, et par son ordre, avec notre bon
Père Jacques de Bonivard, jésuite, de mes mouvements là-dessus, qui me
portaient à faire des instances particulières à Dieu le Père, afin qu'il lui
plût cacher notre vie en lui avec Jésus-Christ, son Fils crucifié ; ils le
trouvèrent bon, et dirent tous deux messe à [167] cette intention. Je communiai
à celle de notre Bienheureux Père, et fis mon action de grâces pendant que le
révérend Père de Bonivard disait la sienne ; et comme ce très-bon
serviteur de Dieu communiait, j'eus une lumière d'esprit fort grande, et une
certitude intérieure que la très-sainte Trinité avait ouï nos prières, à
savoir, de notre Bienheureux Père, du Père de Bonivard, et de moi très-indigne,
et que sa divine Bonté avait notre requête très-agréable, et nous accordait
pour ce cher Institut un grand don de vie intérieure, cachée et souffrante
amoureusement avec Jésus-Christ en croix, et que l'immense libéralité ne
retrancherait rien des grâces préparées aux âmes qui lui seraient fidèles dans
cette petite Congrégation, mais qu'elles seraient comme les grâces du Fils de
Dieu (à proportion de notre néant), cachées en Dieu, et leur manifestation pour
l'éternité ; que si, en quelques âmes, il en paraissait quelque chose, et
s'il se faisait quelque merveille, ce serait en hommage et rapport de la
transfiguration et des œuvres miraculeuses de notre Sauveur Jésus. Ce qui me
consola extrêmement en cette vue, c'est que notre Bienheureux Père, le révérend
Père de Bonivard et moi, eûmes les mêmes sentiments, et conclûmes que Dieu
voulait que les filles de cette Congrégation fussent les adoratrices et
imitatrices des bassesses de son divin Fils, et de sa vie parfaite,
intérieurement toute cachée en Dieu et toute commune devant le
monde : de quoi nous tâchâmes de rendre à sa Bonté infinie, actions de
grâces. »
CHAPITRE VII.
de diverses maladies
de notre bienheureuse mère, de sa résignation et de son abandon dans la
souffrance.
La volonté de Dieu était que ce petit Institut fût spécialement pour
les faibles et infirmes ; c'est pourquoi il nous donna une Mère qui sut,
par son expérience, compatir à nos infirmités, afin qu'étant bien intelligente
de tout, elle confortât les autres. Les premières années de religion de notre
Bienheureuse Mère s'écoulèrent dans de perpétuelles incommodités, et cette
digne Mère nous a dit souvent que sans cela elle aurait eu une très-grande
peine que notre Bienheureux Père eût tenu l'Institut dans la modération où il
l'a laissée, touchant les pénitences et macérations corporelles, à quoi elle
était adonnée et fort inclinée.
Ses maladies commencèrent, comme nous avons dit, l'année de son
noviciat ; elle avait des intervalles très-bons, et d'ordinaire, pour ses
langueurs, ne laissait point défaire ses exercices de religion et ses fonctions
de charité, et ne parut jamais plus forte que dans son infirmité, la grâce de
Dieu faisant tout en elle et par elle. Il lui prenait quelquefois tous les
jours certains accidents si violents, qu'on la jugeait devoir bientôt trépasser ;
son visage était doux, tranquille et serein, et tout son corps destitué de
forces ; d'autres fois, elle enflait à vue d'œil, et perdait la
parole ; l'on courait promptement appeler notre Bienheureux Père ; à
mesure qu'il lui parlait de Notre-Seigneur, elle revenait [169] à elle, et
l'enflure se passait. Ce qui me fait souvenir d'une autre sainte femme et
grande servante de Dieu, sainte Catherine de Gênes, laquelle dans ses assauts
impétueux de l'amour divin qui la mettaient comme dans un martyre d'amoureuses
souffrances, trouvait un égal soulagement à entendre parler de Dieu, ce qui
modérait l'opération intérieure que l'amour faisait en elle ; ainsi,
jamais l'on ne trouva remède qui apportât soulagement à notre Bienheureuse
Mère, dans ces accidents si extraordinaires, que de faire venir notre
Bienheureux Père, lequel, écrivant sur le sujet de ces maladies, dit les
paroles suivantes : « Je recommande à vos prières la santé de la mère
abeille de notre nouvelle ruche, elle est grandement travaillée de maladie !
et notre bon M. Grandis, quoiqu'il soit l'un des doctes médecins que j'aie vus,
ne sait qu'ordonner pour ce mal, qu'il dit avoir quelque cause inconnue à
Galien. Je ne sais si le diable nous veut épouvanter par là, ou si elle n'est
point trop âpre à la cueillette ; toutefois, je sais bien qu'elle n'a
point de meilleur remède à son gré que de s'exposer au soleil de
Justice. »
Un jour que cette digne Mère était dans un accident où notre
Bienheureux Père crut quasi que la violence de la douleur et de l'amour divin
lui ravirait la vie, lui qui n'était attaché qu'à sacrifier sa volonté sur
l'autel de la volonté divine, lui dit d'un visage tranquille et
recueilli : « Peut-être, ma fille, que Dieu se veut contenter de
notre essai, et du désir que nous avons eu de lui ériger cette petite
Compagnie, comme il se contenta de la volonté qu'eut Abraham de lui sacrifier
son fils ; si cela est et qu'il lui plaise que nous nous en retournions
demi-chemin, sa volonté soit faite. — Oui, répartit la malade, mon très-cher
seigneur, sa volonté soit faite au temps et à l'éternité. — Si Dieu ne veut pas
que nous passions outre, ajouta le Bienheureux, au moins sa Bonté aura vu que
nous nous sommes mis de bonne volonté à faire l'œuvre qu'il nous avait
inspirée. » [170] Ainsi ces deux saintes âmes faisaient ensemble
d'admirables résignations.
Cependant ces maux inconnus de notre Bienheureuse Mère s'allaient
toujours augmentant, les médecins de cette ville furent d'avis que l'on fît une
consulte de plusieurs. Entre ceux qui furent appelés fut un de Genève ;
notre Bienheureux Père, comme un vigilant Pasteur, espérait par ce moyen de
retirer cette sienne brebis de la gueule du loup de l'hérésie, et lorsque pour
lui parler plus à loisir il prenait son temps en la chambre de notre très-digne
Mère, le contentement qu'elle en recevait était capable de la faire revenir de
ses accidents. Dans toute cette consulte, les médecins ne purent trouver la
cause du mal de cette digne Mère, ce qui fit dire à l'un d'iceux qu'il la
croyait plus malade d'amour divin que du détraquement des humeurs ; aussi
ne firent-ils que quelques légères ordonnances qui regardaient simplement sa
nourriture, et jamais cette sainte malade ne demanda aucun remède pour sa
guérison ; seulement elle exhortait ses filles à la soutenir par les
pommes de leurs bonnes actions dans une parfaite observance, et la récréer par
les fleurs de leurs ferventes affections au service de Dieu. Elle ne parlait
d'aucune chose qui concernât son soulagement, ayant abandonné à Dieu et à l'obéissance
sa santé et sa vie, sans qu'elle voulût plus penser ni avoir soin d'elle-même.
Il lui survint de grands accès de fièvre continue, accompagnée de mouvements
convulsifs, ce qui lui laissa une fièvre erratique qu'elle garda longtemps, et
pour laquelle le médecin lui ordonna de ne point souper, ce qui l'affaiblit
extrêmement. « Je le connaissais fort bien, dit-elle une fois, mais je n'y
arrêtais pas ma pensée, et jusqu'à ce que notre Bienheureux Père m'eût commandé
de dire quand on me donnerait quelque chose que je verrais m'être nuisible,
j'eusse eu grand scrupule de me mêler de moi-même, après m'être donnée à Dieu
et à l'obéissance, et j'eusse bien mieux aimé mourir par soumission et abandon
de [171] moi-même que de vivre par mon propre souci. » Une autre fois elle
dit que ces maux qu'elle avait eus en ses premières années de Religion ne lui
ôtaient aucune liberté pour ses fonctions d'esprit, lequel elle sentait
toujours prompt dans cette infirmité, dans laquelle, ajoute-t-elle, je
n'estimais pas de rien souffrir, sinon en la très-grande répugnance que j'avais
d'être traitée autrement que la Communauté, et pour la peine où je voyais notre
Bienheureux Père et toutes nos bonnes Sœurs, lesquelles, grâce à Dieu, mes
accidents n'empêchaient point de servir de tout mon petit pouvoir. » Il
lui arriva un de ces accidents dont nous avons parlé ci-dessus, fort violent,
qui occasionna à notre Bienheureux Père de prendre ce prétexte pour faire
revenir le médecin de Genève qui avait de bonnes dispositions pour la guérison
de son âme, sans un sien fils qui le tint si fort de près qu'il fut cause de sa
perte. En s'en retournant cette seconde fois, il dit qu'il ne pouvait trouver
au vrai la cause ni les remèdes de ce mal, et que cette dame étant si
vertueuse, il ne doutait point qu'il n'y eût quelque ressort céleste qui jouait
pour la tenir dans cette manière de souffrance. Les infirmières de notre
Bienheureuse Mère l'entendaient quelquefois, quand elle croyait être seule, qui
disait : « Oui, mon Dieu, faites souffrir, faites souffrir cette
nature trop vive, afin qu'elle apprenne s'il faut avoir tant d'ardeur aux
rigueurs extérieures pour soi et pour les autres. »
Les enfants du monde oyant parler de ces fréquents accidents de
maladies où notre Bienheureuse Mère tombait souvent, faisaient des contes à
plaisir du renversement des desseins de notre Bienheureux Père, lequel parmi
tout cela pratiquait une admirable patience, et disait « que si Dieu
voulait ôter la première pierre du fondement, que sa Providence savait ce qu'elle
voulait faire du reste de l'édifice ; que dans cette confiance il en
demeurerait en repos, » et cependant il prenait un soin incomparable de
son soulagement, la visitant comme un autre saint Jérôme sa sainte Paule, et
lui écrivant quelquefois des petits billets de dévotion. Nous en avons encore
un écrit de sa main, par lequel il la conjure de modérer son ardeur de suivre
les exercices communs, et de se conserver pour sa chère Congrégation ;
« car, voyez-vous, ma chère Mère, dit-il, vous êtes, pour cette sainte
besogne, le courage de mon cœur et le cœur de mon courage. »
CHAPITRE VIII.
de la mort du
beau-père de notre bienheureuse et de son voyage à montelon ; de sa grande
patience et débonnaireté dans la conduite de ses affaires.
Comme nous avons dit ci-dessus, les maux et accidents de notre
très-digne Mère ne l'empêchaient pas de vaquer à la conduite de sa maison, Dieu
lui ayant donné une double force d'esprit, l'une pour soutenir la maladie,
l'autre pour agir au bien intérieur et extérieur de sa Communauté qui
s'accroissait, en sorte que la petite maison du faubourg était trop étroite
pour la contenir. Il fallut penser à bâtir un monastère et à se loger dans la
ville, ce qui ne fut pas sans difficultés, lesquelles étant surmontées par la
grâce divine, on fit le changement de maison la veille de Toussaint, et le
lendemain le Saint-Sacrement y fut exposé ; cela était l'année 1612.
Après ce changement, notre chère Sœur Claude-Françoise Roget, la
première reçue en la Congrégation après nos trois premières Mères, commença à
se trouver un peu mal ; mais comme elle fut charitablement servie, et avec
grand soin, l'étisie qu'elle couvait dès son enfance ne parut pas jusqu'au
printemps de l'année suivante, et elle ne décéda pourtant qu'au mois de juin,
en l'octave du Saint-Sacrement. Notre Bienheureuse Mère la servit
charitablement en sa maladie ; l'assista soigneusement en son dernier
passage, la lava de ses propres mains, et la pleura très-maternellement. Comme
on n'avait point encore de sépulture, le corps de cette chère Sœur fut [174]
porté aux révérends Pères Jacobins ; notre Bienheureuse Mère et toutes nos
Sœurs, n'étant pas encore en clôture, assistèrent à son enterrement. Cette
chère Sœur était seulement âgée d'environ dix-huit ans, et était une vraie colombe
toute pure et propre à voler au sein de Dieu pour s'y reposer éternellement.[37]
À peine ces funérailles étaient finies, que l'on avertit notre
Bienheureuse Mère qu'il fallait rendre d'autres devoirs funèbres à M. son
beau-père qui était décédé, âgé de quatre-vingt-quatre ans. Notre Bienheureux
Père jugea qu'il était absolument nécessaire que notre digne Mère fît un voyage
en Bourgogne ; ce qu'elle entreprit par son obéissance, menant pour
compagne notre chère Mère Péronne-Marie de Châtel ; MM. les barons de Thorens
et de Chantal l'accompagnaient. Elle arriva heureusement à Montelon, où elle
parut avec un cœur doux, gracieux et compatissant envers ceux qui l'avaient
tant contrariée ; elle fit un accueil si débonnaire à la servante du bon
vieillard décédé et à ses enfants, que chacun en bénissait Dieu et en était
étonné. Comme les affaires du défunt avaient été extrêmement mal conduites,
l'on avait laissé échoir les rentes de plusieurs années, sans faire payer ces
rentes aux sujets, et ceux qui avaient payé, on ne l'avait pas mis en écrit, ce
qui ne donna pas peu de besogne à notre Bienheureuse Mère pour laisser des
comptes nets et équitables. Dès le matin, après ses exercices spirituels, elle
ne bougeait d'une salle, entourée de papiers et de paysans ; elle demeurait
dans sa dévote gravité et douce force sans se troubler, sans se passionner et
sans élever sa parole une fois plus que l'autre, ainsi que nous l'avons appris
de [175] ceux même qui étaient témoins oculaires et admirateurs de la grande
sagesse, justice et modération de cette sainte femme. Il y eut un paysan plus
hautain que les autres qui fit beaucoup de bruit, et dit plusieurs paroles
indiscrètes, parce qu'étant des amis de la servante jadis maîtresse, elle lui
avait promis de faire mettre toutes ses décharges sans qu'il eût payé. Ce que
ne trouvant pas fait, il se mit en terrible colère contre notre digne Mère,
pensant et disant qu'elle avait arraché son feuillet. Comme elle vit ce pauvre
homme si passionné et parlant contre elle avec tant d'extravagance, elle
empêcha M. le baron de Thorens, qui était présent, de lui donner des coups de
bâton, et fit mettre notre chère Mère de Châtel en prière pour ce passionné,
duquel s'approchant gracieusement elle le prit par les cheveux et lui fit le
signe de la croix sur le front- au même instant, son esprit fut changé, il se
jeta à genoux et découvrit devant tous son tort, demandant pardon et
miséricorde. Elle lui accorda l'un et l'autre très-copieusement, et fit grâce à
d'autres qu'elle jugeait qui eussent été trop molestés, si on les eût
contraints de payer toutes les échutes.
Elle visita tous les terriers et titres principaux des biens, des
maisons de ses enfants, les contrats, livres de raisons, bref, tout ce qui
était requis pour établir un bon ordre ; elle mit des grangers aux
métairies, des fermiers et receveurs aux châteaux ; elle allait à cheval
tout d'un jour de Montelon à Bourbilly, qui sont éloignés de dix ou douze
lieues. D'autant que le baron, son fils, était encore jeune et engagé à la
cour, elle fit vendre une partie des meubles qui se pouvaient gâter, laissant
seulement quelques chambres garnies. Avant de partir, elle eut soin, par une
très-grande charité, de bien accommoder la servante du bon vieillard défunt, et
ses enfants, les récompensant du mal qu'elle avait reçu d'eux, comme s'ils
eussent été ses grands bienfaiteurs, sans plus parler des choses [176] passées.[38] Elle faisait venir cette femme manger avec
elle et l'entretenir de ce que faisait et disait feu son beau-père depuis son
départ, et de l'heureuse fin de bon catholique que Dieu lui avait fait la grâce
d'avoir.
Ce fut une chose qui édifiait grandement, que lorsque cette sainte
femme traitait des affaires, elle ne s'alléguait jamais, se tenant pour
vraiment morte au monde ; mais disait toujours : « Vous devez à
mes enfants telle et telle chose », et ainsi en toutes autres rencontres
elle avait des termes singuliers hors d'elle. A son retour de ce voyage qui ne
dura que six semaines en tout, elle passa à Dijon, remplissant chacun d'édification,
ne s'arrêtant ni là ni ailleurs, qu'autant que la nécessité le requérait.
Le révérend Père Mathias de Dôle, capucin de grande vertu et
réputation, qui avait fréquenté souvent notre très-digne Mère avant sa
retraite, la visita plusieurs fois, tandis qu'en ce voyage elle fut en
Bourgogne, où il était gardien des capucins du couvent d'Autun. Il en écrivit à
notre Bienheureux Père les paroles suivantes : « Ce n'est plus une
Judith que notre madame de » Chantal, c'est une sainte Paule ; toutes
ses actions font voir » l'opération de Dieu en son âme, et les traces de
votre [177] direction ; ce n'est plus une baronne, c'est une
Sulamite ; toute cette contrée reste pleine de la douce odeur de ses
célestes vertus ; nos religieuses de Dijon, comme les filles de Sion, l'annoncent
Bienheureuse, et toutes nos dames la louent hautement. »
CHAPITRE IX.
notre dévote mère
fonde une maison de notre institut à lyon ; elle reçoit alors quelques
grâces miraculeuses.
Au retour de ce voyage, l'année 1613 était sur son déclin ; ce qui
en restait et toute l'année suivante 1614, fut employé, avec plusieurs
difficultés, à commencer de bâtir un monastère, ainsi que nous avons bien
amplement discouru dans notre fondation, et des obstacles qui se présentèrent,
parmi lesquels nos bienheureux Fondateur et Fondatrice pratiquèrent d'insignes
vertus : et Dieu bénissait tellement leurs desseins, que, malgré tous les
empêchements, sans que l'un ni l'autre sortissent de leur paix et tranquillité,
la besogne s'avançait heureusement.
Tandis que le bâtiment de ce premier monastère de l'Institut
s'avançait, Notre-Seigneur disposait le spirituel et le temporel pour commencer
une seconde maison de la Congrégation. Ce sage père de famille qui n'allume pas
la chandelle pour la mettre cachée sous le boisseau, ne voulut pas cacher plus
longtemps notre très-digne Mère, qui était un flambeau de toutes vertus dans ce
recoin où son humilité se plaisait si parfaitement.
Madame de Gouffier, religieuse du Paraclet au pays de Saintonge, ayant
vu l’Introduction à la vie dévote, et appris que l'auteur de ce divin
livre avait érigé une Congrégation, où il avait donné des lois encore plus
parfaites et spirituelles que celles qu'elle admirait dans ce cher livre, elle
fit vœu à Dieu de ne cesser de procurer de venir en Savoie pour voir ce saint
[179] Prélat et sa Congrégation ; elle trouva à Lyon madame d'Auxerre,
laquelle était touchée du même désir. C'était une dame de grande qualité et
moyens, qui depuis vingt ans qu'elle était veuve, aspirait incessamment à la
vie parfaite et retirée ; elle avait cherché son repos dans toutes les
maisons religieuses de femmes dont elle s'était pu aviser, non qu'elle y fût
entrée, mais par la communication et connaissance qu'elle prenait de leur
Institut, sans y pouvoir trouver ce qu'elle cherchait. Elle vint donc à Annecy
avec madame de Gouffier, après Pâques de l'année 1613, et dès la première fois
qu'elle vit notre très-digne Mère avec sa petite troupe, elle sentit en son âme
le repos qu'elle avait cherché jusqu'alors sans le trouver, et dit : et
Vraiment, voici la manière de vie que Dieu m'a toujours fait désirer, sans la
connaître. » Elle s'en retourna à Lyon bien résolue d'y procurer
l'érection d'une maison de sainte Marie, comme celle qu'elle avait vue à
Annecy, ce qu'il lui fut facile d'obtenir de Mgr Denis de Marquemont ;
mais l'ennemi de toutes bonnes œuvres vint à la traverse et fit changer tout ce
dessein, ainsi que nous l'avons amplement décrit au petit recueil de la vie de
cette chère Sœur, et en la fondation de Lyon.
Il s'éleva un peu de jalousie contre la Congrégation de la Visitation,
et l'on voulut faire à Lyon une Congrégation de la Présentation, laquelle on
commença, et voulut-on que la bonne madame d'Auxerre fût à Lyon, comme la Mère
de Chantal à Annecy, fondatrice et supérieure de cette Maison. Quoique cette
très-bonne âme n'aimât rien tant que la petite Visitation qu'elle avait vue, et
n'eût plus grande crainte que de s'engager à la conduite, néanmoins, pressée
des Puissances supérieures, elle se soumit ; on voila des filles :
nouvelle qui fut apportée à Annecy lorsqu'on croyait que l'on venait prendre
des Sœurs pour aller fonder à Lyon. Notre Bienheureuse Mère ne se fâcha
aucunement de ce changement, au contraire, elle en bénit Dieu, disant à nos
Sœurs « que cela devait apprendre à toutes qu'il [180] faut jeter de
profondes racines en la très-sainte humilité, et qu'après, Dieu aurait soin de
faire jeter çà et là les branches de cet Institut », maxime qu'elle a
gardée toute sa vie, ayant toujours eu plus de soin incomparablement d'établir
et fonder son Ordre ès vraies vertus, que d'en augmenter le nombre des maisons.
Or, si le Seigneur n'édifie la maison, ceux qui la bâtissent
travaillent pour néant ; l'esprit humain avait commencé cette nouvelle
Congrégation de la Présentation, l'esprit humain la détruisit. La confusion des
langues se jeta parmi ces congrégées ; je veux dire il arriva parmi elles
une telle mésintelligence, qu'elles ne purent vivre six semaines ensemble,
quoique toutes fussent de très-bonnes âmes ; mais il ne plaisait pas à
Dieu de bénir leur assemblée, tellement que l'on n'eut plus de hâte que
d'écrire à notre Bienheureux Père et à notre très-digne Mère, qu'il fallait que
les filles de la Visitation de sainte Marie allassent fonder à Lyon. Mgr le
cardinal Denis de Marquemont, archevêque de Lyon, envoya M. Mesnard, sacristain
de Saint-Nisier, avec un carrosse quérir les Sœurs. Notre très-digne Mère
partit d'Annecy, le jour de la conversion de saint Paul 1615, avec nos
très-honorées Mères Marie-Jacqueline Favre, Péronne-Marie de Châtel,
Marie-Aimée de Blonay, et encore madame de Gouffier qui tenait place et faisait
toutes les fonctions des religieuses.
Notre très-digne Mère allait à Lyon bien incommodée corporellement, sa
santé étant fort petite, mais grandement joyeuse en son âme d'aller travailler
pour la gloire de Dieu. Elle sentit aux approches de Lyon les bons Anges du
royaume de France qui lui faisaient l'accueil, et eut une grande certitude
intérieure du progrès et du fruit que l'Institut ferait en France, et que cela
était la cause d'une nouvelle joie entre les Anges.
Avant que notre Bienheureuse Mère et sa chère troupe arrivassent à
Lyon, l'on voulut visiter les patentes royales obtenues pour l'autre
établissement, afin de faire changer le mot de [181] Présentation en celui de
Visitation- pour cela il fallait quelque retardement, et des allées et venues.
Notre-Seigneur y mit ordre : à l'ouverture des patentes, l'on vit que le
mot était miraculeusement changé, et qu'où les hommes avaient mis Congrégation
de la Présentation, il y avait en beau caractère bien formé, Congrégation
de la Visitation Sainte-Marie ; cette merveille fut grandement
admirée, toucha bien les cœurs, et fut cause que notre petit Institut fut mieux
goûté qu'il n'eût été. Ceux qui avaient été contraires à notre établissement
disaient alors : « La main de Dieu travaille pour ces Religieuses
ici. »
La veille de la Purification, notre Bienheureuse Mère et ses filles
arrivèrent heureusement, et furent chèrement et joyeusement reçues des
congrégées, singulièrement de la bonne madame d'Auxerre, laquelle n'ayant
jamais aspiré qu'à la perfection de l'humilité, se déposa tout à l'heure de la
charge qu'on lui avait donnée en cette maison, remit les clefs à notre
Bienheureuse Mère, mais elle lui remit encore plus parfaitement son cœur et sa
volonté ; ce que firent pareillement ses deux compagnes, car la quatrième
s'était retirée de parmi elles avant la venue de nos Sœurs. Le lendemain, jour
de la Purification de cette Vierge plus pure que le soleil, l'établissement de
ces petites filles de Sainte-Marie de la Visitation se fit avec grande
solennité, Mgr de Marquemont faisant lui-même l'action, et témoignant une
grande estime et respect de la vertu de notre Bienheureuse Mère.[39] Ce même jour, la bonne madame d'Auxerre
[182] changea d'habit, et ses deux compagnes aussi, et prirent celui de
novices. Elle prit le nom de Marie-Renée, et fut fondatrice temporelle de cette
maison-là, comme il est marqué en la fondation, et au recueil de la vie de
cette très-honorée Sœur qui était véritablement un soleil de vertus, mais
excellemment sur toutes, de l'humilité. Notre Bienheureuse Mère nous a dit
qu'elle ne voyait jamais cette bonne Sœur sans sentir son âme émue de
s'abaisser devant Dieu, à l'exemple de l'abaissement et anéantissement qui
reluisaient en cette vertueuse novice, laquelle, de son côté, s'estimait si
indigne d'être en la compagnie de notre Bienheureuse Mère, qu'elle ne l'osait
quasi approcher, et disait que Dieu lui avait dit en son cœur, quand cette
digne Mère était entrée en leur maison : « Je vous donne pour vous
conduire l'une des plus grandes Servantes que j'aie maintenant sur terre ;
en cela, ma fille, je vous témoigne mon amour. » Cela demeura si fort
imprimé au cœur de notre chère Sœur d'Auxerre, qu'à peine osait-elle regarder
en face notre digne Mère, et si elle parlait à ses deux compagnes ou aux autres
novices qui furent reçues après elle, c'était pour les exciter à bien profiter
de la conduite de cette unique Mère. On l'a quelquefois entendue dans l'excès
de sa ferveur, croyant être seule, qu'elle se disait à elle-même :
« Sais-tu qui tu es, Marie-Renée ? tu es un atome d'ordures auprès de
cette montagne de perfection ; » puis se tournant vers
Notre-Seigneur : « Ah ! mon Dieu, disait-elle, si vous me permettez
de vous faire une demande, je vous supplie que la mort ferme mes yeux ; il
me suffit, puisque je vois une maison de sainte Marie en France ;
mettez-moi au purgatoire pour purger mes péchés, et ne me laissez plus jouir de
tant de bonheur que de demeurer avec votre Sainte. » Voilà comme les
justes se connaissent à fond les uns les autres ; cette bonne servante du
Seigneur fut écoutée du Ciel, car elle ne fit pas son noviciat entier, qu'elle
fut jugée digne d'aller faire l'éternelle profession de l'amour et eut la grâce
à [183] laquelle son humilité l'empêchait d'aspirer. Notre Bienheureuse Mère
lui ferma les yeux et l'assista en son dernier passage, qu'elle fit aussi
saintement que sa grande persévérance aux vertus et en la vraie dévotion le
pouvait faire espérer et souhaiter.
Or, quoique notre très-honorée Sœur d'Auxerre eût très-honnêtement
donné pour la fondation, l'on ne laissa pas au commencement d'avoir beaucoup de
pauvreté et d'incommodité, d'autant que ses parents qui étaient mécontents au
possible de la bonne œuvre qu'elle faisait, lui saisirent son bien, et lui
firent plusieurs grandes contradictions que notre Bienheureuse Mère supporta et
surmonta avec une généreuse humilité et adresse très-grande à ajuster toutes
choses avec paix. Durant ces contradictions, notre très-digne Mère goûtait avec
de grandes suavités les fruits intérieurs de la pauvreté et disette où était le
monastère. Une fois, entre autres, étant tout à fait réduite à ne savoir plus
où prendre pour nourrir sa Communauté, elle en confiait amoureusement le soin à
la céleste Providence, quand voilà qu'un homme inconnu sonne à la porte, et dit
à la portière : « Faites-moi venir la Mère de Chantal. » Quand
elle fut là, il lui mit en main un papier sans lui dire ce que c'était, mais
seulement lui dit : « Madame, celui qui vous envoie cette aumône vous
prie de prier pour lui, » et s'en alla comme cela. Notre très-digne Mère
retourna à la Communauté, car on était à la récréation ; elle n'avait
point encore ouvert son papier ; elle le déplia devant toutes les Sœurs,
et trouva dans icelui quatre-vingts écus au soleil. Les larmes lui vinrent aux
yeux d'une très-humble reconnaissance envers la divine Bonté, et mena toutes
ses chères filles en faire action de grâces à l'auteur de tous biens. De là à
quelque temps, se trouvant un peu en peine, n'ayant pas de quoi acheter une
custode d'argent, et lui fâchant de laisser le Très-Saint-Sacrement dans une
d'étain, elle pria ce divin Sauveur, puisqu'il prenait tant de soin de ses [184] épouses,
qu'il prît aussi soin de soi-même ; ce qu'il fit, et lorsque l'on y
pensait le moins, une personne inconnue vint derechef sonner à la porte, et
sans vouloir dire son nom, donna une custode d'argent dorée, priant instamment
que l'on s'en servît le plus tôt qu'il se pourrait.
Notre Bienheureuse Mère demeura neuf mois à Lyon, reçut sept
religieuses, supporta beaucoup de traverses, dont les nouveaux Instituts ne
sont jamais exempts, et laissa Supérieure notre très-honorée Mère
Marie-Jacqueline Favre ; assistante et directrice, notre bien chère Mère
Marie-Aimée de Blonay, et s'en revint accompagnée de notre chère Sœur
Marie-Hélène Darères, alors dite madame de Vars, femme veuve de beaucoup de
piété et de vertu, et fille spirituelle de notre Bienheureux Père.
CHAPITRE X.
notre bienheureuse
fait une nouvelle fondation à moulins ; sa constance sur la mort de sa
fille ; elle éprouve quelques peines d'esprit sur le baptême de son
petit-fils.
À peine notre Bienheureuse Mère était de retour de la fondation de
Lyon, que non-seulement plusieurs filles, mais plusieurs villes entières,
courant après l'odeur de ses vertus, demandèrent des établissements de
Sainte-Marie, et, si l'on eût eu des religieuses assez pour fournir partout,
plusieurs maisons se fussent faites, qui ne l'ont été que bien des années
après, même qui ne le sont pas encore, et nous avons trouvé un billet écrit de
la sainte main de notre Bienheureux Père qui dit ces mots :
« Vraiment, la moisson est bien grande, il se faut confier que Dieu
donnera des ouvrières ; voilà Toulouse qui veut de nos filles de
Sainte-Marie, Moulins, Riom, Montbrison, Reims, et c'est grand cas, partout
l'on veut la Mère. » Et, en un autre billet, écrivant à notre Bienheureuse
Mère, ce saint Prélat dit : « Hé ! ma très-chère Mère, je dis,
ma très-unique Mère, que nous avons d'obligation à Notre-Seigneur ! et
combien de confiance devons-nous avoir que ce que sa miséricorde a commencé en
nous, elle le parachèvera, et donnera un tel accroissement à ce peu d'huile de
bonne volonté que nous avons, que tous nos vaisseaux s'en rempliront, et
plusieurs autres de ceux de nos voisins, par diverses fondations. »
Pour cela, cette digne Mère, comme la pieuse veuve qui [186] obéissait
à l'homme de Dieu, fermait bien sa chambre sur elle, je veux dire, se tenait petite,
humble et cachée aux yeux du monde, et son cœur tout retiré en la divine Bonté
et dans l'étroite observance. L'année 1615 se finit en cette sorte, et la
suivante, 1616, à peine se commença, que Notre-Seigneur visita notre très-digne
Mère de grands maux corporels et langueurs irrémédiables qui lui étaient
causés, comme l'on croyait, parce qu'elle n'avait pas pris le loisir de se bien
remettre d'une grande maladie qu'elle avait faite à Lyon durant les neuf mois
de son séjour.
Cependant, le printemps étant venu, la ville de Moulins pressait avec
tant d'instances pour avoir des Sœurs pour faire un établissement, que tout
retardement était ennuyeux. L'on verra, dans la propre fondation de cette
maison-là, diverses lettres écrites sur ce sujet à notre Bienheureux Père, de
Monseigneur l'archevêque de Lyon, qui avait alors l'administration de l'évêché
d'Autun, par droit de régale, duquel Moulins dépend. Ce grand cardinal faisait
de grandes instances afin que notre digne Mère allât à Moulins, dresser une
semblable maison que celle qu'elle avait établie à Lyon, de laquelle il disait
recevoir une suavité nonpareille, et toute la province une odeur d'édification
très-grande. M. le maréchal de Saint-Géran, gouverneur du Bourbonnais, les
maires et syndics, M. le Doyen de Notre-Dame, et encore le révérend Père
recteur des Jésuites de Moulins, écrivirent à notre Bienheureux Père, tant pour
demander l'établissement que pour le conjurer que la digne main de cette grande
ouvrière, la Mère de Chantal, allât planter cette nouvelle plante. Il ne plut
pas à Notre-Seigneur de lui donner force et santé pour cela, tellement que,
pour ne plus retarder, le 16 juillet 1616, notre très-honorée Sœur et Mère
Jeanne-Charlotte de Bréchard partit avec quatre compagnes pour aller fonder la
maison de Moulins. Ainsi, ce fut encore une permission de la divine Providence
que cette troisième [187] Mère de l'Institut allât être Supérieure en la
troisième maison d'icelui, comme la première et la seconde l'étaient aux deux
autres, à Annecy et à Lyon.
Peu de temps après le départ de nos chères Sœurs pour la fondation de
Moulins, notre très-digne Mère se porta mieux, et prenait beaucoup de peine,
tant pour faire avancer le bâtiment du monastère qui se faisait alors, et
duquel elle-même avait le soin et la conduite, que pour élever et fonder dans
les vraies vertus religieuses quantité de filles qui étaient reçues, et
lesquelles, quasi toutes, ont rendu en divers lieux des services signalés à
l'Institut, faisant honneur à la digne main qui les avait élevées.
Il semblait que la divine Providence ne donnait de la santé et de la
force à notre Bienheureuse Mère qu'afin qu'elle se disposât à lui faire un
sacrifice de son propre sang. Elle avait auprès d'elle, c'est-à-dire en Savoie,
sa chère fille, la baronne de Thorens, dame des plus accomplies extérieurement
et intérieurement que l'on ait guère vues ; elle était en la fine fleur de
son âge, possédant une parfaite beauté et bonne grâce de corps, et une sincère
pureté de cœur et piété en ses actions, lesquelles elle réglait selon les
enseignements à la vie dévote à laquelle elle s'était du tout rangée. Notre
Bienheureux Père était non-seulement son beau-frère, mais son confesseur et son
père spirituel, et notre digne Mère non-seulement sa mère, mais la directrice de
son âme. Dès que le baron son mari était absent, si quelque devoir bien
légitime ne la retenait en son ménage, elle se retirait au monastère proche de
sa digne mère pour s'affermir toujours davantage en la piété et aux exercices
de dévotion. Au commencement de l'année 1617, le baron de Thorens fut commandé
de mener un régiment en Piémont, où, peu de temps après son arrivée, il fut
atteint de maladie et décéda saintement entre les soldats, dit notre
Bienheureux Père, « où il y a si peu de saints. » Ce décès fut une
plaie de douleur [188] incomparable au cœur de notre très-digne Mère qui aimait
ce cavalier comme s'il eût été son propre fils ; elle supporta ce coup
avec cette généreuse force d'esprit et résignation aux divines volontés, qui a
toujours relui en elle comme un sacré flambeau dans la nuit de tant de diverses
afflictions dont sa vie a été traversée.
La jeune veuve de ce brave baron était au monastère[40] près de sa bonne mère lorsqu'elle reçut ce
coup de mort, et se comporta avec une parfaite vertu, dans une douleur qui ne
se peut exprimer. Elle était enceinte dès fort peu de temps ; n'eût été sa
grossesse, dès le jour qu'elle sut sa viduité, elle eût pris l'habit de sainte
Marie des mains de sa digne mère, auprès de laquelle elle demeura environ cinq
mois. Une nuit, lorsque l'on s'y attendait le moins, elle fut violemment saisie
des tranchées de l'enfantement. Le péril évident de la mort où on la voyait fut
cause qu'on ne la fit pas porter en la maison de la ville qu'on avait préparée
pour ses couches, notre Bienheureux Père ne le voulant pas, mais fit entrer
plusieurs dames des plus honorables et amies de notre Bienheureuse Mère. La
pauvre veuve accoucha d'un fils qui eut la grâce que Job avait demandée, d'être
porté du sein de sa mère en celui de la terre. Ce pauvre petit n'eut de vie
mortelle que pour être régénéré en l'immortelle par le saint sacrement de
baptême, qui lui fut conféré à cause de l'urgente nécessité, par sa sainte
grand'mère, laquelle le vit expirer entre ses bras, et ce fut une chose
admirable de voir la résignation, la force et la tranquillité de son esprit
parmi des rencontres d'eux-mêmes si affligeants et si attendrissants pour un
cœur maternel qui, comme le sien, au récit de notre Bienheureux Père,
« aimait puissamment et ressentait vivement. » [189]
La patiente accouchée se disposa à suivre de bien près en l'autre monde
son cher enfant, et parce que nous avons écrit son histoire un peu au long afin
de la joindre à celle de sa sainte mère, comme ce petit rameau d'or qui sortit
jadis d'un arbre de merveille, nous ne répéterons pas ici sa sainte mort,
seulement dirons-nous qu'elle reçut l'habit de novice, fit profession et mourut
entre les bras de notre Bienheureux Père et de notre Bienheureuse Mère et la
sienne, qui eut le courage de lui fermer les yeux. Elle fut enterrée dans
l'église de ce monastère, et est la première qui y ait été mise.
Après la sépulture de cette aimable défunte qui, comme vraie fille de
la Congrégation, fut enterrée dans notre habit, l'ennemi, jaloux de la constance
de notre très-digne Mère, et dépité que dans l'accident mortel d'une fille si
chère elle n'eût donné que des bénédictions à Dieu, la vint traverser par une
bourrasque qui l'affligea au non plus, lui jetant si vivement dans l'esprit
qu'elle n'avait point donné d'eau à son petit-fils en le baptisant, et qu'elle
n'avait point bien dit les paroles nécessaires pour le saint baptême ; que
par ainsi son imprudence et sa précipitation seraient cause que cette petite
âme ne verrait jamais Dieu et se lamenterait éternellement contre elle. Cette
peine offusqua tellement la mémoire de notre très-digne Mère, qu'elle ne se
pouvait en façon quelconque souvenir comme elle avait fait cette action, et
croyait vrai ce que la tentation lui suggérait. Elle envoya quérir notre
Bienheureux Père, et se jetant à ses pieds toute baignée de larmes, lui demanda
pénitence de la faute qu'elle croyait avoir faite, et comme elle répétait ces
paroles : « Moi, Monseigneur, que je sois cause qu'une âme ne voie
jamais Dieu, que j'en sois cause ! » Le Bienheureux lui dit :
« Ma Mère, d'où vient ceci que vous vous regardiez vous-même, avez-vous
encore quelque intérêt propre ? » À ces mots, elle vit que la
violence de sa tentation était venue du regard et de la réflexion qu'elle [190]
avait fait sur elle-même. Sa mémoire revint en sa liberté et elle et les Sœurs
qui étaient présentes se ressouvinrent fort bien qu'elle avait jeté de l'eau
bénite sur le petit enfant, et avait prononcé avec très-grande ferveur les
sacrées paroles ordonnées par la sainte Église.
Quand notre Bienheureuse Mère nous parlait, plusieurs années après, de
l'imperfection de la contrition et des douleurs des fautes, elle disait
quelquefois cet exemple, et que notre Bienheureux Père lui avait fort inculqué
que, dans les regrets du mal, il faut plus regarder Dieu, contre qui il est
commis, que nous qui l'avons commis, et que dans ce regard d'un Dieu si bon et
si miséricordieux, offensé, la contrition est plus vive, l'âme plus épurée,
l'esprit mieux éclairé, et l'ennemi a moins de prise pour embrouiller le cœur.
Cette digne Mère nous a dit : « que depuis ce jour-là l'instruction
de ce Bienheureux lui avait toujours servi de méthode pour tous ses actes de
contrition. »
CHAPITRE XI.
notre bienheureuse
mère est guérie par miracle d'une grande maladie ; elle fonde deux
maisons : grenoble et bourges.
Quelques semaines après que notre très-digne Mère eût fait les
funérailles de sa chère fille, l'on crut qu'il faudrait faire les
siennes ; elle fut atteinte d'une grande fièvre continue. Dès le
commencement de cette maladie, elle commanda à son infirmière de lui venir
faire tous les jours son examen, et lui dire sincèrement les fautes qu'elle
commettrait. Elle lui ordonna aussi de bien prendre garde que l'on ne lui
donnât aucun remède de prix exquis, « lesquels, dit-elle, me sont en
horreur, parce que cela ressent les délicatesses et superfluités
mondaines ; » elle se faisait lire le discours de saint Bernard aux
religieux malades du Mont-Dieu, et disait à son infirmière, qui était notre très-bonne
Mère Péronne-Marie de Châtel, « qu'encore que les avis de ce grand saint
ne s'observent pas en ce temps à la lettre, à cause de la faiblesse de notre
nature ; que néanmoins, toutes les personnes religieuses les doivent avoir
devant les yeux en leurs maladies, pour en tirer matière d'humiliation et des
motifs d'amour à la souffrance, quand on ne les sert pas à leur gré, voyant que
pour mal qu'elles soient, elles sont beaucoup mieux que n'étaient ces saints
personnages. » Cette affection à la sainte pauvreté et à la souffrance
était accompagnée d'une obéissance si religieuse, qu'elle prenait et faisait
tout ce que le médecin lui ordonnait. Il plut à Dieu de la mener jusqu'aux
portes de la mort, pour l'en [192] retirer ; elle reçut tous ses sacrements,
et était si basse qu'on la croyait dans sa dernière agonie, quand notre
Bienheureux Père fut inspiré de lui donner à prendre des reliques du grand
saint Charles, archevêque de Milan, auquel il fit un vœu. À l'instant qu'il eut
donné les saintes reliques à la malade, elle fit un grand soupir que l'on
croyait être le dernier ; mais, ouvrant les yeux, elle dit à notre
Bienheureux Père : « Mon Père, je ne mourrai pas. — Non, ma fille,
lui répliqua-t-il, vous vivrez éternellement par la divine miséricorde. — J'entends,
dit la convalescente, que je suis guérie et me porte fort bien, grâce à Dieu et
à son saint. » À ces paroles, le Bienheureux Prélat, qui était entouré de
toute la Communauté de ses filles, entonna une douce action de grâces à Dieu,
que l'on poursuivit joyeusement ; et, dans peu de jours, notre très-digne
Mère eut repris ses premières forces, ne demeurant point faible et languissante
de cette maladie, comme elle faisait d'ordinaire des autres ; aussi, le
médecin qui l'avait guérie ne fait jamais des cures imparfaites. Si Dieu
redonna la santé et la vie à sa fidèle Servante, elle l'employa soudain, comme
la belle-mère de saint Pierre, au service de sa divine Majesté. Cette guérison
arriva au commencement de février 1618.
Peu de jours après icelle, notre saint Fondateur partit pour aller
prêcher le carême à Grenoble, où il en avait déjà prêché un. Soudain qu'il fut
en cette ville, on le sollicita bien fort de faire venir de ses Filles de la
Visitation Sainte-Marie. Il y avait déjà quatre demoiselles de Grenoble qui
étaient venues à Annecy prendre notre habit, pour donner plus de facilité à
faire l'établissement. Notre Bienheureux Père manda donc à notre très-digne
Mère « qu'elle l'allât trouver à Grenoble, et menât des Sœurs pour faire
l'établissement et les quatre novices reçues à cette intention. »
Cette digne Mère, avec ses religieuses, arriva le septième avril,
veille des Rameaux, l'année que dessus 1618. [193] Monseigneur de Calcédoine,
coadjuteur de l'évêché de Grenoble, reçut fort honorablement notre Bienheureuse
Mère, et, avec le clergé, lui offrit toutes sortes d'assistances. Ce bon
Monseigneur de Calcédoine[41] demeura si édifié, qu'il désira le lendemain
de confesser notre digne Mère et ses filles, ce qu'il fit, et en reçut tant de
satisfaction, qu'il disait n'avoir jamais rencontré des consciences semblables.
Il distribua les palmes aux Sœurs, fit l'office de l'autel, dit la sainte
messe, communia la Communauté et exposa le Saint-Sacrement ; dès ce jour,
l'établissement fut fait. Notre Bienheureuse Mère demeura à Grenoble environ
six semaines, pendant lequel temps elle visita plusieurs maisons pour en
acheter une, et, n'en trouvant point, elle arrêta que l'on achèterait une place
nommée Chalemont, lieu écarté, montueux, et qui était hors de tout commerce,
quoique dans l'enceinte de la ville ; elle dit que plusieurs incommodités
que l'on aurait à bâtir en ce lieu-là seraient récompensées par la tranquillité
de laquelle l'on y jouirait favorablement. Elle donna place à quelques filles
et établit supérieure notre très-honorée Mère Péronne-Marie de Châtel, puis
s'en retourna en cette maison d'Annecy, accompagnée de notre chère Sœur et Mère
Claude-Agnès de la Roche. Il n'y avait pas quinze jours qu'elle était de
retour, quand elle reçut des lettres qu'il fallait partir pour aller établir
une maison dans la ville de Bourges, où elle s'achemina soudain avec des Sœurs,[42] passa par nos maisons [194] de Lyon et de
Moulins, et arriva heureusement à Bourges, et fut reçue fort solennellement
avec musique dans la grande église. Monsieur le grand vicaire monta en chaire
et fit une petite exhortation au peuple, le congratulant de l'arrivée de cette
sainte femme, et lui dit que c'était ce que voulait signifier une grande et
admirable comète qui avait paru fort gracieusement sur la ville de Bourges,
deux jours auparavant l'arrivée de notre digne Mère ; que cet astre du
ciel leur avait annoncé la bénédiction qui leur devait arriver de posséder
quelque temps dans leur ville une si grande servante de Dieu. L'établissement
se fit avec grand applaudissement du peuple, et notre Bienheureuse Mère demeura
six mois en cette nouvelle maison, avec beaucoup de pauvreté, quoique
Monseigneur l'archevêque, son unique frère, eût ordonné à ses gens d'avoir un
extrême soin que rien ne manquât au monastère ; néanmoins, Dieu permettait
fréquemment que la négligence des officiers donnât matière à cette digne Mère
d'exercer la pauvreté. On s'est trouvé quelquefois sans avoir du pain pour le
dîner ; elle exhortait les Sœurs de ne pas laisser d'aller au réfectoire à
l'heure ordonnée par la règle, et se contenter de manger leur potage, et il est
arrivé deux ou trois fois que justement quand le Benedicite était dit,
l'on sonnait à la porte, et quelques bonnes femmes, qui humainement ne savaient
pas la nécessité où l'on était, apportaient pour toutes les Sœurs chacune un
pain bien blanc et bien frais.
Notre digne Mère ne voulait point permettre que l'on avertît
Monseigneur de Bourges de la négligence de ses officiers, tant pour n'être
importune, que pour avoir toujours quelque chose à endurer pour Notre-Seigneur,
comme aussi parce qu'elle souffrait avec peine cet appareil avec lequel son
digne frère voulut qu'elle fût servie tandis qu'elle demeura à Bourges. Elle en
écrivit à notre Bienheureux Père, qui lui fit « réponse qu'elle agît avec
liberté d'esprit et sans scrupule ; que ce qui se [195] souffrait par
obéissance et condescendance, quoiqu'il nous fût désagréable, ne pouvait être
que bon, et qu'elle usât sans cérémonie des viandes que Monseigneur de Bourges
lui enverrait. »
Le temps qu'elle demeura dans ce nouvel établissement, elle accommoda
fort joliment la maison, reçut plusieurs bonnes filles, et les établit dans une
grande ferveur et observance. Notre Bienheureux Père était alors à Paris, et
lui manda de l'aller trouver, « que tandis qu'il était là, il fallait
seconder les désirs de plusieurs bonnes âmes qui désiraient un établissement de
Sainte-Marie dans Paris ; qu'il y avait des difficultés innombrables, mais
que Dieu peut tout vaincre. » « Dans cette pensée, ma chère Mère,
disait ce Bienheureux, prenons nouveau courage, ou plutôt renouvelons notre
ancien courage pour faire merveille au service de Dieu, et de notre bien-aimée
petite Congrégation qui est sienne. »
Quand Monseigneur de Bourges, qui espérait de garder près de soi
quelques années sa digne sœur, s'aperçut qu'elle se disposait d'aller à Paris,
il s'opposa tout de bon à ce voyage. Elle lui fît plusieurs aimables
remontrances sans le pouvoir vaincre ; enfin, le jour qu'elle devait partir,
il lui vint dire qu'il avait partout défendu que l'on ne lui donnât aucun
équipage ; alors elle se raffermit et lui dit : « Monseigneur,
cela n'importe, s'il n'y a point d'équipage, l'obéissance a de bonnes jambes,
nous irons fort bien à pied. » Cette détermination toucha ce bon Seigneur,
et il lui prêta son carrosse pour la conduire jusqu'à Paris. Elle laissa
supérieure à Bourges notre très-chère Sœur Anne-Marie Rosset, et s'achemina
vers Paris avec quatre professes et une novice, qu'elle avait fait venir de
notre monastère de Moulins à cet effet. Elle s'en allait le plus joyeusement du
monde servir Dieu pour Dieu, et en la seule confiance de l'obéissance ;
car elle partit de Bourges pour aller fonder à [196] Paris, sans avoir d'autres
richesses que dix-neuf testons,[43] ni autre souci que celui d'obéir, et, par
les chemins, elle encourageait grandement ses compagnes à l'amour de la
souffrance, et à la totale remise de toutes choses en Dieu et en sa Providence,
sans leur faire semblant des croix qu'elle attendait de trouver à Paris ;
car notre Bienheureux Père le lui avait mandé, et, en cela même, elle se
réjouissait et s'encourageait grandement.
CHAPITRE XII.
notre bienheureuse
mère vient fonder à paris ; son humilité et patience dans les difficultés
qu'elle y rencontre.
La veille de Quasimodo 1619, notre digne Mère et ses filles arrivèrent
à Paris, et ne fut point déçue de son attente, trouvant des bonnes croix à
porter, Dieu permettant qu'il se trouvât d'autant plus de contradictions à ce
nouvel établissement, qu'il voulait rendre ce monastère-là florissant en toutes
sortes de bénédictions, comme il est maintenant par la divine grâce. On s'éleva
avec grande véhémence contre notre manière de vivre, non-seulement les
personnes du monde, mais des personnes de religion, de piété et de grand
mérite ; et pour rabattre le trop grand lustre que l'on disait que notre
manière de vivre aurait dans Paris, si nous nous établissions, l'on résolut que
seulement nous y serions reçues pour gouverner les Andriettes et les filles de
Sainte-Madelaine qui sont les repenties. Un très-grand Père de religion,
qui est décédé depuis fort peu d'années, en réputation de sainteté, vint porter
la parole à notre très-digne Mère, que l'on ne voulait point que nous eussions
de maisons à nous dans Paris, mais que nous prissions la conduite de ces
Congrégations qui n'étaient pas bien réglées ; que, si l'on ne voulait
accepter cela, il faudrait s'en retourner d'où l'on était venu. Elle lui
répondit avec une grande humilité et sainte force : « Hé bien !
mon cher Père, nous nous en retournerons plutôt que de faire une brèche à notre
règle et à notre Institut ; nous ne sommes attachées qu'à faire la volonté
de Dieu ; il nous a [198] fait venir ici ; s'il lui plaît que nous
nous en retournions, nous lui rendrons notre obéissance d'aussi bon cœur d'un
côté que d'autre. » Cette manière de traiter toucha si fort ce bon Père,
et lui fit tellement voir que l'esprit de Jésus était dans la Congrégation de
Sainte-Marie, que dès ce jour-là il changea de note, et fut aussi zélé à
procurer notre établissement (avec les conditions requises) qu'il avait été
ardent à l'empêcher ; ce qui fut un grand bien, d'autant que ce Père ici
était puissant, à cause de l'estime que l'on faisait de sa vertu ; son
jugement en tirait plusieurs autres après lui. Il disait haut et clair que
l'esprit de Dieu conduisait la Mère de Chantal, que c'était Dieu qui l'avait
amenée à Paris pour le salut de plusieurs âmes. Ainsi, petit à petit les
contradictions cessèrent, et notre Bienheureux Père prit jour pour faire un
établissement avec les conditions requises. Il écrivit un billet à notre digne
Mère, dès son logis, où il disait : « O ma chère Mère, que la
prudence humaine est admirable ! croiriez-vous que des grands serviteurs
et des servantes de Dieu m'ont encore dit aujourd'hui que la douceur et la
piété de notre Institut étaient tellement au goût des esprits français, que
vous ôteriez toute la vogue aux autres maisons religieuses ; que quand on
aurait vu cette madame de Chantal, il n'y aurait plus que pour elle. Or sus,
cela n'est rien, Dieu qui voit que nous ne venons pas à Paris pour nous faire
voir, mais afin de faire voir à sa Bonté plusieurs âmes s'acheminer purement à
son saint service, nous aidera. Je réponds de la sincérité de vos intentions
comme des miennes propres, si tien et mien se doit dire entre nous que Dieu a
unis pour lui rendre un même service. »
Le jour de saint Jacques et saint Philippe, 1er de mai 1619,
ce Bienheureux vint dire messe en la chapelle de la petite maison où nos Sœurs
étaient retirées, fit une exhortation et exposa le Saint-Sacrement ; ce
jour-là se compte pour le jour de l’établissement. Nos bonnes Sœurs étaient
logées au faubourg [199] Saint-Michel, dans une petite maison très-incommode,
singulièrement en ce qu'elle était entre deux tripots, oyant jour et nuit le
tintamarre des joueurs. Elles trouvèrent dans cette maisonnette deux filles qui
avaient envie d'être religieuses, mais qui n'eurent pas le courage de
persévérer ; elles avaient apprêté quelques petits meubles et lits pour
nos Sœurs, qu'il leur fallut payer à discrétion pour éviter le bruit. Il
semblait que Dieu prenait plaisir à tenir notre digne Mère dans la pauvreté, au
milieu des abondances de cette grande ville ; elle n'avait pas seulement du
linge pour en changer. Les Sœurs qu'elle avait menées à la fondation, tombèrent
malades ; il ne demeura sur pied que cette unique Mère et deux jeunes
novices pour chanter l'Office, et faire les choses requises pour le service des
malades, pour répondre à la porte et servir à la sacristie. Notre Bienheureuse
Mère faisait pour toutes les officières, apprêtait à la cuisine, servait à
l'infirmerie, chantait l'Office avec ses deux novices d'une voix si forte et
soutenante, que l'on eût jugé qu'il y avait bon nombre de voix au chœur. L'on
fut environ trois mois dans cette petite et très-incommode maison, après
lesquels il fallut penser d'en changer, parce qu'il se présentait des filles
pour être reçues. Ce fut avec très-grande difficulté que l'on changea de maison ;
néanmoins Notre-Seigneur assista en ce rencontre sa sainte Servante comme il
faisait toujours, et après qu'il eut exercé sa patience plusieurs mois, lui
envoya du secours, lui faisant recevoir de braves filles et de bon lieu qui
apportèrent de quoi accommoder la maison.
Comme l'on était en si beau chemin, pour avancer quelque chose, Dieu
permit que la peste se mît furieusement dans Paris ; la cour et tous les
principaux en sortirent ; en sorte que cette ville-monde pensa devenir un
petit désert ; et, en effet, l'herbe crût fort haute parmi les rues. Notre
maison était encore en sa naissance et sans appui, si bien qu'elle demeura fort
destituée de toute assistance, et notre digne Mère nous a dit que, ne [200]
sachant plus que faire, ni de quoi nourrir les Sœurs, elle allait avec larmes
devant le Saint-Sacrement dire son Pater, demandant au Père céleste le
pain quotidien pour ses filles. Une autre fois, nous parlant des difficultés
qui s'étaient trouvées, tant pour acheter des places que pour l'établissement,
elle dit « qu'elle avait plus acheté la maison de Paris par larmes et
prières que par argent. » Dieu lui donna des grandes bénédictions après
ses travaux, et singulièrement par la réception de notre très-honorée Sœur
Hélène-Angélique Lhuillier, que sa providence amena par une vocation
extraordinaire ; elle se rendit fondatrice, en cédant toutefois les
privilèges à madame de Villeneuve, sa sœur. Alors on acheta les écuries de
l'hôtel de Zamet, que notre Bienheureuse Mère fit accommoder, pour y loger ses
religieuses. Les grandes dames et princesses commencèrent à visiter et
affectionner si fort notre digne Mère, que plusieurs se dirigeaient par ses
avis et lui conféraient de leurs âmes. Madame la comtesse de Saint-Paul,
très-vertueuse princesse, voulut avoir de nos Sœurs pour faire un établissement
à Orléans. Il fut le neuvième, le septième et le huitième ayant été faits à
Montferrand et à Nevers, par nos maisons de Lyon et de Moulins. La chère Mère
Marie-Jacqueline Favre alla fonder à Monferrand, laissant supérieure à Lyon
notre très-honorée Mère de Blonay ; et notre chère Sœur Paule-Jéronime de
Monthouz, professe d'Annecy, alla fonder à Nevers, prenant des Sœurs à Moulins.
Notre Bienheureux Père envoya à Paris notre très-chère Sœur et Mère
Claude-Agnès de la Roche, avec quatre compagnes, pour la fondation d'Orléans,
où notre digne Mère les envoya avec quelques novices de Paris, dont elle leur
donna le dot. L'établissement d'Orléans se fit ; et comme notre très-chère
Sœur de la Roche avait été la neuvième fille de l'Institut, par un pur
rencontre, et sans attention, elle fut la première Mère de la neuvième maison
d'icelui. Entre les exercices que notre très-digne Mère eut à Paris, ce fut de
supporter les [201] rodomontades que lui fit plusieurs mois de suite une dame
qui avait fait quelques assistances au commencement,[44] qu'elle fit payer bien cher. Elle se piqua
de ce que notre Bienheureuse Mère ne lui voulut pas souffrir quelques libertés
qui étaient entièrement contre la règle et la bienséance d'une maison religieuse ;
elle prenait sujet de tout pour ergoter et désapprouver ce que notre digne Mère
faisait. Elle détournait les filles par-dessous main de venir chez nous ;
et si notre très-honorée Sœur Hélène-Angélique Lhuillier n'eût été solidement
vertueuse, elle lui eût fait perdre sa vocation. Quelquefois elle éclatait tout
à fait et venait aux reproches, taxant notre Bienheureuse Mère en face d'être
une ingrate, et lui disant tout ce que sa passion lui suggérait, sans pouvoir
tirer autre parole d'elle, que de douceur et d'humilité ; et au sortir du
parloir, notre digne Mère disait à la Sœur qui l'avait assistée :
« Allons recommander à Dieu cette chère âme », sans rien ajouter ni
discourir sur le tort qu'elle avait de la traiter de la sorte ; et quand
elle fut malade, elle la fit visiter et servir, comme si c'eût été une des
meilleures amies du monastère.
Sur la fin de l'année 1621, notre digne Mère, voyant la maison de Paris
en très-bon état temporel et spirituel, pensait de s'en retirer et s'en aller
travailler ailleurs ; mais Notre-Seigneur l'arrêta au lit par une maladie
de trois mois ou environ. Dès qu'elle fut guérie, elle fit faire élection d'une
supérieure pour se retirer : le sort tomba heureusement sur notre chère
Sœur Anne-Catherine de Beaumont, à laquelle elle remit une communauté de
trente-quatre religieuses, lesquelles cette digne Mère disait être toutes
très-dignes de leur vocation, et la plupart desquelles ont rendu des services
notables à l'Institut, en la conduite et établissement de diverses maisons.
[202]
Quand on s'aperçut que notre très-digne Mère voulait se retirer de
Paris, l'on fit plusieurs instances pour l'y retenir ; mais ce fut en
vain ; car, bien que plusieurs personnes s'attachassent à elle et
quittassent avec grand'peine sa présence et sa conduite, tant dedans que
dehors ; pour elle, elle ne s'attachait jamais à rien qu'à faire l'œuvre
que Dieu lui commettait, le plus diligemment et soigneusement qu'elle pouvait,
pour sa pure gloire, sans prétention d'autre contentement que de contenter son
Dieu.
CHAPITRE XIII.
notre bienheureuse
mère visite plusieurs maisons religieuses, se rendant dans les fondations
dorléans, de bourges, nevers et moulins. chemin faisant, elle s'arrête chez sa
chère fille, madame de toulonjon : elle en sort pour aller fonder à dijon.
Ainsi dégagée de tout, elle fit ses adieux à Paris, et en partit
nonobstant la rigueur du froid, le 21 février 1622, accompagnée de notre chère
Sœur, Gasparde d'Avisé, madame de Port-Royal, qui est une âme d'insigne et
extraordinaire vertu, grande fille spirituelle de notre Bienheureux Père, qui
disait qu'elle n'avait point le cœur, l'esprit, ni le courage de son sexe,
tellement il lui trouvait une âme généreuse et relevée au service de Dieu.
Cette vertueuse dame avait eu des extrêmes désirs d'être fille de la
Visitation ; mais étant dès son bas âge liée à une autre religion, notre
Bienheureux Père et notre très-digne Mère pratiquèrent en cela une grande
abnégation ; et comme écrivait ce Bienheureux au Révérend Père Binet, de
la sainte Compagnie de Jésus : « Quand notre Mère de Chantal et moi
saurions qu'une âme serait sainte canonisée dans sainte Marie, si elle a son
appel et qu'elle soit utile dans une autre Congrégation, nous ne voudrions pas
l'en retirer. » Ainsi, madame de Port-Royal demeura en son monastère,
duquel elle changea le nom et le rang d'Abbesse, faisant mettre sa supériorité
en triennal.
Au sortir de Paris, elle alla prendre notre très-digne Mère [204] pour
la mener à Maubuisson, abbaye qu'elle allait réformer ; elle la garda quatre
jours, afin qu'elle parlât à toutes les religieuses et lui donnât de bons avis
pour la réforme et règlement des exercices religieux. Notre très-digne Mère se
trouvait un peu mal de fluxion ; madame de Port-Royal la saigna de sa
propre main et trempa tant de linges qu'elle put dans son sang ; à chaque
repas, elle lui faisait changer de serviettes pour les garder comme reliques.
Si la volonté de Dieu n'eût été comme une aimable chaîne d'arrêt à madame de
Port-Royal, elle eût suivi notre Bienheureuse Mère, laquelle, au sortir de
Maubuisson, s'en alla à Pontoise, où elle fut reçue chez les révérendes
Carmélites avec une cordialité si grande, qu'elle écrivit à notre chère Sœur la
supérieure de Paris, « qu'elle était parmi ces bonnes servantes de Dieu,
avec la même franchise et union que dans une de nos Communautés ; »
et ces bonnes Mères écrivirent « qu'il leur semblait tenir parmi elles
leur sainte Mère Thérèse de Jésus. » Plusieurs lui parlèrent de leur
intérieur. Elle révéra avec une dévotion toute particulière le tombeau de la
Bienheureuse Sœur Marie de l'Incarnation,[45] et ayant pris congé de ces saintes
religieuses, s'en alla en notre maison d'Orléans, où elle reçut de grandes
consolations de la parfaitement bonne conduite de notre très-chère Sœur et Mère
Claude-Agnès de la Roche ; elle visita une maison de religieuses de saint
Benoît qui l'avait grandement désirée, et lesquelles la [205] firent veiller
quasi toute la nuit pour lui parler de leur intérieur, et apprendre d'elle les
vraies maximes religieuses à quoi elles désiraient se former. Tandis que les
unes parlaient à cette digne Mère, les autres faisaient parler deux de nos
Sœurs qui étaient avec Sa Charité, à leurs novices, pour les instruire.
D'Orléans elle alla à Bourges établir notre chère Sœur Françoise-Gabrielle
Bally en la charge de supérieure, où elle fut élue, parce que l'on avait besoin
de notre très-chère Sœur Anne-Marie Rosset qui l'était alors, pour l'employer à
la fondation de Dijon. S'en retournant, elle passa par Nevers et par Moulins,[46] affermissant toujours de plus en plus nos
bonnes Sœurs en la perfection de l'observance. De là, par le commandement de
notre Bienheureux Père, elle vint à Allonne chez madame de Toulonjon, sa fille,
où elle s'arrêta quelques jours pour attendre les Sœurs que notre Bienheureux
Père lui devait envoyer d'Annecy pour la fondation de Dijon.
Ce séjour chez madame de Toulonjon ne fut pas infructueux ;
plusieurs dames et demoiselles des environs vinrent visiter notre Bienheureuse
Mère et en restèrent fort édifiées. Une religieuse d'un ordre non réformé qui
lui parlait alors, disait plusieurs années après qu'elle n'avait jamais oublié
les instructions qu'elle en avait reçues, et portait toujours dans son âme un
regret cuisant de se voir dans l'impuissance d'être fille d'une si digne mère.
Quant à madame de Touloujon, sa chère fille, [206] qui était mariée depuis peu
d'années, il ne se peut dire avec quelle consolation et profit elle reçut et
garda chez elle cette unique mère. Quoiqu'elle fût enceinte de près de huit mois,
elle se traîna à genoux plusieurs pas au-devant de sa sainte mère, sans que
l'on pût l'en empêcher. Elle avait déjà, les deux années précédentes, accouché
de deux fils avant terme, l'un ne vécut que trois semaines, l'autre que quinze
jours, et l'on craignait fort qu'il n'en fût toujours ainsi et qu'elle ne se
blessât, mais ce fut au contraire, elle accoucha heureusement d'une belle fille
qui est encore en vie[47] quoique trois enfants lui moururent par
après en l'état d'innocence ; aussi, quand cette vertueuse veuve revint de
Pignerol avec son petit-fils qui n'avait que six semaines, durant les quatre
mois de séjour qu'elle fit en cette ville, elle faisait souvent apporter son
petit pour recevoir la bénédiction de sa sainte grand'mère, « afin, disait-elle,
que celle qui m'a conservé la fille me conserve le fils, » ce qui est
arrivé jusqu'à aujourd'hui par la divine grâce.
Nos Sœurs que notre Bienheureuse Mère attendait à Allonne y étant
arrivées, elle partit pour aller à Dijon. Elle y arriva en avril et fut reçue
de tout le monde universellement avec un excès de joie si extraordinaire, que
quelques seigneurs du parlement qui avaient beaucoup contrarié notre
établissement étaient étonnés ; ils dirent qu'il fallait bien qu'il y eût
un mouvement du ciel, non commun dans les âmes du menu peuple, qui avait
accompagné de malédictions et de rumeurs l'établissement de quelques autres
religieuses, et pour celles-ci les marchands et artisans d'eux-mêmes fermèrent
leurs boutiques, et chacun se mit par les rues avec une telle acclamation de
joie et telle presse de peuple, que notre Bienheureuse Mère et les Sœurs qui
étaient avec Sa Charité, nous ont assuré que l'on [207] n'entendait ni l'on ne
sentait rouler le carrosse, et semblait que ces bonnes gens le portassent à bras ;
aussi demeura-t-on beaucoup de temps à faire bien peu de chemin, n'étant pas
possible de fendre la presse. Sur le soir, après que ceux de la ville eurent
rendu leurs devoirs à notre très-digne Mère, il vint une innocente compagnie de
plus de deux cents villageois et villageoises des environs de Dijon faire la
bienvenue à notre digne Mère, laquelle agréa si fort leur simplicité, qu'elle
fît venir nos Sœurs dans une grande cour et les fit dévoiler pour accueillir
plus cordialement cette nouvelle visite. Elle caressa fort ces bonnes gens, et
après leur avoir dit plusieurs saintes paroles, pour les exhorter à vivre en la
crainte de Dieu et gagner le ciel en travaillant à la terre, elle les renvoya,
après toutefois qu'ils eurent pris sa bénédiction, car ils se mirent à genoux
et ne se voulurent point lever qu'elle ne la leur eût baillée. Le lendemain, 8
mai 1622, monsieur le grand vicaire vint faire l'établissement de la part de
Monseigneur de Langres qui était absent ; cette action se fit avec
beaucoup de solennité.
Peu de temps après, elle reçut à l'habit notre chère sœur Claire-Marie
Parise (le 6 juin 1622), qui avait procuré notre établissement ; la
réception de cette fille en émut plusieurs autres qui se présentèrent pour être
reçues. Mais entre toutes celles qui vinrent se ranger sous une si sainte
conductrice, Dieu amena par une grâce spéciale madame la présidente Le Grand,
âgée de soixante-quinze ou seize ans. Durant le temps que notre Bienheureuse
Mère était au monde, elle honorait comme sa mère celle qui à présent vint se
mettre à genoux devant elle, lui demandant en toute humilité d'être sa fille et
sa novice ; cette digne Mère la reçut avec une très-grande reconnaissance
envers Dieu de donner à l'Institut une âme si véritablement vertueuse, et laquelle
entra en religion avec un si général oubli de ce qu'elle avait été au monde,
qu'elle ne voulait que travailler au jardin, ne respirait que mortifications,
ne [208] voulant pas seulement
permettre que l'on fit son lit ni qu'on la traitât autrement que la
communauté ; elle disait à nos Sœurs qu'il y avait plusieurs années
qu'elle s'estimait indigne de délier la courroie des souliers de notre unique
Mère. Cette chère Sœur est décédée en notre monastère de Dijon, très-saintement
et âgée de plus de quatre-vingts ans.
Quelques mois après notre établissement à Dijon, Monseigneur de
Langres, comme un bon pasteur, cherchant la plus grande perfection de ses
brebis, désirait fort la réforme des dames Bernardines du Tart, et jugeant que
personne ne pouvait donner un meilleur commencement à une si sainte besogne que
notre Bienheureuse Mère, de laquelle il faisait une estime incomparable, il
persuada à une de ces dames du Tart d'aller demeurer quelque temps avec elle,
« seulement, lui disait-il, pour prendre autant de divertissement » ;
mais notre unique Mère, qui était experte au maniement et discernement des
esprits, voyant de si bonnes qualités à celui de cette dame pour servir à la
gloire de Dieu, lui donna de si douces amorces à la dévotion, que celle qui
auparavant ne respirait qu'à faire juger sa profession nulle, ne pensa plus
qu'à la réforme de son couvent, qu'elle entreprit avec madame la coadjutrice du
couvent du Tart, et en vinrent heureusement à bout. Elles firent venir
plusieurs de leurs religieuses parmi nos Sœurs pour apprendre les pratiques
monastiques, et durant sept ou huit mois, il y eut toujours à Tart, par l'ordre
de notre digne Mère, deux de nos Sœurs pour aider ces bonnes dames en leur
dessein. Cette digne Mère leur conseilla de prendre la réforme que madame de
Port-Royal établissait, ce qu'elles firent, et persévérèrent saintement.
Notre Bienheureuse Mère demeura six mois à Dijon, acheta une fort belle
maison pour loger ses religieuses ; elle reçut plusieurs bonnes filles,
les fonda parfaitement en l'observance, établit supérieure notre très-honorée
Mère Marie-Jacqueline [209] Favre, que notre Bienheureux Père rappela à cet
effet de Montferrand, et partit de Dijon qu'elle laissa plein de toutes saintes
édifications de ses grandes vertus, et de son côté elle s'en allait
très-consolée de voir une maison de son ordre si heureusement établie au lieu
de sa naissance.
CHAPITRE XIV.
entrevue à lyon de
notre bienheureuse avec notre saint fondateur ; elle va à grenoble où elle
reçoit la nouvelle de sa mort ; son admirable résignation à la volonté de
dieu.
Elle arriva à Lyon, comme son obéissance portait, sur la fin du mois
d'octobre, et y trouva notre Bienheureux Père qui ne faisait que passer, allant
accompagner Mgr le cardinal de Savoie, à Avignon, si bien qu'ils n'eurent point
de loisir de se parler. Ce Bienheureux lui commanda d'aller visiter nos maisons
de Montferrand et de Saint-Étienne, ce qu'elle fit et prit temps là pour faire
ses renouvellements et exercices annuels de retraite.
Sur le commencement de décembre, elle se rendit à Lyon, où notre
Bienheureux était déjà arrivé ; le roi et les deux reines y étaient et le
cardinal de Savoie. Si grand nombre de princes et de princesses, de grands
seigneurs et de grandes dames avaient recours à notre Bienheureux Père comme à
un oracle, que ce saint homme n'avait pas un quart d'heure à lui pour parler à
souhait à notre très-digne Mère, laquelle avait une envie incroyable de revoir
toute son âme entre les mains de son digne Conducteur, y ayant près de trois
ans et demi qu'ils ne s'étaient vus et qu'elle ne lui avait conféré de son
intérieur ; elle avait aussi plusieurs choses à lui consulter pour
l'observance, les cérémonies et le bien de l'Institut dont elle avait fait des
amples mémoires tant à Paris qu'à Dijon.
Un jour, ce Bienheureux s'étant dégagé de la presse de ses autres
affaires, vint au parloir trouver notre Bienheureuse Mère, [211] et lui
dit : « Ma Mère, nous aurons quelques heures libres ; qui
commencera de nous deux à dire ce qu'il a à dire ? » Notre digne Mère
qui était ardente et qui avait plus de soin de son âme que de toute autre
chose, répondit promptement : « Moi, s'il vous plaît, mon Père, mon
cœur a grand besoin d'être revu de vous. » Ce Bienheureux, qui était sur
la fin de son entière consommation, ne voulant ni ne désirant plus rien, voyant
un peu d'empressement, quoique spirituel, en celle qu'il voulait toute
parfaite, lui dit suavement, mais avec grande gravité : « Eh
quoi ! ma Mère, avez-vous encore des désirs empressés et du choix ?
Je vous croyais trouver tout angélique. » Et là-dessus connaissant bien
que notre digne Mère était de ces âmes parfaites dont parle saint Bernard, qui
n'ont pas besoin de direction, Dieu étant lui-même leur guide : « Ma
Mère, lui dit-il, nous parlerons de nous-même à Annecy ; maintenant
achevons les affaires de notre Congrégation. Oh ! ajouta-t-il, que je
l'aime notre petit Institut, parce que Dieu est beaucoup aimé en
icelui ! » Notre digne Mère, sans dire un mot de réplique, serra le
mémoire qu'elle avait préparé pour parler, par ordre de ce qui s'était passé en
son âme en ces trois ans et demi d'absence ; elle déplia ceux qu'elle
avait faits des affaires de l'Institut ; et ces deux saintes âmes furent
quatre grandes heures à conférer et résoudre diverses choses pour le bien de
l'Institut, que l'on devait mettre au Coutumier ; surtout notre
Bienheureux Père arrêta qu'il ne fallait plus écouter de propositions pour nous
ranger sous un chef de général ni de générale ; que plus il priait, et
plus Dieu lui faisait connaître que c'était sa volonté que l'Institut demeurât
simplement et uniquement à la conduite du Saint-Siège et de Messeigneurs les
évêques aux diocèses desquels nous serions établies ; « car,
voyez-vous, dit ce Bienheureux, nos filles, ce sont les filles du
clergé. »
Après cet entretien de quatre heures, ce Bienheureux commanda à notre
très-digne Mère d'aller à Grenoble visiter nos [212] Sœurs, et s'il se pouvait
à Valence, et s'en retourner par Belley, qu'ainsi elle aurait vu toutes les
maisons qui étaient pour lors établies ; lui ordonna aussi de passer à
Chambéry, de visiter une maison pour nous y établir, et voir à Rumilly les
Bernardines, qui, sous la conduite de ce Bienheureux, commençaient leur
réforme. Elle partit ainsi de Lyon avec la bénédiction de ce Bienheureux
Prélat, qu'elle espérait revoir bientôt à Annecy, et s'en alla à notre
monastère de Grenoble. Étant en chemin, il lui prit une grande tristesse et
serrement de cœur de ce que notre Bienheureux Père ne lui avait pas voulu
permettre de lui parler de son intérieur ; mais, sans vouloir réfléchir
sur elle-même, ni gloser sur ce qu'avait fait son supérieur, elle fit un acte
d'abandonnement d'elle-même à la divine volonté, et, prenant son livre de
Psaumes, elle se mit à chanter dans la litière le psalme 26, Dominus
illuminatio mea, répétant diverses fois ce verset : Quoniam pater
meus et mater mea dereliquerunt me, Dominus autem assumpsit me[48] ; avec ce remède elle se guérit, et
c'était son ordinaire remède dans ses maux intérieurs, que l'abandonnement
d'elle-même en Dieu et quelques versets de l'Écriture sainte.
Elle arriva en notre monastère de Grenoble pour y faire un peu de
retraite avant la fête de Noël qu'elle y passa. Il lui arriva, le jour des
Innocents,[49] qu'étant en oraison où elle recommandait à
Notre-Seigneur notre Bienheureux Père, elle ouït une voix très-distincte qui
lui dit : Il n'est plus. « Non, dit-elle, mon Dieu ! il
n'est plus, lui, ni ne vit plus, lui, mais vous êtes et vivez en
lui » ; prenant cette parole : Il n'est plus, pour la perfection
de transformation en Dieu où elle croyait ce saint [213] homme être arrivé,
mais en vérité c'était un avertissement qu'il n'était plus en terre, ni en
l'état en lequel elle le recommandait à Dieu ; et, en effet, le lendemain
à soir, M. Michel Favre, aumônier de ce Bienheureux et confesseur de ce
monastère, qui accompagnait notre digne Mère, reçut la nouvelle du décès de
notre Bienheureux Père. Cette digne Mère faisant quelque réflexion sur la
parole qu'elle avait ouïe : Il n'est plus, il lui vint en la pensée
que possible c'était un avertissement de mort, mais comme nous ne voulons pas
nous persuader les choses que nous redoutons beaucoup, elle ne voulut
aucunement admettre cette pensée, et partit toute joyeuse de Grenoble, où elle
n'avait trouvé dans notre monastère que tout sujet de consolation, cette
maison-là étant alors conduite par notre très-honorée Mère Péronne-Marie de
Châtel. M. Michel Favre avait grand soin que par les chemins notre digne Mère
ne reçût lettres, ni ne parlât à personne qui lui apprît la fâcheuse nouvelle
du saint décès de notre Bienheureux Père.
Elle arriva à Belley deux jours avant les Rois ; cette chère
communauté savait déjà qu'elle était orpheline d'un si saint Père ; mais
notre chère Sœur Marie-Madeleine de Mouxy, qui était alors supérieure, avait
gagné sur ses filles qu'elles ne témoigneraient point leur douleur devant notre
très-digne Mère, laquelle passa ce jour-là et la veille des Rois joyeusement.
Le jour des Rois, des Pères capucins la vinrent visiter ; après quelques
discours de la grande fête, elle dit qu'elle était en peine que l'on n'eût
point de nouvelles de Monseigneur. M. Michel lui dit que l'on lui avait écrit
qu'il était tombé à Lyon ; elle repartit promptement que dès le lendemain
elle voulait partir et retourner à Lyon. Le bon M. Michel, qui était confesseur
de cette digne Mère depuis onze ou douze ans, savait bien qu'elle recevait avec
paix les breuvages, pour amers qu'ils fussent, s'ils lui étaient présentés dans
la coupe de la volonté de Dieu, lui dit : « Ma Mère, il faut vouloir
ce que Dieu veut ; prenez la [214] peine de voir cette
lettre » ; et il lui mit en main celle que Monseigneur de
Genève, d'heureuse mémoire, frère et successeur de notre Bienheureux Père, lui
écrivait. Elle trouva en cette lettre comme Dieu avait appelé à soi ce saint
Prélat, et je ne saurais mieux représenter la solide vertu avec laquelle cette
Bienheureuse Mère reçut ce coup mortel, qu'en rapportant ce qu'elle-même en
écrivit à une de nos Mères supérieures. Voici ses propres mots :
« Lorsque M. Michel me mit en main la lettre de Monseigneur de Genève, le
cœur me battait extrêmement ; je me retirai toute en Dieu et en sa
volonté, me doutant bien qu'il y avait quelque chose de douloureux dans cette
lettre. En ce peu d'espace que je me tins retirée, j'eus l'intelligence de la
parole qui m'avait été dite à Grenoble : Il n'est plus ; vérité
dont je fus toute éclaircie en lisant cette bénite lettre. Je me jetais à
genoux, adorant la divine Providence et embrassant au mieux qu'il me fut
possible la très sainte volonté de Dieu, et, en icelle, mon incomparable
affliction. Je pleurais abondamment le reste du jour, et toute la nuit
jusqu'après la sainte Communion, mais fort doucement, et avec une grande paix
et tranquillité dans cette volonté divine, et dans la gloire dont jouit ce
Bienheureux. Car Dieu m'en donna beaucoup de sentiments avec des lumières fort
claires, des dons et grâces que la divine Majesté lui avait conférés, et des
grands désirs de vivre meshui selon ce que j'ai reçu de cet homme de
Dieu ; voilà ce que votre bonté, ma chère Fille, a voulu savoir de ma
misère. »
Un Père de religion l'étant venu voir et la voyant pleurer, lui dit que
la parfaite résignation d'une âme devait sécher les pleurs, à quoi elle
répondit : « Mon cher Père, si je savais que mes larmes fussent
désagréables à Dieu, je n'en jetterais pas une » ; et dès lors, par
un pouvoir absolu sur elle-même, défendit à ses yeux de pleurer ; mais
l'extrême violence qu'elle faisait à sa nature, lui fit enfler l'estomac, ce
qui fut cause que M. Michel lui [215] commanda de laisser le libre passage à
ses justes larmes ; « que le père ne frappait l'enfant qu'afin qu'il
sentît le coup, et ne requérait sinon que l'enfant fût soumis sous sa
main ; or cela, elle l'était parfaitement.
Le soir qu'elle eut reçu cette fâcheuse nouvelle, elle se retira sans
pouvoir souper ; la supérieure commanda qu'on lui apportât une bonne rôtie
au sucre. La dépensière se méprit, et, au lieu de sucre, mit à force sel blanc
sur cette rôtie, de laquelle notre très-digne Mère mangea la moitié par
condescendance, sans s'apercevoir que c'était du sel et non du sucre ;
elle posa cette rôtie, ne pouvant pas davantage manger. La supérieure en voulut
tâter pour voir si elle était bien faite, et, la trouvant salée comme saumure,
elle demanda à notre Bienheureuse Mère si cela ne lui faisait point de
mal ; mais elle lui dit de n'être point en peine, « qu'elle était
dans un état de ne pouvoir rien trouver de doux que la volonté de Dieu, ni rien
d'amer que sa très-âpre douleur. » Elle fut ce soir même à la récréation
avec les Sœurs, mais sans pouvoir dire un mot, que par ses pleurs et sa
tranquille modestie ; après icelle, elle se retira, dit matines avec notre
chère Sœur, Marie-Gasparde d'Avisé, sa compagne, se fit lire un chapitre de l’Imitation
de Jésus, puis se coucha,[50] voulant être seule pour se consoler avec
Notre-Seigneur ; mais [216] peu de temps après qu'elle fut couchée, notre
chère Sœur, Marie-Simplicienne Fardel, entra en sa chambre et passa la nuit à genoux
devant son lit, lui parlant du dernier entretien qu'elle avait fait avec ce
Bienheureux, et comme elle lui avait prédit sa mort, lorsqu'il avait passé par
Belley, en allant à la suite du prince cardinal de Savoie, en Avignon, ainsi
que nous l'avons remarqué au petit recueil de sa vie.
Le matin étant venu, cette digne Mère se leva avec la communauté,
quoiqu'elle n'eût pas fermé l'œil ; et après la sainte communion, d'un
esprit tranquille quoique affligé, elle fit réponse à Monseigneur de Genève,
écrivit à notre chère Sœur Françoise-Marguerite Favrot, alors assistante dans
ce monastère, et à notre très-honorée Mère de Blonay, pour lors supérieure de
notre maison, à Lyon, la conjurant de faire tous ses efforts pour faire
relâcher ce béni corps de notre Bienheureux Père : « Je vous en
conjure, lui dit-elle, et si je l'ose, je vous le commande. » Cette digne
Mère fit avec paix tout ce qu'elle avait à faire à Belley, parla à toutes les
Sœurs, fit les changements d'officières, reçut les visites, écrivit en divers
lieux des lettres toutes dévotes et pleines de résignation ; puis, ayant
pris congé des Sœurs, qu'elle exhorta fort à conserver l'esprit de leur saint
Fondateur, elle s'achemina à Chambéry pour visiter une maison pour notre
établissement, et ne voulut pas accepter celle de madame la marquise de la
Chambre, d'autant qu'il eût fallu avoir de la dispute avec M. le marquis d'Aix,
son neveu. « Cette maison, dit-elle, est belle et commode, mais nous
sommes filles de paix et d'humilité ; notre petitesse n'aime pas avoir
rien à débattre avec les grands de ce monde. » De là elle s'achemina chez
les Mères Bernardines de Rumilly, qui [217] commençaient leur réforme ;
elle y fut cinq ou six jours, jusqu'à ce que Monseigneur de Genève lui mandât
de s'en venir ; et, quoique quelques-unes de ces bonnes religieuses
eussent demeuré parmi nous quelque temps, pour apprendre les exercices et
pratiques monastiques, si est-ce que Monseigneur de Genève et cette digne Mère
jugèrent à propos de leur prêter deux de nos Sœurs, qui furent six mois chez
elles, tant pour aider à dresser le spirituel, que les cérémonies, les offices
et l'extérieur d'une maison religieuse.
CHAPITRE XV.
le corps de notre
saint fondateur est apporté de lyon à annecy ; notre bienheureuse mère lui
rend ses devoirs et fait ensuite un voyage a moulins.
Notre Bienheureuse Mère approchant d'Annecy, plusieurs amis du
monastère lui allèrent au-devant, sans que ni elle ni eux se pussent dire autre
chose que par larmes et silence, et quelques courtes paroles d'adoration de la
volonté de Dieu et de soumission à sa divine disposition. Son entrée parmi ses
chères filles ne fut pas, comme les autres fois, en allégresse et
jubilation ; ne pouvant parler à sa chère troupe orpheline d'un si saint
Père, elle la mena devant le très-saint Sacrement faire un peu de prières. Dès
le lendemain de son arrivée, elle se mit à faire préparer les choses requises,
pour envoyer quérir le béni corps de ce saint Prélat ; à pourvoir à sa
pompe funèbre, et faire serrer ce qui lui avait servi ; à ramasser ce
qu'il avait dit et écrit. Soudain, on parla d'écrire la vie de celui dont les
actions ne doivent jamais être éteintes dans la mémoire des vrais enfants de
l'Église.
Le corps de notre saint Fondateur fut apporté de Lyon, et après que
Messieurs du chapitre de saint Pierre d'Annecy lui eurent rendu les honneurs
dans leur église, il fut apporté dans la nôtre, et posé pour trois mois tout
proche notre grille, attendant que l'on eût accommodé un lieu convenable pour
élever son tombeau. Cette sainte affligée demeurait le plus qu'elle pouvait en
oraison devant ce béni cercueil, et ne cherchait pas [219] en vain des flammes
dans les cendres de ce phénix d'amour ; car elle reçut beaucoup de grâces
et de forces par les intercessions de celui qui ne lui était pas moins Père au
ciel qu'il l'avait été en la terre, d'autant que ce Bienheureux lui avait dit à
Lyon que, lorsqu'il serait à Annecy, elle lui rendrait compte de son intérieur.
Lui voulant autant obéir mort que s'il eût été en vie, elle prit un jour,
qu'elle procura lui être laissé bien libre, pour faire cette reddition de
compte. S'étant mise à genoux devant le cercueil de ce Bienheureux, elle lui
parla comme si elle l'eût vu de ses yeux, et si elle n'ouït pas de ses oreilles
extérieures la voix de ce cher Père, elle l'ouït bien de celle du cœur ;
et non-seulement ce grand Élie jeta sur elle le manteau de sa protection
paternelle, mais il est bien probable qu'il lui impétra beaucoup de son double
esprit pour conduire l'Institut, duquel il lui laissait tout le soin, et qui se
devait tant multiplier en si peu d'années.
La tranquillité et la suavité que cette digne Mère possédait proche ce
saint corps, fut interrompue par un voyage qu'elle fut contrainte de faire en
notre monastère de Moulins, pour remédier aux troubles que la Fondatrice
faisait aux Religieuses. Elle calma ce désordre par sa prudence ; et s'en
revint par Lyon, où elle vénéra, avec une admirable générosité et dévotion, le
cœur de notre saint Fondateur qui repose en l'église de notre monastère de
Belle-Cour. Devant ce saint cœur, elle renouvela ses vœux et singulièrement
celui de la pureté de cœur, et de faire toujours ce qu'elle croirait être le
plus parfait et agréable à Dieu. Elle entretint à souhait notre très-honorée
Mère de Blonay de tout ce qui s'était passé au décès de ce Bienheureux Père, se
faisant rapporter tout ce qu'il avait fait et dit, et mettant ordre que l'on en
fît des bons et fidèles recueils, afin que, par après, tout fût rédigé en un
corps. Elle apprit que ce Bienheureux avait dit en son dernier entretien, à nos
Sœurs de Lyon, que s'il était religieux et qu'il ne fût pas prêtre, qu'il [220]
ne demanderait point de communier plus que les autres, et qu'il ne voudrait
faire chose aucune de plus que la communauté. Étant de retour ici, elle crut
être obligée de suivre les sentiments de ce Bienheureux Père, et supplia
Monseigneur de Genève de lui permettre de quitter la communion journalière
qu'elle faisait dès environ quatorze ans ; ce que ce bon Prélat ne voulut
pas concéder à son humilité, vu même que c'était par le commandement et
direction de ce Bienheureux Père qu'elle faisait ces communions, lui disant
qu'elle devait plus s'attacher à ce qu'il avait disposé en particulier pour
elle, qu'à l'intention universelle qu'il avait eue par après pour le général de
l'Institut. Elle se soumit à cela, et continua, comme elle a toujours fait, ses
communions.
En revenant de Lyon, elle passa encore par Chambéry, et après une
visite générale et fort pénible de quantité de maisons, elle en arrêta une au
faubourg du Reclus.
Cette année 1623, étant de retour à Annecy, elle envoya des Sœurs faire
la fondation de notre monastère de Marseille, qui fut le premier qui s'établit
depuis le décès de notre Bienheureux Père. Elle fit aussi faire la Visite
Canonique pour la première fois en ce monastère, donnant la méthode qu'il faut
tenir en cette action, et instruisant les Sœurs comme elles s'y devaient
comporter. Cette digne Mère, après tant de saintes actions faites pour notre
bien, finit cette année par une, de laquelle nous sentons et sentirons toujours
le dommage. Monseigneur de Genève avait eu le loisir de voir les papiers de son
saint frère, et avait trouvé dans iceux une extrême quantité de lettres de
cette digne Mère à ce Bienheureux ; sachant bien que c'était tous les plus
secrets sentiments de son âme, par un respect nonpareil envers cette digne
Mère, il lui envoya toutes ses lettres, lesquelles elle brûla, sans que nos
Sœurs l'en pussent empêcher. Feu M. Michel Favre, duquel nous avons parlé ci-dessus,
et lequel était le confesseur, l'aumônier et le [221] secrétaire confident de
notre Bienheureux Père, nous a assuré que ce saint Prélat avait pris la peine
de mettre à part les lettres de cette digne Mère qui devaient servir pour sa
vie, et en avait coté une grande partie de sa sainte main, avec des petites
marques et remarques qu'il avait écrites sur l'apostille, espérant à son
loisir, quand il serait déchargé de l'évêché, comme il désirait, d'écrire
quelques mémoires particuliers de ce qu'il savait de cette sainte âme :
Dieu nous a frustré de tous ces biens.[51]
CHAPITRE XVI.
notre bienheureuse
mère travaille avec plusieurs de nos mères à notre coutumier, d'après les
usages et selon les paroles de notre saint fondateur ; sa fermeté dans les
affaires de l'institut.
L'année 1624 se commença par la disposition de la fondation de notre
monastère de Chambéry. Mgr le prince Thomas, qui a toujours honoré notre
Bienheureuse Mère d'une affection pleine de piété, l'envoya prendre ici dans
son carrosse, et par un excès de sainte bienveillance, ce bon prince voulait
aller bien loin hors la ville pour y faire entrer cette digne Mère en
magnificence, accompagnée du clergé, de la cour et du sénat ; mais elle le
supplia avec tant d'instance de ne point faire tout cet appareil, qu'il laissa
entrer les petites avec petitesse et humilité, que ce bon Prince se retint,
aimant mieux s'abstenir de ce contentement que de mettre la modestie de cette
digne Mère en contrainte. Il fit exposer le Saint-Sacrement avant l'arrivée de
nos Sœurs en la chapelle qui leur était préparée. « Voyez-vous, dit-il, la
bonne madame de Chantal sera si aise de voir Notre-Seigneur qui l'attend déjà
en sa maison, que cela la réjouira plus que tout ce que nous aurions su
faire. » Ce bon prince l'alla attendre à la porte de cette petite
chapelle, dans laquelle il l'introduisit lui-même, faisant marcher quatre de
ses pages qui portaient des flambeaux allumés devant elle. La musique de la
sainte chapelle chanta quantité de beaux motets ; l'on donna la bénédiction
du Saint-Sacrement, et ainsi [223] l'établissement se fit. C'était le jour du
grand saint Antoine, auquel notre Bienheureuse Mère avait une particulière
dévotion ; et fut fort consolée de mettre cette nouvelle maison sous la
protection d'un si saint abbé et si parfait religieux.
Mgr le prince Thomas, joignant les bienfaits effectifs aux affectifs,
voulut donner à souper à notre digne Mère et à ses filles ; il leur
envoya des vivres en telle abondance, qu'elles en eurent pour nourrir huit
jours leur communauté, et firent part aux pauvres de leur festin. Il donna
aussi de fort beaux présents pour l'autel, et en toutes rencontres il a
toujours favorisé et protégé la Visitation. Notre très-digne Mère demeura près
de quatre mois à Chambéry, reçut assez bon nombre de filles entre lesquelles
plusieurs ont très-bien servi et servent encore aujourd'hui.
Un peu avant les fêtes de Pentecôte, elle revint en ce monastère
d'Annecy, pour faire l'assemblée des Mères de l'Ordre, et laissa pour
assistante à Chambéry, à la place de supérieure, notre chère Sœur
Marie-Adrienne Fichet. Quelques jours après la Pentecôte, les Mères qu'elle
avait averties à l'avantage arrivèrent ici, et furent reçues de cette
Bienheureuse avec une cordialité et humilité très-grandes. Elles commencèrent
toutes ensemble à rédiger en un corps le Coutumier, Cérémonial, Formulaire, et
autres bons avis très-utiles pour la perfection religieuse. De tout cela notre
Bienheureux Père avait des mémoires en latin et en français ; on en avait
établi la pratique dans ce monastère d'Annecy, n'ayant pas le loisir de les
mettre par écrit, de quoi aussi il ne s'était pas pressé, sa simple ordonnance
tenant lieu de règle à notre Bienheureuse Mère, et à nos premières Mères et
Sœurs. En toute occasion, notre Bienheureuse Mère citait notre saint Fondateur,
et ne voulait rien dire ni établir d'elle-même dans l'Institut, bien que nos
Sœurs les supérieures la suppliassent d'agir comme Mère commune et comme
Fondatrice de la Congrégation. « Non pas cela, dit-elle, [224] mais, puisque vous me le permettez, je me
tiendrai parmi vous comme la sœur aînée de la famille qui a plus pratiqué et
communiqué avec le père que les autres. » Pour ranger ce livre avec plus
de circonspection, elle demanda deux Pères du collège de Chambéry, qui vinrent,
ici, lesquels, avec M. Michel, notre confesseur, elle envoyait consulter
Monseigneur de Genève, d'heureuse mémoire, sans l'autorité et obéissance duquel
elle n'eût rien voulu établir. Lorsque le Coutumier fut fini de ranger
et écrit bien au net, notre digne Mère le prit, et menant avec soi toutes les
Mères et Sœurs anciennes qu'elle avait assemblées, elle posa ce petit volume
sur le tombeau de notre saint Fondateur, fit mettre toute sa troupe en oraison
et pria elle-même à chaudes larmes ce Bienheureux, que si elle y avait mis un
seul mot qui ne fût de ses intentions, elle le conjurait d'obtenir de Dieu
qu'on le trouvât effacé. Dieu donna un sentiment intérieur à cette digne Mère
et à toutes ses chères Sœurs qui étaient autour d'elle, que tout ce qui était
contenu en ce livre était vraiment les intentions de notre Bienheureux
Fondateur. Toutes se levèrent de leur oraison fort consolées, et l'on assembla
le chapitre pour lire devant toutes le Coutumier dès un bout jusqu'à
l'autre ; et ensuite les Sœurs firent un acte capitulaire, assurant
que tout ce qu'elles avaient ouï lire était conforme à ce que notre Bienheureux
Père avait fait pratiquer en ce monastère. Finalement, notre digne Mère pria
Monseigneur notre Prélat de donner son approbation, ce qu'il fit, comme elle se
voit encore aujourd'hui audit Coutumier, lequel étant si heureusement
fini, toutes ces bonnes Mères retournèrent chacune en leur monastère, se
séparant de notre Bienheureuse avec autant de regret qu'elles avaient eu de
suavité et de contentement en sa chère présence.
Or il était arrivé en notre monastère de Grenoble que, ne sachant pas
que notre Bienheureux Père avait déclaré qu'il ne fallait pas que les
supérieures fussent en charge, en un même [225] monastère, plus de deux
triennaux, le Père spirituel et nos chères Sœurs de Grenoble, qui aimaient
parfaitement notre très-bonne Mère Péronne-Marie de Châtel, la réélurent après
ses six ans, à son très-grand regret ; mais comme l'on n'avait point
encore le Coutumier, l'on ne voulut point condescendre aux raisons
qu'elle alléguait pour n'être pas réélue, les attribuant à son humilité. Notre
très-digne Mère résolut, en l'assemblée des Mères, que cette élection serait
tenue pour nulle, quoiqu'elle eût pour excuse l'ignorance des intentions de
notre Bienheureux Père ; qu'il ne fallait point laisser cet exemple dans
l'Institut ; et ne voulut jamais recevoir de raisons pour fléchir en ce
point, ordonnant à notre Mère de Châtel d'obtenir permission d'aller fonder
notre maison d'Aix, en Provence. Elle donna ordre à quatre ou cinq de nos Sœurs
les supérieures, qui s'en retournaient en France, d'obtenir du Père spirituel
la rupture de cette élection ; à quoi elles n'avancèrent rien, bien
qu'elles se missent à diverses fois à genoux devant lui ; ce que sachant,
notre Bienheureuse Mère alla elle-même à Grenoble. La chère Mère Péronne-Marie
de Châtel en était partie au mois d'août de cette même année 1624 pour aller
fonder à Aix ; mais il avait fallu donner de grandes assurances qu'elle y
retournerait. Notre Bienheureuse prit son temps pendant cette absence ;
elle arriva à Grenoble au mois de septembre ; d'abord elle reconnut que la
directrice et les novices s'étaient liées d'une affection trop forte pour
gagner toutes ensemble leurs parents, qui étaient les principaux de la ville,
afin qu'ils aidassent à maintenir cette élection. Avec une sainte adresse, sans
faire semblant de rien, ni sans s'y prendre par voie d'autorité et de
correction, elle alla au noviciat, et trouvant la maîtresse un peu pâle, elle lui
dit qu'elle connaissait bien qu'elle traînait quelque chose qui n'était pas
bon, et sur-le-champ la fit mettre à l'infirmerie, ordonnant à l'infirmière de
ne lui point laisser prendre l'air et d'en avoir bien soin pendant ce temps
qu'elle serait directrice en sa place ; ainsi tout le [226] petit commerce
fut rompu au dedans, après quoi elle parla au supérieur, lui représentant la
nécessité qu'il y avait de rompre cette élection. Lui qui avait fait résistance
à tant d'autres, fut tellement gagné par la sagesse et l'humilité de cette
digne Mère, qu'il lui dit « que jamais il n'avait eu intention de faire
brèche à l'Institut, que si toutefois elle jugeait que cette élection y fût
préjudiciable, que comme Mère universelle elle avait le pouvoir de commander ce
qu'elle jugeait pour le mieux, et qu'il avait une entière affection de lui
obéir. » Notre digne Mère lui répondit « qu'elle n'avait point
d'autorité, mais qu'elle le conjurait, lui qui était supérieur de cette
maison-là, de faire procéder à une nouvelle élection », ce qu'il fit
soudain.
Après être demeurée environ trois semaines à Grenoble,[52] elle laissa cette communauté composée de
filles très-vertueuses, extrêmement contentes et en paix, et s'en revint passer
ici après avoir visité nos Sœurs de Chambéry.
CHAPITRE XVII.
les fondations
continuent ; grands honneurs et applaudissements que notre dévote mère
reçoit à besançon.
Incontinent après le décès de notre Bienheureux Père, Notre-Seigneur
manifesta sa sainteté par les miracles qui se faisaient, tant à son tombeau
qu'en divers autres lieux par son invocation et par l'application de ses
reliques, ce qui consolait plus qu'il ne se peut dire notre digne Mère,
laquelle, les années 1623 et 1624, avait procuré que Messieurs de la chambre du
conseil et corps de ville donnassent commission au révérend Père Dom Juste
Guérin, barnabite, à présent notre très-honoré et digne évêque, d'aller avec M.
Ducret, greffier ; ducal, en Chablais, Ternier, Gaillard et autres lieux
plus éloignés, pour s'informer de la sainteté de vie et miracles de notre
Bienheureux Père dont les merveilles se découvraient si grandes que, l'année
1625, cette digne Mère, qui pourvoyait à toutes les dépenses pour une telle et
si grande entreprise, avec une générosité qui ne s'abattait de rien, procura et
tint main que Monseigneur de Genève d'aujourd'hui allât à Rome pour poursuivre
les expéditions des lettres et commissions apostoliques, pour procéder aux
procès et information de la sainteté de la vie de ce Bienheureux.
Cela étant fait, elle disposa ce qui était nécessaire pour la fondation
de notre monastère de Thonon, qui s'établit premièrement à Evian, d'où il fut
transféré. Elle y mena les Sœurs le jour de sainte Madeleine 1625, demeura
quelque quinze jours [228] ou trois semaines en cette nouvelle maison, puis
s'en revint, laissant pour Supérieure, à Evian, notre chère sœur
Marie-Françoise Humbert. Dès qu'elle fut de retour, on pressa pour la fondation
de Rumilly, de laquelle madame de la Fléchère, sainte veuve et grande fille
spirituelle de notre Bienheureux Père, fit préparer sa maison avec un soin et
une affection dignes de sa parfaite dévotion. Notre Bienheureuse Mère alla à
Chambéry quérir notre chère Sœur Marie-Adrienne Fichet, qui y était assistante
et qu'elle voulait employer à ce nouvel établissement. L'on élut à Chambéry,
pour supérieure, notre chère Sœur Marie-Gasparde d'Avisé. Cette digne Mère alla
faire la fondation de Rumilly à la Saint-Michel de cette même année. Elle y
demeura quelque temps, reçut des bonnes filles, puis laissa pour supérieure
notre chère Sœur Marie-Adrienne Fichet, et s'en revint travailler à faire
ranger en bon ordre les Entretiens de notre Bienheureux Père et les
prédications que l'on avait recueillies, ramassant çà et là les lettres
missives que ce Bienheureux avait écrites, et les faisant ranger pour les
imprimer, prenant un soin et peine incroyables pour les lire et relire, afin de
retrancher ce qui ne serait pas convenable qui parût aux yeux du public.
Au mois d'avril 1626, cette digne Mère fut contrainte d'aller en
Lorraine établir une de nos maisons, de laquelle haute et puissante dame de
Génicourt, veuve de M. de Haraucourt, se rendait fondatrice et désirait
ardemment que notre Bienheureuse Mère allât elle-même conduire les Sœurs pour
ériger cette nouvelle école de vertus ; et même les princes et princesses
de Lorraine écrivirent afin qu'elle allât faire ce voyage, disant qu'ils
avaient grand désir que leur État possédât pour quelque temps cette grande
Servante de Dieu, qu'ils désiraient extrêmement de voir. Elle partit donc le 27
avril, avec des Sœurs pour la fondation, et alla passer par Besançon, où la
dévote Sœur Madeleine Adlaine, pressée d'une inspiration divine, poursuivait un
[229] de nos établissements, auquel s'opposait quantité d'obstacles. Il se présenta
à Besançon devant cette digne Mère quatre-vingts filles qui aspiraient toutes à
être religieuses de Sainte-Marie, sans savoir comme elles en pourraient venir à
bout, ne voyant point d'avancement pour notre fondation dans cette ville
impériale ; seulement elles s'étaient assemblées pour témoigner à cette
digne Mère le désir qu'elles avaient d'être ses filles, prendre sa bénédiction
et se recommander à ses prières. Cette digne Mère se mit à rire gracieusement
se voyant assiégée de cette petite armée ; elle exhorta fort toutes ces
bonnes filles au service de Dieu, à la dévotion à la sainte Vierge, et leur
donna bonne espérance que Notre-Seigneur exaucerait leurs prières, et que,
malgré la prudence humaine, notre établissement se ferait à Besançon. Après cela,
elle les fit toutes ranger autour de cette grande salle pour leur dire à
chacune un mot en particulier et les caresser ; et pénétrant avec la
lumière de Dieu dans le fond des cœurs, après avoir regardé ces filles l'une
après l'autre, elle en choisit trente-six, à qui elle dit qu'elles seraient
reçues quand l'établissement de Besançon serait fait, ce qui arriva : pas
une de celles que cette digne Mère avait nommées n'a manqué de faire la sainte
profession en notre monastère de Besançon, qui s'établit en 1630, le jour de
saint Louis. Dès que Messieurs du chapitre surent que la Mère de Chantal était
arrivée à Besançon, ils s'assemblèrent et résolurent de montrer le saint Suaire
à sa considération, grâce que cette Bienheureuse Mère reçut avec une humilité et
joie très-grande, disant qu'elle mettait cette faveur au rang des plus grandes
consolations qu'elle eût reçues en sa vie. Elle baisa et vénéra cette sainte
relique, ensevelissant son cœur dans ce sacré linceul, où le corps précieux de
son divin Amant avait été déposé avec tant d'amoureux soins par Joseph et
Nicodème. L'on fut étonné que Messieurs du chapitre eussent de leur propre
mouvement montré extraordinairement le saint Suaire, [230] étant une faveur qui
ne s'accorde guère qu'aux princes ou princesses. Mais Dieu qui favorise les
désirs des humbles, voyant que sa fidèle servante n'osait demander cette grâce
qu'elle désirait puissamment, il inspira à ces messieurs les chanoines de faire
cet acte de charité, ce divin Amant ne voulant point cacher le Suaire de son
corps à cette bien-aimée, à laquelle il découvrait si souvent les secrets de
son cœur.
Les affaires de notre Institut l'obligèrent de séjourner trois jours
dans Besançon ; tous les seigneurs et les dames qui y étaient alors en
grand nombre, lui allèrent faire offre de leur logis, qu'elle refusa
humblement, aimant mieux demeurer dans la simplicité avec ses religieuses que
d'être magnifiquement accommodée. M. le prince et madame la princesse de
Cantecroix la prièrent au moins de venir entendre la messe dans leur chapelle,
ce qu'elle fit pour donner en cela satisfaction à leur piété. On lui avait fait
préparer de grands tapis et de riches carreaux pour se mettre à genoux, de quoi
elle ne se voulut point servir, disant à madame la princesse de Cantecroix :
« Madame, ne me commandez point, s'il vous plaît, de me mettre sur cet
agenouilloir, j'y serais trop mal à mon aise ; une religieuse a toujours
son agenouilloir préparé en tous lieux, à savoir, la terre, qui est le carreau
dont Notre-Seigneur se servit priant au jardin des Olives, et quand il passait
la nuit en oraison à la montagne. » Ce trait religieux édifia extrêmement
la princesse qui ne sut que répondre, et notre très-digne Mère s'alla mettre à
genoux avec ses huit religieuses, car elle menait, outre les six Sœurs de la
fondation, une compagne pour s'en revenir et une Sœur pour directrice en une de
nos maisons. Elles étaient toutes rangées en cette belle chapelle, et firent
les cérémonies de la messe, ne plus ne moins que si elles eussent été dans un
de nos chœurs, ce qui consolait si fort M. le marquis de Cantecroix, qu'il dit
« qu'il lui semblait voir en ces neuf religieuses, les neuf chœurs des
Anges dans sa chapelle, et [231] que la Mère de Chantal était comme un grand
séraphin ; qu'il lui semblait voir sortir un feu divin de son visage, que
jamais il n'avait rien vu de tel. » Après que la messe fut finie et
l'action de grâces faite, M. et madame de Cantecroix prièrent avec grande
instance notre Bienheureuse Mère d'entrer dans leur hôtel pour en voir les
raretés, de quoi elle s'excusa humblement, disant qu'elle ne pouvait rien voir
en leur magnifique logis qui approchât ce qu'elle voyait en leur personne et en
leur chapelle, que cela lui suffisait. Voyant qu'il ne fallait pas mettre en
contrainte sa modestie religieuse, ils firent appeler Monsieur le comte, leur
fils, et le firent mettre à genoux pour recevoir la bénédiction de cette digne
Mère, laquelle, après plusieurs refus, la donna pour ne pas paraître plus
opiniâtre qu'humble. Le prince et la princesse la conduisirent au lieu de sa
retraite et lui envoyèrent par leurs officiers un dîner fort magnifique, et les
trois jours qu'elle demeura à Besançon, ce vertueux prince et cette bonne
princesse la visitèrent toutes les après-midi. Tant que le jour durait, il y
avait deux grandes salles perpétuellement remplies de monde qui venait voir
cette digne Mère ; à mesure que les uns sortaient, les autres
entraient ; ils se faisaient charitablement place : « Afin,
disaient-ils, que tous puissent voir cette sainte, il n'y faut guère demeurer
chacun. » Elle était en perpétuelle conteste pour ne pas donner sa
bénédiction à ceux qui la demandaient, étant pour l'ordinaire personnes de
considération ; et disait à nos Sœurs : « Pour l'amour de Dieu,
sortons d'ici, ce peuple se méprend et ne connaît pas qui je suis. » Elle
passa chez madame de Château-Rouleau, à Salins, qui est décédée en réputation
de sainteté : ces deux grandes servantes de Notre-Seigneur se parlèrent à
cœur ouvert avec beaucoup de saintes suavités de part et d'autre, et se voulant
séparer, chacune voulait avoir la bénédiction de celle qu'elle estimait lui
être supérieure en vertus, et enfin elles se bénirent l'une l'autre au nom de
Notre-Seigneur. [232]
Avant que d'arriver au Pont-à-Mousson où elle allait fonder, madame de
Génicourt, fondatrice de la maison qui allait s'établir, voulut qu'elle logeât
chez elle ; le frère et la sœur de cette maison avaient ensemble un procès
d'importance. Notre Bienheureuse Mère, entrant là-dedans, invoqua le secours de
Celui qui commanda jadis aux Apôtres d'annoncer la paix aux maisons où ils
entreraient, et fut inspirée de s'enquérir discrètement comment allait la paix
entre les proches, et on lui fit le récit de tout, disant que puisque Dieu
l'avait amenée en ce lieu-là, il fallait que ce fût pour en tirer quelques
fruits. Tout le différend lui fut remis, et elle accorda ces deux parties avec
tant de bonheur et de contentement de part et d'autre, que depuis ils
demeurèrent en parfaite union. Le beau-fils de madame de Génicourt, qui avait
en grande aversion que sa belle-mère se rendît fondatrice de cette maison, fut
tellement touché de la sagesse et sincérité de notre très-digne Mère qu'il
avoua véritablement avoir plus fait que Salomon, qu'il avait trouvé la femme
forte ; et de là, en avant, ce brave seigneur voulut que notre
très-digne Mère l'adoptât, le tînt et le nommât son fils, et non-seulement ne
détourna plus sa belle-mère de faire du bien à notre maison du Pont, ains
lui-même y en fit beaucoup.
Cette fondation se fit fort heureusement et avec de grands avantages
temporels, et fut favorisée de tout ce qui se peut des sérénissimes princes et
princesses de Lorraine, qui visitaient souvent cette très-digne Mère, et depuis
lui écrivirent quelquefois avec grande bonté et respect. Le sérénissime duc de
Lorraine a souvent dit à nos Sœurs qu'à bon droit il les devait appeler ses sœurs,
puisqu'il tenait, aimait et honorait la Mère de Chantal comme sa
mère ; par ce, disait-il : « C'est la sainte de notre
siècle. »
CHAPITRE XVIII.
notre digne mère est
déchargée de la supériorité ; elle entreprend plusieurs voyages qu'on la
pressait de paire.
Pendant le séjour que notre très-digne Mère fit au Pont-à-Mousson, le
temps de sa déposition étant échu, elle ne voulut point retarder, et envoya à
Monseigneur de Genève sa déposition par écrit, et ce bon Prélat la vint
annoncer à la communauté qui fut extrêmement mortifiée, voyant qu'il fallait
que l'humilité de cette bonne Mère eût son effet. L'on élut notre très-honorée
Mère Péronne-Marie de Châtel, que cette Bienheureuse Mère avait fait rappeler
d'Aix, en Provence, pour la mettre assistante céans en son absence. Elle
témoigna un contentement non-pareil de se voir déposée, et faisait passer sa
compagne devant elle, pour observer la règle qui ordonne aux Mères déposées
d'aller les toutes dernières.
Notre chère Sœur Anne-Catherine de Beaumont, alors supérieure en notre
monastère de Paris, en la rue Saint-Antoine, sachant que notre unique Mère
était en Lorraine, fit tout son possible pour procurer qu'elle allât à Paris.
Monseigneur de Bourges, madame de Chantal, sa belle-fille, et quantité d'autres
personnes, firent de grandes instances pour ce voyage ; à quoi elle
répondit « que de nécessité elle n'y en voyait point, que d'utilité elle
était si peu de chose, qu'elle était inutile partout. » Elle
demeura en Lorraine environ quatre mois, mit cette maison dans un très-heureux
acheminement, reçut des bonnes et braves filles et des meilleures maisons,
laissa pour [234] supérieure notre chère Sœur Paule-Jéromine Favrot,[53] et se mit en chemin pour s'en revenir en ce
monastère. Elle dit qu'elle n'avait jamais eu une inclination si hâtée de
sortir d'aucun lieu que de Pont-à-Mousson, à cause de l'extraordinaire
applaudissement qu'elle y recevait, et des visites continuelles qu'elle y
avait, tant de ceux de la cour, que de plusieurs autres personnes des environs
qui la venaient consulter. Entre autres, il y vint une personne de grande
perfection et vie intérieure, conduite par des états fort relevés et spirituels,
qui n'avait pu trouver personne qui eût entendu sa voie intérieure, ni qui lui
eût donné une entière satisfaction et repos d'esprit. Attirée par le bruit de
la réputation de cette digne Mère, elle la vint consulter, et lui ayant parlé à
diverses reprises, plusieurs heures de suite, en demeura si pleinement
satisfaite et si entièrement éclairée, qu'elle dit que jusqu'alors elle n'avait
vécu que de ténèbres et d'ignorance ; mais que cette digne Mère lui avait
découvert les vrais sentiers intérieurs de la perfection, et que Dieu lui avait
tenu la promesse qu'il lui avait faite, lorsqu'une fois, le priant avec grande
véhémence d'esprit de lui enseigner quelqu'un qui l'assurât de sa voie et de la
vérité de ses grâces, Notre-Seigneur lui avait dit : « Dispose-toi,
je t'enverrai ma fidèle Servante, à laquelle j'ai donné la lumière et le
don de la conduite ; elle t'éclaircira. » Cette bonne âme
publiait partout que, comme saint Paul disait que Notre-Seigneur Jésus-Christ
était venu au monde pour lui seul, qu'aussi, quoique sans comparaison, elle
pouvait dire que Dieu avait envoyé pour elle cette digne Mère en Lorraine.
Elle était allée par le Comté, et s'en revint par le duché de
Bourgogne, visita plusieurs de nos maisons, passa chez madame de Toulonjon, sa fille,
où madame de Coulange et madame de Chantal, sa belle-fille, se rendirent de
Paris pour la [235] venir voir. Cette digne Mère fît ici un trait de sa grande
habitude à retrancher à sa nature toutes les petites satisfactions humaines.
Pour aller d'Autun chez madame de Toulonjon, l'on voulait qu'elle fit un détour
pour passer à Montelon, qui était une terre de feu M. de Chantal ; elle ne
le voulut pas, disant que cela ne lui servirait qu'à lui donner une inutile
complaisance et lui causerait quelque distraction des choses du monde ;
ainsi, elle se sépara du carrosse de sa belle-fille, et entra dans un autre
pour venir le droit chemin, quoiqu'il lui fâchât de quitter cette très-bonne et
très-belle-fille, qui avait fait un si long voyage pour la venir voir.
En ce temps-là, cette Bienheureuse Mère reçut une consolation qui lui
fut nonpareille, et laquelle était de très-grande édification, je ne craindrai
pas de la rapporter un peu au long. Elle n'avait qu'un unique frère,
Monseigneur l'archevêque de Bourges, lequel elle aimait chèrement ;
quoique ce fût un très-bon prélat, et qu'il vécut dans la crainte de Dieu, si
était-il au monde et à la cour d'une manière qui faisait tirer une peine
très-grande à notre Bienheureuse Mère, et souvent elle priait Dieu de changer
le cœur de ce cher frère, en sorte qu'il ne servît plus à deux maîtres. Environ
ce temps-là elle fut exaucée ; Dieu renversa ce grand prélat sur son lit,
pour l'élever par après bien haut en son amour. Il lui fit entendre, comme à un
autre Ezéchias, qu'il fallait qu'il mît ordre à sa maison, qu'il n'avait plus
que deux jours de vie. Dès qu'il eut ouï cette sentence des médecins, il se mit
à penser et à repasser dans sa mémoire, en l'amertume de son âme, toutes les
années de sa vie devant Dieu ; sa Bonté divine fit en lui deux merveilles,
ainsi que nous allons voir, rapportant les propres paroles de la lettre qu'il
écrivit à notre Bienheureuse Mère après sa guérison ; voici ses
mots : « Ma très-unique sœur, vous êtes la première à qui j'écris
depuis ma maladie, et il est bien raisonnable, puisque, après Dieu et
Notre-Dame, je tiens la santé et la vie de vous, et, par [236] conséquent, il
faut que je vous raconte mon aventure. Ma maladie était si furieuse, et m'avait
réduit si bas, que l'on me donna l'extrême-onction ; j'eus un
assoupissement de vingt-quatre heures que l'on crut être l'achèvement de ma
vie ; à force de remèdes violents, l'on me redonna un peu de connaissance,
et aussitôt j'entendis de mes amis et les médecins qui dirent que sans miracle
je ne verrais pas lever deux fois le soleil. Je ne leur répondis pas un mot,
mais je m'enfonçai dans mon lit et me mis à penser à ma conscience ;
alors, il me semblait que Notre-Seigneur ne me regardait que parce que j'ai la
grâce d'être votre frère, mon unique sœur, et qu'il me disait en son courroux,
que, si je ne prenais garde à moi, je passerais par les mains de sa justice, de
laquelle je pris une telle épouvante, que je croyais être perdu ; et, dans
un déplaisir extrême de ma vie passée, je m'enhardis de prier Dieu de tout mon
cœur de prolonger mes jours, lui protestant d'employer ceux qu'il lui plairait
me donner à son saint service. À l'instant, je fis quatre vœux, non
simples ; mais j'eus l'intention de les faire fermes et solennels comme
sont ceux des religieux. Le premier, je fis et refis le vœu de chasteté
perpétuelle ; le second, que j'irai à Notre-Dame de Lorette, voyage que je
m'étais oublié de faire après avoir été guéri ; mais je spécifiais que
j'irai moi-même, sans m'en faire dispenser ; le troisième, que de Lorette
j'irai gagner les pardons à Rome et visiter les saints lieux ; le
quatrième, que je dirai tous les jours messe sans jamais y manquer, sinon par
absolue impuissance et nécessité. Mes vœux étant ainsi faits, je fus trois
heures sans me remuer, me tenant auprès de Notre-Seigneur, et lui jurant de
mettre ordre à ma vie. Durant ce temps-là, sans que je m'en aperçusse, je fis
une crise de sueur incomparable, et moi que l'on ne pensait rien moins que
d'aller enterrer, fus trouvé sans fièvre et sans aucune incommodité. Jugez par
là, ma très-chère sœur, combien me [237] voilà obligé envers la divine Majesté
et envers vous pour l'amour de qui j'ai été regardé en miséricorde. »
Jusqu'ici ce sont les paroles de ce bon archevêque, lequel accomplit si
exactement ses vœux, que, même le jour qu'il prit le mal de la mort, il voulut
encore dire la sainte messe, et la léthargie le saisit à l'autel, ainsi que
nous le dirons en son lieu, remarquant seulement ici que Notre-Seigneur lui
ajouta, comme à Ezéchias, quinze ans à ses années, lesquelles il a employées au
service de la divine Majesté, avec une pureté de conscience et des œuvres de
charité tout à fait remarquables.
Le changement de ce grand prélat donna de si grands sentiments de
reconnaissance à notre Bienheureuse Mère, qu'elle en fit faire des prières et
communions en actions de grâces dans tous nos monastères, et faisait en son
particulier trois communions tous les ans, pour rendre grâces à la très-sainte
Trinité de celle qu'avait reçue cet unique frère, qui ne tarda point d'aller
rendre son vœu à Notre-Dame de Lorette, et, au retour, passa en cette ville
d'Annecy où il fit de grandes aumônes, fit une revue générale de sa conscience,
en conféra longuement avec sa sainte sœur, retrancha, par son avis, de son
train, quelques personnes superflues, prit d'elle des exercices qu'elle lui
écrivit de sa main pour la conduite de son âme. Dès lors, ils s'écrivirent plus
souvent l'un à l'autre, et Monseigneur de Bourges appelait cette digne Mère la
sainte directrice de son âme.
CHAPITRE XIX.
notre digne mère fait
travailler aux informations de la vie de notre bienheureux père ; son
admirable constance en la mort de son fils.
Notre Bienheureuse Mère venant de son voyage de Lorraine, et entrant au
monastère où était élue supérieure notre très-bonne Mère de Châtel, d'heureuse
mémoire, elle ne manqua pas de faire entrer sa compagne la première[54] et de se mettre à genoux pour recevoir la
bénédiction de la supérieure, laquelle, au contraire, la contraignit
agréablement de donner la sienne à la communauté. Cette digne Mère se retira au
chœur en la place des déposées, qui est toute la dernière. Il est vrai qu'elle
n'y demeura que quelques jours, Monseigneur de Genève, frère et successeur de
notre Bienheureux Père, lui ayant commandé, à l'instance de notre Mère de
Châtel, de prendre en haut une place plus commode, tant au chœur qu'au
réfectoire.
Cette digne Mère trouva que le révérend Père Dom Juste Guérin
travaillait avec M. Ramus, subdélégué par le Saint-Siège apostolique, aux
informations de la vie et miracles de notre Bienheureux Père. Elle se mit
elle-même à y travailler, faisant à loisir une très-belle déposition, et
procurant que ceux qui avaient connu et conversé avec ce Bienheureux en fissent
aussi. Ce fut alors que l'on commença à lui faire faire ses Réponses sur
nos Règles, Constitutions et Coutumier. Dans ces [239] occupations, elle finit
l'année 1626, et commença la suivante, 1627, procurant qu'outre M. Ramus, l'on
obtînt d'autres commissaires apostoliques. Messeigneurs de Bourges et de
Belley, l'ancien, furent nommés par Sa Sainteté.
Cette digne Mère pressait fort Monseigneur de Bourges, son unique
frère, de venir promptement travailler à la gloire de notre Bienheureux Père.
Ce digne archevêque lui écrivit, étant sur le point de partir pour se rendre en
cette ville, les paroles suivantes : « J'ai une consolation
nonpareille de la commission que Sa Sainteté m'a donnée de travailler à
l'information de la vie et miracles de notre grand et saint Prélat ; sans
doute le Ciel m'a préparé pour faire moins indignement cette enquête ;
Dieu me donne des goûts non communs de son saint amour, et des dégoûts pour les
choses du monde, que les avoir ou ne les avoir pas m'est chose indifférente. Si
Dieu me voulait encore donner une semblable maladie à celle que j'eus
dernièrement, avec les mêmes lumières pour mon salut, je l'accepterais de bon
cœur. Je vous dis mes pensées comme à la sainte directrice de ma conscience, et
me réjouis extrêmement d'aller recevoir vos conseils de votre propre bouche.
Or, sachez, ma très-chère sœur, que je ne veux point que notre cher Monseigneur
de Belley l'ancien, moi ni mes domestiques, coûtent rien à votre couvent, et
quand nous irons à la campagne, fournirai-je encore six ou sept écus par jour
pour la dépense commune de ceux qui seront requis pour travailler à notre bel
ouvrage. Oh ! que je me réjouis d'ouïr tous les jours raconter les grâces
et les vertus du Saint que le Ciel nous a donné pour être le flambeau de nos
jours et le modèle de notre vie ! » Nous rapportons ainsi au long les
paroles de ce bon prélat pour faire voir les obligations que nous lui
avons ; car, sans les frais et dépenses qu'il fit pour cette bénite œuvre,
jamais nous n'aurions pu soutenir, sans une entière ruine du monastère, cette
dépense. [240]
Ce grand archevêque et Mgr Camus, évêque ancien de Belley, arrivèrent
ici au printemps de l'année 1627, et l'on commença, selon toutes les formalités
requises, à recevoir les dépositions ; souvent cela se faisait dans notre
parloir, et en la présence de notre Bienheureuse Mère, laquelle, si elle avait
arrosé de larmes, par le passé, le tombeau de son saint Père, alors elle le
couvrait des fleurs d'une suavité nonpareille, et de continuelles actions de
grâce à Notre-Seigneur, qu'elle voyait si admirable en ses Saints. Si elle
avait semé en larmoyant, elle cueillait en joie, et portait d'ordinaire
gaiement sa gerbe sous son bras, je veux dire qu'elle avait toujours dans sa
manche quelques dépositions des vertus de notre saint Fondateur, pour les lire
dès qu'elle avait un moment de loisir.[55] Tout l'été se passa en cette douce
occupation, mais lorsque cette chaste abeille ne pensait qu'à nourrir suavement
son âme du miel de mille consolations qu'elle amassait sur les fleurs des
vertus de notre Bienheureux Père, il plut à Notre-Seigneur de l'abreuver de
fiel par une affliction bien sensible.
Elle n'avait qu'un fils qu'elle avait toujours aimé d'un amour unique,
et qui avait pour elle les sentiments les plus filials, tendres et respectueux,
que la nature ait jamais gravés dans l'âme d'un fils bien né. C'était un
seigneur autant accompli de corps, d'esprit et d'humeur que l'on en ait vu en
son siècle ; il était généralement aimé, et n'avait besoin pour cela
d'autre artifice que de se faire voir, étant si aimable qu'il n'a jamais été
haï que de ceux qui le regardaient avec des yeux jaloux de sa fortune. Il n'eut
jamais de duels pour lui, quoiqu'il se soit souvent battu ; ç'a été pour
être second de ses amis qui l'en priaient et piqué de cet aiguillon pernicieux
qui porte les âmes généreuses à un acte si lâche. Il avait épousé une femme
noble, riche et si aimable en toutes façons,[56] qu'il écrivait à notre digne Mère les
paroles suivantes : « J'admire la conduite de Dieu sur nous ;
quand vous seriez demeurée au monde selon nos souhaits, que vous auriez pris
tous les soins de nous avancer, que votre amour maternel et votre nonpareille
prudence vous auraient su faire inventer, vous n'auriez pas pensé à me loger
mieux que je suis, Dieu m'ayant donné en mon mariage tous les avantages
souhaitables à ceux de ma condition, de mon âge et de mon humeur. » Parmi
tant d'avantages et étant si bien vu à la cour, ce jeune seigneur avait de
grandes complaisances au monde. Or, il arriva qu'un grand seigneur de France, son
intime ami, ayant eu la tête tranchée pour certaines raisons d'État, la mort de
cet ami retira un peu M. de Chantal des affections terrestres, ne pouvant ôter
de devant ses yeux le désastre de son ami ; et la fin des folles
occupations des hommes mondains, qui acquièrent quelquefois, après mille soins
et travaux, un supplice temporel et un châtiment éternel.
Quelques mois après la mort de ce grand seigneur, le baron de Chantal
sentit une nuit qu'on le soulevait par les épaules, jusqu'à deux ou trois
reprises, comme le voulant mettre à bas du lit, et il entendit et connut
distinctement la voix de son ami mort qui lui dit par deux fois ces
paroles : « Prépare-toi, Chantal, il faut venir, il faut
venir. » Le baron de Chantal, qui aimait assez cet ami pour le faire vivre
en sa mémoire, mais [242] non pas pour le suivre au tombeau, lui
repartit : « Non, non, je n'irai pas encore » ; alors
l'esprit frappa un grand coup proche du lit, dont le valet de chambre qui était
couché dans un autre lit fut éveillé, et, ayant apporté de la chandelle, son
maître passa le reste de la nuit à lire un bon livre pour se divertir et calmer
l'émotion de son esprit. Notre-Seigneur, qui voulait disposer le baron de
Chantal à une heureuse mort, permit que la visite de son ami décédé laissât en
lui de fréquentes pensées de la mort ; la cour ne lui plaisait plus tant
qu'auparavant, et, s'étant présenté une occasion d'aller servir l'Église et le
roi, en l'île de Rhé, contre les Anglais, il laissa les plaisirs du Louvre aux
autres courtisans et alla conquérir le Ciel. Un jour que l'on devait donner un
rude choc, le baron de Chantal se confessa et communia avec une piété
extraordinaire, avant d'aller combattre ; le combat fut sanglant, et il
s'y comporta avec tant de valeur qu'il changea trois fois de cheval ;
enfin, Dieu permit qu'il fût blessé à mort, et, joignant ses mains, réclama la
miséricorde de Dieu et trépassa ainsi glorieusement.
Monseigneur de Genève ayant appris cette nouvelle, se résolut d'en
présenter lui-même le calice à la Bienheureuse Mère de ce digne fils ; car
d'en laisser la commission à Monseigneur de Bourges, qui était alors, comme
nous avons dit, en cette ville, il était trop affligé lui-même pour consoler
autrui. Après la sainte messe, où notre Bienheureuse avait communié, le digne
prélat la fit appeler au parloir, et manda par la Sœur portière à notre chère
Mère de Châtel qu'elle se tînt prête, afin que si notre digne Mère tombait à
cœur failli elle la secourût.
Le parloir était plein de Messeigneurs les commissaires, plusieurs
ecclésiastiques et quelques Pères de religion ; Monseigneur de Genève
dit : « Ma Mère, nous avons des nouvelles de guerre à vous
dire ; il s'est donné un rude choc en l'île de Rhé ; le baron de
Chantal, avant que d'y aller, a ouï messe, s'est confessé et communié. — Et
enfin, Monseigneur, dit cette [243] digne Mère, il est mort ! » Le
bon prélat se mit à pleurer sans pouvoir répondre une seule parole, et ce fut
un gémissement universel dans ce parloir ; cette vraie femme forte
connaissant par là la vérité de sa perte, demeura seule tranquille parmi tant
de sanglots, et s'étant mise à genoux les mains jointes, les yeux élevés au
ciel et le cœur percé d'une véritable douleur, elle laissa le passage libre à
ses larmes et aux paroles de son amoureuse soumission aux volontés
divines ; voici ses propres paroles que nous avons encore en écrit de la
main de notre Mère de Châtel, laquelle était à son côté, et qui les a soudain
écrites : « Mon Seigneur et mon Dieu, dit-elle, souffrez que je parle
pour donner un peu d'essor à ma douleur, et que dirai-je mon Dieu, sinon vous
rendre grâce de l'honneur que vous avez fait à cet unique fils de le prendre
lorsqu'il combattait pour l'Église romaine ? » Puis elle prit un
crucifix, duquel elle baisa les deux mains : « Mon Rédempteur,
dit-elle, je reçois vos coups avec toute la soumission de mon âme, et vous prie
de recevoir cet enfant entre les bras de votre infinie miséricorde. »
Après cela, elle adressa la parole à son cher défunt et dit : « O mon
cher fils ! que vous êtes heureux d'avoir scellé par votre sang la
fidélité que vos aïeux ont toujours eue pour l'Église romaine ; en cela je
m'estime bien heureuse, et rends grâce à Dieu d'avoir été votre mère. »
Sur cela, elle se tourna vers notre Mère de Châtel, et dirent ensemble un De
profundis.
Messeigneurs et les assistants, voyant que cette femme forte n'avait
besoin d'autre soutien que celui de sa grande vertu, ne lui disaient pas un
mot, la douleur et l'admiration leur ravissaient le discours. Elle se leva et
pleurant pacifiquement et sans sanglots, elle dit à Monseigneur de
Genève : « Je vous assure qu'il y a plus de dix-huit mois que je me
sentais intérieurement sollicitée de demander à Dieu que sa bonté me fit la
grâce que mon fils mourût à son service, et non dans ces duels malheureux où
ses amis l'engageaient quelquefois. » Comme elle [244] disait cela,
Monseigneur de Bourges, oncle du défunt, s'approcha avec tant de larmes et de
soupirs, qu'il émouvait tout le monde à faire comme lui. Notre Bienheureuse
Mère le consolait avec des paroles célestes, et il lui disait : « O
ma chère sœur ! votre résignation m'épouvante, elle est digne de votre
seule vertu, pour moi je n'y saurais encore atteindre ; » et
racontait par le menu les perfections, le mérite et le bon naturel du défunt,
soulageant sa douleur en l'augmentant par ces petits souvenirs qui sont si
chers après la perte de quelque personne bien aimée. Tandis que le bon
archevêque faisait ce discours, notre Bienheureuse Mère l'entrecoupait toujours
de temps en temps de quelques paroles de dévotion.
Étant sortie du parloir, elle alla devant le Saint-Sacrement, où elle
fut longtemps en oraison, jusqu'à ce que la supérieure la priât d'aller prendre
un peu de nourriture ; ce qu'elle fit, se levant de sa prière toute
tranquille et toute résignée. Elle se mit à la suite des exercices religieux et
à poursuivre les affaires commencées, comme si de rien n'eût été ; et
jamais ni l'affliction ni la consolation ne l'empêchaient de rendre son devoir,
quoique dans les rencontres fort affligeantes elle fût toujours quelques jours
fort retirée en elle-même et un peu abattue, ayant un cœur fort sensible aux
pertes de ceux qu'elle aimait.
Quelques jours après la réception de cette douloureuse nouvelle, notre
Bienheureuse Mère écrivit à une de nos Sœurs supérieures les paroles
suivantes : « Je vous remercie, ma très-chère fille, des prières que
vous avez fait faire pour mon fils. Il est vrai, j'ai ressenti cette mort, non
toutefois comme mort, mais comme vie pour l'âme de cet enfant, Dieu m'ayant donné
un sentiment très-tendre et une lumière fort claire de sa miséricorde envers
cette âme ; hélas ! la moindre des appréhensions que j'avais de le
voir mourir en la disgrâce de Dieu parmi ces duels où ses amis l'engageaient me
serrait plus le cœur que sa mort qui a été très-bonne et chrétienne. Je
confesse que cette mort [245] m'a été sensible, mais la consolation que ce fils
ait donné son sang pour la foi a surpassé ma douleur ; et outre
cela, ma chère fille, il y a si longtemps que j'ai donné ce fils et toutes
choses à Notre-Seigneur, que sa bonté m'a fait la grâce de ne plus avoir de
désirs, sinon qu'il lui plaise disposer de tout à son gré, au temps et en
l'éternité. »
Ce qui en ce rencontre touchait bien fort notre Bienheureuse Mère,
c'était l'extrême douleur où elle voyait Monseigneur de Bourges qui aimait le
défunt, non comme son neveu, mais comme son propre fils, et ne se pouvait
remettre de sa perte, et par conséquent n'avait pas la liberté pour s'appliquer
comme auparavant à la sainte besogne des informations de la vie de notre
Bienheureux Père, dont le moindre retardement était fort pénible à notre
Bienheureuse Mère, laquelle voyant que ses paroles ne faisaient pas une
impression aussi efficace qu'elle l'eût souhaitée au cœur de ce bon frère, pour
le réduire à une parfaite résignation, elle se résolut d'avoir recours à
Notre-Seigneur, et pria notre très-honorée Mère de Châtel de faire avec elle
trois communions pour impétrer de la très-sainte Trinité la consolation et
conformité parfaite requises à ce bon prélat. À la troisième de ces communions
faites à cette intention, ces deux chères Mères étant à genoux l'une proche de
l'autre, au chœur, faisant leurs actions de grâce, notre Bienheureuse Mère se
tourna vers la mère de Châtel, et lui dit : « Ma chère Mère, disons
chacune un Laudate Dominum, etc. Dieu nous a exaucées. » Ce
qu'elles firent ; et après, notre mère de Châtel la priant de lui dire
comme quoi elle avait eu cette connaissance, la regardant comme sa supérieure,
elle lui en rendit compte en cette sorte : « Au commencement de la
messe, dit-elle, comme je demandais à Dieu une entière conformité de la volonté
de Monseigneur de Bourges à la sienne très-sainte, mon âme fut puissamment
tirée en cette divine volonté, que je vis être Dieu même, et l'on me fit une
interrogation intérieure, si j'étais prête à souffrir pour [246] mon
frère ; je répondis que j'étais prête à faire la volonté divine ;
alors je connus, en cette volonté divine, que Monseigneur de Bourges avait trop
aimé mon fils selon le monde, et qu'en punition de ce grand amour naturel et de
ces qualités mondaines, Dieu permettait ce grand ennui, qu'il souffrait de sa
perte, et que les motifs de résignation qu'on lui donnait et que lui-même
voyait ne le soulageaient point. Je me livrais derechef à la divine volonté,
protestant à Notre-Seigneur que si telle était sa sainte ordonnance et bon
plaisir, de bon cœur je me dépouillais, pour ce bon frère qui disait la messe,
de la tranquillité et résignation que sa bonté m'avait donnée. Je demeurai dans
ce sentiment jusqu'après la sainte communion, qu'il me fut dit
intérieurement : Je vous ôte et lui donne ; dès lors je
sentis toute ma petite résignation se départir de moi, quant au sentiment, et
vis entrer en la partie inférieure de mon âme toutes les tendresses et autres
mouvements de douleur et de souvenir de mon fils, que j'avais vu en Monseigneur
de Bourges, ce qui me fit bien souffrir quelque temps durant, sentant en mon
âme une perpétuelle distraction de ce fils, et serrement de cœur ; mais, au
reste, je fus très-consolée, lorsque après la messe, allant trouver le bon
Monseigneur de Bourges, droit en entrant, il me cria dès la porte : Enfin,
ma chère sœur, j'ai remis ma volonté entre les mains de Dieu, et sur la fin de
la messe, je me suis trouvé tout guéri de l'extrême inquiétude où j'étais pour
la perte de notre cher défunt ; ajoutant plusieurs autres paroles de
résignation, dont je bénis Dieu avec un grand sentiment de reconnaissance
envers la divine bonté. Dès ce matin-là, Monseigneur de Bourges se mit à
travailler assidûment aux affaires de notre Bienheureux Père comme
auparavant. » Voilà la déclaration que cette Bienheureuse Mère a faite de
sa propre bouche sur ce sujet, et quoique par une charité non commune elle eût
tiré à soi les ennuis et douleurs de Monseigneur son [247] bon frère, si est-ce
qu'elle ne parlait non plus du cher défunt que si elle eût été dans des
sensibles résignations de sa perte. Mais s'il en fallait dire quelque chose,
c'était en bénissant Dieu de la grâce qu'il lui avait faite de mourir en
chevalier chrétien, et encore disait-elle cela en peu de mots, mais avec une
entière résignation.
Environ trois mois après le décès du baron de Chantal, une bonne âme le
vit en état de grâce, mais dans une grande souffrance au purgatoire comme dans
un puits profond, et vit notre Bienheureuse Mère au-dessus du puits avec une
grande croix en sa main, dont elle tendait le bout à ce cher fils souffrant, et
avec cela, petit à petit, l'élevait de cet abîme de souffrance. L'on attribuait
le soulagement que cette sainte donnait à son fils avec la croix, à ses
souffrances dont elle lui appliquait les mérites par la vertu de la croix et du
sang de Jésus-Christ. La personne qui eut cette vision fut tellement tourmentée
de voir par quelles souffrances cette âme se purgeait en purgatoire des vains
plaisirs qu'elle avait eus au monde, qu'elle en demeura comme pâmée et avec une
sueur froide universellement par tout son corps ; en sorte qu'il fallut
lui aller au secours et ne pouvait-on la faire revenir à soi ; cette vue
lui profita beaucoup pour son âme.
CHAPITRE XX.
notre bienheureuse
mère est élue à orléans supérieure ; deux miracles de cette digne mère, avec plusieurs choses
remarquables en son voyage.
L'Ascension de l’année passée 1626, nos chères Sœurs d'Orléans ayant à
faire une élection, et sachant notre Bienheureuse Mère déposée, elles l'élurent
pour Supérieure. Et si bien Sa Charité ne pouvait accepter un triennal hors de
cette première maison de l'Institut, à cause que notre Bienheureux Père avait
témoigné qu'il voulait qu'elle eût un soin universel des maisons, mais qu'elle
ne s'attachât point à la conduite particulière que de celle-ci ; néanmoins
il fut jugé à propos qu'elle fit un voyage à Orléans pour faire faire une
nouvelle élection ; mais son voyage fut retardé jusqu'au mois de
septembre, auquel temps Messeigneurs les commissaires devaient finir ce qu'ils
avaient à faire pour lors en ce pays, touchant les informations de la vie de
notre Bienheureux Père. Comme elle disposait de son voyage, les dames de
Crémieux et les principaux de la ville, désirant une de nos maisons dans leur
ville, ils souhaitèrent fort que notre Bienheureuse Mère y menât les
Sœurs ; l'on conclut donc qu'elle passerait par Crémieux pour faire
l'établissement.
Le jour que notre Bienheureuse Mère partit pour ce voyage, M. de
Granieu de Grenoble, étant depuis plusieurs années travaillé de grandes
douleurs de tête, venait chercher sa santé au tombeau de notre Bienheureux
Père ; il arriva tout comme notre digne Mère sortait du monastère. Ce
dévot gentilhomme [249] se jeta à genoux devant elle, qui, voyant que c'était
le fils de madame de Granieu, l'une de ses plus chères et fidèles amies
spirituelles, en lui disant gracieusement bonjour, elle appuya sa main sur sa
tête ; il se leva tout joyeux et tout guéri, et entrant dans notre
parloir, il raconta comme sa douleur de tête s'était passée lorsque la main de
cette digne Mère s'était appuyée dessus. « J'étais, disait ce bon
gentilhomme, venu chercher ma santé vers le Saint, et je l'ai trouvée vers la
Sainte. »
Le premier soir que cette digne Mère passa à Crémieux, il arriva une
chose notable de l'efficace de ses prières. Mesdames de Saint-Julien et de
Mépieu, qui avaient procuré la fondation, s'étaient logées ensemble, et tout leur
train, pour laisser l'une de leurs maisons plus libre à notre Bienheureuse Mère
et à ses filles. Or, il arriva qu'un palefrenier ayant bu plus qu'il ne fallait
pour porter du feu avec de la paille, mit le feu dans la litière ; s'étant
endormi avec une chandelle en sa main, et s'éveillant en sursaut, se voyant
environné de feu, il sauta par la fenêtre et s'enfuit sans pourvoir à autre
secours ; les chevaux qui étaient en bon nombre menaient un grand
tintamarre dans cette écurie, ce qui éveilla de bonne heure ceux du logis. La
bonne et dévote madame de Mépieu, voyant le feu dans sa maison dont il ne
fallait attendre qu'un total embrasement, fit courir à notre digne Mère, la
suppliant de faire tel vœu qu'elle jugerait à propos, qu'elle l'accomplirait.
Ce fut une chose véritablement miraculeuse et reconnue telle de tous. Dès
aussitôt que notre Bienheureuse Mère se fut mise à genoux, le feu s'éteignit
comme si un déluge d'eau fût tombé dessus ; les planchers qui commençaient
à enfoncer demeurèrent comme en voûte ; et on trouva de la paille à moitié
brûlée ; un pouvoir souverain ayant arrêté ce feu qui était tel qu'il
suffit de dire que des gros chevaux de carrosse, de cent écus la pièce, furent
trouvés morts et tout grillés sous les râteliers. Chacun criait : « Miracle !
miracle ! » Mais l'humble [250]
Servante de Dieu ne manqua pas d'inculquer puissamment que ce miracle
était arrivé par les intercessions de notre saint Fondateur, au tombeau duquel
elle avait fait vœu que madame de Mépieu offrirait une petite maison d'argent,
ce qu'elle a exécuté ; mais quelque défense que cette vraie humble pût
faire, chacun ne laissa pas de lui attribuer ce miracle, et depuis, ceux de la
ville de Crémieux lui ont une spéciale dévotion.
Elle fit l'établissement avec grande consolation et édification du
peuple, y laissa pour supérieure notre chère Sœur Marie-Adrienne Fichet, et
poursuivant son voyage, elle arriva à Orléans où il ne se peut dire avec quelle
sainte jubilation elle fut reçue, ni combien de consolation elle eut en ce monastère-là,
que Notre-Seigneur gratifia de plusieurs miracles pendant son séjour, par les
intercessions et l'application des reliques de notre Bienheureux Père.
Notre digne Mère fit trois mois de séjour dans le monastère d'Orléans,
et quoiqu'elle n'eût pas accepté le triennal, elle condescendit, puisqu'elle
était élue, à faire toutes les fonctions de supérieure avec une exactitude,
douceur et humilité qui remplissaient le dedans et le dehors d'une rare
édification. Après cela, elle fit entendre au chapitre comme elle ne pouvait
servir plus longtemps leur maison pour les raisons ci-dessus, mais que l'on
avait trouvé bon qu'elle les allât servir pour quelque temps, pour donner
exemple que rien que l'impossibilité ne doit empêcher les supérieures d'aller
aux maisons où elles peuvent être élues ; que puisqu'elle était hors de
pouvoir de les servir davantage, elle les priait de procéder à une nouvelle
élection ; ce que ses chères sœurs firent avec non moins de mortification
que de filiale soumission à cette digne Mère, laquelle grandement satisfaite de
cette communauté, et ayant reçu commandement de Monseigneur de Genève, elle se
rendit à Paris où elle demeura quelque temps, tant dans le monastère de la
ville qu'en celui du faubourg Saint-Jacques. Cette digne [251] Mère croyant que
bientôt notre maison de Turin s'établirait et que notre chère Sœur
Anne-Catherine de Beaumont, alors supérieure au faubourg Saint-Jacques,
supporterait avec plus de santé l'air du Piémont, elle fit que Monseigneur de
Genève la rappelât en ce monastère, et fit venir supérieure au faubourg notre
très-honorée Mère Marie-Jacqueline Favre, qui avait été. rappelée de Dijon, et
était pour lors en notre maison de Bourg-en-Bresse qu'elle avait établie.
Le printemps et l'été de cette année 1628 donnèrent grande commodité à
cette Bienheureuse Mère de visiter quantité de nos monastères ; elle fut
empêchée par la contagion d'aller en quelques-uns, mais elle trouva moyen de
leur faire tenir de ses lettres, les animant à la charité réciproque, et à subir
avec amoureuse soumission le fléau de Notre-Seigneur.
Elle passa à Allonne, chez madame de Toulonjon, sa fille, où elle
séjourna quatre ou cinq jours pour des affaires,[57] et, ne pouvant aller visiter nos Sœurs
d'Autun, à cause que la peste était furieusement dans la ville, elle leur
écrivit. Notre chère Sœur Marie-Hélène de Chastellux, alors supérieure, sachant
que notre digne Mère ne venait qu'à une petite demi-lieue d'Autun, elle obtint
permission des supérieurs de l'aller attendre au milieu d'un champ, et que là,
lui parlant de loin, elle rendrait compte de sa maison à celle qui, comme Mère
commune, devait savoir l'état de toutes. Quand notre Bienheureuse Mère vit
cette bonne supérieure éloignée d'elle, qui lui voulait parler comme cela, elle
invoqua le secours de Notre-Seigneur, demeura un peu en oraison ; puis,
faisant le signe de la croix : « Assemblons-nous, dit-elle, au nom de
Dieu, il sera au milieu de nous, et nous défendra du mal. » Cela dit, elle
va à grands pas vers la [252] chère supérieure, qui n'osait s'approcher,
l'embrassa tendrement et la fît monter en carrosse et s'asseoir proche d'elle.
Madame de Toulonjon, qui conduisait sa digne mère, n'osait dire mot, quoiqu'il
lui fâchât fort, à cause de mademoiselle sa fille, qui était alors âgée seulement
de six ans, et l'unique de ses enfants ; elle disait à la compagne de
notre Bienheureuse Mère : « Véritablement, si je n'étais assurée en
mon âme que ma mère est une sainte, je transirais d'appréhension. »
Elles allèrent coucher chez M. le baron de Roussillon, qui avait épousé
la fille du comte de Chastellux, propre sœur de notre chère Sœur la supérieure
d'Autun. Quand la bonne baronne de Roussillon vit sa sœur, et qu'elle sut que
le même jour elle était sortie d'Autun, elle se jeta à genoux devant notre
Bienheureuse Mère, et lui dit : « Madame, si votre sainteté ne me
mettait hors de crainte, je tremblerais et je quitterais ma maison à ma
sœur ; mais j'ai confiance que point de mal ne peut arriver à qui reçoit
le bien de votre bénédiction. » Elle obtint que cette digne Mère bénît sa
maison, et avec cela demeura si hors de crainte, que la nuit suivante elle
coucha avec sa chère sœur, la bonne Mère de Chastellux, de laquelle le
lendemain notre Bienheureuse Mère se sépara, l'ayant comblée de consolations,
et l'ayant assurée que Notre-Seigneur préserverait sa maison de la
contagion ; ce qui arriva, quoique toutes les maisons plus voisines du
monastère restèrent entièrement désertes, tant l'infection et la mortalité y
furent grandes.
De là cette digne Mère alla en notre monastère de Dijon, où pour
plusieurs bonnes affaires, tant de Messieurs ses enfants que de l'Institut,
elle demeura trois semaines. Monseigneur de Bourges s'y rendit tout exprès pour
la voir et lui conférer de son âme, ce qu'il fit à diverses reprises, et fort à
son contentement et très-grand profit.
Son séjour dans Dijon fut plein de mille bénédictions, et, comme lui
dit une personne de doctrine, qui vint lui faire une [253] très-belle harangue,
elle pouvait dire comme Jacob, au retour de Mésopotamie : Le Seigneur
m'a bénie de deux troupes ; car, elle avait, d'un côté, Madame sa
fille et sa petite-fille, et, de l'autre, environ quarante religieuses, dont
six étaient destinées pour notre fondation de Besançon, toutes dans une grande
réputation de vertu et perfection religieuse.
De Dijon elle alla à Châlons, où elle séjourna quelques jours chez
Monseigneur l'évêque, son propre neveu, tant parce que l'on traitait déjà de
nous y établir, que parce que ce bon prélat ne voulut jamais lui donner un équipage
pour s'en aller, qu'elle n'eût demeuré quatre ou cinq jours dans sa ville,
pendant lesquels il conféra avec elle et prit ses avis, non-seulement pour son
particulier, mais pour le bien général de son diocèse. Les Mères Carmélites et
les dames de Lencharre, religieuses réformées de Saint-Benoît, demandèrent fort
instamment que cette digne Mère passât chez elles, ce qu'elle leur accorda avec
le congé de Monseigneur l'évêque, duquel les Ursulines de Châlons obtinrent
qu'elle irait dîner en leur réfectoire, et voir un peu la suite de leurs
exercices pour prendre ses avis, qu'elle leur donna avec grande humilité et
cordialité. Ces bonnes religieuses lui coupèrent une partie de la queue de son
voile, ce dont elle pleura tendrement le soir en se déshabillant, et le matin
elle pria Monseigneur de Châlons de la laisser partir, ajoutant « que ces
bonnes religieuses et ce peuple de Châlons faisaient en l'estime qu'ils avaient
d'elle, une chose si déraisonnable, qu'elle ne la pouvait supporter ». « Ma
bonne tante, lui dit-il, plus vous trouvez qu'ils font mal, plus je trouve
qu'ils font bien. » Elle se tenait dans une grande salle de l'évêché, où
Monseigneur voulait qu'elle donnât accès à ceux qui la venaient visiter, qui
étaient en si grand nombre, et de toutes sortes d'états, que c'était un
concours général. Elle se tenait si proche contre une muraille, qu'on ne
pouvait passer derrière elle pour couper ses habits, et, malgré cela, elle ne
[254] put empêcher que, tant de la robe que du voile, on ne lui en coupât tous
les jours quelque pièce.
Au sortir de Châlons, madame la comtesse de Saint-Trivier la fit
supplier d'aller coucher chez elle, ce qu'elle fit, et cette vertueuse dame lui
parla à cœur ouvert, et écrivit sur ses tablettes les avis qu'elle lui donna,
disant qu'elle voulait s'en servir toute sa vie pour tirer fruit de ses
afflictions. Cette digne Mère veilla fort tard pour accommoder deux personnes
qui étaient en mauvaise intelligence, et empêcha un duel qui se devait faire.
Le lendemain, elle alla à Bourg, séjourna quelques jours chez nos Sœurs ;
puis repassa à Crémieux, où madame la comtesse de Disimieux la vint voir et fut
guérie de l'hydropisie, comme nous dirons ailleurs, et ayant laissé nos chères
Sœurs fort encouragées à la perfection, elle poursuivit son chemin.
CHAPITRE XXI.
notre digne mère, de
retour à annecy ; elle y passe le temps de la peste à travailler pour
l'institut.
La veille de tous les Saints, 1628, notre Bienheureuse Mère rentra dans
ce monastère au retour de son voyage d'Orléans et de Paris, et arriva justement
pour faire tirer les béatitudes : il lui échut à elle les purs et
nets de cœur, ce qui la fit fort rentrer en elle-même, et dit à notre
chère Mère Péronne-Marie de Châtel, que Notre-Seigneur lui signifiait par là
qu'il fallait qu'elle fît une petite revue de sa conscience pour la nettoyer
des taches et ordures qu'elle pourrait avoir amassées dans le voyage et tracas
des affaires. Il n'y avait pas demi-heure que cette digne Mère était entrée au
monastère, que madame la princesse de Carignan y arriva, car elle était en
cette ville ; elle l'enferma dans une chambre, et fut là près de deux
heures à lui découvrir son cœur, et venait souvent au monastère pour le même
sujet.
Le mois des Avents suivants, notre Bienheureuse Mère fit une revue
extraordinaire de sa conscience, et renouvela entre les mains de notre chère
Mère de Châtel tous ses vœux, tant publics que particuliers, la priant fort de
faire faire des prières pour elle, afin qu'elle vécût et mourût dans
l'observance d'iceux. Les premiers mois de l'année 1629, nos Sœurs de Grenoble
désirèrent fort qu'elle allât faire un petit voyage chez elles pour quelques
besoins particuliers. Elle qui était toujours prête à aller servir les maisons,
était disposée de très-grand [256]
cœur d'y aller, quoiqu'elle fût
travaillée d'un grand rhume et de fluxion sur le visage ; mais Monseigneur
de Genève et notre Mère de Châtel ne lui voulurent pas permettre de se mettre
aux champs ; et l'on envoya à Grenoble notre chère Sœur Anne-Catherine de
Beaumont, qui était alors en cette maison, celle de Turin n'étant plus en terme
de s'établir.
Le temps de la déposition de notre très-bonne Mère de Châtel étant échu
selon la règle, le chapitre élut pour supérieure notre très-digne Mère,
laquelle souhaitait bien d'avoir quelques années de repos et vivre en
inférieure ; toutefois, parce qu'elle ne voulait d'une volonté absolue que
celle de Dieu, elle se soumit et accepta la charge ; Dieu voulant que ce
monastère jouît à souhait, et plus tranquillement que jamais, des fruits de la
bonne conduite de sa Bienheureuse Mère ; car, la peste, qui depuis environ
le mois de mars, paraissait un peu en la ville, se rendit universelle et
très-furieuse. On fit tout ce que l'on put humainement faire pour persuader à
cette digne Mère de sortir de cet air infect, et d'aller dans une de nos autres
maisons ; mais ce fut en vain. Monseigneur le prince Thomas et madame la
princesse de Carignan, sa femme, lui écrivirent pour la conjurer de se retirer
en une autre ville ; lui représentant, avec une piété et une affection
admirables, que notre enclos étant fort petit et notre communauté fort grande,
si la peste se mettait chez nous, que sa personne serait en grand danger ;
que partant ils la conjuraient de se retirer, et que, où qu'elle allât, ils
prendraient soin de la défrayer ; que si, pour leurs prières, elle ne
sortait pas du danger, qu'ils en obtiendraient une lettre de Son Altesse
Royale, qui en porterait un exprès commandement. Le soin de ce grand prince et
de cette bonne princesse donna beaucoup de déplaisir à notre Bienheureuse
Mère ; son humilité souffrant toujours beaucoup quand elle voyait que les
grands faisaient état d'elle, qui ne cherchait que la petitesse ; elle
leur fit réponse, et leur fit parler avec tant de soumission, [257] de
générosité et de sagesse, qu'elle obtint qu'ils agréeraient son séjour ici, de
quoi elle fut fort consolée, et disait « que si elle eût abandonné ce
monastère, Dieu l'ayant attachée par l'élection que l'on avait fait d'elle à sa
conduite et à son service, elle eut cru d'abandonner la divine volonté qui
voulait être servie d'elle céans. »
Ainsi, elle demeura parmi nous en ce temps de calamité universelle, où
étant fort peu divertie pour le parloir, elle employait tout son loisir au
service de l'Institut, tâchant par ses paroles toutes de feu et de ferveur, de
nous établir en une parfaite observance. Elle mit la main pour la dernière fois
à ses Réponses, revoyant quantité de questions qu'on lui avait faites de nos
maisons. Elle mit un ordre admirable pour nous garantir de ce mal contagieux,
ainsi que nous avons marqué en notre fondation, ayant un soin et une vigilance
admirables du général et du particulier de la communauté ; mais
véritablement, nous croyons que notre meilleur préservatif fut sa parfaite confiance
en Dieu. Elle dédia trois petites chambres séparées, l'une à sainte Anne,
l'autre à saint Sébastien, et la troisième à saint Roch, portant en chaque
chambre leur image en procession, et ordonna que, tous les ans, au jour de leur
fête, on y fit la procession. Elle destinait ces chambres pour celles qui
seraient frappées de contagion, s'il plaisait à Dieu de visiter le monastère de
ce fléau ; plusieurs Sœurs y furent retirées à diverses fois pour des
fièvres, des petites glandes et autres incommodités dont cette digne Mère ne
s'épouvanta jamais, pourvoyant à tout avec tranquillité et paix.
Monseigneur de Genève (Jean-François de Sales), d'heureuse
mémoire, dit « que la parfaite générosité qu'il avait admirée en cette
sainte femme, à ne point vouloir abandonner son petit troupeau, mais attendre
avec résignation le mal qu'il plairait à Dieu lui envoyer, l'avait fait
résoudre à exposer sa personne, sa vie et ses moyens pour secourir et assister
son [258] peuple » ; ce qu'il fit avec une dévotion si ardente et
avec un soin si vigilant et véritablement pastoral, que cette bienheureuse Mère
disait : « Que si notre saint Fondateur eût été en vie, elle ne sait
s'il eût fait quelque chose de plus que ce que faisait son digne frère et
successeur. » Tous les matins, ce bon prélat, avant sa visite, venait dire
messe en notre église, et donner le bonjour à notre digne Mère ; disant,
comme vrai humble qu'il était, « qu'il venait prendre ordre vers elle de
ce qu'il avait à faire tout le jour », et tous les soirs lui venait rendre
compte, disait-il, de ce qu'il avait fait. Ce bon prélat lui disait, avec des
larmes de joie, exprimées de l'intime consolation qu'il sentait en son
cœur : « O ma digne Mère ! vous êtes mon Moïse, je suis votre
Josué ; tandis que vous tenez vos mains élevées au ciel, je bataille avec
nos gens contre la calamité de mon cher peuple. »
Notre parloir était fermé à tous autres qu'à Monseigneur et à ses gens,
et c'était ceux qui nous mettaient le plus en danger, ne bougeant de parmi les
cabanes des pestiférés ; mais, par révérence envers le supérieur, et par
l'amour de la sainte charité, jamais notre digne Mère ne voulut qu'on en
témoignât rien, d'autant que les gens de Monseigneur venaient prendre tous les
jours les potages et autres choses que notre Bienheureuse Mère faisait
continuellement préparer pour les pauvres et les malades. Notre-Seigneur, qui
se plaisait en sa charité, lui donna moyen de la continuer. Notre chère Sœur et
Mère Marie-Jacqueline Favre, alors supérieure en notre maison du faubourg Saint-Jacques
à Paris, envoya un homme exprès pour apprendre des nouvelles de cette digne
Mère, avec cent écus d'aumônes et plusieurs préservatifs. Notre chère Sœur
Hélène-Angélique Lhuillier, alors supérieure en notre monastère de la rue
Saint-Antoine, à Paris, et madame de Villeneuve, sa sœur, envoyèrent aussi
chacune cent écus. Notre très-honorée Mère de Blonay fit aussi que son
monastère de Lyon en Belle-Cour, où elle était déposée, [259] envoya des
drogues et préservatifs et cent écus pour secourir les pauvres.
Ces quatre cents écus vinrent tout à propos pour continuer les grandes
charités journalières que notre Bienheureuse Mère faisait faire, et même sa
charité fut si grande qu'elle fit assister d'une partie de cette somme quelques
personnes qui l'avaient beaucoup contrariées en quelque affaire du monastère.
Or, d'autant qu'on n'avait pas pourvu à faire la provision de blé, le monastère
s'en trouva grandement défourni ; mais, pour cela, notre Bienheureuse Mère
ne voulut en façon quelconque que l'on désistât de faire l'aumône quotidienne
et générale, et, afin d'avoir plus de quoi donner aux pauvres, elle proposa à
la communauté, si elle voulait bien manger du pain noir, à quoi toutes
s'accordèrent de très-grand cœur, et notre Bienheureuse Mère voulut être la
belle première qui en mangeât, et disait : « que ce pain étant
assaisonné par la sainte charité, avait un goût si savoureux, qu'elle n'en
avait jamais mangé de meilleur à son gré. » Celles qui avaient alors les
charges de l'économie du monastère assurent que, plusieurs mois durant, le blé
fut miraculeusement multiplié, tant pour les pauvres que pour la communauté.
Notre Bienheureuse Mère employa à ces exercices de vraie charité les
années 1629 et 1630, les calamités et pauvretés ayant eu leur règne tout ce
temps-là. Elle écrivit à toutes nos maisons une fort grande lettre pour leur
rendre raison comme elle s'était comportée durant ce temps d'affliction,
« afin, dit-elle, que vous me fassiez la charité de me dire ce en quoi
nous aurons manqué. » En actions de grâces que Dieu avait préservé cette
maison de peste, elle dédia un oratoire au mystère du sacré mont de Calvaire,
et un autre à sainte Madeleine, ordonnant que tout les ans, aux deux
Sainte-Croix de mai et de septembre, l'on fit la procession à l'oratoire du
Calvaire, chantant les hymnes propres, et disant dans icelui l'oremus Respice,
[260] quœsumus, etc., à laquelle Sainte-Croix elle avait grande
dévotion ; et qu'au jour de sainte Madeleine l'on fit aussi la procession
en son oratoire avec les hymnes convenables, et chantant dans l'oratoire
l'antienne des premières vêpres de cette sainte avec le verset et l'oraison.
Elle écrivit à une de nos maisons qu'elle avait fait cela parce que des
bénéfices particuliers chacun en rend grâce en son particulier, mais que des
bénéfices communs, il était bien raisonnable d'établir quelque petite dévotion
conforme à nos observances, par laquelle le général rendît grâce du bienfait
reçu.[58]
CHAPITRE XXII.
notre digne mère
assiste à l'ouverture du tombeau de notre bienheureux père françois de
sales ; nouvelles afflictions qui lui arrivent.
Au commencement de l'année 1631, nos chères Sœurs de Provence firent de
grandes instances pour qu'il plût à Monseigneur de Genève de permettre à notre
très-digne Mère de visiter les monastères de cette province-là, là où elle
n'avait point encore été ; ce qu'elle eût fait très-volontiers, mais
d'autant qu'il fallait recommencer à travailler au procès de l'information de
notre Bienheureux Père, elle ne put pas sortir de ce monastère pour un si long
voyage, et il fut résolu qu'elle enverrait à sa place notre très-honorée Mère
de Châtel, qui alla conduire dix de nos Sœurs, à savoir : six pour la
fondation de notre monastère de Montpellier, et quatre pour diverses de nos
maisons de Provence, qui avaient instamment demandé quelques professes de cette
première maison. Avant qu'elles partissent, notre Bienheureuse Mère eut un
très-grand soin de les instruire et de les encourager à persévérer en la
simplicité de leurs observances, et entre autre leur dit « qu'en passant
par nos maisons, elles n'affectassent point de beaucoup louer cette
communauté ; qu'elles disent avec humilité le bien qui s'y pratique, et
qu'on n'y cherche point d'autre perfection que celle d'une entière observance ;
ajoutant que si on les interrogeait des défauts, qu'elles se gardassent bien de
nommer les particulières, mais qu'elles disent qu'oui, qu'elles avaient vu
commettre telle et telle faute, [202]
de laquelle on avait donné telle
et telle pénitence, et qu'elles disent bien qu'on ne faisait pas état céans de
ne jamais faillir, mais d'aimer cordialement d'être reprises. »
Les affaires de la béatification, qui avaient empêché notre
Bienheureuse Mère d'aller en Provence, furent retardées jusqu'en l'année 1632,
par une grande maladie que fit Monseigneur de Bourges. Dès qu'il fut un peu
remis, il se mit en chemin pour venir ici, pressé du désir de travailler pour
notre Bienheureux Père, et de l'affection de voir sa très-digne sœur. Quand il
arriva en cette ville, il était extrêmement défait et si faible, qu'il fallait
que deux de ses serviteurs lui aidassent quand il voulait seulement monter six
escaliers ; mais, comme le contentement est souvent une médecine aussi
salutaire que douce, dès ce premier soir il reprit l'appétit et le sommeil, et
se trouva le lendemain si vigoureux et si prêt à travailler à la sainte besogne
qui l'avait amené en ce pays, que ses gens en étaient ravis, et lui en
bénissait Dieu. Après avoir ouï, pendant près de deux mois durant, plusieurs
dépositions, le 4 août, le tombeau de notre Bienheureux Père fut ouvert. Il
n'est pas croyable avec quelle dévotion, quel soin et quelle ardeur cette digne
Mère avait pourvu à tout ce qui était requis, ni de combien de mouvements de
reconnaissance son cœur était plein, voyant ce béni corps frais et entier.
Quand le monde fut retiré, cela veut dire sur les neuf à dix heures du
soir, elle alla avec toute la Communauté vénérer ce saint corps, et fut
longuement en oraison à genoux devant icelui, avec un visage si enflammé, et
une façon et action si rabaissées, que l'on n'eût su discerner ce qui la tirait
hors d'elle-même, ou l'amour ou l'humilité et anéantissement ; elle était
si transportée, qu'elle n'apercevait point les Sœurs qui étaient toutes autour
d'elle, ni ne sentait qu'on la pressait de part et d'autre, car il faut
confesser que l'amour, même le plus filial et le plus tendre, n'est pas
prudent, et que nous nous pressions [263] et empressions pour faire toucher
quelque chose à ce béni corps. Notre Bienheureuse Mère nous laissait faire sans
qu'elle fit mouvement quelconque, ni qu'elle ouvrît les yeux. En ce rencontre
ici, cette Bienheureuse fit un acte signalé d'obéissance : Messeigneurs
les commissaires avaient défendu que l'on touchât ce béni corps, voulant dire
que l'on n'en coupât rien ; néanmoins, parce qu'ils ne s'étaient pas
expliqués, jamais cette digne Mère n'osa nous permettre de lui baiser la main,
ni la baiser elle-même, se contentant de nous faire baiser son vêtement. Le
lendemain, elle alla avec notre Supérieur, couvrir d'un taffetas blanc la face
de ce Bienheureux, et demanda permission de lui baiser la main ; ce
qu'ayant obtenu, elle baissa la tête, et fit poser cette sainte main sur
icelle ; et ce Bienheureux, comme s'il eût été en vie, étendit sa main sur
la tête de son unique fille, et la lui serra, comme lui faisant une paternelle
caresse. Elle sentit très-sensiblement le mouvement surnaturel de cette main
morte qui semblait être encore animée, et nous gardons encore, comme pour une
double relique, le voile que cette digne mère portait alors. Les Sœurs qui
étaient présentes virent cette sainte main se mouvoir et les doigts serrer la
tête de cette digne Mère.
Mgr le prince Thomas et madame la princesse sa femme étaient venus en
cette ville pour se trouver à l'ouverture de ce cercueil. Des seigneurs et
dames de haute qualité, de Paris, Dijon, Grenoble et autres lieux éloignés,
s'étaient rendus ici à même effet ; et comme il semblait que notre digne
Mère servait d'écho et de voix à ce Bienheureux, qui ne parlait plus que par
elle, qui le citait en toute rencontre, elle fut extrêmement accablée du
parloir, plusieurs voulant avoir des loisirs de plusieurs heures pour lui
découvrir leurs cœurs ; elle satisfit à tous avec une extraordinaire
suavité et force d'esprit.
Messeigneurs les commissaires étant retournés en France, notre
Bienheureuse Mère demeura chargée de faire transcrire [264] les
Dépositions, et de prévoir et préparer les choses requises pour le voyage des
révérends Pères, Dom Juste et Dom Maurice, qui devaient aller à Rome présenter
toutes les informations au Saint-Siège. Cette Bienheureuse Mère fit une petite
quête en nos maisons plus commodes, afin qu'elles contribuassent de leurs biens
temporels, pour honorer celui qui nous en a tant fait de spirituels, à quoi les
monastères s'accordèrent avec une très-filiale affection et cordiale franchise,
ainsi que nous avons remarqué plus au long dans notre fondation.
Notre Bienheureuse s'occupait à cela avec une grande suavité, lorsqu'il
plut à Notre-Seigneur lui donner un nouveau sujet de douleur par le décès de M.
Michel Favre, premier confesseur de la Congrégation. Dès que notre très-digne
Mère le sut malade, elle alla prier Dieu qui était son recours ordinaire, et au
sortir de son oraison, elle dit : « Voici un nouveau dépouillement,
ce bon homme s'en va au repos éternel, vers son bon maître, notre Bienheureux
Père. Je n'avais guère de plus douces consolations en ce monde que celles que
je recevais de conférer avec ce très-bon fils de notre Bienheureux Père, trouvant
en lui beaucoup de vestiges de l'esprit et de la solide dévotion de notre
Bienheureux Fondateur ; mais puisque Dieu veut qu'il meure, il ne faut pas
vouloir qu'il vive. »
Ce bon M. Michel avait toute sa vie été fort timoré et avec une
tentation de crainte trop grande des jugements de Dieu pour l'heure de sa mort.
Notre Bienheureuse Mère, avec laquelle il avait conféré, le recommanda fort à
Notre-Seigneur, puis lui écrivit un billet, et lui envoya dire quelques paroles
d'encouragement et d'abandon de lui-même à la merci de la divine volonté, ce
qui fit une telle impression en l'âme du malade, que peu de temps après il lui
manda qu'il la suppliait de n'être point en peine de lui, que toutes ses
craintes effroyables s'étaient converties en une paisible confiance en la
miséricorde de Dieu. [265] Or, d'autant que ce vertueux ecclésiastique avait
été tant d'années avec notre Bienheureux Père, et confesseur ordinaire de notre
Bienheureuse Mère, et l'avait accompagnée à la plupart de ses voyages, on le
pria de dire les sentiments qu'il avait de la vertu de notre digne Mère :
« Hélas ! dit-il, ceux qui sont sur le lit de la mort, sont sur la
chaire de vérité ; mon véritable sentiment c'est que notre digne Mère est
l'une des plus grandes Servantes de Dieu que je crois être maintenant sur la
terre. Il y a vingt-trois ans que j'admire en elle une conscience plus pure,
plus claire et plus nette que le cristal. J'avais toujours eu envie d'en écrire
quelque chose, mais j'en ai été retenu par mon indignité, et pour avoir souvent
ouï dire à notre Bienheureux Père qu'il n'était pas digne de parler de cette
sainte femme ; dans ces vues, je me suis tu. » Ce bon serviteur de
Dieu décéda le 24 mars 1633, et laissa notre Bienheureuse Mère exécutrice
charitable de son testament, dont elle s'acquitta très-soigneusement et
consciencieusement, et prit un soin tout maternel d'un petit neveu qu'avait le
vertueux défunt ; et l'a fait élever et poursuivre ses études, le tenant à
cet effet dans la chambre de monsieur notre confesseur.
Cette même année, au mois d'août, notre Bienheureuse Mère reçut la
nouvelle du décès de madame la baronne de Chantal, sa belle-fille, qui laissait
sa petite orpheline de père et de mère[59] ; elle en fut fort touchée, car elle
l'aimait comme si c'eût été sa propre fille ; mais elle n'eut d'autre
parole dans la bouche que celle qui lui était ordinaire en semblable
douloureuse rencontre : « Le Seigneur l'a donnée, le Seigneur l'a
ôtée, son saint nom soit béni. »
A peine le triste messager qui lui avait annoncé le décès de sa
belle-fille avait fait son ambassade, qu'en voici venir un autre qui lui dit
que M. de Toulonjon, son beau-fils, était décédé. [266] Quand on lui apporta
cette nouvelle, elle était au parloir vers monsieur le prévôt de Sales,[60] qui lui lisait quelque chose de la vie de
notre Bienheureux Père, qu'il composait alors ; elle changea de couleur,
et dit : « Voilà bien des morts » ; puis, se reprenant au
même instant, elle joignit les mains et ajouta : « Mais plutôt
voilà bien des pèlerins qui se hâtent d'aller au logis éternel ;
recevez-les, Seigneur Jésus, entre les bras de votre miséricorde » ;
et, ayant un peu prié pour le défunt et jeté quelques larmes, elle s'affermit
et pria monsieur le prévôt de continuer sa lecture ; finissant d'un esprit
tranquille et présent à soi-même ce qu'elle avait commencé, quoique son cœur
fût fort attendri de la perte de ce seigneur, qui était un cavalier fort
accompli, fort pieux et fort avant dans la fortune ; et, outre cela, cette
digne Mère était affligée de la très-cuisante affliction de madame de Toulonjon
sa fille, qui était alors à Pignerol, dont le défunt était gouverneur.
CHAPITRE XXIII.
notre bienheureuse
mère établit un second monastère à annecy.
M. Michel Favre, duquel nous venons de parler au chapitre précédent,
avait souvent, durant sa vie, eu des grands désirs de voir une seconde maison
de la Visitation Sainte-Marie en cette ville d'Annecy, et en avait quelquefois
fait la proposition à notre Bienheureuse Mère, laquelle avait toujours
très-absolument rejeté cette proposition ; il fallait que ce fût Dieu seul
qui en donnât le mouvement au cœur de cette digne Mère, comme sa bonté fit, les
fêtes de Pâques de l'année 1633. Étant appelée pour aller au parloir, elle y
trouva un grand nombre de filles qui se jetèrent à genoux devant elle, firent
fort bien leur petite harangue pour la conjurer de mettre ordre qu'elles ne
demeurassent plus guère au monde, toutes prétendant à notre manière de vie. À
cet instant, Dieu inspira à notre très-digne Mère d'établir une seconde maison
dans cette ville, mais l'inspiration fut si vive et si constante que jamais
elle ne chancela. Le lendemain, elle fit la sainte communion à cette intention,
et fut tellement confirmée en la croyance que c'était la volonté de Dieu,
qu'elle se résolut dès ce jour-là de commencer à travailler à ce dessein,
lequel elle exposa à feu Monseigneur de Genève et à M. Baytaz de
Château-Martin, notre très-honoré Père spirituel, tous deux approuvant cette
entreprise. Il est vrai qu'ils firent un peu de difficulté sur le
temporel ; mais notre digne Mère leur ayant dit la grande confiance
qu'elle avait en la divine [268] Providence pour y pourvoir, ils s'en
arrêtèrent là ; et elle, bien contente de travailler sous l'aveu de ses
supérieurs, sans le consentement desquels elle n'entreprenait jamais rien de
tant soit peu important. Elle ne perdit point de temps, et tira le consentement
de Mgr le prince Thomas, par le moyen de M. le comte de Balbian, seigneur
très-vertueux et qui honorait beaucoup cette digne Mère. Elle pria aussi le
révérend père Dom Juste Guérin, à présent notre très-digne évêque, qui allait à
Turin pour les affaires de la béatification de notre Bienheureux Père, de
communiquer le dessein de cet établissement à S. A. R. Victor Amédée, ajoutant
qu'elle tiendrait les sentiments et volonté du Prince souverain comme un signe
certain de la volonté divine en ce sujet. À la simple proposition que l'on fit
de cet établissement, ce grand Prince, qui voyait de bon œil toutes les œuvres
de piété, agréa si entièrement celle-ci, qu'il voulait qu'elle s'exécutât.
« Voyant, dit notre digne Mère, toutes les volontés des souverains
inclinées à ce bon œuvre, bien que je me trouvasse en moi-même fort combattue
de considérations humaines, pour la difficulté que j'avais à me charger d'une
si grande entreprise en l'âge où je me voyais, et dans un pays si
pauvre, si n'eussé-je pas eu le courage de reculer, craignant de commettre une
trop grande infidélité envers Dieu, en une occasion si importante à sa gloire
et au bien des âmes. Le mois d'octobre de la même année, Dom Juste ayant obtenu
les patentes de Son Altesse Royale pour l'établissement, les envoya à cette
digne Mère, qui les porta offrir à Notre-Seigneur, lui recommandant instamment
cette entreprise.
Or, elle fit différer de présenter les patentes au corps de ville
jusqu'au mois de janvier de l'année suivante 1634, et ce fut ici où il s'éleva
une telle bourrasque et persécution dans la ville contre notre Bienheureuse
Mère et contre cette maison, que ce n'était que calomnies et menaces,
desquelles cette digne Mère [269] ne s'émut jamais ; et comme une personne
de très-notable considération vint faire un grand discours à notre Bienheureuse
Mère de la persécution qui s'était élevée contre elle, sans s'émouvoir, elle
répondit gracieusement « que jamais les menaces des hommes ne la feraient
reculer d'un pas en l'œuvre de Dieu ; que la seule volonté de Son Altesse
et des supérieurs l'en pouvaient retirer. » Cependant, on dressa des
lettres diffamatoires contre cette digne Mère et la maison de céans, pour
présenter à Son Altesse Royale, lequel n'en tint compte. On fit perdre des
lettres de jussion obtenues. Le sénat était inaccessible et inflexible même aux
raisons que Mgr le prince Thomas représentait en notre faveur ; de même,
le corps de cette ville ne voulait aucunement fléchir pour les témoignages que
madame la duchesse de Nemours, qui était alors en cette ville, rendait de ses
absolues volontés. Bref, l'ennemi usa de toutes les plus fortes batteries dont
il se put aviser pour empêcher cet établissement ; et, voyant qu'il n'en
pouvait venir à bout, se voulant venger sur celle qui en avait l'entreprise, il
attaqua notre Bienheureuse Mère d'une furieuse tentation, lui représentant
qu'elle contrevenait à la volonté de Dieu de ne point désister en une chose que
tout le monde contrariait ; que la voix du peuple est la voix de Dieu, lui
étant avis que c'était une grande témérité à elle de vouloir s'affermir en ce
dessein. La tentation la pressait de si près qu'il lui semblait de se voir
chargée et coupable de tous les péchés que commettaient ceux qui contrariaient
la fondation, ce qui affligeait son cœur plus qu'il ne se peut dire. Dans cette
angoisse, elle s'en alla devant son crucifix pleurer à chaudes larmes,
demandant à Dieu une claire connaissance de sa volonté, protestant mille fois
que si elle était qu'elle ne parlât plus de cet établissement, qu'elle
désisterait d'aussi bon cœur les poursuites qu'elle les avait commencées.
Il ne plut pas au Bien-Aimé de consoler lui-même sa fidèle Épouse, mais
il la renvoya pour être instruite au tabernacle des [270] Pasteurs. Elle fit
appeler notre très-digne Père spirituel, auquel elle découvrit ingénument sa
peine, et duquel elle reçut des instructions que cette digne Mère nous a dit
qu'elle n'avait jamais oubliées, tant elles avaient apporté de paix et de
sérénité à son esprit et d'assurance que c'était la volonté de Dieu qu'elle
poursuivît son entreprise, que tout ce soulèvement du peuple était une
tentation qui se dissiperait. « Les paroles de ce bon serviteur de Dieu,
dit notre Bienheureuse Mère, me consolèrent extrêmement, et me firent
clairement voir l'impertinence de ma tentation, me laissant si encouragée, que,
quand les difficultés et l'orage eussent duré dix ans, je n'aurais point reculé,
moyennant la divine grâce. » Quoique les difficultés et contradictions
semblaient se grossir, notre Bienheureuse Mère, assurée par ses supérieurs (en
qui elle se fiait plus qu'en ses propres sentiments) qu'elle faisait la volonté
de Dieu, se mit à préparer des matériaux et à choisir des places pour bâtir.
Les gens du monde en riaient, et elle ne s'en mettait point en souci, demeurant
tranquillement dans sa parfaite confiance que Dieu parferait son œuvre, ce qui
arriva plus avantageusement qu'on n'eût su souhaiter, Son Altesse Royale ayant
dit avec des paroles fort absolues qu'il voulait cet établissement, et qu'il
était assuré que la Mère de Chantal ne lui demandait rien que de bien juste.
Dieu toucha aussi Messieurs du Sénat et ceux de cette ville, en telle sorte que
ceux qui avaient plus contrarié furent les premiers à présenter leurs filles
pour ce nouvel établissement ; et, non-seulement en la réception des
filles, mais encore en quelques autres rencontres auprès de madame la duchesse
de Nemours, notre Bienheureuse Mère avait attention et suavité à rendre des
services et favoriser ceux qui l'avaient le plus contredite.
Non-seulement Notre-Seigneur aplanit les difficultés des permissions,
mais encore celles qu'avait apportées la pauvreté de cette maison qui avait
déjà fait de grandes dépenses pour les [271] affaires de la béatification de
notre Bienheureux Père. M. le commandeur de Sillery sachant l'entreprise que
faisait notre Bienheureuse Mère, voulut être fondateur de l'église de cette
seconde maison, et que sur la première pierre il y eût écrit ces mots : Celui
qui fonde cette Église, Dieu le sait. Nos chères Sœurs de Paris
contribuèrent aussi du leur propre avec une parfaite charité pour donner moyen
à cette très-digne Mère de bâtir un monastère, tellement que cette chère maison
est toute bâtie de charités, ainsi que nous l'avons dit plus amplement en sa
propre fondation. Notre Bienheureuse Mère voyant ce dessein réussir si
heureusement, donna l'entrée, en ce premier monastère, à onze prétendantes qui
étaient destinées pour la fondation, afin que toutes sortissent ensemble de
cette maison pour la commencer.
Le samedi auquel notre Bienheureuse Mère nomma au chapitre, selon notre
coutume, celles qui étaient choisies pour supérieure et pour coopératrices à ce
commencement, elle nous fit un entretien tout de feu du puissant désir qu'elle
avait que ces deux maisons, vécussent en parfaite intelligence, nous disant
qu'elle voudrait donner de son sang en abondance, s'il était requis, pour faire
un ciment d'union entre nos cœurs, si ferme qu'ils fussent indivisibles, et que
si elle pouvait prévoir qu'il dût jamais arriver une ombre de mésintelligence
entre ces deux maisons elle voudrait boire la confusion de quitter là ce
dessein tant poursuivi. « Je voudrais, disait-elle, faire cesser les
ouvriers, anéantir cette entreprise, et que le monde m'en montrât au doigt.
Cette abjection ne me serait rien au prix de la douleur que j'aurais, si je
voyais de l'émulation et des froideurs entre ces deux maisons. »
Le jour de la très-adorable Trinité, 1634, après souper, et quasi à
même heure que nos premières Mères commencèrent l'Institut, les onze
prétendantes et les Sœurs destinées pour la fondation s'en allèrent
processionnellement, conduites par notre Bienheureuse Mère commencer cette
chère seconde maison [272] dans un corps de logis à part de M. le président
Favre de la Val-bonne, qui était autrefois le logis où demeurait notre
Bienheureux Père ; la foule de peuple était si grande, qu'à peine
pouvait-on passer les rues. Notre Bienheureuse Mère y demeura quelques jours,
puis laissa supérieure notre chère Sœur Madelaine-Élisabeth de Lucinge. Cette
digne Mère prenait soin elle-même de tout voir et prévoir ce qui était requis
pour l'accommodement de nos Sœurs, en faisant même des mémoires de sa chère
main ; et quoiqu'elle les fît meubler et accommoder avec une entière
charité, et que leur monastère se bâtit des aumônes qu'on lui avait faites, si
avait-elle grand désir que leurs meubles et ornements ressentissent fort cette grande
et sainte pauvreté du commencement de notre Institut, dont elle voulait que
cette chère seconde maison fût un crayon ; et vraiment elle l'était en
ferveur et pureté de vie, et cette digne Mère en recevait un contentement
très-grand. Elle alla, par l'ordre de feu Monseigneur de Genève, donner l'habit
aux premières filles reçues, et en était tellement satisfaite, qu'elle disait
« que si c'était la volonté de Dieu, elle eût voulu tous les ans souffrir
plus de peines, de soins et de contradictions, pour ériger une maison où Dieu
fût aussi fidèlement servi et glorifié qu'il l'était là dedans. »
CHAPITRE XXIV.
déposition de notre
digne mère ; décès de mgr jean-françois ; nouveau voyage en france.
L'année 1635 était celle en laquelle notre Bienheureuse Mère finissait,
en cette maison, son second triennal,[61] et notre très-honorée Mère Péronne-Marie de
Châtel, le sien à Chambéry. Notre Bienheureuse Mère obtint de feu Monseigneur
de Genève qu'il rappelât notre très-honorée Mère Favre (déposée en notre
deuxième monastère de Paris) que le chapitre de Chambéry avait instamment
demandée, et l'on croyait que cet air-là, étant le sien natal, serait propre à
sa santé. Cette bonne Mère arriva ici justement pour se trouver à notre
élection. Nous élûmes céans notre très-bonne Mère de Châtel, et la chère Mère
Favre le fut à Chambéry. Notre Mère élue étant arrivée, il y avait trop de
[274] suavité à voir cette digne Fondatrice entre ses deux premières filles,
sans toutefois qu'elle voulût leur condescendre de quitter son dernier rang de
déposée ; et prenant quelquefois par la main notre très-honorée Mère
Favre, elle lui disait : « Ma grande fille, allons dire nos
coulpes ; il nous fait si grand bien à nous autres qui avons si longtemps
été Mères, de faire un peu les actions d'humilité des inférieures. »
Comme nous jouissions de la douce suavité de voir nos premières Mères
ensemble, leur contentement et le nôtre fut interrompu par la prompte maladie
et mort de Monseigneur de Genève, frère de notre Bienheureux Père[62] ; décès qui toucha fort notre
Bienheureuse Mère, d'autant qu'elle estimait ce grand prélat comme un très-bon
pilier de l'Église, et le pleura comme tel, mais toujours avec sa parfaite
résignation accoutumée en tous tels semblables rencontres et accidents
affligeants.
Ce bon seigneur, avant son décès, avait accordé à plusieurs prélats et
grands personnages, que notre Bienheureuse Mère irait faire un voyage en France
pour conclure plusieurs choses très-nécessaires, et parler à Messeigneurs les
prélats, qui tenaient à Paris leur assemblée générale. Comme cette Bienheureuse
Mère dit en sa seconde épître, qui est imprimée au commencement du Coutumier,
le principal dessein de ceux qui l'appelaient à Paris (où elle arriva au
mois de juillet 1635), était pour voir si l'on pourrait établir un moyen
d'union dans notre Institut. Elle supplia donc en toute humilité quelques-uns
de Messeigneurs les prélats de s'assembler avec M. le commandeur de Sillery. On
mit sur le tapis les moyens d'union que l'on nous proposait, « lesquels,
dit notre Bienheureuse Mère, ils agitèrent entre eux assez longtemps ;
mais, ajouta-t-elle, ils virent clair comme le jour que toutes ces nouvelles
propositions renverseraient les fondements de notre Congrégation, et [275]
qu'ils seraient pires et suivis de plus grands inconvénients que le mal qu'on
se proposait d'éviter par iceux. Après cela nous leur dîmes en toute sincérité
les pensées et intentions que nous avions reconnues en notre Bienheureux Père
pour ce sujet, et leur lûmes les propres paroles qu'il nous avait dites. Ces
bons seigneurs admirèrent la prudence de notre Bienheureux Père. Que veut-on
davantage ? dirent-ils ; c'est le Fondateur qui parle et qui laisse
un moyen d'union, non d'autorité, mais de charité, plus doux et plus solide.
Tous demeurèrent d'accord d'un commun sentiment qu'il n'en fallait point
chercher d'autres, et que cette déclaration devait arrêter toutes sortes de
propositions. » Voilà les propres paroles de notre Bienheureuse Mère,
laquelle s'employa à revoir tout le Coutumier et le Cérémonial,
ajustant les éclaircissements très-nécessaires qu'il fallait faire imprimer, et
avec l'avis de Messeigneurs les prélats, plusieurs points très-notables des
intentions de notre Bienheureux Père, qu'il était nécessaire d'ajouter au Coutumier
que l'on voulait remettre sous la presse. Elle mit aussi ordre pour faire
imprimer les heures à notre usage, selon la réforme du Saint-Père Urbain VIII.
Ayant fini ce qu'elle avait à faire à Paris, nos monastères de
Bourgogne, du Languedoc, Dauphiné et Provence, ayant obtenu de Monsieur notre
Père spirituel (le siège de l'évêché de Genève était alors vacant ), que cette
digne Mère les allât visiter. Elle fit une ronde partout par là, à quoi elle
employa dès le mois d'avril jusques au mois d'octobre de l'année 1636 qu'elle
revint en ce monastère ; par où l'on voit la fatigue qu'elle eut en ce
voyage, le faisant par la Provence au fort des plus grandes chaleurs,
lesquelles elle craignait grandement, sa complexion naturelle étant sanguine et
chaude ; mais tout travail lui semblait petit et elle n'y faisait pas
attention, pourvu qu'elle servît Dieu et son Ordre. Or, parce qu'en son
obéissance, Monsieur notre très-honoré Père spirituel avait mis, pour [276]
prévenir l'importunité des monastères, que cette Bienheureuse demeurât en ce
voyage le moins qu'elle pourrait, faisant toutefois tout ce qu'elle jugerait
nécessaire, elle s'attacha tellement à cette obéissance, qu'on ne l'eût pas
fait arrêter un jour dans une maison, par-dessus ce qu'elle croyait de la
véritable nécessité.
Passant en notre monastère d'Autun, où elle ne fit que coucher, elle
parla à toutes les Sœurs jusqu'aux tourières et Sœurs du petit habit. Elle ne
voulait point passer chez madame de Toulonjon sa fille, qui est tout proche,
bien qu'elle sût son fils unique malade à l'extrémité. Cette bonne dame et M.
l'abbé de Saint-Satur, son beau-frère, l'allèrent quérir pour la contraindre de
passer par Allonne, leur ordinaire résidence, parce qu'elle le pouvait, chemin
faisant. Elle y condescendit, fit mettre madame sa fille dans la litière avec
elle, laissant les autres au carrosse, et s'entretinrent ce temps-là. Elle ne
fit que dîner chez madame sa fille, et en partit pour aller encore coucher à
trois ou quatre lieues de là, après avoir donné sa bénédiction à son petit-fils,
et assuré qu'on devait espérer qu'il n'en mourrait pas, comme il est arrivé,
grâce à Dieu. Elle pria fort madame sa fille de ne la pas accompagner, et cela,
afin d'être plus libre à faire de grandes journées, pour rendre plus
promptement et plus ponctuellement son obéissance. Elle se levait souvent en ce
voyage dès les deux heures après minuit pour ouïr messe et partir
promptement ; et, en l'âge où elle était, elle se rendait le
réveille-matin de ceux qui étaient avec elle, et c'était son ordinaire, dans
ses voyages, de soulager la peine de ceux qui l'accompagnaient par une si
dévote et agréable gaieté, sans rien rabattre de ses exercices spirituels,
qu'elle tenait tout en joie et en courage pour supporter la fatigue.
On a remarqué une providence de Dieu admirable, à donner un temps
propre à cette Bienheureuse pour voyager par la [277] Provence ; car,
comme elle s'était volontairement exposée à ce travail par amour, l'amour lui
fit ombre, la gardant des ardentes touches du soleil, le jour ; et la
nuit, des froides humidités de la lune. Il bénissait son entrée et sa sortie,
et semblait que ce Dieu eût pourvu, à cette vraie Israélite, d'une nuée
rafraîchissante contre les extrêmes chaleurs de la Provence ; et nos
chères Sœurs de cette province-là nous ont écrit que les habitants du lieu leur
venaient dire, que de vie d'homme on n'avait vu en Provence un été si
bénin ; que, contre la coutume, deux ou trois fois la semaine, il tombait
une petite pluie rafraîchissante qui mitigeait les ardentes chaleurs, et fertilisait
grandement la terre. Notre Bienheureuse Mère et sa compagne nous ont assuré
qu'elles n'avaient jamais moins senti l'incommodité des chaleurs, qu'en
voyageant par la Provence au plus gros de l'été, et qu'elles s'étonnaient
lorsqu'on s'en plaignait si fort.
Passant à Nîmes, on ne pouvait trouver logis pour cette Bienheureuse
Mère, que chez des huguenots où elle ne voulait pas entrer, non plus que
l'amoureux saint Jean séjourner où était Cerinthus ; elle aima mieux se
loger en certaine pauvre petite bicoque, où l'on vendait seulement le vin au
pot. Quand elle fut entrée dans ce chétif logis, ces bonnes gens lui
dirent : « Madame, nous sommes pauvres, mais nous sommes bons
catholiques. » Cette Bienheureuse fut toute en joie de cette nouvelle.
« Bénis soyez-vous de Dieu, dit-elle ; que vous êtes riches dans
votre pauvreté d'avoir la pureté de la foi ! » et elle les exhorta
avec une ardente affection à se tenir fermes en cette sainte foi.
Il n'y avait en cette pauvre maisonnette que le seul lit du maître et
de la maîtresse, bien chétif et malpropre. Notre Bienheureuse se mit en devoir
d'aider à sa compagne à l'accommoder, et disait qu'elle ne se souvenait pas
d'avoir été mieux logée à son gré. En ces entrefaites, il arriva un seigneur et
dame de qualité qui, ayant su que notre Bienheureuse était [278] arrivée à
Nîmes, l'allèrent chercher, et tout étonnés de la trouver en ce mauvais logis,
s'opiniâtrèrent à ne l'y pas laisser ; tellement qu'elle fut contrainte de
se laisser conduire chez eux, où elle fut reçue et traitée très-honorablement.
Avant de partir de Nîmes, elle eut le contentement de voir le révérend Père
Fichet, de la sainte Compagnie de Jésus, lequel lui parla de l'établissement
d'une de nos maisons à Nîmes ; mais cette digne Mère, avec un parfait
dénûment, et n'ayant point d'autres intérêts que la plus grande gloire de Dieu,
remercia ce bon Père de sa sainte affection, et lui témoigna qu'elle croyait
qu'il serait plus utile à cette ville, si remplie de huguenots, d'y établir des
Religieuses qui vaquent à l'instruction de la jeunesse, et tiennent des
pensionnaires, et qu'après, si la divine Providence nous y voulait, nous y
irions. Ce qui édifia extraordinairement le révérend Père.
En ce voyage de Provence et Languedoc, notre Bienheureuse Mère fut obligée
d'aller quelque temps sur l'eau. Un matin, partant de notre maison du
Saint-Esprit, chacun disait qu'il y avait du hasarda entreprendre ce
voyage ; la Bienheureuse dit : « S'il y a du danger, il ne faut
pas tenter Dieu, mais il le faut savoir des bateliers. » Ils dirent, après
avoir regardé l'air et les nuées, que l'on aurait gagné le gîte avant que
l'orage vînt. « C'est assez, dit notre digne Mère : notre Bienheureux
Père se fut mis à la merci de la divine Providence sur la parole des
bateliers ; car Dieu leur a donné l'intelligence suffisante et nécessaire
pour faire leur métier. » Sur cela, elle s'embarqua.
Il lui est arrivé en ce voyage de ne pouvoir s'arrêter pour prendre de
la nourriture jusqu'à trois ou quatre heures de l'après-midi, et de ne trouver
par des villages que du lait, du pain noir et du fromage blanc dont elle était
si contente, qu'elle faisait part de sa joie aux autres, et tenait tout en paix
et sainte allégresse. En ce voyage on fit de grands honneurs à notre
Bienheureuse Mère en la plupart des villes, mais [279] singulièrement à
Montpellier et à Arles ; Messeigneurs les prélats desdits lieux se mettant
les premiers en devoir, elle fut visitée du clergé, de la noblesse et de la
justice. Un député de chaque corps lui faisait une harangue, ce qui mortifiait
cette bonne Sainte, en sorte que, si, selon l'esprit de notre Bienheureux Père,
nous ne devions faire profession d'une modeste civilité, elle se fût allée
cacher au fond d'une cellule, pour ne point entendre ces louanges. Elle logea
en Provence chez une dame de qualité, laquelle, par respect, voulut elle-même
lui apprêter son vivre de ses propres mains. Le soir, cette femme lui
dit : « Ma Mère, bénissons Dieu ; il y a trois mois que j'avais
tous les soirs un accès de fièvre quotidienne, mais, en entrant chez moi, vous
m'avez apporté la santé, et me voici guérie. »
Les maisons que notre Bienheureuse Mère ne put pas visiter, à cause de
l'éloignement et que ces grands détours eussent trop prolongé son voyage, les
supérieures avec une compagne l'allaient trouver aux monastères plus voisins,
par l'ordre des prélats, pour conférer avec elle de leurs affaires et lui
rendre compte de leur maison, et tous en reçurent une satisfaction et une
édification merveilleuses, jointes à une très-grande utilité pour le
gouvernement. Avant que de s'en retourner en Provence, parce qu'elle se
détournait de peu, elle alla visiter la Sainte-Baume[63] avec une grande dévotion, et s'en revint
passant par nos maisons du Dauphiné.
CHAPITRE XXV.
de la mort des
premières mères de l'institut, et des peines intérieures de notre bienheureuse
Comme nous avons dit ci-dessus, cette Bienheureuse Mère fut de retour
de ce grand voyage environ le mois d'octobre 1636. Quelque peu de temps après
son arrivée, elle se mit à faire une revue générale de son intérieur et de sa
conscience, avec une exactitude admirable et une humilité qui jetait dans
l'extrémité de l’étonnement notre très-chère Mère de Châtel. Comme si Dieu eût
voulu récompenser, par une surabondance de travaux intérieurs, notre
Bienheureuse Mère des services qu'elle avait rendus à sa divine Majesté, ses
peines et tentations s'accrurent merveilleusement, et la mirent dans le martyre
extrême dont nous parlerons tantôt. Cette seule chose lui était à soulagement
qu'elle était hors de la charge de Supérieure, et qu'elle reposait son âme
entre les mains et à la direction d'une Mère à laquelle elle avait une entière
confiance et créance.
Notre chère Mère de Châtel, qui avait une inclination que, je puis dire
nonpareille, que l'on rédigeât par écrit tout ce qui pourrait servir à
l'avenir, à l'Institut, prit un soin continuel de faire parler notre
Bienheureuse Mère des commencements d'icelui, des fondations des maisons, de la
vertu de nos premières Mères et Sœurs décédées, faisant commencer le livre des
vies de nos Sœurs, celui des fondations et celui des méditations pour nos
solitudes annuelles, afin que le tout se fit sous l'œil, sous l'instruction et
la correction de cette Bienheureuse Mère, [281] laquelle elle tenait fort de près
à cet effet pour lui faire prendre du temps pour cela, ce que cette
Bienheureuse faisait avec grand soin, par esprit d'obéissance. Elle coula ainsi
doucement le reste de l'année 1636 et le commencement de l'année 1637, qui fut
bien l'année de ses grands dépouillements. Au mois de juin, Dieu retira à soi
sa première fille et fidèle compagne, notre très-honorée Sœur et Mère Favre.
Cette Bienheureuse Mère eut obéissance d'aller à Chambéry où elle était
décédée ; elle y séjourna quelques semaines et vit faire élection d'une
supérieure. Étant de retour en ce monastère, le temps des solitudes
s'approchant cette Bienheureuse Mère se disposa à la faire avec une préparation
et dévotion très-grande. Elle y entra donc avec notre très-honorée Mère
Péronne-Marie de Châtel, laquelle, dans cette même solitude, fut atteinte du
mal qui la tira de la solitude de ce monde en la société des saints, comme nous
croyons pieusement.
Dès les premiers jours de sa maladie, le cœur de notre très-digne Mère
fut dans un pressentiment de cette mort, qui lui causait des attendrissements
et des larmes qui perçaient tous nos cœurs d'une double douleur, et nous
donnait une conjecture presque infaillible et universelle de notre prochaine
perte, qui arriva le 22 octobre, ainsi que nous avons dit au recueil de la vie
de cette chère Mère Péronne-Marie, où nous avons remarqué comme cette chère
mourante attendit de passer que notre Bienheureuse Mère lui eût donné son congé
et sa bénédiction, après laquelle, sans différer d'un moment, elle expira.
Par ce décès, notre Bienheureuse Mère demeura grandement dénuée de
consolation, et d'autant plus qu'elle était alors dans un redoublement de
travail intérieur que l'on ne pourra jamais savoir en totalité, que dans
l'éternité, et dans lequel elle suivait avec une humilité et simplicité
d'enfant la direction de notre très-chère Mère de Châtel, ainsi que le prouvent
les papiers écrits de la main de cette chère défunte, qu'elle portait toujours
[282] sur elle, et par le soin qu'elle avait eu d'écrire de sa bénite main ce
que cette bonne Mère lui disait sur ses redditions de compte, et il sera encore
plus visible par diverses lettres écrites, tant au révérend Père de Condren
qu'à d'autres, que je ne rapporte pas ici.
Notre chapitre ayant à faire élection de supérieure, n'eut garde de
jeter les yeux sur autre que sur cette Bienheureuse Mère, laquelle reçut la
charge, comme elle écrivit, avec beaucoup de larmes et très-grande répugnance,
mais de la main de Dieu et de l'obéissance. Et nous dit en diverses rencontres,
que ce serait le dernier triennal de sa vie ; qu'elle désirait qu'il
portât coup et fût notable pour affermir cette maison dans une grande
observance, et que surtout, Dieu lui avait donné celle lumière et affection,
qu'elle devait mettre son soin principal à bien enraciner l'union ; que de
l'union dépendait tout le bon train de la maison. Ayant trouvé ces paroles
dorées prononcées par la bouche d'or de saint Jean Chrysostôme : Si
tous aimaient et étaient aimés, pas un ne ferait tort l'un à l’autre, tous les
maux seraient éloignés de nous, le péché nous serait inconnu comme aussi le nom
du vice, elle les fit écrire afin de les répéter souvent, et ordonna à
quelques-unes de ses filles de les écrire en leurs règles ou petits livrets.
Dans ce dernier triennal, elle parut dans une douceur si extraordinaire, si
accomplie et si ravissante, qu'il semblait que cette divine qualité de bonté et
de douceur eût submergé la force éminente de son naturel, et l'active ardeur de
son zèle qui parut plus grand que jamais dans sa bénignité, plus fort dans sa
douceur, et plus victorieux sur les volontés et esprits de ses inférieurs dans
sa patience.
La maison était assez endettée, ce qui voulut donner un peu de souci à
cette Bienheureuse ; mais elle se jeta avec toutes les affaires temporelles
et ses douleurs spirituelles dans le sein et le soin de la céleste Providence,
qui régissant et bénissant sa fidèle Servante, lui fit la grâce, avant la fin
de son triennal, de [283] voir les affaires temporelles débarrassées et les
dettes payées, ce qui lui était du soulagement ; et nous lui avons souvent
ouï dire que les filles de la Visitation doivent éviter de s'engager et
endetter, tant qu'il leur sera possible, parce que ce souci travaille l'esprit
et le distrait grandement de l'attention aux choses intérieures. À peine
avait-elle repris la croix de la supériorité et fini ses actes de résignation
pour la privation de ces deux chères filles de son cœur, nos Mères Favre et de
Châtel, qu'elle reçut les lettres du décès de notre chère Mère, Jeanne-Charlotte
de Brechard, qui trépassa saintement en notre monastère de Riom, le 18 novembre
de la même année 1637, ce qui renouvela bien fort les maternelles douleurs de
cette Bienheureuse Mère, et son ennui incomparable de la vie présente. Elle
écrivit à une de nos Sœurs les supérieures « que sa chétive vieillesse
(ainsi l'appelait-elle) était bien dépouillée, que ses chères premières
compagnes s'en allaient au ciel et la laissaient en terre, pleine de
misères ; qu'elles étaient des fruits mûrs et prêts à être servis en la
table du Roi céleste, mais qu'elle était demeurée sur la branche, parce qu'elle
était encore toute verte ou peut-être toute pourrie et vermoulue » ;
ce sont ces propres paroles qu'elle proférait avec un très-humble sentiment et
de grosses larmes.
CHAPITRE XXVI.
nouvelle fondation
que va faire notre bienheureuse mère à turin.
Continuant sa bonne conduite, l'année 1638 lui fournit de nouvelles
besognes, Dieu disposant les choses en sorte qu'il fallût se résoudre à voir
sortir cette Bienheureuse Mère pour aller jeter elle-même les racines de notre
Congrégation en Piémont.. Nous dirons au long dans le narré de la fondation de
Turin comme Dieu disposa en sorte les choses pour icelle que, si elle ne se fût
faite, il y a grande apparence qu'elle ne se serait faite de plusieurs années.
Monseigneur de Genève, alors nommé (le révérend Père Dom Juste Guérin,
barnabite), confesseur des Sérénissimes infantes et de Madame Mecthilde de
Savoie, employa ses soins et son affection vigilante pour l'établissement de
Turin, lequel était en pourparler, il y avait plus de vingt ans. La Signora
Dona Mecthilde de Savoie se déclara fondatrice réelle, fit les poursuites à
Rome, tant pour obtenir les bulles de fondation, selon les maximes de l'Italie,
que pour les autres permissions. Cependant, notre Bienheureuse Mère disposait
de deçà ce qu'il fallait pour cette fondation, et d'autant que Madame Royale,
Monseigneur l'archevêque de Turin et Madame Dona Mecthilde désiraient fortement
que cette Bienheureuse Mère allât elle-même faire cette fondation contre le
sens et le sentiment quasi universel de tout le monde, qui appréhendait fort ce
voyage pour elle, à cause de la différence de la température de l'air. Avec
l'avis et licence de nos supérieurs, elle se résolut à [285] ce béni voyage,
disant « qu'elle se sentait assez de force et de vigueur pour rendre
encore ce petit service à l'Institut ; que s'il se rencontrait des
contradictions notables, comme on le prévoyait, il était plus raisonnable
qu'elle les supportât qu'une autre, et qu'au reste, elle avait une très-grande
confiance et vue qu'elle ne mourrait point en ce voyage ; que si néanmoins
l'espérance qu'elle avait de nous revoir était déçue par l'événement contraire,
qu'elle et nous ne devions point avoir de volonté que celle de
Dieu » ; ainsi elle nous laissa bien touchées et paraissait l'être
aussi un peu comme elle l'était toutes les fois qu'elle sortait de cette maison
pour aller en voyage, excepté le dernier, comme nous dirons ci-après,
quoiqu'elle s'en allât toujours courageuse et avec une résignation
inexplicable.
Elle partit de ce monastère le jour de la Sainte-Croix de septembre
1638, pour aller fonder la septante-sixième maison de son Ordre. Elle passa par
Chambéry, de là chez madame la baronne de Chivron, qui la reçut comme une
sainte ; ce que fit semblablement Monseigneur l'archevêque de Tarentaise,
lui envoyant bien loin au devant son grand vicaire et plusieurs autres
ecclésiastiques. Il y vint lui-même à l'entrée pour la mener loger en son
palais archiépiscopal, avec sa petite troupe, à laquelle il fit voir toutes les
reliques et belles antiquités de son église cathédrale. Il eut bien voulu
retenir ses hôtesses encore un jour, mais notre Bienheureuse Mère fut debout
avant le jour, quoiqu'elle se trouvât incommodée du chemin ; le bon
archevêque s'en apercevant fit de nouvelles instances pour la retenir, mais
Monsieur le théologal d'Aoste, confesseur de nos Sœurs dudit lieu, était
arrivé. Il venait avertir que la Signora Mecthilde, qui venait au devant de
notre Bienheureuse Mère, serait dans trois jours à la Val-d'Aoste, ce qui fit
encore plus presser. Monseigneur de Tarentaise, avec une débonnaireté non
pareille, alla accompagner plus de deux grandes lieues [286] notre
Bienheureuse, ne la pouvant quitter qu'il ne la vît hors de danger des
précipices de ces lieux-là.
Madame la comtesse de la Val-d'Isère envoya conjurer notre Bienheureuse
d'aller loger chez elle et la reçut avec une révérence nonpareille. Le
lendemain, elle passa la montagne de Saint-Bernard, quoiqu'il plût quasi
presque tout le jour. À l'entrée de la Val-d'Aoste, quantité de dames lui
allèrent au devant. Madame Mecthilde y arriva le même jour, quoique, à cause de
l'extrême fatigue de ces effroyables chemins, elles ne se purent voir que le
lendemain. Dès que la bonne Signora Mecthilde eut envisagé notre Bienheureuse
Mère, elle fut saisie d'une allégresse intérieure si grande qu'elle changea de
visage elle-même, et disait qu'en regardant cette digne Mère, tous les longs
ennuis et fâcheries de sa vie étaient effacés de son cœur. Sans que notre
Bienheureuse l'en pût empêcher, elle lui baisait la main avec un respect
nonpareil, et disait qu'elle sentait en son âme, pour cette digne Mère, les
sentiments plus respectueux qu'on doit porter aux choses saintes.
Il fallut séjourner cinq jours chez nos chères Sœurs de la Val-d'Aoste,
d'où notre Bienheureuse partit le 26 septembre, après avoir vu et vénéré les
saintes reliques. Elles allèrent loger à Châtillon ; sur le chemin, on
saluait cette digne Mère des châteaux voisins, avec le canon et autres pièces
d'artillerie, ce qui se faisait en partie pour obliger la Signora Mecthilde qui
la conduisait avec tout son grand train et plusieurs personnes distinguées. Il
y eut deux journées de rudes chemins par des lieux effroyables, et dans
lesquels notre Bienheureuse fut grandement fatiguée ; et il lui fit grand
bien et à sa troupe, entrant dans la grande plaine d'Italie, de trouver du
rafraîchissement chez madame la marquise de Bourgfranc, laquelle les reçut avec
une magnificence qui n'eût pas été tolérée par notre Bienheureuse Mère, qui
n'aimait rien à l'égal de la simplicité, si ce n'eût été la considération de la
Signora Mecthilde, qui méritait [287] vraiment en toute façon qu'on la traitât
en princesse. À la couchée d'Yvrée, on avait fait descendre notre Bienheureuse
en un logis, mais Monseigneur l'évêque dudit lieu le sachant, quoique la nuit
fût quasi close, la vint trouver, lui demandant pardon si, par un malentendu,
on l'avait laissée entrer en un logis si peu digne d'elle ; que le
carrosse était à la porte pour la mener chez des religieuses de Sainte-Claire
qui l'attendaient. Ce religieux prélat la conduisit dans ce couvent, et dit aux
religieuses qu'il leur confiait le plus grand trésor qui fût alors au monde. Il
est certain qu'une âme humble, amoureuse et fidèle, est un trésor à Dieu et aux
hommes.
Il ne se peut dire les caresses et l'accueil que ces bonnes religieuses
firent à notre Bienheureuse et aux Sœurs de la Fondation. Monseigneur l'évêque
avait fait apporter de chez lui le souper de notre digne Mère, et le lendemain
lui vint dire messe, à laquelle ces bonnes religieuses de Sainte-Claire firent
une excellente musique d'instruments et de belles voix. Nos Sœurs dînèrent en
leur réfectoire et allèrent à la récréation ensemble, en laquelle, pour réjouir
saintement notre Bienheureuse Mère, elles chantèrent plusieurs beaux motets en
musique. Elles reçurent ses avis avec une affection filiale, et la
contraignirent de leur donner sa bénédiction maternelle, pleurant à chaudes
larmes quand il fallut qu'elle les quittât pour poursuivre son chemin.
Monseigneur d'Yvrée ne put refuser à M. le baron du Perron de faire entrer
notre Bienheureuse Mère et ses religieuses dans sa maison, qui semblait plutôt
un Louvre que le château d'un seigneur particulier. Il avait fait
préparer une magnifique collation ; mais notre Bienheureuse Mère, avec sa
religieuse et toujours parfaite modestie, s'en excusa absolument, ce qui édifia
beaucoup toute cette noblesse, et chacun la regardait comme une sainte. M. le
baron du Perron dit que son intention était, faisant entrer notre Bienheureuse
Mère chez lui, d'attirer le regard miséricordieux de Notre-Seigneur sur sa
maison, à laquelle il [288] croyait que l'entrée de cette sainte porterait à
jamais bénédiction.
Enfin, le 30 septembre, notre Bienheureuse Mère et ses religieuses, si
honorablement accompagnées, se trouvèrent aux portes de Turin, où des
principales dames, tant marquises que comtesses, venaient faire la bienvenue à
notre digne Mère, quand la Signora Dona Mecthilde reçut une lettre de Madame
Royale, qui lui ordonnait de mener notre Bienheureuse Mère au Valentin, où elle
était auprès du duc son fils, malade à mort, qu'elle désirait que notre
Bienheureuse Mère le vît et priât pour lui. Sa Charité fut extrêmement
mortifiée de voir l'estime que Madame Royale faisait d'elle ; il fallut
pourtant obéir, et arriva au Valentin sur les quatre heures après midi. Madame
Royale la reçut avec grande affection et témoignages de joie et d'estime, et la
conduisit avec nos Sœurs proche de son cher malade, lui disant que c'était la
Mère de Chantal qui avait beaucoup de crédit auprès de Dieu, et les filles du
Bienheureux François de Sales. Il leur présenta ses mains l'une après l'autre,
se recommandant surtout aux prières de notre Bienheureuse Mère, à laquelle il
faisait une toute particulière caresse, quoiqu'il parlât si bas, qu'à peine le
pouvait-on ouïr ; et notre Bienheureuse Mère fut extrêmement édifiée et
consolée de le voir dans une si douce modestie et égalité dans l'ardeur de sa
fièvre. La Sérénissime Infante Marie arriva pour assister à l'achèvement du
baptême de l'Altesse malade, son neveu. Elle fit des caresses nonpareilles à
notre Bienheureuse Mère, laquelle Madame Royale vint prendre pour lui parler en
particulier, et, au sortir de cet entretien, elle fit de grandes
congratulations à la Signora Mecthilde d'avoir si bien poursuivi la fondation,
que cette digne Mère y fût venue, disant qu'elle voulait aussi que la ville de
Turin lui sût un peu de gré de cette grâce, qu'elle s'y était employée vers le
Saint-Père. Cette grande et pieuse princesse, entre les cinq et six heures du
soir, voulut dire en sa chapelle [289] les Litanies de Notre-Dame, et la
troisième partie du Rosaire. Elle fit mettre à genoux notre Bienheureuse Mère
proche d'elle et d'un récollet, Frère-lai, qui est avec raison en grande
réputation de sainteté ; eux trois faisaient un chœur, et tout le peuple
l'autre, tant pour répondre aux Litanies, que pour dire tout haut l’Ave
Maria, duquel Madame Royale, notre Bienheureuse Mère et ce bon frère
disaient la moitié et le peuple le reste. Cette dévotion étant finie, Madame
Royale dit adieu à notre Bienheureuse Mère, qui lui avait demandé licence de se
retirer de cette foule de monde. Cette bonne princesse pleurait amèrement la
perte de Son Altesse son fils, et témoigna un sensible regret de se voir
empêchée d'aller elle-même introduire notre Bienheureuse Mère dans Turin et
dans la maison préparée pour fonder. Durant le temps de la prière que Madame
Royale faisait faire, comme nous venons de le dire, pour la santé de l'Altesse
son fils, il arriva à notre Bienheureuse un si grand attrait et désir de prier
pour l'heureuse prospérité de Charles-Emmanuel, qui est le duc d'aujourd'hui,
second fils de Madame Royale, qu'elle ne put point avoir de liberté intérieure
de prier pour la santé du malade. Elle se leva de sa prière avec un certain
sentiment si grand que Dieu voulait que le puîné régnât, qu'elle se mit à dire
à Madame Royale des paroles de consolation et de résignation sur la mort du
malade, tandis que les autres la flattaient de discours de bonne espérance de
l'issue de son mal. Elle sortit du Valentin environ les huit heures du
soir ; madame Mecthilde, quoiqu'elle dût retourner cette même nuit trouver
Madame Royale, ne laissa pas de conduire et introduire elle-même notre
Bienheureuse Mère et ses religieuses en la maison qu'elle leur avait fait
préparer.
Ce n'est pas ici le lieu de raconter par le menu les difficultés qui se
rencontrèrent encore pour l'établissement, pour la fulmination des bulles, pour
arrêter une maison et place propre à bâtir le couvent ; suffit de dire
qu'une autre main, moins adroite [290] et moins estimée que celle de cette
Bienheureuse Mère, eût eu bien de la peine à dévider cette fusée. Avant que la
clôture fût établie, les sérénissimes Infantes désirèrent de voir chez elles
notre Bienheureuse Mère, qu'elles reçurent avec grande joie et dévotion ;
et singulièrement l'Infante Catherine lui parla de cœur, je dis de ce cœur
duquel elle avait, dès près de vingt ans, aspiré à la Visitation ; et elle
en avait été empêchée contre sa volonté par des raisons d'État et
considérations humaines.
Notre Bienheureuse Mère fut aussi vénérer le saint Suaire, dans
l'église de Saint-Jean ; Madame Royale allant en propre personne le faire
montrer, et quantité d'autres reliques, principalement du bois de la sainte
Croix et des sacrées épines de la couronne du Roi du ciel et de la terre.
Devant ces divins trésors, le cœur de notre Bienheureuse Mère se fondait de
dévotion et d'une révérence sainte qui la retenaient si longuement en oraison,
qu'elle y eût bien passé la nuit, laquelle s'approchant contraignit Madame
Royale de remonter en carrosse pour retourner trouver Son Altesse malade,
qu'elle recommanda, avec une ardeur extrême, à notre Bienheureuse Mère ;
mais il plut à Dieu de le retirer de cette vie, ce qui ne fut point un accident
imprévu pour elle.
Les carmélites et les annonciades désirèrent fort de voir notre
Bienheureuse Mère, ce qui leur fut accordé, et elles lui demeurèrent
parfaitement affectionnées et en très-haute estime de sa vertu ; sentiment
qui s'imprima dans tous ceux qui conversèrent avec elle, chacun lisant dans son
visage la sainteté de son âme, et parlant d'elle avec honneur et vénération.
Les dames piémontaises, tandis que la clôture ne fut pas établie, ne pouvaient
sortir d'auprès de cette digne Mère, et prenaient un goût singulier à notre
manière de vie ; mais nous parlerons plus amplement de cela en la
fondation et des parfaites bontés de M. le marquis de Pianesse, fils unique de
la signora Mecthilde, qui fut la cause fondamentale de notre établissement, et
qui a toujours [291] honoré notre Bienheureuse Mère comme sa vraie mère, et
l'est venue voir ici tout exprès.
Durant le temps que cette Bienheureuse demeura à Turin, Monseigneur le
nonce lui fit l'honneur de la visiter, ce qui fut un très-grand bien pour tout
l'Ordre, d'autant qu'elle le désabusa entièrement de plusieurs choses qu'on lui
avait dites contre notre congrégation ; il ajouta pleine foi à ses paroles
avec très-grand témoignage d'estime d'elle ; de même Monseigneur
l'archevêque de Turin lui donna sa propre nièce, qui lui était fort
chère ; elle fut la première reçue. Madame Royale favorisa hautement et
puissamment notre établissement et notre Bienheureuse Mère, laquelle elle
allait souvent voir, et dîner avec elle, l'entretenant quelquefois en
particulier deux et trois heures de toute son âme, lui ayant une confiance
entière. Nos chères Sœurs de Turin nous ont écrit que les sept mois que notre
Bienheureuse demeura à fonder et bien établir leur maison, ont été comme le
principe de toutes leurs bénédictions. Elle les mit, après mille difficultés,
en maison propre. Elle reçut plusieurs bons sujets et filles de bons lieux et
leur laissa la bienveillance générale de toute la ville. Elle les fournit d'un
très-bon et très-vertueux confesseur, y établit pour supérieure notre chère
Sœur Madeleine-Elisabeth de Lucinge.
Tout le monde, deçà les monts, croyait que jamais Madame Royale ne
permettrait à notre Bienheureuse Mère de retourner en ces quartiers, ce qui
mettait fort en appréhension, mais Dieu y pourvut ; car, lorsqu'on y
pensait le moins, Monseigneur notre bon prélat, qui était alors à Turin, lui
vint dire qu'il se fallait retirer, à cause des approches de l'armée espagnole.
Cette digne Mère écrivit à Madame Royale pour lui demander son congé ;
cette grande et pieuse princesse monta en carrosse, et lui vint rendre réponse
de vive voix, lui permettant de se retirer, l'entretenant fort longtemps en
particulier avec une grande abondance de larmes. À peine cette Bienheureuse
Mère prit du temps [292] pour faire ses adieux, tant on la pressait de se
retirer. Elle laissa nos chères Sœurs bien touchées de son prompt départ, mais
grandement consolées d'avoir été cultivées et enseignées par une si digne Mère.
CHAPITRE XXVII.
notre bienheureuse
mère met tous ses soins à procurer et établir en savoie les révérends pères de
la mission,
Le 19 d'avril 1639, notre Bienheureuse Mère sortit de Turin ; M.
le marquis de Pianesse et M. le marquis de Lulin, qui lui prêtait son équipage,
allèrent pour la monter en carrosse. Monseigneur l'archevêque lui vint donner
sa bénédiction. La signora Mecthilde la fut conduire à une lieue loin de Turin,
et la quitta avec un indicible regret. Notre Bienheureuse Mère demeura à la
conduite de M. Pioton, à présent très-digne ecclésiastique, et de tout temps
très-vertueux serviteur de Dieu et fidèle ami de notre institut. Cette chère
Mère le chérissait comme son frère ; aussi l'appelait-elle de ce nom
cordial, et il lui avait aidé à démêler et supporter les affaires plus
difficiles et pénibles de l'établissement de notre maison de Turin.
Elle alla en notre monastère de Pignerol, où elle arriva fort tard et
avec beaucoup de fatigues ; néanmoins, elle ne laissa pas de recevoir des
visites de plusieurs qui la venaient voir, tant pour son propre mérite qu'en
qualité de belle-mère et mère de leur gouverneur et gouvernante.[64] Elle fit fort peu de séjour parmi nos chères
Sœurs ; elle leur parla pourtant à toutes en particulier, mais on la
pressait tellement de sortir du Piémont, que le soir de son arrivée, on voulait
quasi la contraindre de remonter en carrosse pour gagner chemin toute la
nuit ; et ce n'était pas sans cause, puisque quatre jours après la sortie
de [294] cette Bienheureuse Mère, de Turin, l'armée espagnole y donna une rude
attaque.
Notre Bienheureuse Mère s'en revint par le Dauphiné. Depuis Pignerol
jusqu'à Embrun elle courut d'étranges hasards sur le bord des affreux
précipices qui faisaient blêmir notre chère Sœur Jeanne-Thérèse Picoteau, sa
compagne, de quoi cette Bienheureuse Mère souriait dévotement, disant quelques
courtes paroles de résignation et d'abandonnement à la céleste Providence. Sur
la fin du mois de mai, nous vîmes de retour cette Bienheureuse Mère qui vint
finir parmi nous l'année 1639, laquelle Dieu lui fit passer dans une
très-cuisante douleur, par les grandes appréhensions où elle était, sachant nos
chères Sœurs de Turin dans l'horrible effroi de la guerre, qui s'échauffa
furieusement, et dans les pauvretés et nécessités où le siège réduisait la
plupart du peuple ; notre monastère de Turin était justement entre les
deux batteries française et espagnole. L'ennemi se servait de sa compassion maternelle
et de son affection charitable pour lui donner des soucis superflus, des
prévoyances sinistres et funestes des hasards que pouvaient courir nos chères
Sœurs, tant par l'insolence des soldats que par la cruauté des armes. À tout
cela elle opposait son remède ordinaire, qui était de regarder Dieu, que tout
se conduit par sa volonté ou permission, que rien n'est hors du soin de sa
Providence. Elle cherchait tous les moyens possibles d'écrire à ses chères
Sœurs et de les encouragera porter leur tribulation avec une généreuse vertu,
les assurant qu'au milieu de ses craintes, elle avait une grande espérance que
Dieu les tenait comme petits poussins à l'ombre des ailes de sa divine
protection, et qu'il ne leur arriverait aucun mal ; ce qui a été vrai, non
sans grande merveille, ainsi que nous dirons en la fondation ; et ces
chères Sœurs l'ont attribué en partie à l'effet des prières de cette digne
Mère ; aussi en avait-elle un soin continuel, et elle les recommandait aux
prières de toutes nos maisons. [295]
Au retour de ce voyage de Turin, il est vrai que nous trouvâmes notre
Bienheureuse Mère, quoique en bonne santé, un peu usée par l'air de ce pays-là
et la fatigue, et ses jambes affaiblies, mais aussi son esprit dans une force
toujours plus sainte, plus suave et plus aimable. Il faut remarquer que
lorsqu'elle allait faire quelque voyage, toujours, à son retour, nous trouvions
en elle certain surcroît de perfection qui n'était pas ordinaire ; ne
bougeant d'entre nous, nous ne nous apercevions pas universellement de ces
accroissements, quoique véritablement nous vissions bien que cette fidèle
Épouse allait incessamment de vertu en vertu, et que, comme vraie fleur du
Paradis, croissait sans discontinuation, d'autant qu'elle se tenait toujours à
la vue de son divin Soleil. Cette fidèle Épouse avait bien les mains faites
au tour, et ne pouvait cesser d'agir pour la gloire de Dieu et le service
du prochain. Elle avait eu, dès plusieurs années, un grand désir de procurer
quelques dignes ouvriers pour travailler dans ce diocèse de Genève, qui lui
était cher, comme étant le propre bercail de notre saint Fondateur. Après avoir
cherché divers moyens de mettre cette inspiration en exécution, et avoir
grandement recommandé la chose à Notre-Seigneur, sa Providence la poussa et fortifia
pour faire un coup d'une sainte hardiesse et adresse, engageant M. le
commandeur de Sillery, fondateur de notre monastère de Paris, à la rue de
Saint-Antoine, de faire une fondation de Messieurs de la Mission en ce diocèse.
Ce grand serviteur de Dieu, qui avait une très-haute estime de notre
Bienheureuse Mère, s'accorda à ce qu'elle voulut, et lui répondit de la manière
la plus obligeante. Cette sainte âme voyant une chose si souhaitable résolue,
en eut une joie inexprimable, et poussa vivement la roue afin que l'on en vînt
à l'exécution, demandant des ouvriers à M. Vincent,[65] fondateur de Messieurs les Missionnaires.
[296]
Il y avait trop de plaisir de voir cette vraie servante de
Notre-Seigneur s'embesogner à faire préparer tout ce qu'il fallait pour le
logement, les petits meubles et la sacristie de ces bons Messieurs, à quoi elle
voulait coudre et travailler elle-même, et elle disait avec une suavité
aimable : « Voyez-vous, quand je pense que nos Messieurs se
fourreront dans les buissons et les épines des difficultés et travaux pour
retirer du vice et de l'erreur les chères brebis de notre Bienheureux Père et
Pasteur, il me semble que je rajeunis de les voir venir en ce diocèse. »
Lorsqu'au mois de février 1640 ces bons Messieurs de la Mission arrivèrent,
elle témoigna une joie qui ne se peut exprimer, non plus que le soin maternel
qu'elle prit pour leur temporel, voulant que cette maison y contribuât
charitablement. Quand la Sœur portière, ou celles qui avaient des affaires au
dehors, pouvaient savoir quelque chose du fruit que faisaient dans les âmes ces
bons Messieurs les Missionnaires, par leurs prédications et catéchismes,
c'était à qui irait la première en faire le récit, aux récréations, à cette
Bienheureuse Mère, qui y prenait un plaisir singulier. M. Vincent, envoyant ces
chers enfants travailler en ce diocèse, leur ordonna de tenir notre
Bienheureuse Mère pour leur Mère, et de lui conférer avec une entière confiance
leurs difficultés, ce qu'ils ont pratiqué avec tant d'humilité et bonté, qu'elle
en était en admiration ; elle leur donnait tout le temps qu'ils voulaient
avec une joie particulière, et nous excitait souvent à la vertu par leurs
exemples.
Cette Bienheureuse employa le printemps et l'été de cette année 1640 à
faire lire devant elles les Petites Coutumes, les fondations qui étaient
pour lors écrites en partie, et les vies de nos premières Mères, prenant
quelquefois la peine de les corriger de sa propre main. Comme nous avons dit
qu'elle nous avait assuré qu'elle courrait le dernier triennal de sa vie, elle
minutait tout doucement sa déposition, et par une adresse [297] incomparable,
prévenait doucement l'esprit de Monseigneur notre prélat, afin qu'il ne permît
plus qu'elle fût mise sur le catalogue, ce qu'elle obtint selon son désir. Elle
pourvut aussi de loin en loin au désengagement de notre très-honorée Mère
Marie-Aimée de Blonay, qui allait terminer son triennal en notre monastère de
Bourg. Il y avait plusieurs années que cette Bienheureuse Mère désirait la
rappeler en cette maison, mais le temps n'était pas venu ; Dieu voulait
que celle qui avait autrefois été nommée la cadette, par tendresse
d'affection de nos Bienheureux Père et Mère, vînt, par droit de mérite et de
succession, prendre la place de ses aînées et être la dernière Mère de celle
qui, étant Mère de toutes, n'était inférieure que par un excès de son humilité.
CHAPITRE XXVIII.
de la mort de
monseigneur de bourges.
Lorsque Monseigneur le cardinal de Lyon eut accordé à Monseigneur de
Genève le retour en cette maison de notre très-chère Mère Marie-Aimée de
Blonay, notre Bienheureuse en fit un petit feu de joie dans son cœur, et
disposa toutes choses à son entière déposition et démission de la supériorité.
Elle parlait fort peu de cette affaire, attendant avec joie le temps de la
mettre à exécution. Comme elle prétendait à se dépouiller de tout pour
s'employer plus totalement aux choses célestes, Notre-Seigneur mit aussi la
main pour contribuer à la dénuer de tout, et retira à soi Mgr André Frémyot,
archevêque de Bourges, frère unique de cette Bienheureuse Mère, laquelle, par
un sentiment et esprit de prophétie, environ trois mois avant son décès, lui
avait écrit, avec des paroles fortes et tendres, qu'elle le conjurait de se
préparer à la mort ; que, de son côté, elle faisait le même dessein, parce
que ni lui ni elle n'avaient plus guère à vivre. Puisque nous avons parlé
ci-dessus de la vertu et des grâces que ce digne archevêque avait reçues de
Dieu, il ne sera pas hors de propos de dire un mot ici de son heureuse fin.
Il y avait environ quinze ans que ce bon prélat persévérait en
l'heureux état de piété que Dieu lui avait fait la grâce d'embrasser en cette
grande maladie de laquelle nous avons parlé ci-dessus. Sa bonté et bénignité
étaient si grandes, que feu Monseigneur de Genève, frère de notre Bienheureux
Père, disait qu'il croyait que Dieu et les Anges étaient amoureux de cette âme.
Ses [299] aumônes et ses charités étaient innombrables ; s'il avait de
grands biens, aussi en faisait-il de grandes, et, ses dernières années, il
nourrissait plus de deux et quelquefois trois cents pauvres, tant Lorrains
qu'autres, les faisant travaillera son abbaye de Ferrière. Si ce n'eût été les
grandes charités qu'il faisait et l'utilité qu'il apportait à plusieurs, il se
fût retiré aux Pères de l'Oratoire ou aux Chartreux, plusieurs années avant sa
mort ; mais on ne lui conseilla pas, à quoi il soumit le grand désir qu'il
avait de se retirer à l'écart de ce grand monde. Voici comme il en écrivait à
notre Bienheureuse Mère : « Enfin, ma très-unique sœur, il est conclu
qu'il me faut priver du doux repos que j'espérais trouver dans la seule et
douce conversation avec Dieu. On me fait voir quantité de raisons contre ma
retraite ; cela m'est pénible, je vous assure, car il me faut vivre à Paris
comme à Paris, tenir train et table, ne bouger des compagnies ; cela me
distrait de la dévotion intérieure à laquelle tous les jours je me sens plus
attiré. Si je croyais mes propres pensées, contre l'avis de tout le monde, je
m'irais enfermer chez les chartreux ou chez les pères de l'Oratoire, non pour
être des leurs, mais pour y vivre retiré du monde, et avoir une personne que je
regarderais comme mon supérieur, et ne ferais en tout que ce qu'il
m'ordonnerait. »
Jusqu'ici sont les paroles de ce bon prélat, lequel Dieu allait
disposant pour le retirer à soi. Il eut une maladie au commencement de l'année
1641, de laquelle on écrivit à notre Bienheureuse Mère qu'il était parfaitement
guéri ; elle se mit à sourire contre le crucifix qui était sur la table,
et nous dit : « Il est guéri, ce n'est pas pour aller loin. »
Elle lui écrivit derechef pour le prier qu'il se disposât à bien mourir, et
qu'il priât pour elle à la sainte messe, demandant à Dieu une bonne disposition
pour elle. Nous ne croyons pas pourtant qu'elle sût que cette année-là devait
terminer le cours de la sainte vie de l'un et de l'autre, car quelquefois elle
nous signifiait le [300] contraire, nous disant qu'elle espérait bien qu'elle
ne passerait pas sa septante-troisième année, mais qu'elle se sentait assez
forte pour aller jusque-là.
Monseigneur de Châlons, neveu de ce digne prélat, et madame de
Toulonjon, sa nièce et fille unique de notre Bienheureuse Mère, se rendirent à
Paris pour quelques affaires ; mais que la Providence de Dieu est
douce ! elle les y conduisit pour y recevoir le dernier soupir de leur bon
oncle. Le surlendemain de leur arrivée, Monseigneur de Bourges, disant messe
aux minimes qu'il affectionnait fort, eut un grand étourdissement à l'autel et
acheva avec peine sa messe, après laquelle, ayant pris quelque chose, cela se
passa. Monseigneur de Châlons, Monsieur l'abbé de Saint-Satur et madame de
Toulonjon allèrent dîner chez lui. Il commença de dîner de fort bon
appétit ; sur la fin du repas il évanouit ; on le mit au lit, on le saigna.
Il revint et se porta si bien, que le lendemain, jour de l'Ascension de
Notre-Seigneur, il voulait, selon sa bonne coutume, dire la sainte messe, mais
on l'en empêcha. Il l'ouït vêtu et à genoux et communia. À midi du même jour,
l'apoplexie le reprit, on le ressaigna, et revint à soi, quoiqu'il demeurât
bien assoupi ; le lendemain, qui était le vendredi, il retomba encore en
apoplexie, on le saigna au pied, ce qui lui donna de bons intervalles dans
lesquels on lui donna l'Extrême-Onction, à quoi il répondit lui-même. De temps
en temps, il disait de très-belles et dévotes paroles, témoignant toujours que
son cœur était dans une grande résignation. À la fin de l'Extrême-Onction, il
donna à tous sa bénédiction paternelle. Depuis cette action, il demeura fort
assoupi, et, quand il se réveillait, il jetait des hauts cris, réclamant
toujours Notre-Seigneur, ce qui manifestait sa bonne habitude intérieure. Ses
plaintes et ses cris tiraient les larmes des yeux des assistants, et notamment
de madame sa chère nièce ; néanmoins, les médecins soutenaient par leur
doctrine qu'il ne souffrait point de mal, et que [301] ses cris étaient l'effet
de l'apoplexie et convulsion qu'il ne sentait point. Le samedi, il eut un peu
d'intervalle le matin, et reçut la sainte communion comme Viatique par la main
de monsieur le curé de Saint-Paul. Pour dernier remède, les médecins le firent
saigner aux tempes ; alors il n'avait point de connaissance, et il le
fallut tenir avec violence, car il avait toute sa force. Depuis cette saignée,
il n'eut plus de relâche à crier de belles paroles à Dieu et à se tourner de
tous côtés sans trouver repos, et, dès cette heure, il fut saisi de la fièvre,
qui ne le quitta plus jusqu'au lundi suivant qu'il rendit l'esprit à Dieu,
entre onze heures et midi, le treize mai, toujours bien assisté, entre autres
des bons pères minimes qu'il avait fort aimés.
Ainsi que notre Bienheureux Père le fait considérer à sa dévote
Philothée, les plus grands empressements que l'on a après le décès, c'est de
mettre le corps en terre ; ce bon archevêque ayant envoyé son esprit au
ciel, il fallut parler du lieu où l'on mettrait le corps. L'avis premier fut de
le porter à son abbaye de Ferrière ; pour cet effet, on l'embauma ;
mais monsieur l'abbé de Saint-Satur opina, remontrant qu'il devait être inhumé
chez nos Sœurs de Sainte-Marie de Paris, à Saint-Antoine ; qu'il en avait
consacré l'église ; qu'il était frère de la Fondatrice de cet Ordre et
commissaire pour la béatification du Fondateur. Madame de Toulonjon tint fort ferme,
afin que son cher oncle fût enterré en l'église de notre monastère, et notre
chère Sœur Hélène-Angélique Lhuilier écrivit à Monseigneur de Châlons en si
bons termes et avec tant de solides raisons, que ce fut la conclusion qu'il
serait enterré à Sainte-Marie. Il le fallut quasi laisser deux jours sur son
lit de parade, où tout Paris accourut pour le voir aussi beau que jamais, sa
maladie si courte ne l'ayant point exténué. Enfin, avec un convoi magnifique,
il fut porté en notre église de Paris où il reposa une nuit. Toute l'église
était tendue de noir, ornée de plus de trois cents écussons des armoiries du
défunt ; la moitié d'icelle [302] élevée en théâtre, pour Messeigneurs les
évêques et autres personnes de haute qualité, Monseigneur l'évêque d'Amiens fit
l'office, et quatre autres évêques, revêtus avec les mitres blanches,
l'assistaient. Mgr Pierre Camus, évêque de Belley, l'ancien, fit l'oraison
funèbre, où il montra excellemment le cœur, la douceur, les caresses de ce
très-bon prélat envers ses amis et ennemis ; enfin, il donna tant
d'assurances de sa félicité, que les auditeurs en eussent voulu être
spectateurs. On établit un anniversaire de messes chez nos Sœurs, un à Ferrière
et un à Dijon, où son cœur fut porté. Le lendemain de son décès, on envoya en
cinquante églises et couvents de Paris, à chacun dix écus, pour faire dire des
messes pour le défunt. On fit de grands services pour le repos de cette chère
âme, à Paris, à Dijon, à Bourges et dans toutes nos maisons, Dieu permettant
qu'on fit de grands biens à l'âme de celui qui en avait tant fait aux pauvres.
On dit à notre Bienheureuse Mère la nouvelle de cette mort, comme elle
était sur le point de la sainte Communion ; elle la reçut avec sa parfaite
et coutumière résignation, pleurant un peu, après quoi elle suivit son train et
ses exercices à son ordinaire, témoignant un cœur fort tendrement touché d'un
sérieux contentement parmi les tendretés naturelles ; elle nous dit
« qu'elle n'attendait point d'autres nouvelles que celles qu'elle avait
reçues ; que ce qui l'attendrissait, était de voir qu'étant plus âgée que
ce cher frère, elle demeurât encore en ce monde, comme moins disposée d'aller à
Dieu. » À toutes les maisons de notre Ordre auxquelles elle écrivait, elle
recommandait, avec une très-grande humilité et brièveté de paroles, que l'on
fît la charité de prier pour l'âme de ce cher défunt, et que l'on demandât à
Dieu qu'elle se disposât à faire son dernier passage heureusement. Il y avait
plus d'un an qu'elle faisait faire cette prière par nos maisons.
CHAPITRE XXIX.
notre digne mère est
de nouveau déchargée de la supériorité ; sa parfaite humilité et charité.
Le temps de la déposition étant venu, notre Bienheureuse Mère renonça
de tout son cœur, dit-elle, et pour le reste de ses jours, à la charge de
Supérieure. Elle tint un chapitre pour nous disposer à ne plus penser à la
charger de ce faix. Nous pensâmes toutes fondre en larmes ; elle parlait
avec une ardeur de séraphin, et avec une humilité de vraie sainte. Elle demanda
pardon à toutes les Sœurs, ajoutant qu'elle en demandait un tout particulier à
celles qu'elle avait insatisfaites en quelque chose, les assurant qu'elle ne
l'avait point fait par mauvaise volonté, et qu'elle avait agi selon ce qu'elle
avait cru devoir faire. Après cela, chose qu'elle n'avait jamais faite en
chapitre, comme nous étions toutes de rang, elle nous vint embrasser
maternellement l'une après l'autre, nous disant le dernier adieu en qualité de
Supérieure, sans vouloir permettre que nous dissions des paroles d'attendrissement ;
d'autant, nous assura-t-elle, que la charge de Supérieure ne lui ajoutait pas
un brin d'affection pour nous. Elle nous rendit témoignage en paroles courtes
et solides, des vertus et capacité de notre très-chère Mère Marie-Aimée de
Blonay, parce que la plus grande partie de la communauté ne l'avait jamais vue.
Les efforts de nos Sœurs conseillères, ni les larmes de la communauté, ne
purent empêcher que cette Bienheureuse Mère, non-seulement ne fût pas mise sur
le catalogue, mais encore qu'il nous fût défendu [304] de l'élire. Enfin, le
jeudi après l'Ascension de Notre-Seigneur, 1641, selon la règle, notre
très-chère Mère Marie-Aimée de Blonay fut élue, non-seulement canoniquement,
mais unanimement, ce qui donna un grand contentement à notre Bienheureuse, qui
désirait fort de voir cette chère Mère céans ; et elle remercia la
communauté avec une débonnaireté toute sainte, du témoignage qu'on lui avait
donné par cette élection, d'une entière confiance en sa parole.
En attendant que cette chère Mère élue vînt de notre monastère de
Bourg, notre Bienheureuse entretint deux fois la communauté, nous instruisant
comme il se fallait comporter envers les supérieures nouvellement élues,
surtout quand elles viennent dans des communautés où elles ne sont pas connues.
Surtout, elle nous recommanda de ne nous point abaisser l'une l'autre dans
l'esprit de notre nouvelle Mère, exagérant grandement le mal que ferait celle
qui irait raconter les fautes passées de leurs Sœurs ; « que nous
devions agir comme Notre-Seigneur, qui oublie le passé ; que si elle
s'apercevait qu'on manquât à cela, elle en procurerait des bonnes
pénitences ; qu'une Supérieure élue n'a à rendre compte que de ce qui se
fait sous elle, et non de ce qui est passé ; de quoi on ne pouvait parler
sans pécher contre la charité, sinon que quelque nécessité y contraignît, et
qu'on le fît sans passion et sans intérêt ; qu'elle-même, qui avait été
notre Supérieure, lorsqu'il faudrait parler à notre très-chère Mère élue, elle
lui dirait les bonnes dispositions, talents et portée de l'esprit de chacune,
afin qu'elle vît de quel biais elle devait conduire, et que toute Supérieure
déposée doit rendre ce devoir à l'élue, mais qu'elle aurait grand scrupule de
parler des défauts passés ou éteints ; et qu'elle admirait quelquefois
comme il se peut trouver des âmes si mal faites, qu'elles se plaisent à aller
déterrer des défauts commis il y a des années entières, pour en tirer et faire
tirer des conséquences au préjudice du prochain, qu'elles se [305] devaient
assurer que Dieu les mesurerait à cette aune. » Elle nous dit encore
qu'elle s'était abstenue de nous beaucoup parler des vertus de notre chère Mère
de Blonay avant l'élection, crainte que l'on ne pensât qu'elle voulût donner un
branle absolu à cette action, où elle voulait laisser agir le Saint-Esprit,
mais qu'il fallait qu'elle contentât son cœur et les nôtres à nous en parler,
nous conjouissant de cette élection, et nous en disant mille biens avec une
suavité ravissante. Elle écrivit à cette chère Mère, afin qu'elle hâtât sa
venue ; et l'on voyait qu'il tardait à cette Bienheureuse Mère de se voir
sous l'obéissance. Elle prenait soin elle-même de lui faire préparer son lit et
sa chambre, et ne nous parlait, aux récréations et ailleurs, que de bien aimer
et obéir à cette chère Mère, et de nous supporter et aimer tendrement les unes
les autres ; et nous rencontrant au sortir des récréations et assemblées,
elle nous disait, avec un visage enflammé : « Mes chères Sœurs,
amour, amour, amour ! »
Le jour que notre chère Mère arriva, cette Bienheureuse ayant su
qu'elle était à la porte, partit de là avec une allégresse et vitesse
incroyables ; et se jetant à genoux devant elle, elle l'embrassa
amoureusement, et dit : « Voici ma Mère, ma fille, ma sœur, mon propre
cœur et mon âme. » Ces deux chères Mères s'étant relevées, avant que de
saluer la communauté, notre très-digne Mère voulut que l'on allât toutes
ensemble rendre grâces à Notre-Seigneur et à notre Bienheureux Père de cette
heureuse arrivée, et cette sainte et digne Mère, se souriant contre une de ses
filles, lui dit : « Que fais-je plus en cette vie, puisque voilà mon
cher Annecy si bien pourvu d'une Mère telle que je la désirais ? »
Elle dit aussi à notre chère Mère de Blonay : « Ma très-chère Mère,
il y a plusieurs années que j'avais envie de vous revoir dans cette maison,
mais il y a neuf mois entiers que je vous demande à Dieu. »
Dès le matin, le lendemain de l'arrivée, notre Bienheureuse fut en la
chambre de notre nouvelle Supérieure pour lui donner [306] le bonjour, et
savoir comme elle avait passé la nuit, et en tout lui rendait les respects et
déférence d'une petite inférieure. Néanmoins, dans peu de jours, il arriva de
grands dissentiments entre ces deux chères Mères. Notre bonne Mère supérieure
ne pouvait souffrir notre sainte et vénérable Mère, qui courait son année
septantième, au tout dernier rang, avec une Sœur du petit habit ; mais
cette Bienheureuse chérissait cette place avec tant de sainte jalousie, qu'elle
ne voulut jamais condescendre à en prendre une autre. Lorsqu'elle en parlait,
c'était toujours avec témoignage de déplaisir que notre chère Mère prît garde à
cela, disant qu'elle s'étonnait qu'on la crût là en état d'humiliation, vu
qu'il n'y avait rien de plus honorable pour une Religieuse que d'observer sa
règle ; et lorsque notre bonne Mère voulait l'empêcher de dire ses
coulpes, de se mettre à genoux pour recevoir les avertissements faits à la
communauté, cette Bienheureuse s'exclamait : « Hélas ! notre
très-chère Mère m'ôte toute ma suavité. » Enfin, ce différend passa si
avant, qu'il fallut que les supérieurs y vinssent mettre ordre ; mais
notre très-digne Mère les avait si bien prévenus, qu'ils jugèrent en sa
faveur ; et Monseigneur de Genève, ni Monsieur notre Père spirituel, ne
voulurent point recevoir de prétextes ni de raisons, pour ordonner à cette
digne Fondatrice de prendre autre rang que le dernier, disant qu'au royaume des
cieux, les derniers seraient faits les premiers ; qu'on devait laisser
cette Bienheureuse Mère jouir du repos et du contentement de simple
inférieure ; que Jésus-Christ, Fondateur du monde et de l'Église, s'est
fait le dernier de tous les hommes, et qu'avant d'aller à sa passion, il se mit
aux pieds de tous ses disciples. Cette termination consola parfaitement notre
Bienheureuse Mère, qui se tenait si sujette et si humble et sans autorité
qu'elle dit sa coulpe de ce que faute d'attention elle avait fait faire quelque
petite chose à une Sœur avant que d'en avoir demandé la permission. [307]
Écrivant à quelques supérieures déposées, elle leur donnait la joie de
ce qu'elles étaient en égale condition, et s'encourageait avec elles à bien
profiter de ce temps. Elle avait une grande inclination à bien inculquer aux
Supérieures déposées qu'elles ne doivent réserver aucune autorité ni prétention
du gouvernement, disant que déposée voulait dire ôtée, et
entièrement démise du gouvernement ; que ce ne serait qu'une hypocrisie de
se démettre de la charge, et conserver les habitudes et les actions de la
conduite ; que c'était sortir comme Rachel de son pays, mais emporter
l'idole avec soi.[66] Elle pria très-instamment notre chère Mère
de Blonay de prendre soin de sa direction, de la mortifier et exercer, et
qu'elle lui fît cette grâce-là ; qu'on ne lui parlât plus d'aucune affaire
temporelle ; que grâces à Dieu la maison était en bon état, qu'elle en
prît la conduite, et qu'elle n'eût plus à s'en mêler ; que les choses de
la terre lui étaient à grand ennui, et que les discours qu'il fallait faire sur
ce sujet la peinaient fort ; que la seule liberté qu'elle désirait,
c'était de voir les lettres que nos monastères lui écrivaient, et d'avoir les
Sœurs qu'elle employait à [308] l'écriture pour y répondre, demandant congé à
cet effet de leur parler.
Depuis que cette Bienheureuse fut déposée, elle paraissait si
extraordinairement douce et aimable, et dans une si continuelle occupation à
Dieu et aux choses éternelles, que cela donnait du frémissement à quelques-unes
d'entre nous, crainte que ce sacré flambeau ne fût dans son dernier éclat. Elle
nous disait quelquefois qu'elle avait une très-grande suavité à considérer
combien notre très-honorée Mère supérieure était aimée dans cette
communauté ; que, pour elle, elle sentait envers nous l'affection tendre
de ces pauvres vieilles grand'mères pour leurs petits-enfants ; faisant
ainsi de douces comparaisons qui tendaient toujours à l'humilier elle-même, à
nous donner de nouveaux sentiments d'estime pour notre chère Mère et d'union
entre nous, qui étions bien dans nos beaux jours, et dans l'espérance que la
joie sainte et le repos nous maintiendraient longtemps en santé cette vraie et
digne Mère de nos cœurs.
CHAPITRE XXX.
de son élection à
moulins, et de ses derniers adieux au premier monastère d'annecy.
Il y avait plus de dix-huit mois que Paris et Moulins étaient dans des
grandes prétentions de faire faire à notre Bienheureuse Mère encore un voyage
en France, dont elle renvoyait, comme à son ordinaire, toutes les propositions
à l'ordonnance qu'il plairait à Monseigneur de Genève d'en faire. Ce bon seigneur
avait diverses fois dit et écrit qu'il ne voulait plus que notre Bienheureuse
Mère sortît d'ici. Nos chères Sœurs de Moulins furent inspirées toutes
unanimement en l'élection qu'elles devaient faire l'an 1641, d'élire notre
très-digne Mère de Chantal, quoiqu'elle ne fût pas sur leur catalogue. Quand
notre Bienheureuse Mère sut cette élection, elle dit de fort bonne grâce :
« Je renonce à toute supériorité », et manda à la bonne Mère déposée
et aux Sœurs, en des termes fort humbles, « que leur élection ne pouvait
être que frustratoire ; qu'elle n'accepterait jour de sa vie charge de
supériorité, sinon par un exprès commandement de ses supérieurs, et qu'elle
espérait qu'ils ne le lui feraient pas ; qu'il était bien raisonnable que
le peu qui lui restait de vie fût dirigé par l'obéissance ; » ce sont
ses mêmes mots. La très-digne madame de Montmorency voyant un second refus de
ce voyage, écrivit à notre Bienheureuse Mère une lettre qui mit Sa Charité en
grande considération, car elle disait ces mots : « Ma très-chère
Mère, tous ces refus ne me rebutent point ; vous [310] viendrez, et Dieu
fera pour moi ce que les hommes ne veulent pas faire. »
Quand ceux de la ville s'aperçurent que la France voulait encore revoir
cette digne Mère, les plus notables se mirent en devoir d'empêcher ce voyage,
disant qu'en l'âge où elle était si elle venait à mourir hors de l'état de
Savoie, jamais on n'aurait son corps. M. Barfelly envoya exprès à Son
Excellence pour obtenir de lui une lettre de défense ou une de Madame Royale, pour
ne point laisser sortir de l'État cette digne Mère. Pendant toutes ces
entrefaites, Dieu fit pour madame de Montmorency ce que les hommes ne voulaient
pas faire : Monseigneur d'Autun ayant écrit à Monseigneur de Genève, sa
seigneurie commanda à notre Bienheureuse Mère de lui dire si elle jugeait ce
voyage nécessaire ; elle lui répondit, par obéissance, qu'elle avait ce
sentiment, et qu'elle croyait que, s'il le lui commandait, c'était la volonté
de Dieu qu'elle le fit. Ce très-digne prélat nous a dit que comme Dieu donne
aux fondateurs et fondatrices d'Ordres ses lumières, si cette Bienheureuse ne
lui eût parlé de la sorte, qu'il n'eût donné la permission, laquelle il
octroya.
Notre très-chère Mère de Blonay et notre chapitre voyant les sentiments
de cette unique Mère, et en considération des désirs de la très-vertueuse
madame de Montmorency, ne voulurent pas s'opiniâtrer à des oppositions ;
et ce fut une chose toute visible, que dès que ce béni voyage fût conclu, notre
Bienheureuse brûlant du désir d'aller faire un dernier effort pour le bien de
son Institut, et achever le reste de sa sainte vie au service d'icelui, son
visage changea ; elle était dans une allégresse admirable ; elle
parla à toutes nos Sœurs avec une bonté maternelle. Contre sa façon de traiter
et sa coutume, elle envoyait quérir les amis et amies du monastère pour les
entretenir et dire adieu. Parlant à un monsieur, homme très-vertueux de cette
ville, elle lui répondit sur ce que l'on craignait qu'elle ne revint
plus : « Que l'on s'assure, dit-elle, que vive ou morte je [311]
reviendrai ici. » Parlant aussi à M. Pioton, qu'elle appelait son frère
par alliance spirituelle, dès une vingtaine d'années, elle lui dit qu'elle
allait allègrement à ce voyage, parce qu'elle croyait que c'était la volonté de
Dieu, et ajouta avec une admirable ardeur et sentiment intérieur :
« Voyez-vous, mon très-cher frère, je ne veux, par la divine grâce, que la
volonté de mon Dieu, et si je savais que tout à cette heure elle fût que je
m'allasse noyer, je courrais me précipiter dans le lac. »
Elle fit écrire à quasi toutes nos maisons, pour leur dire adieu et que
l'on priât pour son voyage, qu'il plût à Dieu le bénir ; et laissa encore
bon nombre de blancs signés et de lettres dictées à la Sœur qui écrivait pour
elle, afin qu'elle les fit après son départ. Elle disait à quelques-unes de nos
Sœurs supérieures, « que jamais elle n'avait fait voyage si joyeusement,
parce qu'elle en prévoyait certains biens forts grands pour quelques maisons,
et pour son âme en particulier, ayant grande envie de conférer de son intérieur
avec Monseigneur l'archevêque de Sens et M. Vincent ; que cette maison
était en si bon train et avait une si bonne Mère, qu'il fallait qu'elle allât
travailler ailleurs, et qu'elle n'avait point de plus grande suavité que de
penser qu'elle laissait notre très-honorée Mère Marie-Aimée de Blonay dans
Annecy. » Ayant parlé à toutes les Sœurs en particulier, elle voulut
encore parler en général, non pour nous dire autre chose, sinon nous exhorter à
l'amour mutuel ; sachant que dans cet amour tout bonheur est enclos, elle
nous dit tout cordialement « afin que nous sussions où la chercher, que
son lieu était le pied de la croix ; qu'elle tâcherait, Dieu aidant, de
s'y tenir avec tant de fidélité, que nous l'y trouverions ; elle ajouta
que jamais elle, ni nous, n'eûmes plus de sujet de contentement, puisque nous
avions une si bonne Mère ; que cette seule pensée la faisait partir
allègrement, parce qu'il ne lui restait ni peine ni souci de cette maison, mais
seulement de l'amour invariable. » Après cela, elle nous fit toutes ranger
au long de la chambre des assemblées, et sans nous [312] vouloir permettre de
nous mettre à genoux, elle nous embrassa l'une après l'autre, nous disant à
chacune un mot à l'oreille selon notre besoin intérieur ; enfin elle nous
donna sa bénédiction à toutes. Notre bonne Mère qui était absente, parce
qu'elle se fondait de pleurer, arriva. Cette digne Mère s'en alla faire un tour
avec elle, lui demandant des avis pour son intérieur, lui disant qu'il y avait
trois jours qu'elle était fort soulagée de sa peine d'esprit, la priant de lui
marquer une pratique intérieure à quoi elle s'attacherait pendant son
voyage ; et la pria aussi de lui donner le livre qu'elle devait lire, ce
que notre bonne Mère fit plus pour lui obéir que pour la diriger. Une Sœur
voyant que cette digne Mère faisait un adieu si extraordinaire et avec tant de
gaieté, elle qui toujours, quand elle nous quittait, mêlait quelqu'une de ses
bénites larmes parmi les nôtres, lui dit. « Ma Mère, nous ne nous
reverrons plus. — Si ferons, ma fille, lui dit-elle gaiement. — Mais, lui dit
la Sœur, demandez-le donc à Notre-Seigneur. — Non pas cela, dit-elle, sa
volonté soit faite ; nous nous reverrons en cette vie ou en l'autre. »
Enfin le 28 juillet 1641, cette bénite Mère sortit de cette maison. La
porte du monastère était gardée par un grand monde qui l'attendait ;
chacun se mettait par les rues pour lui dire adieu, et elle fil une chose
qu'elle n'avait jamais faite, faisant relever de tous côtés sa litière, et
donnant sa main de côté et d'autre aux dames et disant adieu ; même les
malades se faisaient mettre aux fenêtres pour la voir passer et lui crier
adieu. Hélas ! que nous ne croyions pas que cet adieu dût être si long,
car cette digne Mère était dans une santé, dans une vigueur et dans un bon
visage qui nous faisaient espérer encore, au dire de Monsieur notre médecin,
une quinzaine d'années de vie.
Elle vit nos Sœurs de Rumilly, Belley et Montluel, et partout elle
répandait une odeur de suavité et de sainteté qui faisait dire que jamais on
n'avait rien vu de pareil en elle. Son séjour [313] en notre monastère de Lyon,
en Belle-Cour, fut de quatre jours ; elle parla à toutes les Sœurs et fit
des entretiens généraux avec un zèle et une ardeur de sainte. Sa ferveur et
sainte joie s'accrurent par la vénération du cœur de notre Bienheureux Père, et
elle poursuivit son chemin vers Moulins avec une allégresse qui en donnait à
ceux de sa compagnie. Madame de Montmorency ayant reçu un mot de lettre qui
assignait le jour de l'arrivée de notre Bienheureuse Mère à Moulins, l'afficha
à un grand pilier, afin que toutes les Sœurs, l'une après l'autre, l'allassent
lire. Il n'est pas besoin de dire avec quelle joie cette Bienheureuse Mère fut
reçue dans Moulins, surtout de cette digne madame de Montmorency.
Jamais cette Bienheureuse Mère ne se voulut mettre en la place de la
Supérieure, gardant partout jalousement son dernier rang, et faisant faire à
l'assistante absolument la charge de Supérieure ; même on ne put jamais
gagner sur elle qu'elle donnât la bénédiction de Complies ; au contraire,
elle s'inclinait comme les autres pour la recevoir de l'assistante. Elle se mit
soudain à travailler pour le bien de la maison de Moulins, parlant à toutes les
Sœurs, faisant faire élection d'une Supérieure, en envoyant une à Vannes, et la
chère déposée de Moulins à Semur. Mais qui pourrait dire les réciproques
satisfactions de cette Bienheureuse et de madame de Montmorency ? Certes,
il s'en faut taire, car la chose est indisible, et il se fit une si grande
union de cœurs entre ces deux grandes servantes de Notre-Seigneur, que notre
Bienheureuse disait que son cœur était indivisible et inséparable d'avec celui
de cette très-honorée dame. Dieu voulut interrompre leur réciproque
contentement. Les poursuites pour le voyage de Paris recommencèrent quand on la
sut à Moulins. La reine prit la peine d'en écrire à Monseigneur notre bon
prélat, et à d'autres prélats et bons serviteurs de Dieu, tellement que
Monseigneur envoya à cette digne Mère une obéissance pour s'acheminer à Paris.
La reine lui envoya [314] une de ses litières. Cette Bienheureuse Mère
passa par Nevers, où Monseigneur l'évêque dudit lieu la pria de demeurer un
jour plus qu'elle n'espérait ; elle lui dit : « Monseigneur,
puisque vous me le commandez, je le ferai, mais j'ôterai ce jour-là à ma fille
de Toulonjon. » Ce qui fut vrai, ne demeurant qu'une nuit à Saint-Satur
avec cette chère et vertueuse fille, remettant de se voir plus amplement et à
souhait au retour de Paris. La reine voulut qu'elle passât à Saint-Germain, où
était Sa Majesté. Cette grande princesse témoigna un grand désir de la voir, et
plusieurs fois le jour qui devait être celui de l'arrivée elle s'enquit si elle
n'était point encore là. Elle alla à sa rencontre avec Monseigneur le dauphin
et le duc d'Anjou ; elle la mena dans son cabinet, où elle l'entretint
deux heures, lui témoignant grand désir d'avoir quelque chose d'elle pour le
garder précieusement, et la traita en tout avec des témoignages d'honneur et de
bienveillance dignes de sa grandeur et singulière piété.
CHAPITRE XXXI.
de son dernier séjour
à paris, à nevers et à moulins.
Nous n'entreprenons pas de dire avec quelle joie et honneur notre
Bienheureuse Mère fut reçue dans nos Monastères de Paris, ni par les autres où
elle passa en ce voyage ; il suffit de dire que partout elle répandit le
parfum de sa profonde humilité, la suavité de sa sainte douceur, et ravissait
tous les cœurs par le zèle admirable qu'elle témoignait à l'observance. Si Paris
est appelé une ville-monde, il faut confesser que durant le séjour que notre
Bienheureuse Mère y fit, elle eut un monde d'affaires par la multitude des
personnes qui la venaient consulter de toutes parts, même de fort loin, entre
autres quelques gentilshommes dont quelques-uns assurèrent qu'ils étaient venus
de soixante-dix lieues pour la voir et conférer d'affaires avec elle.
Le désir que cette Bienheureuse avait de satisfaire tout le monde était
cause qu'elle se levait dès les trois ou quatre heures du matin pour faire ses
prières, afin d'avoir le temps plus libre, rendant toujours à Dieu ce qui est
dû à Dieu, puis au prochain ce qui est dû au prochain. Nos chères Sœurs de
Paris nous ont écrit qu'elles étaient ravies de voir l'incomparable fidélité de
cette digne Mère à ne pas quitter un quart d'heure de son oraison mentale pour
la multitude de ses affaires. Un jour qu'elle n'avait presque point dormi et
s'était levée fort matin, il lui survint durant le temps de l'oraison un peu
d'assoupissement, de quoi s'apercevant, elle se leva debout avec une [316]
sainte vitesse, et passa ainsi le reste de l'oraison avec un visage si enflammé
et si dévot qu'elle semblait un ange.
Madame de Port-Royal et les révérendes mères carmélites désirèrent
extrêmement de voir dans leurs monastères cette Bienheureuse Mère, à quoi elle
s'accorda bénignement, étant dans une disposition de si douce condescendance,
qu'elle ne savait rien refuser au prochain de tout ce que légitimement il
pouvait désirer d'elle. Dieu voulut faire éclater la vertu de son humble
servante en telle sorte que nos chères Sœurs de Paris avaient assez d'affaire à
fournir et satisfaire aux personnes de toutes sortes de conditions qui
abordaient pour faire toucher des chapelets et autres choses à cette Bienheureuse
Mère, chacun disant que ce que l'on avait autrefois admiré de vertu en elle ne
semblait que l'aurore auprès du plein midi ; aussi dans peu de temps cette
douce lumière de notre petite Congrégation devait pencher vers son couchant.
Avant de partir de Paris, où elle avait comblé nos deux chères maisons de
suavité, elle envoya prendre la bénédiction et se recommanda aux prières de
Monseigneur le cardinal de Larochefoucault, qui est en estime d'un saint
prélat, lequel lui manda qu'il avait plus besoin de ses prières et de sa
bénédiction, qu'elle de la sienne, témoignant par là la haute estime qu'il en
faisait. Il plut à Notre-Seigneur d'opérer deux guérisons miraculeuses, par le
moyen de cette Bienheureuse Mère, durant son séjour à Paris. La reine, sachant
qu'elle était sur son départ, lui envoya témoigner qu'elle désirait qu'elle
repassât à Saint-Germain, pour l'entretenir à souhait ; mais comme le roi
y était pour lors, notre Bienheureuse Mère s'en excusa par des humbles et
religieuses raisons, que cette grande et pieuse princesse trouva bonnes. Il
semblait que cette digne Mère se portât extrêmement bien à son départ de Paris,
mais c'était l'extrême ferveur et zèle de son esprit qui supportait la
faiblesse du corps. Cette sainte ferveur ne lui faisait refuser aucun travail,
et lui faisait dire qu'il lui était avis [317] que Notre-Seigneur lui avait
donné un estomac tout nouveau pour supporter de tant parler, ce qui lui était
pénible et nuisible. Elle eut la consolation qu'elle avait et désirée et demandée
à Dieu, de conférer amplement de son intérieur à Monseigneur de Sens, et par
cette conférence, elle demeura paisible et toute soulagée de ses peines
intérieures ; Dieu voulant que la fin de sa vie, après tant de travaux et
furieux combats, se finît par sa grâce, dans une paix amoureuse et victorieuse.
Comme si elle eût prévu le temps de son prochain départ de cette vie, elle se
fit instruire par Monseigneur l'archevêque de Sens de la façon avec laquelle
elle se devait disposer à son dernier passage, et pour commencement de
préparation fit une revue générale de toute sa vie et de toute son âme devant
ce digne prélat, qu'elle honorait parfaitement. Nous n'en disons pas davantage,
parce que nous verrons le surplus de leur conférence avec beaucoup plus de satisfaction
dans le récit que Monseigneur de Sens a pris la peine d'écrire à notre chère
Mère de Blonay des vertus de cette Bienheureuse Mère.[67] [318]
Elle arriva en notre monastère de Nevers, qui reçut la bénédiction
qu'elle ait écrit sur leur livre les derniers renouvellements de ses vœux, le
jour de la sainte Présentation de Notre-Dame au Temple, selon notre coutume. Le
24 et le 25 de novembre, elle se trouva fort mal, ce qui fit dire aux médecins
que c'était un messager de la mort ; pour cela elle ne prit pas seulement
un jour de relâche ni de repos ; car le 26 elle fut levée dès les cinq
heures et demie, pour aller faire son oraison au chœur avec la communauté.
Lorsque nos chères Sœurs lui voulurent témoigner de l'appréhension, elle leur
dit : « Mes filles, il faut toujours vouloir ce que Dieu veut, et
mourir quand il lui plaira. » Elle ajouta qu'elle n'aimait point qu'on
s'empressât pour la servir, et qu'elle ne voulait point souffrir que l'on
cherchât des délicatesses ni des choses exquises, disant : « Pauvreté,
humilité, simplicité, voilà nos règles. »
Elle venait de Saint-Germain, où la reine lui avait fait de grandes
faveurs ; de Paris, où chacun l'avait honorée comme une sainte, elle n'en
parlait pas un seul mol ; que si on l'interrogeait, elle semblait n'y
avoir pas pris garde ou ne s'en plus souvenir, et ses discours n'étaient que
feu et ardeur pour la parfaite observance, surtout pour l'amour mutuel et pour
l'esprit d'humilité. Elle témoigna à nos chères Sœurs de Nevers qu'elle était
fort fâchée de ce qu'elles chantaient parfois les litanies dans le chœur à
quatre parties en musique, leur disant que c'était contre l'humilité pour nous
autres pauvres filles de Sainte-Marie, parce que cela avait de l'éclat et
attirait le peuple à l'admiration des belles voix. Elle témoigna aussi à ces
chères Sœurs de Nevers (qui nous l'ont mandé avec une sainte franchise) un
regret sensible qu'elles eussent fait le portail de leur église un peu trop
beau, et les pria de mander à toutes les maisons qu'elles avaient failli en
cela, afin que personne n'y prît exemple, leur disant souvent : « Il
faut tant aimer, avec notre Bienheureux Fondateur, la pauvreté et simplicité de
vie ! Cette belle apparence est contre ces bénites vertus. » Elle
leur disait aussi de fort bonne grâce : « Si c'était chose qui se pût
faire, et qu'il se trouvât quelqu'un qui voulût acheter ce portail, il le
faudrait vendre. » Elle trouva dans notre monastère de Nevers une de nos
chères Sœurs qu'on avait rappelée de notre maison de La Châtre, parce qu'elle n'y
pouvait rendre les services pour lesquels elle avait été envoyée en cette
Fondation, étant devenue percluse de son corps, en sorte que l'on n'avait pas
espérance de la voir jamais marcher. Cette Bienheureuse Mère la guérit, comme
nous dirons en un autre lieu. Quoiqu'elle fît son possible pour cacher cette
merveille, elle éclata néanmoins aux yeux de tous.
Notre chère Sœur la supérieure de Nevers, prenant congé de cette
Bienheureuse Mère, lui dit : « O Dieu ! ma Mère, faut-il penser
que je ne reverrai plus Votre Charité en ce monde ? » Elle l'en
reprit, lui disant « qu'il fallait servir Notre Seigneur avec un grand et
généreux dégagement, et ne point avoir de bornes en nos dépouillements. »
« Ma fille, lui dit-elle encore, vous m'avez dit une parole de tendresse ;
je me souviens que notre Bienheureux Père, en quelque rencontre de séparation,
qu'il allait d'un côté et moi de l'autre, ne voulut pas me souffrir de lui dire
que nous serions longtemps sans nous voir, et que cela me faisait peine. Il me
dit, ce Bienheureux : Ma Mère, il faut adorer les dispositions de Dieu sur
nous, et aller où il nous appelle, sans autre vouloir que l'accomplissement de
sa volonté. »
CHAPITRE XXXII.
de son heureux décès.
Enfin, rien n'est permanent sous le soleil, et les plus belles vies
trouvent leurs termes lorsque l'on s'y attend le moins. Notre digne Mère, qui
venait de faire dans Paris un cours, où elle avait paru comme un soleil en
sainteté, à peine fut-elle arrivée à Moulins, qu'elle eut des indices qu'elle
était dans son occident, et qu'il se fallait coucher dans le lit de la mort,
qui ne fut pas imprévue pour être inopinée. Il y avait plus de quarante années
qu'elle l'attendait de pied ferme par une soigneuse pratique de toutes vertus,
mais elle s'y voulut encore disposer par des pratiques sérieuses. Pour cela,
sentant ses approches, le samedi, 7 décembre, veille de l'Immaculée Conception
de la Mère de Dieu, quoiqu'elle fût fort lasse et accablée, elle alla au
réfectoire, à genoux, pendant la collation des Sœurs, et les bras en croix, à
l'imitation de l'ardent Apôtre des Indes, elle répéta deux fois ces
paroles : « O Mater Dei ! mémento mei[68] ; » puis elle ajouta en français : « O très-sainte Mère
de Dieu ! par votre Immaculée Conception, souvenez-vous de m'assister
toujours, mais spécialement à l'heure de ma mort. » Elle employa une
partie de la récréation du soir à parler, selon sa coutume, des choses utiles
et saintes, avec madame la duchesse de Montmorency.
Le soir, environ les neuf heures, elle se mit en devoir de traverser
une grande cour pour aller de sa chambre aux [321] infirmeries consoler une
Sœur malade qui craignait la mort ; mais comme on ne le lui voulut pas
permettre, elle y envoya ma Sœur la supérieure avec des paroles de confiance en
Dieu, puis tirant un profond soupir : « Hélas ! dit-elle, que
nous aurons d'affaires à cette heure de la mort, et moi la
première ! » Le lendemain, elle était levée à son ordinaire des
premières de la maison, comme la plus ardente en la quête de l'Époux que l’âme
cherche en la sainte oraison ; quand elle eut commencé la sienne, le froid
de la fièvre la prit ; elle ne laissa point pour cela de continuer sa
prière, et après Prime, alla trouver la Sœur malade à l'infirmerie, lui parla
autant qu'elle voulut, quoique le froid de la fièvre s'augmentât. On voulait
qu'elle se couchât, ou du moins qu'elle communiât avant la communauté, pour
éviter la longueur et le froid. « Non, non, dit-elle gracieusement, je
n'ai besoin que de demeurer ici auprès de Dieu, en recueillement avec mon petit
livret en main » (c'était un recueil qu'elle avait fait des principales
instructions que notre Bienheureux Père lui avait données pour sa conduite
intérieure). « Hélas ! dît-elle encore, laissez-moi ce contentement
de communier avec la communauté ; ce jour m'est bien particulier, car il y
a aujourd'hui trente-un ans accomplis que, par le commandement de notre
Bienheureux Père, je communie tous les jours, indigne que je suis de cette
grâce. » Elle fut donc au banquet sacré, avec la communauté, mais à peine
la messe fut finie, qu'il la fallut mettre au lit. Le médecin de madame la
duchesse de Montmorency fut soudain appelé, qui jugea que ce n'était que la
fièvre de rhume ; mais sur les quatre heures du soir, il changea de
langage et assura que ce serait une fièvre dangereuse avec inflammation de
poitrine.
Ce serait ici faire trouver place aux superfluités que nous voulons
éviter de tout notre pouvoir, si nous disions que l'on n'épargna rien pour
soulager cette précieuse malade, et qu'on [322] lui appliqua tous les remèdes
dont on se put aviser, puisque même la digne madame de Montmorency offrit à
Dieu sa vie pour sauver celle de la malade. La bonne Mère de Musy, pour lors
Supérieure, alla faire la même offrande de la sienne et de celles de toutes ses
filles, par leur consentement. Mais Dieu est un maître souverain, il veut ce
qu'il veut, et à lui seul appartient de vouloir. On exposa le Saint-Sacrement
dans notre monastère pour les quarante-heures. Toutes les maisons religieuses
de Moulins se mirent en prières. On eut recours à quantité d'aumônes, de vœux,
de messes que l'on faisait dire en diverses églises, et Dieu voulut que les
ailes de cette colombe qui s'élançait vers les contrées éternelles, fussent
plus fortes pour l'emporter au ciel que toutes les puissances qu'on employait
pour la retenir en la terre, et toujours son mal croissait, la conduisant à son
vrai bien. Le mardi matin, elle dit à notre chère Sœur Jeanne-Thérèse qui la
servait et accompagnait, qu'elle allât communier et faire des bons actes de
résignation à la volonté de Dieu, lui signifiant bien qu'il fallait se séparer.
À une heure après minuit de son quatrième jour, l'oppression
s'augmentant fit juger au médecin qu'il n'y avait plus d'espérance, et ordonna
qu'on lui donnât le saint Viatique. Madame de Montmorency, qui ne bougeait
presque jour et nuit de la chambre de cette digne Mère, fondant en larmes, la
conjura de prendre des reliques de notre Bienheureux Père ; elle lui
répondit : « Madame, je le veux bien, puisque vous le voulez, mais si
ce n'était pour l'amour de vous, j'y aurais un peu de répugnance. »
Condescendant donc, elle prit très-révéremment ces saintes reliques, par
l'application desquelles elle avait guéri tant d'autres malades, et dit tout
haut les mains jointes : « Mon Dieu, si c'est votre volonté et votre
plus grande gloire, pour la consolation de ma chère Madame, donnez-moi la santé
par les intercessions de notre Bienheureux Père. » Puis elle [323]
dit : « Je ne crois pas qu'il me veuille guérir. » Mais, apercevant
que cette parole attendrissait grandement toute l'assemblée, elle ajouta :
« Il faut pourtant espérer possible que notre Bienheureux Père fera
quelque chose en faveur de ma chère Madame. » Témoignant bien par là son
indifférence parfaite à mourir ou à vivre. Sur les quatre heures de ce même
matin, elle fit une revue de sa conscience, et se confessa au révérend père de
Lingendes, recteur de la sainte Compagnie de Jésus, qui l'assista en ce dernier
passage ; Dieu l'ordonnant ainsi pour la rendre plus conforme à notre Bienheureux
Père, qui fut aussi assisté à la mort par un père de cette même Compagnie.
Après cette revue de sa conscience, elle fit appeler Monsieur notre confesseur,
qui était avec elle en voyage, et notre chère Sœur sa compagne, pour leur
parler pour la dernière fois, les chargeant d'écrire de sa part son adieu à
cette communauté d'Annecy, et qu'elle nous conjurait de vivre en grande union
et amour réciproque, conservant la sincérité et simplicité de l'esprit de
l'Institut ; que surtout l'on se gardât de l'ambition des charges ;
que Dieu doit suffire pour toutes choses.
Cette digne Mère, qui avait toujours tant aimé le bon ordre de la
maison de Dieu, n'avait pas voulu qu'on lui apportât le Saint-Sacrement avant
le lever de la communauté. Entendant sonner le réveil, elle se disposa à
recevoir ce Pain de vie par des actes d'humilité sincère, demandant pardon à la
communauté de l'avoir, disait-elle, mal édifiée, et qu'elle n'avait point
d'autre regret que de n'avoir pas bien observé ses règles. Le Saint-Sacrement étant
présent, on lui dit quelques paroles selon l'ordre de la sainte Église,
touchant la foi de cet auguste sacrement ; alors l'ardente flamme de son
amour faisant un sacré effort, malgré l'oppression de poitrine et la faiblesse
où l'avait réduite une ardente fièvre continue, elle éleva sa voix, et, d'une
parole vive et forte, elle dit : « Je crois fermement que mon
Seigneur Jésus-Christ est au très-saint Sacrement de [324] l’autel, je l'y ai
toujours cru et confessé, je l'y adore et reconnais pour mon Dieu, mon
Créateur, mon Sauveur et Rédempteur, qui m'a racheté de son précieux
sang ; je donnerais de bon cœur ma vie pour cette créance, mais je n'en
suis pas digne ; je confesse que je n'attends mon salut que de sa seule
miséricorde. » Après la sainte communion, elle dit avec grande
ferveur : « Mon Père, tandis que j'ai le jugement sain, je vous
demande de tout mon cœur les saintes huiles, vous suppliant de me les donner
quand il en sera temps. » Ce même jour, une partie de la matinée, elle conféra
avec le révérend père de Lingendes, sur le sujet de la lettre qu'elle désirait
écrire pour la dernière fois à toute notre Congrégation. Ce bon père admirait
sa grande présence d'esprit et la solidité de son jugement dans une si grande
fièvre et oppression ; il l'entretint fort longtemps de la soumission que
l'âme doit à la volonté de Dieu, à quoi la malade contribuait, donnant
témoignage que ce discours-là lui plaisait grandement.
Sur le soir, on la supplia d'agréer qu'on lui apportât la sainte
Communion, soudain la minuit passée, à cause de sa faiblesse, et, qu'ayant
communié pour Viatique, il fallait communier à jeun ; elle fit réponse
qu'il ne fallait pas faire ce remuement la nuit, puisqu'elle avait reçu le
saint Viatique, et qu'elle était indigne de la grâce qu'elle avait de communier
tous les jours. Elle se priva donc humblement pour se soumettre à Dieu, à son
infirmité et à la tranquillité de la nuit et du silence monastique, de la
Communion ce jeudi-là, qui était son cinquième jour. Le médecin lui fit prendre
quelques remèdes extraordinaires, et par son ordre, elle obéit, nonobstant les
fortes agitations du mal, à demeurer deux grandes heures sans se remuer. Dans
ce repos, son mal s'augmenta, et on lui demanda s'il ne faudrait pas lui donner
les saintes huiles : « Non, pas encore, dit-elle, il n'y a rien qui
presse, je suis encore assez forte pour attendre. » Sur les deux heures
après midi, elle s'assit sur [325] son lit, et d'un visage serein, d'un œil
ferme et d'une parole assez forte, qui donnait quelque espérance de guérison,
elle fit écrire à toutes nos maisons son adieu et les saintes instructions
d'humilité, simplicité, observance et parfaite union qu'elle nous a laissées
comme son testament maternel. Après que l'on eut transcrit cette lettre au net
et qu'elle l'eut signée, elle dit que sa conscience était en extrême paix, et
qu'elle n'avait plus rien à dire. La promptitude de cet esprit ardent
affaiblissait toujours la chair infirme de cette digne Mère, laquelle après ce
travail s'assoupit un peu ; puis s'éveillant et croyant d'avoir parlé en
dormant, et que madame la duchesse de Montmorency fût à son accoutumé au chevet
de son lit, elle dit : « Madame, m'avez-vous entendue ? »
On lui dit qu'elle était allé souper au réfectoire. « Laissez-la,
dit-elle, c'est que je la voulais entretenir du petit repos que j'ai pris en
Dieu. » Prenant occasion de cette absence, elle parla à nos Sœurs de
l'obligation qu'elles avaient à Dieu d'avoir appelé parmi elles cette vertueuse
princesse, qu'elles la devaient grandement honorer et chérir. Sur cela elle
revint du réfectoire, et la malade lui dit : « Ma chère Dame, je vous
ai entretenue en esprit, mais ce sera demain, Dieu aidant, que je vous en dirai
davantage. » Car sur le soir elle était plus oppressée.
Cette nuit-là, qui fut la dernière de sa vie, ne pouvant point reposer,
elle se fit lire l'épitaphe de saint Jérôme sur la mort de sainte Paule, à quoi
elle donna une attention merveilleuse, et répéta plusieurs fois :
« Oui sommes-nous, nous autres ! nous ne sommes que des atomes auprès
de ces grandes et saintes Religieuses. » Elle se fit aussi lire le
chapitre du décès de notre Bienheureux Père, pour se conformer à lui aussi bien
à la mort qu'à la vie. Madame de Montmorency était proche d'elle lorsqu'on lui
lisait le chapitre du livre neuvième de l'Amour de Dieu, où notre Bienheureux
Père dit : « Ma Mère ou moi, car c'est tout un, sommes malades, je
dois être indifférent [326] en la volonté de Dieu, que le mal surmonte
les remèdes ou les remèdes le mal. » Elle regarda bénignement cette vertueuse dame qui pleurait chaudement,
et lui serrant amoureusement la main : « Voilà qui est pour vous,
Madame », lui dit-elle, ajoutant plusieurs paroles pour la porter à une
parfaite résignation, avouant que Dieu l'avait tellement unie à son cœur, que
nonobstant les longs désirs qu'elle avait eus de la mort, de bon cœur elle eût
accepté de vivre encore quelque temps pour le service et contentement de cette
grande âme, que la douleur où elle la voyait de sa séparation la faisait plus
souffrir que son mal. » Le reste de la nuit, elle se fit lire, dans les
Confessions de saint Augustin, la mort de sainte Monique, et comme l'on fut à
la remarque que fait saint Augustin, que sainte Monique ne se souciait point de
mourir hors de son pays, elle dit : « Voilà qui est pour
nous ; » témoignant être indifférente de mourir hors du monastère de
sa profession. Environ les quatre heures du matin, on lui demanda en quel état
elle était, elle répondit : « La nature rend son combat et l'esprit
souffre. » Fort peu de temps après, pour tenir sa promesse, elle entretint
en particulier madame la duchesse environ une heure et demie ; elle donna
sa bénédiction, par obéissance, à toutes ses filles tant absentes que
présentes, spécialement pour celles de cette communauté d'Annecy. Tout au long
de sa maladie elle observa avec une grande rigueur le document de ne rien
demander ni rien refuser, obéissant avec tant de rigueur à tout ce que le
médecin ordonnait de prendre ou s'abstenir, qu'il en était dans une profonde
admiration, de quoi s'apercevant elle lui dit : « Monsieur, il nous
est ordonné d'obéir au médecin. »
Environ les huit heures du matin, le vendredi, elle demanda le révérend
père de Lingendes, par qui elle désirait être assistée en son dernier passage.
Elle l'entretint fort longuement en particulier, lui faisant un narré de toute
sa vie, et en particulier de son état présent, lui demandant s'il lui fallait
rien changer [327] pour se disposer à la mort. Elle lui dit que Dieu l'avait
mise en un état de repos, de simplicité et de confiance en sa bonté pour ne
rien vouloir que son bon plaisir ; que notre Bienheureux Père et quelqu'un
de Messeigneurs les prélats l'avait affermie en cette voie. Le bon père la
confirma dans sa paix, et elle lui déclara ce qui était dans le sachet qu'elle
portait pendu à son col, le suppliant de le lui faire tenir entre les mains
lorsqu'elle serait en l'agonie, et qu'il fût enseveli avec elle. Se sentant
affaiblir, elle supplia le père de lui donner les saintes huiles, lesquelles
elle reçut avec tant de ferveur d'esprit qu'elle répondit elle-même à toutes
les prières ; cette action finie, le père à genoux devant le lit la
supplia de donner sa bénédiction à lui et à toutes ses filles pour toutes
celles de son Institut. Elle s'en excusa humblement, le suppliant que plutôt il
la bénît, ce qu'il fut contraint de faire ; mais aussi par la force de
l'obéissance il contraignit son humilité, et, les mains jointes et les yeux
levés au ciel, elle dit : « Mes chères filles, voici donc la dernière
fois que j'ai à vous parler, puisque telle est la volonté de Dieu ; je
vous recommande de tout mon cœur de rendre un grand respect et obéissance à vos
Supérieures, regardant Notre-Seigneur en elles ; soyez parfaitement unies
les unes avec les autres, mais de la véritable union des cœurs » ;
répétant plusieurs fois ces paroles : mais de l'union des cœurs. « Vivez
dans une grande simplicité et conservez l'intégrité de la parfaite
observance ; par ce moyen, vous attirerez sur vous les bénédictions de la
miséricorde divine, que je supplie se vouloir répandre sur toutes les filles de
la Visitation. » Après avoir donné sa bénédiction, elle dit encore à la
communauté : « Mes filles, ne faites nul état des choses de cette vie
qui passe ; pensez souvent que vous vous trouverez un jour au même état où
vous me voyez à présent ; qu'il faudra rendre compte à Dieu de toutes vos
pensées, paroles et actions. Ne faites estime que de ce qui peut servir à votre
salut et perfection. » [328]
Le révérend père recteur, qui voyait nos chères Sœurs toutes fondues en
larmes, ne put s'empêcher de pareil attendrissement dans une action si
généreuse d'une part et si douloureuse de l'autre, et craignant que la malade
s'affaiblît trop en continuant de parler avec une si grande ardeur, il dit aux Sœurs
de se retirer. « Il est donc temps de se séparer, dit-elle, mes filles, et
de se dire le dernier adieu. » Toutes, rang par rang, s'approchèrent
d'elle pour lui baiser la main, et elle les regardait d'un vrai œil maternel,
leur disant à toutes à l'oreille, un mot pour leur perfection. Après qu'elle
eut parlé à toutes les Sœurs, le révérend père recteur la supplia de lui dire
quelque chose pour son propre profit ; elle lui répondit avec grande
humilité, et lui fit des remerciements pour le général et le particulier de
leur sainte Compagnie, surtout de la peine qu'il prenait de l'assister en sa
dernière journée ; il se mit à genoux, et lui baisa révéremment la main
avec une haute estime de sa sainteté. Dès lors, cette sainte mourante ne parla
que de Dieu, ne pensa qu'en sa bonté, et regardait de moment en moment l'image
du Crucifix et celle de Notre-Dame-de-Pitié, qui était proche d'elle ; de
temps en temps, le père recteur lui parlait de quelque chose sainte, et faisait
des prières qu'elle se mettait toujours à répondre avec lui. Elle écouta avec
une admirable attention la lecture de la Passion de Notre-Seigneur, en
français, et la profession de foi selon le Concile de Trente, à la fin de
laquelle elle protesta qu'elle croyait cela si fermement, qu'elle eût voulu
mourir pour le soutenir ; elle disait de fois à autres : « Maria,
Mater gratiœ, etc.[69]« Elle supplia le père de lui faire la
recommandation de Tàrne, et lorsqu'il fut aux oraisons, elle [329] lui annonça
qu'il les redirait plusieurs fois ; ce qui fut vrai, car son agonie fut
longue ; et une fois, le père disant ces oraisons en français, elle
s'écria : « Jésus, que ces oraisons sont belles ! » Elle
témoigna désirer d'être un peu seule et en repos, mais quasi tout soudain, elle
fit rappeler le père et lui dit : « O mon père ! que les
jugements de Dieu sont effroyables. » Le père lui demanda si cela lui
faisait de la peine : « Non pas, dit-elle, mais je vous assure que
les jugements de Dieu sont bien effroyables !... »
Le médecin l'étant venu voir, elle le remercia fort cordialement de
tous ses soins, et qu'elle n'avait plus besoin que de ses prières. Il voulut
lui faire prendre d'une gelée fort excellente, elle s'en excusa, disant que
c'était chose perdue, que cela ne servait plus de rien, et en demanda l'avis du
père recteur, qui répondit qu'il fallait prolonger sa vie pour en employer tous
les moments à glorifier Dieu ; dès lors, elle continua à prendre, sans
dire mot, tout ce que l'on voulut. Il lui dit encore que, comme Dieu avait
inspiré en nous l'esprit de vie, aussi venait-il à notre mort retirer à lui
l'esprit et l'âme qu'il avait infusée en nous. Cela la fit tressaillir d'aise.
« Ah ! dit-elle, que cette pensée est douce ! » Il lui
demanda si elle n'espérait pas que notre Bienheureux Père, avec nos Mères et
Sœurs décédées, lui viendraient au-devant. Elle répondit, avec une grande
assurance : « Oui, je m'y fie, il me l'a ainsi promis. » Elle
renouvela solennellement ses vœux selon le formulaire de nos professions, après
quoi l'on vit son visage tout en feu et son corps en diverses agitations. Le
révérend père lui demanda si elle voulait qu'on lui apportât une mitre de notre
Bienheureux Père, qui est gardée dans notre maison de Moulins comme une
précieuse relique : « Non, dit-elle, si c'est pour ma santé ou pour
mon soulagement. » Mais le père lui dit : « C'est afin que la
volonté de Dieu s'accomplisse en vous » ; alors elle la baisa
révéremment et une image de Notre-Dame de Montaigu. Dès ce [330] temps-là, ses
inquiétudes se passèrent, et sa fièvre s'augmenta violemment. L'on fit rentrer
la communauté, pour refaire encore la recommandation de l'âme ; elle prit
en sa main droite le crucifix, et en la gauche le cierge bénit, pour aller
ainsi parée au-devant de son Bien-aimé. Le père de Lingendes lui dit « que
ces grandes douleurs qu'elle souffrait étaient les clameurs qui précèdent la
venue de l'Époux ; qu'il venait, qu'il s'approchait, et si elle ne voulait
pas lui aller au-devant. » « Oui, mon père, dit-elle distinctement,
je m'en vais. Jésus, Jésus, Jésus ! » Par ces trois mots de vie, avec
trois doux amoureux soupirs, elle acheva de mourir, pour commencer de vivre et
de paraître en la vraie vie, avec Jésus en gloire. Elle expira en même temps
que le père recteur prononçait ces paroles : « Subvenite, sancti, etc., »
le 13 décembre 1641, entre les six et sept heures du soir, âgée de près de
soixante-dix ans, desquelles elle en avait passé neuf vivant saintement en
l'état de viduité, et trente et un en l'état monastique, où elle est décédée
selon son souhait, en la condition de simple inférieure sans charge, et tenant
le dernier rang. Sur quoi, selon la parole de Jésus-Christ, nous concluons
qu'elle est grande au Royaume des cieux.
CHAPITRE XXXIII.
des honneurs qu'on à
rendus à sa mémoire.
L'âme de cette bonne et loyale servante étant entrée en la joie de son
Seigneur, nous laissa avec des douleurs qui sont encore trop récentes pour être
renouvelées. Le béni corps, qui avait logé une si digne hôtesse demeura si beau
après sa mort, que l’on ne pouvait se lasser de le voir. La mort ne changea
point son visage, il demeura dans cette grande sérénité qu'il avait durant sa
vie. Toutes les Sœurs vinrent, l’une après l'autre, baiser le saint nom de
Jésus, qu'elle avait elle-même gravé sur son cœur. Il était de la hauteur d'un
pouce, bien formé, excepté l’S, qui n'était pas bien achevé. La croix
était du côté d'en bas, sans doute pour signifier qu'elle était crucifiée à
tout ce qui est de ce monde, et qu'en sa partie inférieure même le monde lui
était crucifié. Le père trouva le petit sachet qu'elle avait recommandé, bien
cousu, et sur icelui une image de la sainte Vierge, tenant son divin Fils, et
dedans, la grande protestation de foi écrite de sa main et signée de son sang,
puis des vœux, prières et abandonnement d'elle-même entre les mains de Dieu. On
tira copie de tout, puis on le remit sur sa poitrine, selon son désir, avec
quelques reliques.
Le lendemain matin, on exposa, selon notre coutume, ce béni corps au
chœur, où toute la ville accourut avec tel témoignage d'estime de sa sainteté,
que, pour contenter le peuple, il fallut approcher le corps de la grille, pour
laisser ce [332] contentement à leur dévotion de faire toucher leurs chapelets
et autres choses. Tous les convois de la ville des Religieux et des paroisses
allèrent, chacun à part, en diverses heures, chanter des De profundis et
des Libera en l'église de nos Sœurs. Messieurs les chanoines de la
collégiale de Notre-Dame y vinrent avec une fort bonne musique. Les révérends
pères Jésuites tendirent leurs autels de noir, et dirent tous leur messe pour
la défunte, qu'ils invoquaient en leur cœur, et d'une voix commune, l'on disait
par la ville qu'il était mort une Sainte à Sainte-Marie.
Madame de Montmorency nous voulant garder cette fidélité de nous rendre
au moins morte celle que nous lui avions prêtée vivante, mit ordre de faire
ouvrir et embaumer son corps ; ce fut en cette ouverture que l'on vit la
cause de sa mort, ayant trouvé le poumon tout gâté, de mauvaise couleur et
plein, du côté gauche, d'un sang pourri et purulent ; son foie, son cœur
et ses autres parties nourricières se trouvèrent fort saines, et les
chirurgiens ont attesté n'avoir jamais vu un cerveau si sain ni une tête si
bien faite, et qu'il ne se fallait pas émerveiller si elle avait le jugement si
bon et l'esprit si bien composé. Le corps fut embaumé, et l'on se diligenta le
plus qu'on put, crainte de quelques difficultés qui n'eussent pas manqué, si la
ville de Moulins n'eût voulu témoigner en cette occasion son amour de
soumission et de respect à madame de Montmorency, qui, faisant céder tous les
intérêts de l'inclination qu'elle avait de garder ce précieux dépôt, à la
justice qui voulait qu'il nous fût rendu, prit elle-même le soin de ce renvoi,
fit mettre le corps dans une châsse de plomb, et celle-là dans une de sapin,
garnie de fer, pour être plus portable ; on la plaça dans un carrosse
couvert d'un grand drap de mort. M. Marcher, notre confesseur, et M. Aviat,
confesseur de notre maison de Moulins, avec quelques officiers de madame la
duchesse, l'accompagnaient, et d'autant que l'on ne tenait pas ce trésor bien
assuré tandis qu'il serait [333] sur les terres de France, on revenait le plus
promptement et le plus secrètement que l'on pouvait dans les lieux qui eussent
pu donner quelque arrêt, à la grande mortification de nos chères Sœurs de Lyon,
qui apprirent que le propre jour de Noël l'on avait passé dans la ville ce béni
corps, sans oser, pour de bonnes raisons, l'arrêter tant soit peu. On le fit
reposer à Montluel, petite ville, où nos pauvres Sœurs de Saint-Amour sont
réfugiées depuis que le malheur des guerres les a chassées de leur maison. Là,
tout ce bon peuple accourut en foule, et nos bonnes Sœurs passèrent la nuit à
l'entour de cette chasse, croyant bien que dès là, ou n'avait rien à craindre.
M. Marcher avertit nos Sœurs de Belley de la précieuse relique qu'il menait
reposer chez elles. Dès que ce bruit fut épanché par la ville, presque toutes
les maisons coururent en notre monastère, apportant des cierges et flambeaux
pour les allumer autour du corps. En moins de deux heures, l'église fut tendue
de noir, et la piété de Monseigneur l'évêque de Belley fut si grande, qu'à
l'imitation de saint Épiphane, il sortit vêtu pontificalement avec tout son
clergé et la musique, pour recevoir et introduire en sa ville cette nouvelle
Paule de notre siècle, rendant des honneurs et témoignages d'estime dignes de
sa piété et de la sainteté de celle qu'il vénérait.
Ce corps, ainsi porté magnifiquement chez nos Sœurs, fut entouré de
tant de lumières, que l'on eût dit qu'il y avait plusieurs chapelles ardentes.
Elles restèrent gardiennes de ce dépôt jusqu'au lendemain que Monseigneur
revenant derechef avec son clergé, Monsieur son théologal fit un très-beau et
docte discours des vertus de notre Bienheureuse. L'on dit une messe solennelle,
et enfin tous virent avec regret sortir de leur ville le trésor qu'ils n'y
pouvaient pas retenir, et qui fut reçu à Saint-Rambert, Seyssel et Rumilly,
selon la petitesse des lieux, avec la même révérence et dévotion. À Seyssel, il
reposa en l'église des bernardines, où la chère Mère de Ballon, première
supérieure de [334] cette sainte réforme, donna, avec toute sa
communauté, des marques véritables de sa parfaite dévotion envers cette
Bienheureuse Mère, avec laquelle elle avait eu une grande union de cœur. Nos
Sœurs de Rumilly, avec une dévotion de vraies filles, passèrent la nuit autour
de cette chasse, et avaient tendu leur église de noir couvert de larmes
blanches.
Enfin, le 30 décembre, ce béni corps aborda cette ville ; il fut
posé en l'église du Sépulcre, où Monsieur le doyen, avec les chanoines de sa
collégiale, l'allèrent prendre ; et accompagné de la foule du peuple, on
nous apporta ce béni dépôt. Ce fut chose vraiment remarquable, qu'au même
instant que le corps entra dans le monastère, nos pauvres cœurs, qui depuis la
nouvelle de notre perte, avaient été si oppressés de douleur, que nous ne
pouvions nous voir à paupières sèches, furent tous universellement saisis d'une
certaine joie intérieure, et d'une certaine certitude spirituelle si grande de
la gloire de l'âme de celle qui nous rendait son corps, que cela sécha nos
larmes, et nous ne pouvions que redire ces mots : « Oh ! qu'elle
est avant dans le ciel, et que nous sommes heureuses d'avoir une telle avocate
devant Dieu ! » Ce sentiment n'a pas été particulier à notre
communauté, mais commun à toutes celles de notre Institut ; et nous
apprenons par les lettres que nous recevons de nos monastères, qu'à la nouvelle
douloureuse de ce décès, leurs cœurs étaient également en douleur de notre
commune et irréparable perte, et en suavité et en confiance, par un sentiment
universel de la gloire de cette Bienheureuse âme ; du soin qu'elle aurait
auprès de Dieu, de ses filles et de fous ses dévots. Il n'est pas besoin de
dire que nous lui avons rendu nos derniers devoirs comme à notre première Mère,
avec les oraisons funèbres, grand'messe en musique et autres témoignages de
notre estime, autant que l'a pu souffrir la simplicité qui doit reluire en
toutes nos actions. Presque toutes nos maisons en ont fait de même, comme il se
voit par le grand nombre [335] d'oraisons, plutôt panégyriques que funèbres,
que l'on nous a cordialement communiquées, tant imprimées qu'en manuscrit.[70]
Nous savons de science certaine que deux des grands et saints
serviteurs de Dieu qui soient au monde l'ont vu monter en gloire, l'un comme
une humble épouse qui se présentait la croix en main pour être reçue par son
Bien-aimé au festin nuptial ; l'autre comme un globe lumineux qui se
joignait à un autre globe (et c'est notre Bienheureux Père), et, ainsi joints,
ces deux globes entraient et s'abîmaient dans le grand globe éternel.[71] Nous savons, de même certitude, que trois
autres âmes [336] dignes de foi l'ont vu en esprit dans l'état de la gloire, au
propre jour de son décès, qu'elles ne savaient en façon quelconque, étant bien
éloignées du lieu où il arriva.
Ce n'est pas de notre seul mouvement que, soudain après le décès de
cette digne Mère, nous lui avons donné le nom de Bienheureuse, c'est le
mouvement de la voix publique ; et les personnes de grande doctrine,
dignité et piété, qui nous ont vues réservées en ce point, nous ont dit de ne
point craindre ; que si bien quelques esprits critiques en disent quelque
chose, il ne faut pas laisser d'honorer celle que Dieu a tant voulu [337]
honorer, et qui a honoré Dieu par une si longue et sainte vie. Ce nous a été
une grande consolation que la louange soit plutôt venue du dehors que de
nous-mêmes pour cette Bienheureuse Mère, et ce serait entreprendre de faire parler
ici toutes les voix de la renommée, que de rapporter toutes les louanges qu'on
lui donne. Nous gardons les lettres de plusieurs de Messeigneurs les évêques,
des abbés, des provinciaux d'Ordres, des supérieurs, des religieux, des
seigneurs de justice, des grandes et vraies servantes de Dieu ; tous,
d'une mutuelle dévotion, la nomment Bienheureuse, demandent de ses reliques et
l'invoquent en leur particulier. Mais, parce que celui-là est véritablement
digne de louange qui est loué de Dieu, je dirai ici une [338] chose qui arriva
à un très-grand et bon serviteur de Dieu : invoquant en sa messe notre
Bienheureux Père, il fut arrêté et ne sut passer outre, et Notre-Seigneur lui
dit : Pourquoi n'invoques-tu pas ma fidèle Servante ? Lui
faisant voir que, lorsque l'on invoque notre Bienheureux Père, il faut
conséquemment invoquer la Bienheureuse, d'autant que ces deux saintes âmes
continuent en l'éternité, où est la consommation de la charité parfaite, de
n'être qu'un, comme, par union parfaite en ce monde, Dieu les avait unies.
Depuis cette vue, toute la communauté où est ce bon et dévot personnage s'est
également mise sous la protection du Bienheureux et de la Bienheureuse, et Dieu
commença à rendre ce mouvement commun ; car nous voyons que plusieurs de
ceux qui font dire des messes en notre église, en ordonnent une au Bienheureux
et une à la Bienheureuse, ou aux deux ensemble.
Le corps de cette Bienheureuse Mère repose présentement dans un petit
tombeau d'attente, jusqu'à ce que Dieu nous ait donné quelque moyen de bâtir
notre église et les chapelles pour ces deux Saints. Il est au long de notre
grille, tout vis-à-vis du tombeau de notre Bienheureux Père, qui est de l'autre
côté de l'autel, lequel est orné de ces précieux dépôts, comme l'arche, de ces
deux séraphins d'or très-pur. Ce qui a donné sujet à Monsieur le doyen de
Notre-Dame, notre Père spirituel, d'attacher en notre église ces vers
suivants :
Mise au côté du grand homme de Dieu
Qui par ses soins se la rendit pareille,
Tu vois, passant, en cet auguste lieu,
De notre temps la seconde merveille.
AUTRES.
De l'Institut qui fait profession
De délivrer
l'âme de passion,
Bien qu'elle
soit en faible corps enclose,
Le Père là, la
Mère ici repose. [339]
Nous savons bien que Dieu a déjà manifesté la gloire de son humble
servante par des grâces miraculeuses, mais nous laissons au temps à découvrir
ces merveilles, et nous concluons cette seconde partie de nos Mémoires par
une chose digne, ce nous semble, d'être laissée dans l'Institut à notre
postérité, pour faire voir qu'il n'y a point de tels liens que celui de la
charité qui unit les cœurs. Dès aussitôt que la nouvelle du décès de notre
Bienheureuse Mère fut épanchée par nos maisons, le jugement humain se vit
trompé en ce qu'il avait cru que, quand cette digne Mère aurait fermé les yeux,
cette grande union de pure charité et cordiale amitié qui avait tenu tous nos
monastères joints à celui-ci, se dissiperait ; car, après avoir rendu les
derniers devoirs à cette sainte Mère, pour montrer que ses intentions étaient
vivantes dans son Institut, presque tous nos monastères, les supérieures et les
communautés, ont envoyé ici des messagers exprès pour renouveler et renouer
leur union avec nous ; protestant, avec tant de véritable bonté, vouloir,
tout comme du vivant de nos Bienheureux Père et Mère, avoir en ce monastère,
dépositaire de leurs corps et de leurs intentions, leur recours, leur
confiance, leur union, leur communication, leur déférence ; ce qui nous a
souvent tiré des yeux les larmes d'une tendre consolation, et donné un grand
sujet de bénir Dieu, qui fait subsister ses ouvrages par sa seule grâce,
lorsqu'il retire à soi les ouvriers.
Ce qui nous donne aussi une grande espérance en sa bonté que, comme la
charité, est la vertu permanente à l'éternité, ayant fondé notre petit Institut
par la grande charité qui unit divinement les âmes de nos Bienheureux Père et
Mère pour la charité des faibles et infirmes, selon la douceur de la charité,
dans la charité de la communication, par une humble cordialité sans obligation ;
enfin, cette sainte charité nous pressera en nos communes observances, et nous
poussera toutes dans le sein de Celui qui est l'essentielle et éternelle
charité, [340] où nous croyons que vivent en unité parfaite nos Bienheureux
Père et Mère.
Reste donc à voir ce qui doit faire vivre cette Bienheureuse Mère dans
nos mémoires et dans notre imitation, à savoir la pratique des saintes vertus.
TROISIÈME PARTIE.
les pratiques de ses
héroïques vertus.
CHAPITRE PREMIER.
de la foi de notre
bienheureuse.
Ayant appris d'un grand, docte et pieux cardinal, que la foi est le
fondement de la sainte maison spirituelle, l'espérance les murailles, et la
charité le toit, il nous semble à propos de commencer le récit des vertus de
notre Bienheureuse Mère par la solidité de sa foi, d'autant que l'on jugera
plus facilement par après de la fermeté admirable de tout le bâtiment.
Irons-nous rechercher la grandeur de la foi de ses aïeux, tant
paternels que maternels, qui l'ont soutenue de leurs plumes, de leurs épées, de
leurs travaux, de leurs propres moyens ? Quelques-uns ont mieux aimé
perdre la vie que de gauchir tant soit peu en la Foi ni au soutien d'icelle, et
notre Bienheureuse Mère rendait tous les jours grâces à Dieu de ce que jamais
aucun de sa race, que l'on ait su, n'a été que très-bon catholique.
Nous avons montré ci-dessus comme Dieu avait tellement infusé le sacré
don de la Foi en l'âme de notre Bienheureuse [342] Mère, que, dès sa tendre
enfance, comme les innocents agneaux qui ne font que naître ont une peur
naturelle et une antipathie si irréconciliable avec les loups, qu'ils crient et
fuient voyant seulement leur peau, ainsi cette fidèle et aimable brebis du
sacré bercail de saint Pierre ne se savait pas encore connaître ni conduire
elle-même, qu'elle pleurait chaudement entre les bras de sa nourrice et se
cachait dans son sein, si quelques hérétiques, qui étaient alors en grand
nombre en France, la voulaient caresser.
Un jour, un des plus grands seigneurs du royaume étant chez M. le
président Frémyot, pour parler de quelque affaire d'État, de ce discours
politique ils descendirent au spirituel et s'échauffèrent des grandes questions
de controverses ; ce grand seigneur dont je parle était huguenot depuis
fort peu de temps, et disait que rien ne lui plaisait en sa religion prétendue,
que ce que l'on y nie la réalité du Saint-Sacrement. Notre Bienheureuse Mère,
qui n'était alors qu'une enfant de quatre à cinq ans, s'échappant de sa
gouvernante, qui la récréait à un coin de la grande salle où ces messieurs
discouraient, courut à ce grand seigneur et lui dit : « Monseigneur,
il faut croire que Jésus-Christ est au Saint-Sacrement, parce qu'il l'a dit.
Quand vous ne croyez pas ce qu'il a dit, vous le faites menteur. » Ce
seigneur fut extrêmement touché du discours de cette enfant, et la raisonna
longtemps. Elle donna toujours des réponses qui ravissaient la compagnie ;
enfin, ce seigneur lui voulut donner des dragées, mais l'aimable petite ne
voulut pas seulement les toucher, ains les prit avec son tablier et courut
agréablement les jeter au feu, disant : « Voyez-vous, Monseigneur,
voilà comme brûleront au feu d'enfer tous les hérétiques, parce qu'ils ne
croient pas ce que Notre-Seigneur a dit. »
Il semblait que cette petite épouse du Sauveur avait entrepris la
conversion de ce seigneur, car, contre son ordinaire de fuir [343] même avec
effroi tous les hérétiques, elle s'accosta avec celui-ci et lui dit une
fois : « Si vous aviez donné un démenti au roi, mon papa vous aurait
fait pendre. » (Elle ne savait pas encore l'honneur que l'on fait aux
gentilshommes de leur trancher la tête.) Puis elle ajouta (en lui montrant
un grand tableau de saint Pierre et de saint Paul) : « Vous
donnez tant de démenti à Notre-Seigneur que ces deux grands présidents-là vous
feront pendre. »
Étant devenue grande, nous avons dit ci-dessus qu'elle aima mieux
tomber en la disgrâce du baron, son beau-frère, que d'épouser un seigneur
hérétique, et protesta qu'elle élirait plutôt une obscure prison pour y passer
sa vie que la maison d'un ennemi de la foi, et dès son jeune âge elle a eu une
lumière de foi si vive et si pénétrante, qu'elle allait jusque dans les cœurs
et discernait par un véritable sentiment le croyant et le mécroyant. Combien de
fois nous a-t-elle raconté la peine qu'elle avait à retenir ses larmes quand
elle voyait par le Poitou les monastères et les églises que les hérétiques
avaient renversés, brûlés et profanés ! Elle nous dit une fois que
lorsqu'elle entendait chanter ce verset de Jérémie : Viœ Sion lugent, etc.,[72] elle se souvenait toujours des serrements de
cœur qu'elle avait eus, considérant les monastères et églises d'où l'exercice
de la sainte foi était banni et que personne ne fréquentait plus. Cette
Bienheureuse Mère, en ses vieux jours, se fit faire un cantique sur cette
première leçon de Jérémie, et disait : « Si j'eusse eu cette chanson
quand j'étais jeune, je l'aurais chantée tous les jours. »
Lorsque cette Bienheureuse Mère faisait sa demeure aux champs étant
mariée, et après étant veuve, elle avait mis ordre que les serviteurs de la maison
qui avaient meilleure voix apprissent le chant du grand Credo, pour
l'aider à chanter plus [344] solennellement à la messe paroissiale, à quoi elle
prenait un singulier plaisir ; et depuis étant religieuse, elle le faisait
quelquefois à la récréation, et on lui voyait un visage extraordinairement
suave en chantant et écoutant ces saintes paroles. Elle avait une dévotion
toute particulière aux saints martyrs, parce qu'ils ont donné leur sang pour la
foi, et aux saints des premiers siècles, parce qu'ils ont soutenu cette sainte
foi par leurs écrits et par leurs travaux, et quand venaient les fêtes de ces
grands saints des premiers siècles, c'était un proverbe entre nous de
dire : C'est un des saints de notre Mère. Elle ne se contentait pas
d'en ouïr lire la vie à table et d'en parler aux conversations, mais encore
elle faisait apporter quelquefois le livre en sa chambre pour les relire en son
particulier ; et en ses dernières années, elle fit acheter la Vie des
Saints en deux tomes, pour la tenir en sa chambre, et avait marqué la vie de
ces grands saints et premiers piliers de l'Église, qu'elle lisait avec une
dévotion admirable. Elle avait une spéciale dévotion à saint Spiridion, qui
captiva la raison d'un subtil philosophe par le symbole de la foi.
Elle savait par cœur l'hymne de saint Thomas, Adoro te devote, etc.,
et la disait souvent, et la fit apprendre et écrire à quelques-unes de ses
religieuses, et leur dit « qu'elle répétait toujours de grande affection
deux ou trois fois cette parole : Je crois tout ce que dit la vérité
suprême, et au commencement de son veuvage, qu'elle s'adonna plus
particulièrement à la dévotion, elle n'avait pas de plus grande suavité que de
convaincre son entendement, disant avec une ferme foi : « Je vois le
jus du raisin et je crois le sang de l'Agneau de Dieu ; je goûte le pain
et je crois la vraie chair de mon Sauveur » ; mais que par après,
quand elle fut sous la conduite de notre Bienheureux Père, il lui apprit à
simplifier sa foi et à en produire des actes fervents, courts, simples et sans
épluchements ; ce qui lui fit bien connaître que la foi la plus simple et
la plus humble [345] est par conséquent la plus amoureuse et la plus
solide. » Tous les jours, à la fin de l'évangile de la messe, cette
Bienheureuse Mère disait de cœur et de bouche le Credo et le Confiteor,
et nous enseignant un jour à faire de même. « O Dieu ! dit-elle,
que nous avons de sujets de nous humilier de n'être pas jugées dignes de
confesser notre créance devant tous les tyrans de la terre ! »
Lorsque cette Bienheureuse Mère fit garnir de sentences sa chambre, où
l'on a fait depuis le noviciat, elle voulut écrire elle-même sur la muraille, à
l'endroit où les pieds de son crucifix aboutissaient, ce trait du
cantique : Je me suis assise à l'ombre de mon Bien-aimé, et son
fruit est doux à ma bouche. Une Sœur la pria de lui dire pourquoi elle
mettait cette sentence en ce lieu-là. « Afin, dit-elle, de faire souvent
des actes de foi très-nus et très-simples, car la foi, quoique lumière, est une
ombre pour la raison humaine, et je veux que mon raisonnement s'asseye en repos
à l'ombre de la foi qui me fait croire que Celui qui fut mis en cette croix
avec tant d'opprobres est le vrai Fils de Dieu. » Une autre fois, sur
quelques rencontres, elle dit qu'elle avait dès longtemps en son intention que
toutes les fois qu'elle regarderait le crucifix, son regard fût un acte de foi
pareil à celui de ce centenier qui, frappant sa poitrine, disait : Car
vraiment tu es le Fils de Dieu. Cette Bienheureuse Mère dit en confiance à
une personne, « qu'étant encore au monde, Dieu lui donna un jour une
grande intelligence de la pureté de la foi, et lui avait fait voir que la
perfection de notre entendement en cette vie c'est sa parfaite captivité et
assujettissement aux choses obscures de notre foi, et que l'entendement serait
éclairé dans la béatitude à proportion qu'il se serait tenu humblement soumis à
ces obscurités, que depuis elle avait toujours eu aversion à ouïr les discours
où l'on veut prouver par raisons naturelles le mystère de la très-sainte
Trinité ou les autres articles de notre foi ; que l'âme fidèle ne doit
point chercher [346] d'autres raisons que cette seule souveraine raison
universelle : Dieu qui a révélé ces choses à son Église. »
Jamais elle ne se souciait d'ouïr lire des miracles faits en
confirmation de notre foi, ni des révélations ; et d'ordinaire elle les
faisait passer quand on lisait au réfectoire les vies des saints ou discours
des fêtes ou mystères de Notre-Seigneur et Notre-Dame ; elle nous disait
quelquefois : Qu'avons-nous à faire de ces preuves, de ces miracles ni des
révélations, sinon pour bénir Dieu qui les a faits pour quelques âmes qui en
avaient besoin ? Dieu a révélé pour nous tout ce qu'il faut à son
Église. » Nous avons ouï dire quelquefois à cette Bienheureuse Mère, avec
très-grande ferveur, qu'elle croyait mille fois mieux tous et un chacun des
articles de notre sainte foi, qu'elle ne croyait d'avoir deux yeux dans la
fête.
Lorsque cette Bienheureuse Mère fit faire les Méditations pour nos solitudes,
tirées des écrits de notre Bienheureux Père, elle voulut en avoir une toute
particulière, sur la grâce incomparable que nous avons d'être filles de la
très-sainte Église ; elle se la fit écrire en un feuillet à part, et dit
que, les deux premiers jours de sa solitude, elle n'avait lu que cette
méditation, et que véritablement elle avait mal au cœur de voir combien d'âmes
profitent et reconnaissent peu le sacré don de la foi, et d'être enfants de
l'Église.
Nous avons trouvé en plusieurs petites prières que cette Bienheureuse
Mère invoquait souvent le saint père Abraham, père des croyants ; elle lui
avait une spéciale dévotion. Elle lisait la sainte Écriture par l'ordre de ses
supérieurs ; mais entre tous les livres de ce sacré volume, les actes des
apôtres lui étaient chers, et l'on ne saurait exprimer combien de fois elle les
a lus et relus, et nous en faisait le récit aux conversations avec une toujours
toute nouvelle ferveur, et nous semblait, à chaque fois qu'elle nous parlait de
cette primitive Église, qu'il y eût quelque chose de nouveau que nous n'avions
jamais ouï. Elle portait sur [347] son cœur, depuis plusieurs années, la grande
protestation de foi écrite de sa main et signée de son sang. L'ennemi qui
connaissait combien la foi de cette sainte femme était grande, lui a tendu de
terribles pièges de ce côté-là, ainsi que nous dirons, parlant de ses
tentations et peines intérieures ; et, comme a dévotement et saintement
remarqué Monseigneur l'évêque du Puy, cette Bienheureuse Mère peut être appelée
martyre de la foi, puisqu'elle s'est persécutée elle-même pour la soutenir en
son cœur, et en élevant l'étendard, appliquant le saint nom de Jésus sur son
cœur avec le fer et le feu, lorsqu'elle était combattue de fortes tentations
contre cette sainte foi, de laquelle elle vivait et montrait sa foi par ses
œuvres.
CHAPITRE II.
de son espérance.
Notre Bienheureuse Mère nous dit une fois qu'elle invoquait toujours
avec ses saints protecteurs notre saint père Abraham, non-seulement pour
l'amour qu'elle portait à sa grande foi, mais parce qu'il espéra contre
l'espérance même. Nous pouvons bien dire d'elle que, comme vraie fille
d'Abraham, elle a espéré contre toute espérance et apparence humaine ;
aussi Dieu a béni et multiplié sa génération sainte selon la vérité de sa
promesse. Elle avait si fermement jeté l'ancre de son espérance en Dieu, que
rien n'était capable de la détourner de ce nord bienheureux, ainsi qu'elle fit
bien voir lorsqu'elle abandonna son pays sans autre vue ni appui que cette vive
espérance en Dieu, qui lui commandait de sortir de sa terre, se dépouillant
totalement de ses prudences humaines pour s'abandonner entièrement à la
conduite de Dieu, avec une ferme confiance qu'il ferait d'elle et par elle sa
sainte volonté.
Combien de choses cette Bienheureuse Mère a entreprises pour le service
de Dieu, sans aucun fondement que l'espoir ferme et immobile que celui pour
lequel elle travaillait lui fournirait ce qui serait requis. Étant au
commencement de notre maison de Paris, à Saint-Antoine, elle écrivait à notre
chère Mère Péronne-Marie de Châtel les paroles suivantes : « Vous me
demandez, ma chère fille, si nous sommes pauvres ; oui, je vous assure, et
si je n'y pense quasi point ; le ciel et la terre peuvent bouleverser, mais
la parole de Dieu demeure [349] éternellement ; pour le fondement de notre
espérance, il a dit que si nous cherchons son royaume et sa justice, il nous
fournira du reste ; je le crois et m'y confie. L'extrémité de la nécessité
où nous nous trouvons quelquefois nous donne de hautes leçons de la perfection
de la sainte confiance et espérance en Dieu, et véritablement nous voyons déjà
combien il fait bon s'attacher à Dieu et espérer en lui contre l'espérance
humaine, car notre établissement s'est fait, par la divine grâce, mieux mille
fois que nous n'eussions osé espérer. »
En une occasion fort importante et qui lui était fort à cœur, elle dit,
sur les difficultés qu'on lui faisait voir : « Il n'est point besoin
que je voie des apparences ni des appuis humains ; il suffit de croire et
d'espérer que la parole de Dieu ne peut être sans son effet. » Elle avait
cotté de sa main et chantait souvent des psaumes qui traitent de cette sainte
espérance ; entre autres celui-ci lui était familier :
En vous mon âme, ô Dieu, s'adresse,
En vous ma
fiance j'ai mis ;
La peur de
rougir ne m'oppresse,
Ni le ris de mes
ennemis.
Qui met en vous
sa confiance,
Ne manque jamais
d'assistance.[73]
Toute son espérance pour les biens éternels était fondée sur les
mérites de Jésus-Christ, sur l'amour qu'il porte de toute éternité à sa
créature, et sur l'amoureux désir qu'il a de conserver l'ouvrage de ses mains
et donner la vie éternelle à qui coopère à ses grâces. « Ces trois points,
disait-elle, sont la pierre angulaire sur laquelle la solide maison de notre espérance
se doit fonder. » Elle parlait une fois à un très-vertueux et dévot
personnage qui vivait dans une trénieur et crainte imparfaite des jugements de
Dieu ; elle lui dit pour le consoler ces propres [350] paroles, dont la
Sœur qui l'assistait fit un fidèle recueil : « Je vous assure, mon
cher Père, que quand je vois le Sauveur mourant d'amour en la croix, ce n'est
jamais sans espérer qu'il nous fera vivre d'amour dans la gloire. Quand je me
regarde moi-même en moi-même, je frémis et connais que sans ressources je
mérite l'enfer ; mais quand je me regarde au pied de la croix et que
j'embrasse ce signe de notre salut, l'espérance du ciel qu'il m'a acquise se
rend si vive que j'oublie l'enfer, et il est bien rare que je pense à l'enfer.
Entre tous les vices desquels Dieu m'a donné horreur particulière, c'est le
désespoir, d'autant que c'est un manquement de foi insupportable. » Ce
dévot personnage produisait quantité de raisons pour appuyer et soutenir ses
craintes, mais cette Bienheureuse Mère lui dit que la crainte excessive aux
âmes déjà avancées en la vie dévote, est une barrière à l'espérance et un
refroidissement à la charité ; comme au contraire, l'humble espérance en
Jésus-Christ est un aiguillon de l'amour. « Pour moi, ajouta-t-elle, j'ai
établi, dès mon commencement, deux maximes en mon esprit, l'une de David,
l'autre de notre Bienheureux Père ; la première, Fais bien, espère en
Dieu ; la seconde, Dieu veut que notre misère serve de trône
à sa miséricorde. Avec ces deux pensées fidèlement pratiquées, je vous
conseille, disait-elle, de ne jamais regarder le ciel sans espérer. »
Elle avait encore une grande inclination à cette parole de Job !
« Qu'il me tue, j'espérerai toujours en lui », et dit qu'il
avait été un temps qu'elle la proférait souvent et avec quelques réconforts
dans ses travaux intérieurs. Une fois, une personne qui la voulait faire
parler, lui demanda si elle pensait à espérer les biens et les joies de la vie
éternelle ; elle repartit avec un très-profond rabaissement :
« Je sais bien qu'aux mérites du Sauveur elles se doivent espérer, mais
mon espérance ne se tourne point de ce côté-là ; je ne désire ni espère
chose quelconque, sinon que Dieu accomplisse sa volonté en moi, et qu'à jamais
[351] il en soit glorifié ; je ne voudrais pas que mon espérance tendît à
mon profit particulier, mais à la gloire éternelle de mon Dieu. » On lui
demanda aussi une fois, si dans divers périls qu'elle avait courus d'être
précipitée dans des abîmes et des rivières, en voyageant, elle avait toujours
espéré que Dieu l'en retirerait ; elle dit que non, « mais qu'elle
avait toujours espéré que Dieu ferait en elle ce qui serait le plus à sa divine
gloire, ou en la sauvant du danger, ou en lui faisant finir sa vie en icelui,
et que dans cette espérance son cœur était tranquille et en repos, et content
de ce que Dieu disposerait d'elle. »
Un jour d'été, qu'il faisait une extrême chaleur, cette Bienheureuse
Mère venant du jardin, s'assit sur un escalier de pierre, où il venait un petit
ventelet fort gracieux ; elle se leva promptement de cette place,
disant : « La nature trouve ici trop à prendre. » S'étant assise
ailleurs, elle demeura fort longtemps sans mot dire, se pinçant la peau des
mains ; elle ouït qu'une Sœur disait à une autre : « Je voudrais
bien savoir la pensée de notre Mère, mais je n'ose pas la lui demander. »
Cette digne Mère, se tournant gracieusement du côté de ses Sœurs, leur dit,
avec une bonté toute maternelle : « Mes filles, je pense que la chair
qui est terre, veut tirer l'esprit en terre ; mais l'esprit, aidé du
Saint-Esprit, tirera la chair au ciel, quand ce corruptible sera couvert
d'incorruption. » Et derechef, pinçant sa main, elle disait avec une
ferveur admirable : « En cette chair je ressusciterai, et cette chair
donnera gloire à la sacrée humanité de mon Rédempteur ; cette espérance
repose dans mon sein. »
CHAPITRE III.
de son amour envers
dieu.
Cette bien-aimée du Seigneur ayant abandonné sa maison et toute sa
chevance pour la dilection, estima que cet amour souverain qui la portait à quitter
tout, n'était rien auprès de celui qui la pressait incessamment de sacrifier à
Dieu sa personne et sa vie, s'abandonnant elle-même pour être plus parfaitement
à son céleste Époux, et mourant en elle-même pour y faire vivre son souverain
amour. Oh ! que ce saint amour sut bien, comme jaloux de ce digne cœur,
chasser tous les autres amours qui pouvaient empêcher la parfaite souveraineté
et suavité de ses divins effets ! Celui qui est marié a encore le cœur
divisé. Le divin Époux, voulant que notre Bienheureuse Mère cherchât d'un cœur
tout nu son seul et unique amour, lui ôta le baron de Chantal, son cher mari,
qu'elle aimait si chèrement et tendrement. Il lui ôta, dis-je, son époux, afin
qu'elle fût avec une entière perfection sa fidèle épouse, et dès le moment de
sa viduité, s'empara avec une telle puissance et une si douce autorité du cœur
et des affections de cette veuve, que jamais, depuis, l'amour de la créature ne
fut rival, dans sa volonté, à l'amour de son Créateur qui la captiva de telle
sorte que, sur-le-champ elle s'engagea par vœu à ce saint amour, lequel
s'appropriant cette bénite âme, exerça en elle et par elle sa domination, et la
gouvernant à son plaisir comme une heureuse captive, l'a menée par des chemins
si divers et des sentiers si [353] étroits, qu'ils feraient horreur à ceux qui
ne sont pas intelligents en la conduite de l'amour.
Le premier sacrifice que cette Bienheureuse Mère fit à l'amour, fut de
sa propre volonté par un si véhément désir de l'obéissance, qu'elle n'aspirait
qu'à être dirigée dans les voies de Dieu. Le goût souverain de cet amour la
dégoûta si fort des choses de la terre, que, comme elle dit elle-même, ainsi
que nous l'avons rapporté ci-dessus, elle eût voulu abandonner père, enfants,
pays et tout, pour aller vivre dans le fond d'un désert, et jouir à souhait de
son Bien-Aimé. Et comme c'est un grand signe d'amour que de se plaire en la
conversation de la chose aimée, cette Bienheureuse Mère, dès son veuvage, se
plaisait tellement en la solitude, pour être seule avec son seul amour, qu'elle
abandonna toutes les conversations mondaines et inutiles, et ne se trouvait en
compagnie que lorsque le devoir, la charité ou la civilité vertueuse le
requérait. Tous les jours ce saint amour l’allait purifiant, il l'éveillait au
bien, il l'excitait, il l'admonestait, il l'instruisait, il la séparait de
tout, et enfin il l'emprisonna glorieusement lorsqu'elle s'enferma dans une
petite maisonnette, au faubourg de cette ville, pour commencer notre
Congrégation. Ce fut ici que cet amour victorieux se rendit plus que jamais
infatigable et insatiable en la pratique de toutes vertus, et où cette
Bienheureuse Mère reçut non-seulement la grâce surabondante de croire et
d'aimer, mais de beaucoup faire et souffrir pour son Bien-Aimé.
Les médecins, et même notre Bienheureux Père, ont attribué aux douces
violences de l'amour céleste les maladies inconnues et irrémédiables que cette
Bienheureuse Mère souffrait dans ses premières années de religion, et notre
Bienheureux Père disait, ainsi qu'il se voit dans une épître, que le saint
amour voulait tout à fait rendre cette digne Mère une sainte Angèle, une sainte
Catherine, et telles autres saintes amantes, à quoi elle a correspondu avec une
fidélité admirable. L'amour de cette [354] Bienheureuse Mère, quoiqu'elle eût
goûté de grandes suavités célestes, était un amour fort, généreux, détaché,
indépendant de tous les goûts, sentiments et plaisirs spirituels, un amour
courageux à entreprendre des choses grandes pour la gloire de Dieu ; un
amour constant parmi la longueur des travaux, un amour hardi dans les
difficultés, un amour soumis dans les succès contraires, un amour toujours
adhérant aux volontés divines, un amour sage et discret, un amour désapproprié
et désintéressé, un amour qui la faisait vivre tout abandonnée à la Providence
de son Amant, un amour de simple confiance, un amour d'épouse et de fille qui
subsistait très-ferme et très-pur et sans propre recherche avec une crainte
chaste et filiale, un amour humble qui la portait jusques à l'anéantissement
total d'elle-même pour exalter son Bien-Aimé, un amour qui l'avait constituée
au parfait oubli d'elle-même par le continuel souvenir de son Dieu, un amour de
conformité qui l'a fait se réjouir de suivre nue Jésus-Christ nu, de vivre dans
les angoisses sur le Calvaire, dans les dérélictions intérieures inexplicables
sur la Croix, ne goûtant que fiel et vinaigre en son intérieur, et quelquefois
en son extérieur quantité de mépris et de contradictions. Bref, ce saint amour
l'a fait persévérer jusques à la fin avec une fidélité toujours croissante au
service de Dieu, fidélité admirable, et qui ne se pourra connaître que dans le
ciel, parce que cette fidélité amoureuse a subsisté non-seulement dans la
douceur de la paix intérieure, mais dans le froid, dans l'horreur, dans la
violence et dans la longueur de la guerre spirituelle, ainsi que nous dirons en
un autre endroit.
Le révérend Père Jean Bertrand, vice-recteur du collège de la sainte
Compagnie de Jésus, qui était un docte et vertueux Père auquel notre Bienheureuse
s'était communiquée avec confiance extraordinaire, disait un jour à notre
très-bonne et chère Mère Péronne-Marie de Châtel, que qui voudrait apprendre
comme l'on doit pratiquer le premier et le grand [355] commandement d'aimer
Dieu de tout son cœur, de toute son âme, etc., et le prochain comme soi-même,
il fallait regarder la pratique de cette digne Mère, et qu'il savait qu'elle
avait reçu d'en haut une intelligence admirable de ce premier
commandement ; « et je ne sais, dit-il, si l'amour divin a jamais eu
une domination plus entière et plus absolue sur une âme, et s'il s'en pourrait
trouver en toute la terre, une plus abandonnée à l'amour que celle-là. »
Cette Bienheureuse aimait, non-seulement de paroles, mais d'œuvres et de
vérité. Mgr le cardinal de Bérulle, fondateur des Pères de
l'Oratoire, et qui est décédé en très-grande réputation de sainteté, communiant
notre Bienheureuse Mère à Dijon depuis qu'elle fut veuve, connut par une
lumière surnaturelle que cette âme était conduite intérieurement par une voie
extraordinaire. Après la messe, il s'enquit qui était cette dame veuve, et dit
ces propres paroles : « Le cœur de cette dame est un autel où le feu
de l'amour ne s'éteint point ; et il se rendra si véhément, qu'il ne
consumera pas seulement les sacrifices, mais l'autel même. » Ce qui a eu
son véritable effet en des manières inexplicables. Lorsque cette Bienheureuse
Mère était en la fondation de notre première maison de Paris, ce grand cardinal
la fut visiter, et dit au retour à madame la comtesse de Saint-Paul, princesse
de grande vertu et conduite par des chemins intérieurs fort épineux, qu'il
venait de voir l'une des grandes amantes que Dieu eût sur la terre ; il
porta plusieurs autres dames à conférer avec cette Bienheureuse Mère de leur intérieur,
l'annonçant comme l'amoureuse Sulamite destinée à conduire ses compagnes en
l'amour céleste, par les déserts et les sentiers les plus périlleux.
Le jour de saint Basile 1632, notre Bienheureuse Mère soutint un assaut
très-grand de l'amour divin qui l'empêchait de pouvoir parler à la
récréation ; elle demeurait les yeux fermés avec un visage tout
enflammé ; elle tâchait de se divertir à filer sa quenouille, et demeurait
prise à la moitié de son aiguillée. [356]
Quand elle vit qu'elle ne pouvait faire autrement, elle fît chanter et
s'essaya de chanter elle-même ce cantique qu'elle s'était fait faire autrefois
par notre très-honorée Mère de Bréchard :
Pourquoi donner à mon âme
Quelque travail ou souci,
Puisque l'amour qui l'enflamme
Ne le permet pas ainsi ?
Il me meut et me gouverne
Tout au gré de son désir,
Et je n'ai ni but ni terme
Que son céleste plaisir.
Mon cœur n'a de complaisance
Qu'aux entretiens amoureux
De cette divine essence,
Seul objet des Bienheureux.
Ce chant la divertit un peu, et, pour cacher la grâce, elle s'essaya de
nous parler, mais avec des paroles de feu, qui furent fidèlement recueillies
sur-le-champ : « Mes chères filles, saint Basile, ni la plupart de
nos saints Pères et piliers de l'Église, n'ont pas été martyrisés ;
pourquoi vous semble-t-il » que cela soit arrivé ? » Après que
chacune eût répondu : « Et moi, dit cette Bienheureuse Mère, je crois
que c'est parce qu'il y a un martyre qui s'appelle le martyre d'amour, dans
lequel Dieu soutenant la vie à ses serviteurs et servantes, pour les faire
travailler à sa gloire, il les rend martyrs et confesseurs tout ensemble ;
je sais, ajouta-t-elle, que c'est le martyre auquel les Filles de la Visitation
sont destinées, et que Dieu le fera souffrir à celles qui seront si heureuses
que de le vouloir. » Une Sœur lui demanda comment ce martyre se pouvait
faire ? « Donnez, lui dit-elle, votre consentement absolu à Dieu, et
vous le sentirez. C'est, poursuivit-elle, que le divin amour fait passer son
glaive dans les plus secrètes et [357] intimes parties de nos âmes, et nous
sépare nous-mêmes de nous-mêmes. Je sais une âme, ajouta-t-elle, laquelle
l'amour a séparée des choses qui lui ont été plus sensibles que si les tyrans
eussent séparé son corps de son âme par le tranchant de leurs épées. »
Nous connûmes bien qu'elle parlait d'elle-même. Une Sœur lui demanda combien ce
martyre durait. « Depuis le moment, répondit-elle, que nous nous sommes
livrées sans réserves à Dieu jusqu'au moment de notre mort, mais cela s'entend
pour les cœurs généreux, et qui, sans se reprendre, sont fidèles à
l'amour ; car, les cœurs faibles et de peu d'amour et de constance,
Notre-Seigneur ne s'applique pas à les martyriser ; il se contente de les
laisser rouler leur petit train, crainte qu'ils ne lui échappent, parce qu'il
ne violente jamais le libre arbitre. » On lui répliqua si ce martyre
d'amour pouvait jamais égaler le martyre corporel. « Ne cherchons point,
dit-elle, l'égalité, quoique je pense que l'un ne cède rien à l'autre, car l’amour
est fort comme la mort, et les martyrs d'amour souffrent plus mille fois en
gardant leur vie, pour faire la volonté de Dieu, que s'il en fallait donner
mille pour témoignage de leur foi, de leur amour et de leur fidélité. »
Une autre fois, que l'on avait lu la vie de saint Jacques le martyr, qui fut
coupé par morceaux, cette Bienheureuse Mère dit qu'elle avait pensé que ce
martyre-là était un portrait du martyre d'amour, sinon que celui d'amour est de
plus longue durée, et que tous les jours le glaive de l'amour coupe et retranche
quelque chose à une âme véritablement fidèle, et que les souffrances secrètes
de l'âme qui ne met point de bornes aux opérations de l'amour sont
inimaginables.
Lorsque notre chère Mère de Châtel fut élue céans pour supérieure
l'année 1635, voyant dans les recueils qu'une Sœur faisait des choses
particulières qu'elle remarquait de notre Bienheureuse Mère, ce que nous venons
de dire du jour de saint Basile, elle la pria fort instamment de lui raconter
ce qui s'était passé [358] en
son âme ce jour-là ; notre Bienheureuse Mère, comme très-obéissante, lui
dit : « Ma chère Mère, il est vrai, Dieu me fit voir ce jour-là,
pensant à saint Basile, un martyre d'amour par lequel il a dessein de faire
passer les filles de cette petite Congrégation, je dis celles qui se voudront
absolument livrer à l'amour, et j'eus une lumière, après la communion, qui
m'apprit que la vie des vraies filles de cet Institut doit être une mort
journalière pour vivre en ce monde à l'évangélique, et leurs offices de
s'abîmer en Dieu et perdre dans cet océan de bonté tout ce qui leur est propre
pour faire et souffrir tout ce qu'il plaira à l'amour ; mais,
ajouta-t-elle avec les larmes aux yeux, ma chère Mère, il ne faut pas faire
grande estime de mes pensées, car mon infidélité me prive de leurs
fruits ; j'ai parlé et poussé nos Sœurs dans la ferveur de l'amour, et je
suis tombée dans une déplorable froideur. » Elle disait cela parce que, le
lendemain du jour de saint Basile 1632, que Dieu lui avait montré la perfection
du martyre d'amour, il la mit de nouveau dans le sacré supplice, laissant sa
bénite âme abandonnée à tant de travaux intérieurs, de tentations, de
souffrances, de ténèbres et de dérélictions, qu'elle ne se connaissait plus
soi-même, et cet état lui a duré tout le reste de sa vie, quoique diversement,
des fois plus, d'autres fois moins ; et, au travers de tant d'épines,
cette rose de charité s'est toujours conservée fraîche et d'une odeur
ravissante, par la force de son amour opérant, capable de tout faire et de tout
soutenir pour l'amour même de Celui qui l'affligeait.
CHAPITRE IV.
suite du même sujet
de son amour envers dieu.
Cet ardent amour de Dieu avait porté notre Bienheureuse Mère à un si
véhément désir de plaire à Celui qu'elle aimait, qu'elle s'obligea par vœu à
faire toujours ce qui serait le plus parfait et plus agréable à Dieu, et, comme
lui écrivit notre Bienheureux Père, son cœur, amoureusement attentif à plaire à
l'Amant céleste, n'avait pas le loisir de se retourner sur soi-même, l'amour la
portant et tournant continuellement son âme du côté de la chose aimée. Et,
comme lui dit encore ce Bienheureux au même écrit, le soin qu'elle avait de la
pureté de son âme la faisait ressembler aux colombes amoureuses qui se lavent
et se mirent le long des ruisseaux, s'agençant, non pour être belles, mais pour
plaire à leur amant. N'était-ce pas avoir un amour bien pur, bien net et bien
simple, puisqu'elle ne se purifiait pas pour être pure, elle ne se parait pas
des vertus pour être belle, mais seulement pour plaire à son Amant divin,
auquel si la laideur eût été aussi agréable, elle l'aurait autant aimée que la
beauté ?
L'amour de cette Bienheureuse Mère ne tendait nullement à la récompense
ni à la jouissance ; aussi ne parlait-elle quasi jamais des suavités de
l'amour, mais toujours de l'opération. Une fois, comme l'on disait qu'une Sœur
avait de grandes consolations intérieures et qu'elle aimait bien
Notre-Seigneur, notre Bienheureuse Mère, comme très-expérimentée en l'amour
véritable, répondit : « Savourer les suavités de Dieu n'est pas [360]
amour solide de Dieu, mais s'humilier, souffrir les injures, être exacte à sa
règle, mourir à soi-même, vivre sans intérêt, vouloir n'être connue que de Dieu
seul, c'est véritablement aimer, et des marques infaillibles de l'amour. »
Sur ce sujet elle écrivait une fois à une supérieure de notre Congrégation les
paroles suivantes : « Quant à cette bonne fille qui se croit si
élevée en amour et qui ne l'est pas en vertu, je crois que ces chaleurs et ces
assauts qu'elle sent sont des ouvrages de la nature et de l'amour-propre ;
car, ma chère fille, il lui faut faire savoir que l'amour divin élève l'âme non
tant à de hautes pensées qu'à une fidèle pratique de la règle et à ces saintes
vertus d'abnégation, d'oubli de soi-même, d'amour à l'abjection et d'une
patience qui sache tout souffrir. O ma fille ! Dieu nous défende de cet
amour sensible qui nous laisse vivre en nous-mêmes, car il mène à la
mort ; et puissions-nous être bien possédées de cet amour divin qui, nous
menant à la mort de nous-mêmes, nous fera arriver à la vie de Dieu ! Les
âmes qui auront véritablement l'amour d'opération, ne manqueront pas de sentir
en un temps ou en un autre les opérations de l'amour en elles. »
Le révérend Père Binet, provincial de la sainte Compagnie en la
province de Paris, dit une fois à notre chère Sœur Anne-Catherine de Beaumont,
qui y était alors supérieure : « L'amour a tellement fermé l'œil du
propre intérêt à la Mère de Chantal, qu'elle n'en a plus de vue ni d'amour
d'espérance, quoiqu'elle ait cette vertu d'espérance en degré éminent ;
mais quand je l'ai interrogée pour connaître un peu son fond, elle m'a dit que,
parce que la grâce et la gloire se trouvent en Dieu, elle espère tout sans
penser toutefois à autre chose qu'à lui, et que si la gloire et les félicités
se pouvaient séparer de Dieu, elle ne ferait jamais un pas pour les acquérir,
ne tendant qu'à Dieu seul. Cette pureté d'amour, ajouta ce bon Père, m'a ravi
tout à fait. » [361]
Cette Bienheureuse Mère avait des maximes et des principes de vertus
qu'elle avait écrits de sa main et tirés de l'Écriture : premièrement
celui-ci : Dieu nous a aimés d'une charité éternelle. Elle disait
que cela devait porter l'âme à un désir éternel d'amour. Secondement : Dieu
a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique. L'âme doit
correspondre à cet amour, en sorte qu'on puisse dire qu'elle a tant aimé Dieu
qu'elle lui a donné, par un don absolu, son unique, son franc arbitre, sa
volonté, et que, comme le monde a traité âprement et à son gré le Fils de Dieu
dès qu'il l'a eu, sans que ce bon Sauveur y ait non plus résisté qu'un agneau
qu'on mène à la boucherie, que de même Dieu fasse en nous, de nous et pour lui
seul tout ce qu'il lui plaira, sans que nous lui résistions. Troisièmement,
elle avait en écrit, mais plus au cœur que sur le papier, cette parole : Celui
qui m'aime est celui qui garde mes commandements. Elle répétait souvent
cette sentence, et nous lui avons ouï dire avec grand sentiment « que
l'amour est ingrat, chétif et indigne du nom d'amour, s'il n'est fidèle à faire
ce qui est des volontés de Dieu. » Elle dit une fois à une prétendante qui
était prête à prendre notre habit, qu'elle purifiât grandement son
intention ; que ce serait un amour avare de quitter le monde, qui n'est
rien, pour posséder Dieu, qui est tout. « Non, ma fille, ajouta-t-elle,
l'âme fidèle doit tout quitter, afin qu'étant libre de tout, elle ne possède ni
ne soit possédée d'aucune chose, ains demeure en l'absolue possession et merci
de l'amour divin, afin qu'il fasse d'elle ce qu'il lui plaira. »
Étant dans une des plus grandes villes de France, une Mère de religion,
qui est une âme d'une vertu éminente et fort gratifiée de Dieu, désira
extrêmement de conférer de son intérieur avec cette Bienheureuse Mère, qui en
fut très-aise. Ces deux grandes servantes de Notre-Seigneur se découvrant
naïvement les états par lesquels Notre-Seigneur les faisait passer, cette bonne
Mère dit à notre Bienheureuse qu'il y avait quelque temps [362] qu'elle était
dans des travaux intérieurs tels que parfois son délaissement était à ce point
d'extrémité qu'il fallait qu'elle se contentât de savoir que Dieu est Dieu,
sans qu'elle l'osât appeler son Dieu, ni penser qu'il fût son Dieu. Notre
Bienheureuse lui dit gracieusement : « Ma chère Mère, je vous laisse
ce point-là, et ne pratiquerai jamais cette abnégation, pour abattue et
angoissée qu'ait été mon âme ; elle n'a jamais été si bas que je n'aie
dit : Mon Dieu, vous êtes mon Dieu et le Dieu de mon cœur. Car si la foi
m'enseigne qu'il est Dieu, le baptême que j'ai reçu me fait voir qu'il est mon
Dieu. » Cette grande religieuse lui répliqua qu'il lui semblait qu'en
ce mot de mon Dieu l'on n'était pas encore dans ce parfait dénùment
d'esprit ; à quoi notre Bienheureuse repartit que nos délaissements ne
peuvent parvenir jusques au point de ceux du Fils de Dieu, et que, dans le plus
grand abandon de tous les abandons imaginables, il avait dit : Mon
Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’avez-vous délaissé ? Elle lui
dit encore les paroles suivantes : « J'ai souvent dit à Notre-Seigneur,
au fort de mes travaux, que s'il lui plaisait de me marquer ma demeure aux
enfers, pourvu qu'il mît ordre que ce fût sans que je l'offensasse, et que mon
tourment éternel fût à sa gloire éternelle, je serais contente, et que toujours
il serait mon Dieu. » Notre Bienheureuse Mère donna à cette vertueuse
religieuse le couplet suivant en écrit, disant qu'elle se plaisait beaucoup à
le chanter parmi ses travaux :
Comme un cuir séché se retire
Au chaud, telle suis de douleur,
Mais j'ai toujours vos lois au cœur
Sans prendre garde à mon martyre ;
Rien ne me console en ce lieu,
Que de savoir : Dieu est mon Dieu.
Cette bonne religieuse remercia beaucoup notre Bienheureuse [363] Mère
de la lumière qu'elle lui avait donnée, publiant qu'elle était bien plus intelligente
qu'elle en l'amour, et qu'elle n'oublierait jamais ses maximes ; qu'il ne
faut pas de plus grande délicatesse en la vie spirituelle, que de suivre
l'exemplaire que le Père nous a montré en son Fils Notre-Seigneur.
Notre Bienheureuse Mère dit à notre très-chère Sœur Anne-Catherine de
Beaumont, « qu'elle avait diverses fois repassé en son esprit l'entretien
qu'elle avait eu avec cette très-vertueuse religieuse, et qu'elle trouvait que
cette distinction de dire Dieu, et n'oser dire mon Dieu, était
insupportable ; que si Dieu lui donnait ces sentiments-là, elle croyait
que son cœur s'anéantirait et se fondrait de douleur. » « Volontiers,
lui dit-elle, je souffrirai la privation des sentiments et l'expérience de
cette douce vérité que Dieu est mon Dieu, mais plutôt je me laisserai arracher
mille vies que d'en perdre la croyance et la confiance. » Une fois, comme
quelques Sœurs disaient à notre Bienheureuse Mère que notre Mère de Châtel
portait toujours le Cantique des cantiques sur elle, et que c'était le plus
ordinaire entretien de ses pensées, elle répondit : « C'était son
attrait, et elle le méritait, car c'était une épouse bien fidèle et bien
amoureuse ; mais pour moi, hors quatre ou cinq versets du cantique, je
n'ai osé m'en servir ; mon inclination c'est les maximes évangéliques,
parce que notre Bienheureux Père me marqua, au commencement, les paroles de
l'épouse : Que mon Bien-aimé me baise d'un baiser de sa bouche, je
m'en suis servie pour le très-saint Sacrement, mais non jamais hors de là, car
ce serait demander des faveurs et des caresses d'amour dues à cette pure
épouse, et non pas à une chétive servante. » L'amour pur et fort de cette
Bienheureuse Mère lui faisait avoir à contentement que tout le long de cette
vie l'Époux céleste la tînt comme une moissonneuse de myrrhe, toujours
travaillant à la mortification et toujours altérée du pourchas d'une plus
grande accroissance au saint amour ; elle ne pouvait faire état [364] de
l'amour de douceur à l'égal de l'amour de douleur et d'humilité profonde.
Elle fit écrire sur la muraille en l'allée la plus fréquentée du
monastère, toutes les admirables qualités que saint Paul donne à la charité, qu'elle
est bénigne, patiente, douce, croit tout, souffre tout, etc. Elle appelait
cette sentence le miroir du monastère, et quelquefois ordonnait aux Sœurs qui
avaient dit leurs coulpes de quelque défaut contre la charité, d'aller lire
cette sentence, et elle-même y allait, goûtant et nous faisant surtout peser
cette parole : Si je parle le langage des Anges et n'ai point la
charité, je ne suis rien, et si je livre mon corps aux tourments et aux
flammes, et n'ai point de charité, cela ne me profite de rien.
Elle parlait assez souvent de l'honneur qu'il faut porter aux
Commandements de Dieu, nous remontrant comme c'était l'obligation des
obligations ; surtout elle parlait fort fréquemment du premier
commandement, et les deux dernières années de sa sainte vie, elle avait appris
à chanter ces divins Commandements comme on les fait chanter, à la fin du
catéchisme, aux enfants ; et véritablement nous pouvons bien dire qu'elle
aimait Dieu de toute son âme et de tout son cœur, de toute sa force et de toute
sa pensée, et que tout son être était sacrifié à l'amour et servait à l'Amant.
CHAPITRE V.
de son amour et
charité à l'égard du prochain.
L'amour de Dieu et celui du prochain étant unis par le Saint-Esprit en
un même commandement, il n'en faut pas séparer le discours, vu même que si
l'amour du prochain était un arbre fleurissant et portant des fruits
d'immortalité au cœur de notre Bienheureuse Mère, l'amour de Dieu en était la
très-pure et précieuse racine. Elle nous dit une fois que son premier directeur
lui avait appris d'aimer tous les prochains en Dieu par certaines pratiques
d'imaginations dévotes qui lui faisaient de la peine ; mais que l'ayant
représenté à notre Bienheureux. Père, il lui répondit qu'elle aimât et bénît
Dieu en toutes ses créatures, et que, s'il fallait regarder les créatures en
elles-mêmes, ce fût dans la poitrine du Sauveur ; et qu'elle s'était toujours
depuis tenue à cette pratique. Elle aimait ses parents d'un amour très-purifié
et parfait, mais suave, doux, gracieux, se conciliant amiablement leur
bienveillance, et leur témoignant la sienne par un véritable désir de leur bien
spirituel. Toutes les lettres qu'elle leur écrivait étaient, ou pour l'utilité
des affaires ou pour le bien de leurs âmes. À l'exemple de Notre-Seigneur, elle
aimait fort chèrement ceux qui l'aimaient, et correspondait très-cordialement
aux âmes qu'elle voyait aller confidemment et sans détours avec elle, bien
qu'elle ne voulût point d'attache, de mollesse, de tendreté ni d'empressement
autour d'elle ; l'amour naturel des correspondances, des sympathies, des
complaisances, fut anéanti en elle et tout rangé [366] sous la loi du pur
amour. Quiconque mettait sa confiance en cette Bienheureuse Mère, pouvait bien
dire qu'il avait trouvé l'amie fidèle et une source de vie et de
consolation pour son cœur. Elle ne se contentait pas d'aimer ceux dont elle se
voyait chérie, mais, montant plus haut, elle chérissait et embrassait des bras
d'une ardente charité ceux qu'elle savait avoir des aversions et des mauvaises
volontés pour elle.
Elle avait tiré et écrit de sa main quantité de sentences de la sainte
Écriture, sur cet amour du prochain ; la première était : Faire
bien aux ingrats pour imiter la bénignité du Père céleste. La
seconde : Jésus-Christ nous a aimés et nous a lavés en son sang. Sur
quoi elle fit écrire un jour les paroles suivantes à une religieuse qui avait
fait quelque difficulté pour la charité envers le prochain : « Ma
chère fille, considérez souvent ces paroles : Jésus-Christ nous a aimés
et lavés en son sang. Pourquoi nous a-t-il aimés, puisque nous
étions de sales et viles créatures ? Il nous a aimés par un excès de charité,
parce qu'il nous voulait laver en son sang, car il n'a pas attendu que nous
ayons été lavés pour nous aimer. Croyez-moi, ma chère fille, aimons sans examen
ce cher prochain, tout pauvre, tout mal fait, tout tel qu'il est, et s'il était
moyen que nous puissions laver ses imperfections dans notre sang, nous devrions
souhaiter de le donner jusqu'à la dernière goutte. »
Elle dit une fois qu'elle n'avait rien trouvé en l'Écriture qui lui eût
tant donné de quoi penser à cet amour du prochain que cette parole de
Jésus-Christ à ses Apôtres : Voici mon commandement : que vous
vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimés. Il dit au général du
monde : Aimez votre prochain comme vous-même ; mais aux
Apôtres, aux âmes religieuses : Aimez-vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés et comme mon Père m'a aimé. « Cela, reprenait-elle, doit
ouvrir devant nos yeux des abîmes de charité pour le prochain, car le Père et
le Fils se sont aimés, s'aiment et s'aimeront d'un amour éternel, d'un amour de
communication, d'égalité et d'unité inséparables, et l'Évangile dit que
Notre-Seigneur a aimé les siens jusqu'à la fin. »
Quand cette Bienheureuse se mettait à parler parmi nous de l'amour du
prochain, c'était avec un discours si plein des traits de l'Écriture, si
enflammé et si fluide, que si le temps des exercices ne l'eut borné, je ne sais
quand elle aurait fini. Elle nous aimait véritablement plus que soi-même,
puisqu'elle s'est donnée soi-même pour notre bien et pour nous dresser le
chemin de salut de notre petite Congrégation. Elle nous a aimées d'un amour de
communication, n'ayant pas même fait la renchérie de tous les plus secrets avis
que notre Bienheureux Père lui avait donnés pour sa conduite intérieure,
qu'elle ne nous les ait mis en commun pour notre bien, et disait une fois fort
gracieusement : « Hors que je ne rends pas compte à nos Sœurs, je
n'ai presque rien de secret pour elles, car elles savent par quel chemin
Notre-Seigneur me conduit. » Elle avait un petit livre écrit à la main des
avis que notre Bienheureux Père lui avait donnés, tant pour l'oraison que pour
ses tentations, et un autre petit cahier écrit de la main de notre Bienheureux
Père et de la sienne ; c'étaient des demandes sur les plus intimes
difficultés de son intérieur. Elle prêtait assez souvent à diverses Sœurs ces
deux livrets,[74] selon leur besoin, leur marquant les points
qu'elle croyait leur être utiles ; et à plusieurs, lorsqu'elles lui
parlaient de leurs peines intérieures, elle disait : « J'ai eu cette
tentation en un tel temps, notre Bienheureux Père me donna tel avis, ou je lus
telle chose qui me fortifia ; voyez voir s'il vous pourrait servir. »
Bref, cette digne Mère pouvait bien dire à ses filles : Je vous ai
communiqué tout ce que j'ai reçu de mon Bienheureux Père. [368]
Elle nous aimait d'un amour d'obéissance, non-seulement par le rare
exemple qu'elle nous a donné de cette vertu, mais par la violence qu'elle s'est
faite à elle-même pour acquérir une certaine complaisance de charité envers le
prochain, que nous avons vue et admirée mille et mille fois, mais que nous ne
saurions exprimer ; elle disait une fois qu'elle faisait attention de
prendre les justes désirs et les vertueuses inclinations que les Sœurs avaient
qu'elle fit ou ne fit pas quelque chose, par manière d'obéissance et de
charité.
Elle nous aimait d'un amour d'égalité, se rendant toute à toutes, et
bien qu'elle fût parmi nous, sans qu'elle y prît garde avec une majesté de
Sainte qui nous la rendait vénérable, c'était avec une douceur de colombe qui
la rendait entièrement accostable. Elle se tenait entre nous comme l'une de
nous ; et disait une fois au parloir à un Père de religion, qu'elle avait
envie par charité de retirer d'un esprit trop austère où il était :
« Me voyez-vous, lui disait-elle, en l'âge où je suis, en l'état intérieur
auquel Dieu me tient, et sous la multitude d'affaires ? je n'ai envie
quelconque de rire ni de parler, et si vous me voyiez avec notre jeunesse, qui
est gaie d'importance, je parle, je les écoute, je ris d'ordinaire sans joie de
ce qu'elles me disent, pour leur donner confiance de se récréer, parce que cela
leur est nécessaire. »
Elle nous aimait d'un amour d'union tel qu'elle disait un jour qu'on
lui parlait de quelque Sœur qui croyait n'être pas aimée d'elle :
« Cette chère âme me fait grand tort, car je vous assure qu'il n'y a fille
de la Visitation, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, qui soit inséparable
de mon cœur. » Elle disait aussi, cette bonne Mère, que ce monastère
d'Annecy était dans le fin centre de son cœur, et tous les autres de l'Institut
rangés autour, en nommant quelques-uns où elle avait remarqué une plus parfaite
vertu et un zèle plus grand pour l'observance, pour l'amour à la bassesse et
humilité ; parce qu'elle sentait que ces [369] monastères-là étaient dans
son cœur les plus proches de celui d'Annecy. On ne saurait exprimer l'attention
qu'elle avait de faire fleurir en cette maison et en toutes celles de
l'Institut, la mutuelle charité et sainte amitié et unité d'esprit. Quand il se
faisait des fondations, c'était toujours l'un des premiers avis qu'elle donnait
ou écrivait à celles qui y allaient être Supérieures, que surtout elles
procurassent une grande et sainte union entre leurs filles. Quand elle écrivait
à quelques communautés ou aux Sœurs du noviciat de quelque maison, jamais elle
n'oubliait de recommander la sainte et mutuelle amitié, et par conséquent
l'estime cordiale des unes et des autres. On l'entendait exprimer avec un grand
sentiment et de grosses larmes aux yeux, qu'on la ferait mourir de regret, que
le cœur lui sécherait de douleur et que l'on avancerait ses jours, si elle ne
voyait la sainte union des cœurs et des esprits dans une communauté où l'on
craignait qu'elle ne fût pas entière.
Bref, nous pouvons dire qu'elle nous a aimées jusqu'à la fin ; en
ce dernier triennal qu'elle a fini la dernière année de sa vie, je ne sais s'il
s'est passé récréations, assemblées, où elle ne se soit trouvée, chapitre
qu'elle n'ait tenu, qu'elle ne nous ait pressées, poussées et excitées
saintement à cet estime et amour réciproque. Quand la fin de son triennal
approcha, elle voulut nous lire au chapitre le traité que le révérend Père
Rodriguez a fait de l'union religieuse, et pria une Sœur de lui en marquer les
plus beaux traits pour les lire ; elle lui dit : « En ces derniers
actes de supériorité que je ferai en ma vie, je ne veux parler à nos Sœurs que
de charité et d'amour, parce que les choses dites les dernières demeurent plus
gravées au cœur ; cette charité et amour mutuel sont la bonne bouche que
je désire donner à cette communauté. » Avant de se déposer de ce dernier
triennal, elle fit deux entretiens à la communauté de cet amour du prochain, et
en était tellement en zèle que, passant parmi les Sœurs, elle se tournait
gracieusement contre chacune [370] et faisant un petit enclin de la tête, elle
disait : « Amour ! amour ! amour ! mes filles, je ne
sais plus autre chose. »
Une Sœur à laquelle elle ordonnait de faire quelques lettres de
communauté, lui dit : « Ma Mère, je vais mettre dans cette lettre que
votre charité est en sa vieillesse comme votre parrain saint Jean, que Votre
Charité ne nous parle plus que d'amour. » Cette digne Mère lui
repartit : « Ma fille, ne faites point cette comparaison, car il ne
faut pas profaner les saints en les comparant aux chétifs pécheurs ; mais
vous me ferez plaisir de mander à ces filles-là que je vous ai dit, il y a plus
de deux ans, que si je croyais mon courage, si je suivais mon inclination et si
je ne craignais d'ennuyer nos Sœurs, je ne parlerais jamais d'autre chose que
de la charité, et je vous assure (ajouta-t-elle avec une bonté et innocence
admirable), que quasi jamais je n'ouvre la bouche pour parler de choses bonnes
que je n'aie envie de dire : Tu aimeras le Seigneur de tout ton
cœur, et ton prochain comme toi-même. »
Si cette Bienheureuse savait que quelqu'une de ses filles eût quelque
froideur ou mécontentement l'une de l'autre, l'on peut véritablement dire
qu'elle n'avait point de repos qu'elle n'eût réuni leurs esprits, et exagérait,
avec des paroles puissantes, le péché qu'il y a de donner quelque ouverture au
refroidissement de la charité ; elle nous a dit et redit une infinité de
fois ce passage de Salomon : Le Seigneur a en haine six choses, mais la
septième lui est en abomination, c'est ceux qui sèment la discorde entre les
frères et sœurs. Elle dit une fois avec grand zèle, que si justice était
faite, il faudrait couper la langue à celle qui sème des paroles de désunion,
ajoutant avec grande ferveur, qu'elle voudrait de tout son cœur qu'on lui
coupât la langue à elle-même, et qu'elle le souffrirait avec suavité, si par ce
moyen elle pouvait bannir de toutes les maisons religieuses, et d'hommes et de
femmes, les semeurs et semeuses de paroles désunissante ? [371]
Il n'y avait aucune imperfection dont elle reprît avec tant de force
que des manquements contre cette sainte charité et union, ni pour lesquels elle
donnât si facilement des pénitences. Elle nous parlait souvent de la
délicatesse de conscience qu'il faut avoir à ne parler qu'en bonne part du
prochain ; et que s'il nous échappait quelques paroles, pour petites
qu'elles fussent, contre cette union, que nous nous en confessassions bien
clairement et particulièrement, sans généralité, nous disant que nous ne
saurions jamais concevoir combien il est facile d'offenser grièvement
Notre-Seigneur, lorsque l'on parle du prochain, surtout si l'on a la moindre
petite ombre d'émulation contre lui.
Lorsqu'on ce dernier triennal elle se déposa, elle entretint deux fois
la communauté, comme nous avons dit ci-dessus, de la charité et union mutuelle,
et entre autres choses, elle nous dit que si, lorsque notre chère Mère
supérieure, Marie-Aimée de Blonay, serait arrivée céans, elle s'apercevait
qu'aucune de nous lui allât parler des fautes passées de ses Sœurs, qu'elle
supplierait Monseigneur d'en donner une pénitence exemplaire. « Ayez, mes
chères Sœurs, nous disait-elle, un grand soin de vous mettre en l'estime l'une
de l'autre, dans l'esprit de votre supérieure ; à quel propos iriez-vous
rappeler les défauts effacés de vos Sœurs, pour donner de l'ombrage de leur
vertu ? » Vous feriez un très-grand péché ; et celle qui pensera
rabattre l'estime de sa Sœur anéantira du tout celle qu'on aurait
d'elle. » Moi-même, ajouta-t-elle, qui sais vos imperfections de toutes,
je me ferais grande conscience de dire autre chose à notre bonne Mère, quand
elle sera revenue, que vos bonnes inclinations naturelles et votre attrait
intérieur, mais rien de vos défauts passés : les imperfections que vous
commettrez sous sa conduite, elle les saura et corrigera. » Après que
notre chère Mère fut arrivée, cette Bienheureuse lui dit devant la communauté
la défense qu'elle avait faite, qu'on ne lui parlât point des fautes passées.
« Notre Mère de Blonay répondit qu'elle lui [372] avait fait grand
plaisir, et qu'elle avait grande aversion que l'on parlât des défauts d'autrui,
sinon lorsque la charité et nécessité le requerraient, selon la règle. »
Cette digne Mère l'embrassa tendrement, et lui dit avec une face riante :
« Ma chère Mère, Dieu vous comble de ses bénédictions ; je vous aime
encore plus que je ne faisais. »
Cette Bienheureuse, en parlant en particulier à notre très-honorée
Mère, pour lui donner connaissance de la communauté, elle prit la carte où le
nom des Sœurs est écrit par rang, et lui dit du bien de toutes, et comme quoi
elle avait tâché de servir leurs esprits, lui disant : « Ma chère
Mère, dans les occasions et sur les sujets des défauts que les particulières
commettront, je vous en dirai davantage. » Elle dit à la Sœur qui écrivait
pour elle, de mettre sur son mémoire, qu'elle faisait faire depuis quelques
mois, pour écrire une lettre à tout l'Institut de diverses choses fort utiles,
qu'il fallait se souvenir d'avertir les maisons, qu'aux changements de
supérieures, il se faisait de grandes fautes contre la charité et
l'union ; et, écrivant une lettre à des supérieures élues et déposées
cette année-là, elle leur dit les paroles suivantes : « Mes chères
filles, vos bons cœurs seront bien aises que je leur fasse part d'une lumière
que Dieu m'a donnée, et laquelle, si Dieu m'en donne le loisir, je veux
communiquer à nos maisons ; c'est que, lorsqu'une supérieure est élue, il
ne faut nullement, sous prétexte de confiance, sans une très-absolue nécessité,
lui parler des fautes passées des Sœurs ; cela ne sert qu'à donner des
impressions et des ombrages ; et ce sont des lourds péchés. Nous avons élu
céans notre bonne Mère de Blonay ; vous savez que c'est une âme d'une
totale confiance ; néanmoins, pour mettre cette pratique céans, et si je
puis dans l'Institut, je ne veux point que nos Sœurs lui parlent, ni lui parler
moi-même des défauts de nos Sœurs, commis avant son arrivée céans ;
faites-en de même entre vous, mes très-chères filles, et vous verrez que cette
[373] pratique de charité universelle attirera sur votre conduite des
bénédictions du ciel très-grandes. Hélas ! mes filles, tout le bien de
notre pauvre cher Institut dépend de la mutuelle union des cœurs. » Elle
avait fait écrire à la porte de notre chambre des assemblées, sur la muraille,
ces vers qu'elle aimait fort et qu'elle chantait quelquefois :
O que c'est un bien qui contente,
Quand les frères d'amour constante
Vivent unis ensemblement !
Car, où la concorde est suivie,
Le Seigneur y donne la vie,
Paix et repos abondamment.
Comme cette Bienheureuse Mère ne nous avait rien tant inculqué pendant
sa vie que cet amour du prochain, elle ne nous a rien tant recommandé à sa
mort ; et, outre ce qu'elle en a dit dans sa lettre générale, elle le fit
écrire en particulier aux Sœurs de cette communauté.
CHAPITRE VI.
suite du même sujet,
de son amour et charité à l'égard du prochain.
Cette Bienheureuse, aimant si fort la fraternité, elle n'était jamais
tardive à faire du bien au prochain ; elle ne se contentait pas de l'amour
affectif, elle y joignait l'effectif, et faisait du bien à tous selon l'étendue
de son pouvoir. Elle avait un zèle extraordinaire pour le salut de l'âme de ce
cher prochain, et pesait extraordinairement cette parole de l'Écriture : Que
Dieu a donné charge à chacun de l’âme de son prochain. Ce désir du salut
des âmes lui fit procurer, avec grande adresse et soin, l'établissement de
Messieurs de la mission de l'institution de M. Vincent de Paul, en ce diocèse,
pour l'instruction des pauvres villageois ; et, quand elle eut la réponse
de M. le commandeur de Sillery, par laquelle il lui mandait qu'il acceptait
l'inspiration que Dieu lui avait donnée d'établir des missionnaires en ce
diocèse, comme si lui-même l'avait reçue, et qu'il s'en rendrait le fondateur,
on ne saurait exprimer la joie que cette nouvelle lui donna, ni les actions de
grâces qu'elle en fit à Dieu et aux hommes.
Elle voulut que ce monastère prît soin de faire apprêter la maison pour
recevoir ces Messieurs, de leur faire faire leurs meubles et linges de
sacristie, dortoir, réfectoire ; elle-même voulait les coudre, et disait,
avec une gaieté et douceur ravissante : « Quand je m'imagine que ces
bons Messieurs viennent pour instruire et nourrir de la parole de Dieu les
brebis de [375] notre Bienheureux Père, je ne sais ce que je ne voudrais faire
pour eux. »
On ne pouvait mieux la réjouir qu'en lui racontant le fruit que les
prédications de ces Messieurs faisaient parmi les paroisses, et assez souvent,
quand elle voyait entrer la Sœur portière aux récréations, elle lui demandait
si elle n'en avait rien appris de nouveau. Nous avons encore trouvé, écrites de
sa main, ces paroles sur un dos de lettre : « Souviens-toi de prier
Monseigneur de Genève qu'il fasse instruire le menu peuple de la ville à ouïr
avec révérence et dévotion la sainte messe, et à offrir à Dieu, le matin, les
actions de toute la journée. » Elle a toujours gardé cette pratique de
charité et humble confiance envers Messeigneurs les prélats de ce diocèse, de
leur dire ce qu'elle avait en vue pour le bien de leur troupeau ; ou si
elle voyait ou entendait dire quelque chose des chanoines ou ecclésiastiques
qui fût digne d'être redressé, elle ne manquait point d'en avertir le prélat,
et disait que comme l'âme est la principale partie de l'homme, aussi, la meilleure,
la première et la principale partie de la charité, doit s'exercer envers l'âme
et pour les biens futurs.
Elle souffrait beaucoup lorsqu'elle ne pouvait faire amender le
prochain des fautes dont elle avait charge de reprendre, et passait au-dessus
de toutes considérations humaines pour procurer l'amendement, se servant de
toutes les voies de douceur et de rigueur dont elle se pouvait aviser. Elle
parlait doucement et fortement, selon que le plus grand bien du prochain le
requérait, mais toujours avec charité et désir incroyable du bien des âmes. Une
fois qu'il fallait nécessairement que, pour relever le prochain de quelques
imperfections, elle fit une chose qui devait déplaire à une personne de
considération notable, elle dit qu'il lui fâchait fort de le faire, mais que,
néanmoins, elle ne pouvait voir cette âme tremper plus longtemps dans son
défaut, [376] et que, quand elle eût dû encourir les mauvaises grâces de tout le
monde, elle n'eût su trahir les âmes commises à son soin. Elle a dit diverses
fois que, si elle avait mille vies, elle les donnerait, l'une après l'autre,
pour le bien et salut du prochain.
Parlerons-nous ici de sa charité envers les nécessiteux : en
vouloir dire les pratiques particulières, il faudrait faire des volumes à part.
Celles qui ont eu les charges de portière et d'économe sous cette bénite Mère
rendent ce témoignage, que jamais elles ne l'ont trouvée plus gracieuse que
lorsqu'elles lui allaient demander de faire quelques charités aux
pauvres ; car, nous ne voulons pas rappeler ici cette charité admirable
qui la porta, à la plus rigoureuse saison de son âge, à sacrifier sa vie et sa
liberté au service du corps et de l'esprit des pauvres,
Elle avait instruit une portière que, lorsqu'elle viendrait lui
demander congé de faire quelques aumônes, elle lui dît : « Ma Mère,
plaît-il à Votre Charité que l'on donne telle chose au nom de
Notre-Seigneur ? » Et elle répondait avec une attention de dévotion
et un témoignage de contentement non-pareil : « Oui, ma fille, donnez
l'aumône à Notre-Seigneur, et pour son amour. » Elle allait elle-même
parler aux Sœurs tourières, afin qu'elles allassent s'informer des plus
nécessiteux, et prenait soin elle-même de faire les bouillons, panades et
autres telles choses, pour les pauvres malades. On l'a quelquefois vue aller à
la dépense et à l'économie demander quelque chose pour les pauvres, et
disait : « Ma fille, au nom de Notre-Seigneur, donnez-moi telle et
telle chose pour nos pauvres, » et s'en allait toute joyeuse le porter à
la Sœur portière, lui disant, avec une gracieuse suavité : « Je suis
meilleure quêteuse que vous ; on m'a donné cela et cela. »
Nous lui avons ouï dire souvent qu'elle n'aimait point que nos [377]
monastères fissent des présents aux personnes riches, sinon qu'on leur eût de
particulières obligations : qu'il fallait épargner le bien que Dieu nous
enverrait, non point pour être riches, non point pour être accommodées de tout,
mais pour faire la charité aux pauvres.
Nous l'avons vue s'assujettir plusieurs semaines durant à aller voir
matin et soir, les portions d'un Père capucin malade, afin de s'assurer si
elles étaient bonnes et bien apprêtées. Toujours, quand il y avait quelques
capucins malades au couvent de cette ville, elle voulait qu'on leur donnât
leurs vivres de céans et avait cet accord avec le révérend Père gardien, que
lorsqu'il serait dans la nécessité et qu'il ne trouverait pas ailleurs, cette
maison fut leur refuge ; et quand ils avaient des Pères étrangers et
qu'ils venaient au monastère demander leur nourriture, cette Bienheureuse Mère
prenait la peine de descendre, et disait à la dépensière :
« Pourriez-vous, ma fille, nous faire ici une charité pour nos bons Pères
capucins ? »
Lorsque le malheur des guerres a contraint plusieurs du comté de
Bourgogne à se retirer en cette ville, il ne se peut dire les charitables soins
que cette Bienheureuse prenait de ces pauvres réfugiés, donnant une certaine
quantité de pains par semaine à des pauvres ménages, et faisant plusieurs
autres charités ; elle disait, lorsque l'on s'étonnait de la grande
quantité de pain qu'elle faisait donner, quoiqu'il n'y eût que la provision
ordinaire du blé : « Donnez hardiment ; mes filles, au nom de
Notre-Seigneur, vous verrez qu'à la fin de l'année, votre dépense n'en sera
point plus grosse. » Ce qui fut si vrai que l'année où nous fîmes
attention à le remarquer, Messieurs nos Supérieurs faisant la visite, et voyant
les comptes de la dépense, s'étonnaient qu'une si grande communauté dépensât si
peu de blé.
Nous avons vu cette Bienheureuse, dans de grandes douleurs [378] de
cœur, lorsqu'elle ne pouvait pas assister le prochain selon son besoin ;
et une fois, à l'occasion d'un pauvre gentilhomme, ruiné par les guerres, qui
ne savait où se retirer, elle nous dit, avec un grand sentiment de compassion :
« Je vous assure que si M. le commandeur de Sillery était encore en vie,
je lui demanderais une aumône de mille ou deux mille écus pour bâtir une petite
maison, en laquelle nous pussions retirer les pauvres personnes
délaissées. »
Quelque prochain que ce fût qui requît de l'instruction ou de la
consolation de cette Mère, elle ne le refusait jamais ; mais il est vrai
qu'elle allait voir, parler et consoler les pauvres avec une gaieté toute
particulière, et n'y plaignait point son temps ; disant qu'envers ces prochains-là,
on pratique tout à la fois les offices de charité, l'on console les affligés,
l'on enseigne les ignorants, leur montrant le fruit qu'ils doivent tirer de
leur tribulation, et l'on sait d'eux-mêmes leurs besoins pour y pourvoir. Elle
avait ordonné à la Sœur lingère de lui mettre à part les chemises rompues pour
les pauvres, et lui faufiler les pièces pour les raccommoder de sa propre
main ; et si on l'eût laissée faire, elle eût voulu aussi apprendre de nos
Sœurs cordonnières à raccommoder elle-même les vieux souliers pour les pauvres.
La charité de cette Bienheureuse n'avait ni indiscrétion ni
profusion ; elle n'eût pas voulu faire des aumônes au préjudice du
traitement de sa communauté, sinon que le prochain eût été dans une absolue et
totale nécessité, comme il arriva une année qu'elle demanda aux Sœurs si elles
ne seraient pas bien aises de continuer le carême quelques semaines après
Pâques, ou au moins de faire maigre quelques jours de la semaine, pour avoir de
quoi assister les pauvres. Durant le temps de la peste, elle tira consentement
de la communauté pour faire manger du pain noir à la table commune, afin de
pouvoir subsister et persévérer à assister les pauvres. L'on peut voir sur les
comptes les signalées [379] charités que cette Bienheureuse Mère faisait quasi
toutes les années par-ci, par-là, à nos pauvres monastères, et voyant que cette
maison ne pouvait subvenir à tous les besoins des autres, elle demandait des
secours à celles qu'elle croyait être en état de les donner plus facilement, et
souvent elle voulait faire ces lettres-là elle-même de sa main, parce que,
disait-elle, elles sont pour la charité.
Nous l'avons vue pleurer de joie et de contentement, lisant une lettre
de notre très-honorée Sœur la supérieure de Rouen, Anne-Thérèse de Préchonnet,
qui lui mandait que bon nombre de novices, qu'elle avait alors avaient fait un
amas de plusieurs choses qui leur appartenaient et qui n'étaient pas de leur
dot, pour en faire un petit fonds pour assister de ce revenu les pauvres
monastères. « Voyez, disait-elle, cette invention de charité me fond le
cœur de reconnaissance envers cette bonne Mère et ses filles. » Elle leur
en écrivit une lettre de remercîments, avec les termes les plus doux qu'elle
put trouver.
Une fois, notre chère Sœur Anne-Elisabeth Perrin, supérieure du Puy,
lui écrivit qu'elle apprenait que plusieurs de nos maisons pâtissaient ;
que cela lui donnait une grande compassion, et qu'elle et sa communauté étaient
résolues, n'étant pas encore à leur aise, de jeûner et épargner pour secourir
les plus nécessiteuses. Notre digne Mère fut si joyeuse de ce trait de charité
qu'elle baisait amoureusement cette lettre, et nous disait :
« Voyez-vous, voilà qui est sorti du cœur et de la main d'une vraie fille
de la Visitation. » Elle la porta à sa ceinture durant deux jours par
dévotion. Nous lui demandâmes pourquoi : « Afin, dit-elle, d'offrir
ces bonnes et charitables filles à Dieu, et que sa bonté me bénisse avec
elles. »
Quand elle ne savait plus où prendre ni demander pour assister les pauvres
monastères, elle avait au moins le soin de les consoler et encourager souvent,
par ses lettres, à s'enrichir des [380]
trésors spirituels parmi cette
disette temporelle, et nous disait que, ne pouvant point faire à nos bonnes
Sœurs de plus grands biens, qu'au moins il faut leur donner la satisfaction de
nos lettres. Elle souffrait une grande pressure de cœur si elle voyait quelques
maisons moins inclinées à soulager les autres, et nous dit une fois que rien ne
la pouvait tant affliger que de voir entre les filles de la Visitation des
charités rétrécies les unes pour les autres.
Mais, finirons-nous le discours des charitables bontés que cette digne
Mère pratiquait envers ceux du dehors et des pauvres maisons de l'Institut,
sans dire un mot de celles qu'elle exerçait dans la communauté ; il est
plus aisé de l'admirer que de le dépeindre. Elle a dit souvent que, par ses
propres souffrances, Dieu l'avait rangée au support et compassion des infirmes,
et que sans les continuelles maladies dont Dieu la gratifia (c'était son
expression) au commencement, elle aurait eu une grande peine de souffrir que
notre Bienheureux Père eût établi l'Ordre dans la douceur où il est, mais que
Dieu lui avait appris que rien n'égale la hauteur de la charité. Elle avait
l'œil sur toutes les nécessités de ses filles, mais singulièrement sur celles
des malades, ayant écrit de sa propre main que, où elle voyait une vraie
nécessité, elle aurait voulu se fondre. Quand il y avait des malades, tous les
jours, sa première action, au sortir de Prime, était de les aller visiter, et y
retournait encore ce jour-là une fois ou deux.
Lorsque c'était des grandes maladies, pour affairée qu'elle fût, elle
dérobait du temps pour les aller servir de ses propres mains, et leur donner à
manger, et avait très-expressément ordonné aux infirmières de l'appeler aux
heures les plus commodes aux malades, et qu'en quelque heure de la nuit que les
malades la demandassent, on allât la réveiller sans crainte ; que c'était
son plus grand repos que de servir ses Sœurs ; elle disait une fois :
« Quand je vois que Dieu me donne une vieillesse si [381] saine, je crois
qu'il me signifie par là qu'il veut que je l'emploie à servir nos
infirmes ; c'est pourquoi je vais le plus que je peux par nos infirmeries. »
On la voyait parfois, de longs espaces de temps, tenir la tête aux
fébricitantes qui étaient dans l'ardeur de la fièvre, et lorsqu'on lui disait
qu'elle se lassait trop : « Au contraire, répondait-elle, je me
récrée et me délasse toujours dans nos infirmeries. »
Elle recommandait les malades à l'infirmière avec des paroles qui
montraient bien l'universelle charité de son digne cœur, et encore en son
dernier triennal, il mourut une novice domestique, cette Bienheureuse pria la
Sœur infirmière de la servir avec autant de soin, et de lui donner tout ce qui
lui fallait comme si c'eût été une des plus grandes religieuses de l'Ordre, et
l'on n'a pas remarqué que jamais cette digne Mère se soit plus assujettie
d'aller servir et faire manger de sa propre main aucune des autres malades,
qu'elle le fit pour cette bonne novice domestique.
Non-seulement elle avait soin des malades, mais aussi des infirmières,
et voulait que le matin elles prissent quelque chose pour chasser le mauvais
air, et avait attention à leur faire reprendre du sommeil dans la journée. Elle
disait quelquefois à notre chère Sœur infirmière qu'elle rendit grâce à Dieu,
comme d'un grand bénéfice, de l'affection qu'il lui avait donnée à servir les
malades, et que si elle eût eu l'âge et les forces, elle eût souhaité de
n'avoir jamais autre charge dans l'Ordre que de servir à l'infirmerie.
Une Sœur infirme lui disant une fois qu'elle avait de la peine, se
croyant à charge à la maison, ne pouvant rien faire, et qu’ayant été reçue sans
dot, cela la faisait souffrir en l'esprit. Notre Bienheureuse Mère lui
repartit : « Ah ! ma chère fille, ne dites pas cela, vous nous
êtes plus précieuse qu'une montagne d'or ; c'est un grand trésor aux
maisons de Dieu, d'avoir des âmes qui souffrent leur mal avec patience, comme
vous le [382] voulez faire, et des sujets pour exercer la très-sainte
charité. » Une fois, faisant prendre quelques soulagements à une Sœur,
elle dit : « J'ai grande envie de faire tout le bien que je pourrai à
nos Sœurs, selon ma règle, car hors de là, je ne veux ni ne peux rien. »
CHAPITRE VII.
de sa patiente
charité à supporter le prochain.
De l'amour bienfaisant de cette Bienheureuse Mère, il faut monter à
l'amour supportant ; Dieu a permis pour sa sanctification que les
occasions de la pratiquer ne lui ont non plus manqué que l'air pour
respirer ; elle avait écrit de sa main ces paroles de
Notre-Seigneur : Si vous saluez vos frères, que faites-vous de plus que
les païens ? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Elle dit une fois, sur quelque occasion où elle était obligée de
parler, qu'elle n'avait pas connaissance depuis qu'elle s'était sacrifiée au
service de Dieu, d'avoir rendu mal pour mal, mais qu'elle avait grande
inclination de surmonter le mal par le bien. En une autre rencontre, elle dit,
au sujet de la vengeance, ces paroles : « J'ai une telle horreur de
ce vice, que s'il m'était arrivé de faire quelque chose par vengeance, je crois
que j'en mourrais de regret ; il n'y a guère de choses qui m'étonnent
davantage, que de penser comme quoi il se peut faire qu'un cœur chrétien se
laisse emporter aux désirs et aux actions de la vengeance, étant chose si
éloignée des maximes du Fils de Dieu. » Une fois, une personne d'assez
basse condition, ne considérant pas la raison que cette Bienheureuse avait eue
de faire quelque chose à quoi sa conscience l'obligeait, se laissant emporter à
la passion, lui dit des paroles fort extravagantes et offensives, la taxant
d'injustice et d'une fausse charité ; notre Bienheureuse Mère écouta tout
cela avec un visage doux, [384] rabaissé et dévot ; et quand cette
personne eut tout dit, notre Bienheureuse Mère ne lui répondit jamais autre
chose, sinon : « Dieu vous bénisse, mon enfant ! » Puis se
tournant vers les Sœurs qui étaient proches d'elle : « Voyez-vous,
dit-elle comme ce cher prochain se détraque ; il est créé à l'image et
semblance de Dieu, il faut l'aimer de tout notre cœur : allons prier à son
intention. »
Une autre personne, non moins passionnée et indiscrète que celle dont
nous venons de parler, vint un jour chanter pouille à notre Bienheureuse Mère
au parloir ; la Sœur qui l'assistait, lui dit : « Vraiment, ma
Mère, ce n'est point l'intention de Monseigneur (c'était notre Bienheureux
Père) que Votre Charité souffre telles choses. » La Bienheureuse se mit à
sourire, et lui dit : « Pardonnez-moi, ma chère fille, Monseigneur
m'a appris que nous devons suivre cet avis de saint Paul, qui dit : Mes
bien-aimés, ne vous revanchez point, ne vous défendez point, souffrez plutôt
que l'on vous fasse tort et injure. » Le lendemain, un proche parent
de cette personne inconsidérée s'alla plaindre hautement de notre Bienheureuse
Mère à M. le prince de Nemours, qui était alors en cette ville. M. de la Roche
d'Allery en vint avertir Sa Charité, afin qu'on fit parler au prince ;
mais elle lui dit gracieusement : « Mon cher frère (elle le nommait
ainsi par alliance sainte, car c'était un gentilhomme de grande vertu), il faut
bien souffrir quelque chose ; si notre prochain ne nous faisait point de mal,
en quoi le supporterions-nous ? J'ai grande consolation qu'étant épouses
de Jésus-Christ, nous soyons comme lui accusées devant les princes ; tout
le remède que j'y apporterai c'est que je vais communier pour notre
accusateur. »
Un gentilhomme fort en colère de ce que sa sœur se faisait religieuse
en un de nos monastères, après avoir fait son possible pour lui persuader de
retourner au monde, n'en pouvant venir à bout, il s'en prit à notre
Bienheureuse Mère par des [385] paroles fort piquantes, à quoi elle n'opposa
que de la modestie et suavité religieuses ; de quoi ce gentilhomme
s'aigrissait davantage ; notre Bienheureuse Mère voyant qu'elle ne le
pouvait adoucir par le miel de ses paroles, se résolut d'y employer les
bienfaits, et procura que la prétendante laissât une notable partie de son bien
à son frère, disant qu'il ne fallait rien épargner pour ramener un prochain
dans la douce charité chrétienne ; elle détermina aussi la prétendante à
faire présent à son frère d'une chaîne de perles qu'elle voulait donner au monastère.
« Ma chère fille, lui disait-elle, donnez les perles du monde au monde,
pour ramener à la très-sainte charité l'âme de votre frère, qui est le précieux
joyau de Jésus-Christ. »
Lorsque l'on bâtissait ce monastère, comme nous avons dit en notre
fondation, il y eut des contradictions grandes, jusqu'à faire chasser nos
ouvriers à coups de pierres. L'une des personnes qui contrariaient le plus
tomba malade ; notre Bienheureuse Mère prit un soin tout extraordinaire de
se venger à la façon des saints par mille bienfaits, lui faisant faire des
coulis, de l'orge mondé et autres petites choses propres à son soulagement,
sans manquer aucun jour de lui en envoyer ; elle disait à nos Sœurs :
« Voyez-vous, mes Sœurs, ce bonhomme mérite que nous en ayons grande
compassion ; il a une tentation d'aversion contre nous, qui ne se guérira
jamais que par notre douceur envers lui. »
Un jeune homme, irrité de ce que celle qu'il recherchait se faisait
religieuse dans une de nos maisons que notre Bienheureuse Mère était allée fonder,
se laissa emporter à sa passion, jusqu'à aller demander notre Bienheureuse Mère
et lui présenter un pasquin ; elle commença à le lire, sans savoir ce que
c'était ; puis, le jetant à terre, elle lui dit : « Monsieur, je
crois que vous vous êtes mépris, ce n'est pas à nous que ce papier-là
s'adresse. » Il lui répondit que c'était à elle-même, et qu'il le lui
voulait expliquer ; sur quoi il se mit à lui dire les [386] choses les
plus humiliantes qui se sauraient imaginer. En sortant du parloir, elle dit à
la Sœur qui l'assistait : « Jamais, je vous assure, je n'ouïs
harangue qui me plût tant que celle de ce jeune homme ; mais, cependant,
j'ai grande pitié de le voir dans le péché ; il faut que nous fassions
tant envers Notre-Seigneur qu'il nous donne cette âme. » Elle pria si
fervemment que Notre-Seigneur lui accorda sa demande ; ce jeune homme se
convertit, lui vint demander pardon avec larmes, se fit religieux, et est
encore aujourd'hui un très-vertueux prêtre et grand prédicateur.
Un personnage qui avait écrit une lettre diffamatoire à son prince
contre notre Bienheureuse Mère, se trouva en nécessité de recourir à
elle ; elle lui alla parler avec autant de paix et de tranquillité qu'à un
des plus grands amis de la maison, n'oublia rien pour lui rendre le service
qu'il désirait, et ne voulut pas seulement lui faire connaître ce qu'il avait
fait contre elle et contre le monastère. Une Sœur lui dit : « Ma
Mère, il faut dire la vérité, vous en souffrez trop. » « Ma fille,
lui dit-elle, « venez voir notre belle sentence : La charité
souffre tout, la charité supporte tout. »
Quelques personnes oublieuses de leur devoir lui ont reproché, après
plusieurs autres paroles, d'avoir fait plus de mal que de bien dans
l'Institut ; à quoi elle n'opposa que douceur, disant qu'il pourrait être
vrai, mais que c'était contre sa volonté et connaissance. Encore un peu avant
qu'elle partît de ce monastère, un esprit mécontent lui écrivit une lettre si
hautaine, et la blâmait en tant de points, où elle était parfaitement innocente,
que nous avions horreur de la lire ; mais elle nous pria de ne pas sauter
un mot, de bien tout dire, et, crainte que quelque chose n'eût été passée sous
silence, elle nous en fit recommencer la lecture, l'écoutant avec un visage si
recueilli et dévot, qu'à tout moment je cessais de lire pour la regarder.
Lorsque la lettre fut finie, elle nous dit : « Il faut chercher un
bon biais [387] de douceur pour gagner cette chère âme ; je n'en sache
aucune dans l'Institut pour le bien de laquelle je voulusse plus volontiers
donner mes yeux et ma vie. » Elle fit écrire diverses lettres pour
procurer satisfaction à cette personne, et serra la sienne en sa layette, pour
relire, comme nous croyons, en son particulier, les blâmes qu'on lui
donnait ; et, quoique l'écriture l'incommodât fort en ce temps, elle
voulut faire un billet de sa main à cette personne, « afin, nous dit-elle,
qu'elle voie mieux combien je l'aime. »
Cette Bienheureuse Mère nous redisait souvent les paroles de saint
Paul : Portez les charges les uns des autres, et ajoutait qu'il n'y
avait pas de plus grande charge à supporter au prochain que ses imperfections
et ce qui nous heurte ; elle nous donnait un admirable exemple de cette
vertu, et l'on peut dire qu'on la voyait croître à l'œil en cette vertu du support
du prochain.
On lui donna une fois une chanson qui avait été faite contre elle et
blâmait sa conduite ; elle nous la fit lire en sa présence et l'écoutait
comme un cantique de suavité ; après, elle nous dit : « Que
ferons-nous ici ? Ce n'est pas le moyen de gagner ce prochain que de lui
faire voir sa faute ; la disposition n'y est pas ; il vaut mieux que
je supporte cela, et il me sera aussi facile que de me coucher (elle se mettait
au lit) ; mais ayons recours à Dieu, je communierai demain pour cette âme,
faites de votre côté une dévotion à un tel saint. »
Elle avait une adresse admirable à couvrir et supporter les fautes du
prochain, mais singulièrement lorsqu'elles étaient contre elle. Une fois, sur
une notable contradiction, une Sœur lui ayant dit : « Ma Mère, voilà
des morceaux propres à l'estomac des saints, parce qu'ils ont la chaleur de la
charité pour les digérer, » elle lui répondit : « Ma fille, ne
dites pas cela, je ne suis pas digne d'avoir des morceaux des saints ;
mais Dieu permet, pour mon humiliation, que je ressente ces choses ; [388]
il voit mon cœur, je ne veux point d'autre défense, sa bonté sait bien que je
sacrifierais ma vie pour le bien de quelle âme que ce soit. »
En quelque autre rencontre, elle dit : « Il y a trois mois
que je patiente, que je souffre, que je vais épiant l'occasion d'entrer dans ce
cœur, et tous mes soins sont interprétés d'une autre façon ; je ne veux
point pourtant désister, car je suis encore bien loin d'avoir pardonné jusqu'à
septante fois sept fois.[75]«
Écrivant à notre très-honorée Mère de Blonay sur quelque chose où on
lui avait donné un déplaisir sensible, elle disait ces propres paroles :
« Pensez, ma chère Mère, si cette privation m'a mortifiée ; mais, ô
Dieu ! ma toute aimée Mère, accoutumons-nous à souffrir les coups de dards
que les mains qui devraient caresser lancent contre nous, serrons ces flèches
en notre cœur et ne les rendons jamais ; mais toujours le bien pour le
mal. »
Cette Bienheureuse avait une aversion nonpareille que l'on gardât du
ressouvenir des déplaisirs reçus par le prochain, et n'oubliait rien pour
porter les âmes à cet oubli des torts que l'on pouvait avoir reçus.
Une religieuse lui écrivit une fois qu'une autre avait de si grandes
froideurs pour elle que cela lui glaçait le cœur ; cette Bienheureuse lui
fit réponse : « Ma chère fille, ce n'est pas les maximes de la
charité de se laisser surmonter par le mal ; exercez-vous, je vous
supplie, à une telle exactitude à suivre [389] les maximes du Fils de Dieu, que
la chaleur de votre cordiale charité fonde la froideur qui est au cœur de votre
Sœur. »
Une Sœur lui dit une fois qu'elle avait ouï qu'une autre parlait d'un
défaut qu'elle avait commis, il y avait quelques années ; cette
Bienheureuse lui demanda quelles résolutions elle avait faites là-dessus.
« De tâcher, lui dit la Sœur, pour l'amour de Notre-Seigneur, de couvrir
les défauts, le plus que je pourrai, de celles qui vont déterrer les miens pour
faire que telle personne ne m'ait pas confiance. » « Ah ! ma fille,
dit cette Bienheureuse Mère, vous me rajeunissez. » Et l'embrassant
tendrement : « Plaise à mon Dieu que jamais ces résolutions ne
sortent de votre âme ! je m'estimerais heureuse de mourir pour la graver
au cœur de toutes les filles de la Visitation. » Et, continuant de parler :
« Il ne faut jamais craindre, dit-elle, de ne pas se revenger contre le
prochain, car Dieu prend si hautement le parti de ceux qui se taisent, crainte
de nuire à ceux qui leur nuisent, que tout revient à leur gloire.[76]«
Une personne voulant une fois demander pardon à cette digne Mère de
quantités de paroles qu'elle avait dites autrefois contre elle, et plusieurs
autres exercices qu'elle lui avait donnés, la Bienheureuse lui dit :
« Non, je vous supplie, ne rappelez point cela en votre esprit, je ne sais
plus où tout cela est, et n'ai point de mémoire, par la grâce de Dieu, pour me
ressouvenir de ce que l'on a fait contre moi ; quand les choses sont une
fois souffertes pour Dieu, qu'en avons-nous plus à faire ? »
Quelqu'une de nos Sœurs écrivit une fois à notre Bienheureuse Mère
qu'elle voulait changer de lieu, parce qu'elle ne pouvait demeurer avec des
personnes qui l'avaient humiliée et [390] contrariée, elle lui fit cette
réponse : « Seigneur Jésus, ma chère fille ! en quelle école avez-vous
été nourrie, que vous n'ayez point encore appris à souffrir de votre
prochain ? avec qui Jésus-Christ demeurait-il ? n'était-ce point avec
un larron qui murmurait des caresses que l'on faisait à sa divine personne,
humiliant si fort Jésus-Christ que de dire en plein banquet, que ce que l'on
employait pour lui était perdu ? n'était-ce point avec un traître qui le
vendit à petit prix ? Oh ! ma fille, que nous sommes ignorantes en la
leçon du support du prochain ! hélas ! à l'ombre du mépris et de la
contradiction, il faut penser à témoigner notre peu de charité. Ma chère fille,
croyez-moi, servez-vous de cette considération avec laquelle j'en ai déjà guéri
quelques autres ; où voulez-vous demeurer éternellement ? Sans doute
vous prétendez au salut ; la chère âme contre laquelle vous êtes heurtée,
y va d'un bon pas ; dites-moi, ma chère fille, comment prétendez-vous que
Dieu vous unisse éternellement en un même séjour, si vous ne pouvez pas, pour
l'amour de lui, demeurer ensemble durant le moment de la vie mortelle ? Croyez-moi,
ne pensez jamais à vous séparer du prochain, faute de le savoir supporter, car
vous vous sépareriez de Dieu. »
Une autre religieuse fit dire à cette digne Mère, par une personne de
confiance qui allait la voir, qu'elle ne pouvait plus demeurer avec une
personne qu'elle aimait certainement, mais qu'elle ne pouvait pas voir ni lui
parler ; notre Bienheureuse dit : « Je ne veux faire autre
réponse à cette fille, sinon que vous lui disiez de ma part que si elle ne
s'adonne au support gracieux du prochain, quand ce viendra l'heure de sa mort,
Notre-Seigneur lui dira : Je vous ai aimée d'une charité éternelle, je
vous aime encore, parce que vous êtes mon ouvrage, mais je ne vous peux voir ni
parler ; et partant, il nous faut séparer, retirez-vous de moi. »
Cette parole produisit un fruit excellent ; aussi s'adressait-elle à une
âme bien bonne. [391]
Je ne puis sortir de ces chapitres de la charité de cette
Bienheureuse ; ce sont des abîmes sans fond, et desquels je sors par cette
généralité, que véritablement elle était patiente et supportante envers tous.
Mais je ferais tort si, en parlant de son amour supportant, je ne le joignais à
son amour punissant ; elle était très-exacte, et même quelquefois
paraissait un peu sévère à corriger et donner des pénitences ; les choses
qui s'adressaient immédiatement à elle et qui n'étaient sues que d'elle, elle
les souffrait et supportait, tâchant de corriger par douceur ; mais ce qui
était fait devant les autres, elle passait sur les considérations particulières
pour s'attacher au bien général, et nous lui avons vu enjoindre des pénitences
en pleurant, et disant du profond de son cœur : « Plût à mon Dieu
qu'il me fut loisible de subir moi-même cette pénitence, pourvu que mon support
ne fût point nuisible à mes Sœurs ! »
Elle écrivit une fois à une de nos supérieures : « Il est
vrai, ma chère fille, j'ai une inclination incroyable à la parole que me dit
notre Bienheureux Père, qu'il faut supporter le prochain jusqu'à la niaiserie,
et puisque vous voulez que je vous dise comme vous la devez entendre, je vous
dirai naïvement comme quoi je désire la pratiquer moi-même : c'est en
supportant les fâcheuses humeurs, certaines petites importunités qui ne font
point d'autre mal que de nous ennuyer, certaines petites déraisons, certaines
faiblesses, certaines inconsidérations, faute d'avoir plus longue vue,
certaines fautes qui buttent entièrement et secrètement contre
nous-mêmes ; mais, ô Dieu ! ma chère fille, ce qui mal édifie les
Sœurs, ce qui est volontaire ; les choses où il y a de la malice, des
opiniâtretés manifestes, oh ! vraiment notre Bienheureux Père ne nous
enseigna jamais à supporter telles choses, sans essayer, par toutes les voies
possibles de douceur et de rigueur, à en faire amender ; et il est vrai
que je suis un peu ferme en cela, parce que cette maison est sujette à donner
des filles dehors ; [392] nous en avons donné quatre, cette année ;
je ne veux pas que l'on aille dire : notre Mère d'Annecy supporte tout,
souffre tout, cela serait très-préjudiciable dans les maisons ; nous
autres supérieures devons tellement supporter nos filles ; que ce support
ne nous empêche point de les porter en Paradis. »
CHAPITRE VIII.
comment elle pratiqua
les quatre vertus cardinales.
Si le cœur de notre Bienheureuse Mère était le char de l'amour, nous
pouvons dire qu'il roulait sur ces quatre roues : prudence, tempérance,
justice et force.
Sa prudence était surnaturelle, et devrait plutôt être appelée sagesse
que prudence, tant elle l'avait divinisée. Elle haïssait le vice de la duplicité
et artifice, en sorte que le seul nom, comme elle le dit, lui faisait horreur.
Une fois, quelque Sœur parlant contre la prudence, pensait louer la
simplicité ; notre Bienheureuse lui dit : « Distinguez donc la
prudence humaine, car notre Mère, la Sainte Église, nous enseigne à demander à
Dieu qu'il nous enseigne les voies de sa prudence. » Écrivant une fois à
une de nos supérieures, elle lui disait : « Enfin, ma chère fille,
les bonnes supérieures de Sainte Marie doivent être des prudentes colombes, en
sorte quelles sachent mêler une once de prudence parmi dix livres de
simplicité ; les vertus sont une chaîne d'honneur, la prudence est l'une
des boucles ; si on l'ôte, on rend la chaîne défectueuse en cet
endroit. » Elle disait aussi : « Plusieurs blâment la prudence
indiscrètement, et d'autres la pratiquent sans mesure, les uns et les autres
font mal. » Si cette Bienheureuse blâmait ces extrémités, elle les fuyait
soigneusement : sa prudence était modérée, et sa simplicité était unique.
Notre Bienheureux Père, parlant de l'ordre qu'elle mit à ses affaires pour se
retirer du monde, dit : « Elle a fait tout cela avec une prudence si
[394] admirable, que la téméraire sagesse du monde n'y saurait rien trouver à
censurer, et les gens sages et vertueux y trouvent beaucoup à louer. »
L'on a pu voir par tout ce qui est dit ci-dessus, et qui se dira ci-après,
combien la prudence de cette Sainte était parfaite pour ajuster tant d'affaires
diverses, pratiquer avec toutes sortes de personnes de toute condition, et savoir
se maintenir avec tous.
Elle a toujours été si réglée, que sa vie en tout et partout a été une
perpétuelle tempérance ; elle dit une fois, « qu'en quelque lieu
qu'elle fût et quelques sortes de viande qu'on lui donnât, elle faisait
attention de ne manger toujours que d'une ou de deux sortes de viande, tant
qu'elle le pouvait. » Et lorsqu'elle était en voyage et que les maisons la
voulaient traiter extraordinairement, elle ne pouvait souffrir ce qui sentait
l'abondance, priant les supérieures de ne lui faire donner que sa petite
portion. Et quand elle était céans, ces dernières années, elle mangeait fort
peu, sa portion pour l'ordinaire était des plus petites, et quoique l'on prît
garde à lui donner des choses substantielles et nourrissantes, elle ne voulait
point souffrir ce qui ressentait tant soit peu la mollesse des sens. Elle ne
mangeait véritablement que pour se soutenir, et nous disait quelquefois :
« L'on ne saurait croire combien le boire et le manger me sont ennuyeux,
et ils me le seraient encore davantage, ce n'était que je mange sans goût, sans
appétit, et seulement pour obéir à Dieu.[77]« [395]
La justice et l'équité lui étaient naturelles ; toute sa vie et au
monde et en la Religion, elle a eu une grande inclination que l'on rendit à
chacun ce qui lui appartenait ; elle nous dit une fois, riant innocemment
avec nous, que lorsqu'elle était à son ménage, elle ne savait presque point de
sentences de l'Écriture, que celle-ci : « Rendez à César ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Au commencement de notre Institut, cette digne Mère, traitant de
quelque affaire avec une dame de qualité, notre Bienheureux Père vit qu'elle
tenait fort ferme et ne voulait pas relâcher ; il lui dit qu'elle était
trop ferme, à quoi elle répondit : « Monseigneur, je ne puis rien
relâcher où je vois la justice ; quand ce serait contre moi-même, je m'y
tiendrais inébranlable. » Notre Bienheureux lui répliqua : « Ma
Mère, ma Mère, vous êtes plus juste que bonne ; je ne veux point que vous
soyez si juste, il faut être plus bonne que juste. » Cette parole fit un
très-grand effet dans l'esprit de notre digne Mère, par qui elle fut longtemps
méditée ; et nous lui en avons vu faire des pratiques très-signalées,
assaisonnant sa justice de tant de bonté que ce n'était plus en ces dernières
années qu'une juste et aimable bénignité. Lorsque l'on traitait de quelque
affaire un peu [396] embrouillée, ou qu'il fallait débattre quelque chose avec
le prochain, elle priait soigneusement les Sœurs qui avaient soin du temporel
d'être extraordinairement attentives que tout se passât avec une charitable
équité. Lorsqu'on lui disait quelque chose du prochain, elle examinait
soigneusement les deux parties ; et dit une fois, avec un profond
soupir : « Dieu nous défende des supérieures qui croient légèrement
toutes choses car elles feront beaucoup de petites injustices ; mais Dieu
nous préserve encore plus des inférieures injustes. »
Nous avons vu en quelques rencontres où l'on voulait que cette
Bienheureuse se montrât plus âpre qu'il ne lui semblait convenable, qu'elle
allait cherchant de petites adresses pour ajuster tout, en sorte que chacun fut
content ; et enfin, elle disait : « Voyez-vous, mes Sœurs, par
justice les anciens eussent lapidé la pauvre femme adultère ; mais par
bonté Jésus la délivra ; ce bon Sauveur est venu en terre, afin d'associer
la justice à la paix ; imitons-le. » Oh ! combien de choses lui
avons-nous vu céder et lâcher par bonté, qu'elle eût pu exiger et retenir par
justice !
Une personne de dehors ayant une fois dérobé quelque chose au
monastère, l'on en avertit cette Bienheureuse Mère, pour savoir si elle avait
fait ce présent ou si c'était un larcin ; elle reprit gracieusement ce
mot : « Un larcin, voudriez-vous bien juger que cette personne-là en eût fait un ? Il faut
être plus juste en ses jugements. » Et elle détourna le propos ; et
faisant appeler en particulier la personne qui avait dérobé, elle lui
dit : « Prenez exemple à nous ; par justice nous pouvons vous
faire rendre votre larcin et vous donner confusion ; mais par miséricorde,
nous nous contentons de vous dire de vous en confesser ; nous vous donnons
ce que vous avez pris, à la charge que ce sera une marque chez vous de ne faire
jamais tort à votre prochain. »
Les maçons qui bâtissaient notre seconde maison furent [397] convaincus
d'avoir fait des manquements notables aux murailles, et condamnés à les faire
réparer à leurs dépens ; et l'on voulait d'autres ouvriers, ce qui eût
beaucoup préjudicié à la réputation de ceux-ci, pour leur métier ; notre
Bienheureuse ne put jamais supporter cette justice si rigoureuse, et dit
« qu'en conscience cela lui semblait injuste pour des servantes de Dieu,
qui doivent posséder et pratiquer toutes les vertus avec des puretés et des
délicatesses relevées au-dessus du commun. » Elle fit venir tous ces
pauvres maçons, leur inculqua beaucoup de faire le reste de la besogne
loyalement et équitablement, leur fit réparer les fautes qu'ils avaient
commises, et afin qu'ils n'en fussent pas grevés, elle voulut que ce monastère
leur donnât une somme d'argent du sien propre. Notre très-bonne Mère de Châtel,
qui était au parloir avec elle, au sortir de là, monta dans la cellule de la
Sœur qui écrivait pour elle, et lui fit écrire cet acte de vertu, faisant
mettre au commencement du mémoire : « Béni soit Dieu qui nous a donné
une Mère si dignement juste et si saintement bonne. » Notre Bienheureuse
Mère disait que la vraie règle de la justice chrétienne, c'est ces
paroles : « Fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'il te
fit ; qui ne vit pas conformément à cela, ne vit pas justement, et
fait grand tort à son âme, car l’âme du juste est le siège de
Dieu. »
Notre Bienheureux Père parlant une fois à M. l'Abbé d'Abondance lui dit
gracieusement : « J'ai trouvé dans Dijon ce que Salomon était en peine
de trouver dans Jérusalem. » Ce bon Abbé pressait le saint Prélat
d'expliquer ce que c'était. « C'est, dit-il, que j'ai trouvé la femme
forte en madame de Chantal. » En plusieurs épîtres, ce Bienheureux lui
donne toujours cet éloge.
Il faudrait un discours tout entier pour parler de la force de cette
digne Mère, car toute sa vie elle apparut forte, ainsi que chacun a pu le voir.
Nous ne voulons pas rappeler la force avec laquelle elle s'est arrachée des
mains de ses parents, et a passé [398] sur son propre fils pour obéir à Dieu,
qui l'inspirait à sortir de sa terre. La perfection de sa force peut se juger
de la constante guerre que l'ennemi lui a faite tout le temps de sa vie sans
rien gagner sur elle ; c'était un fort et ferme rocher, qui voyait briser
à ses pieds les diverses adversités, comme faisant hommage à sa constance.
Lorsqu'on l'eut jugée plus faible, c'est alors qu'elle était plus forte par la
grâce de Notre-Seigneur qui la rendait forte dans ses faiblesses ; forte
en prospérité, ne s'évanouissant point dans la complaisance et la vanité ;
forte en l'adversité, sans s'abattre ; forte à soutenir et supporter le
prochain ; forte à s'abattre et s'abaisser soi-même ; forte à
souffrir les blâmes et contradictions ; forte à ne point désister des choses
entreprises pour les fondations et le bien de son Ordre, contre toutes les
menaces et contradictions, disant en une occasion fort prégnante :
« Il n'y a que les hommes contre nous ; quand l'enfer s'y joindrait
encore, nous ne voudrions point nous désister de faire l'œuvre de Dieu. »
Elle était forte à supporter, voire même à porter gaiement une multitude de
tant et si différentes affaires ; bref, forte en pâtissant, en agissant en
jouissant en son commencement, en son progrès, en sa fin ; même l'on peut dire
que la faiblesse du vieil âge faisait davantage éclater la sainte force de son
cœur, de son esprit et de son amour, en sorte que, sans se regarder elle-même,
aucune entreprise où elle voyait la volonté de Dieu et l'obéissance, ne
l'étonnait ; le Seigneur était sa force ; c'est pourquoi elle pouvait
tout en celui qui la confortait et la renforçait pour résister à tout ce qui
est mal, et faire tout ce qui est bien.
CHAPITRE IX.
de sa piété et de son
zèle au culte divin.
L'on a pu remarquer dans tous les discours précédents, que dès le plus
bas âge de notre Bienheureuse Mère, le ciel l'avait douée d'une piété signalée
et envers Dieu et envers le prochain ; mais nous ne voulons parler ici que
de ce qui concerne les choses saintes pour lesquelles notre Bienheureuse avait
un respect incomparable et un zèle inexplicable : en tout ce qui
concernait le culte et service de Dieu, elle appliquait partout la piété et
dévotion, et faisait profit de tout ce qui la pouvait faire avancer en cet
heureux chemin.
Elle célébrait les fêtes de Notre-Seigneur et de Notre-Dame avec
spéciale attention et dévotion. Durant l'avent et le carême, elle parlait
ordinairement au chapitre de l'anéantissement du Verbe dans les entrailles de
sa sainte Mère, et de la Passion. En ces deux temps-là, elle voulait que l'on
fit une attention particulière à faire les récréations plus dévotement qu'à
l'ordinaire, et nous disait quelquefois avec une suavité admirable qu'elle nous
donnait demi-heure de la récréation pour nous divertir innocemment et indifféremment,
mais que l'autre demi-heure, elle voulait que nous la lui donnassions pour nous
entretenir dévotement et sérieusement.
Aux fêtes de Noël, il y avait trop de plaisir à voir avec quelle
dévotion elle allait quelquefois elle-même envelopper le petit Jésus pour le
poser dans la crèche de Bethléem, que l'on accoutume de faire ; elle y
allait soigneusement tous les jours faire [400]
ses actes d'adoration. Elle
prenait grand plaisir que l'on chantât à la récréation des noëls que les Sœurs
faisaient ; elle ne se souciait point de la bonne rime pourvu qu'elle y
trouvât de la dévotion ; même elle témoignait prendre plaisir d'en ouïr où
l'on entremêlât quelques traits innocents et récréatifs.
Dès le commencement de l'Institut, elle avait, par l'ordre de notre
Bienheureux Père, établi la coutume qu'on chantât des noëls au chœur, dès le
jour de la Nativité jusqu'au jour des Rois ; pour affairée qu'elle fût,
elle prenait du loisir pour voir et ouïr chanter les noëls qui se devaient
chanter au chœur, afin que l'on n'y en dît que de bien à propos. Une fois
s'étant aperçue qu'une Sœur témoignait de la difficulté de chanter un noël sur
certain air qui, disait-elle, lui peinait l'estomac, cette digne Mère fut fort
touchée de ce défaut, et dit avec grand sentiment de cœur :
« Hélas ! que nous sommes peu dévotes ! nous voyons notre
Seigneur pleurer pour nous, et il nous fâche de souffrir un peu à chanter pour
lui. » Elle avait une affection spéciale que l'on célébrât avec dévotion
la fête de l'Épiphanie, et faisait toujours faire la communion ce jour-là en
action de grâces de ce que Jésus-Christ s'était manifesté à la gentilité.
Le jour de Pâques, tant qu'elle pouvait, elle allait avec la communauté
faire sept stations en l'honneur des sept apparitions, et pour gagner les
indulgences. Le jour de l'Ascension, elle ne manquait point d'aller au chœur
avec la communauté, demi-quart d'heure avant midi, pour accompagner, par
adoration, Notre-Seigneur montant au ciel en son triomphe, et en a établi la
coutume dans nos maisons. Lorsqu'au jour de la Pentecôte, elle avait tiré avec
la communauté le don du Saint Esprit, elle se faisait chercher par après, dans
quelques livres spirituels, l'explication du don qui lui était échu[78] ; et lui étant venu deux années [401]
de suite le don de piété, elle en témoigna une grande joie, disant que la
volonté de Dieu, par ce sort, était qu'elle se rendît bien dévote, et aussi que
nous ne manquions à être bonnes religieuses, que parce que nous manquions à
être vraiment dévotes. Au commencement de chaque année, elle mettait
soigneusement dans ses règles le billet du saint protecteur qui lui était échu
et était celui de l'année précédente, et comme on lui demandait pourquoi elle
prenait ce soin : « Afin, dit-elle, que tous les jours, ouvrant nos
règles, j'honore mon saint protecteur, baisant son nom, et le priant de m'être
protecteur. » C'était une chose admirable, comme pour toutes les actions
de piété, même qui n'étaient pas d'obligation, elle trouvait du loisir ;
nous l'avons vue s'assujettir à venir au noviciat avec une troupe de jeunes
Sœurs, chanter tous les jours, durant les octaves de la Sainte Vierge, le Magnificat
devant son tableau. Tant qu'elle pouvait, elle ne perdait aucune procession
ni autre prière, action et prière de nulle obligation ains de simple
dévotion ; et soit que l'on fût en des actions obligatoires ou volontaires
de piété, elle ne voulait aucunement que l'on fit des actes légers, disant fort
fréquemment qu'il fallait servir Dieu sérieusement et comme Dieu.
Elle ne manquait point, autour des bonnes fêtes et au commencement de
l'année, de nous donner des défis pour la plus parfaite pratique de quelque
vertu et exercice de dévotion, s'as-sujettissant elle-même de marquer ses
fautes et en dire tout haut le nombre, lorsque l'on en rendait compte ;
elle faisait écrire le [402] défi du commencement de l'année dans la chambre
des assemblées, crainte que l'on vînt à l'oublier ; et Sa Charité, après
nous avoir plusieurs fois dit que nous n'étions pas assez fidèles à faire attention
à bien pratiquer nos défis, trouva cette faute digne de nous en faire reprendre
par Monsieur notre très-honoré Père spirituel, en la visite annuelle.
Enfin cette bénite Mère n'oubliait rien de tout ce qui pouvait
contribuer à avancer sa chère âme et celles de ses filles en la piété et
dévotion, et pouvons bien dire que le zèle de la maison de Dieu la dévorait.
Elle souffrait extraordinairement quand elle savait qu'en quelques
monastères la principale étude n'était pas celle de la dévotion, et dit une
fois qu'elle emploierait toutes ses forces afin que l'on s'appliquât si bien à
la dévotion céans, que tout y ressentît la piété et religiosité.
Quel zèle n'avait-elle pas pour la célébration des divins
Offices ! elle en était la grande surveillante, nous reprenant jusqu'aux
moindres petites fautes ; les plus minces cérémonies lui étaient en
vénération ; toute âgée qu'elle était, voyant que nous traînions trop à
l'Office, elle s'efforçait elle-même de soutenir le chœur, afin de nous tirer
de notre défaut. Combien de fois a-t-elle fait assembler dans sa chambre les
jeunes Sœurs ! Ou bien elle allait au noviciat et nous faisait chanter
devant elle, chantant elle-même, nous reprenant et instruisant tout à loisir,
comme si elle n'eût autre chose à faire. Quand elle passait par les monastères,
c'était sa principale surveillance de voir si le divin Office se célébrait avec
l'entière observance du cérémonial, ne s'épargnant point à chanter et beaucoup
parler pour bien instruire ses filles. Elle nous a dit quelquefois qu'au commencement
de notre Institut, notre Bienheureux Père l'ayant reprise de quelques mauvaises
prononciations qu'il avait remarquées d'elle à l'Office, et ayant une extrême
peine à prononcer autrement, elle avait passé quelques nuits sans pouvoir
dormir, pour l'extrême désir qu'elle avait de bien dire [403] l'Office,
prononçant tant et tant de fois à part soi les mots esquels elle avait des
difficultés, qu'elle s'y habitua.
Jusques à sa soixante et dixième année que Dieu l'appela pour chanter
les louanges de sa divine Majesté dans le ciel, elle n'a jamais manqué à faire
l'Office aux grandes fêtes de Notre-Seigneur, de Notre-Dame, de saint Joseph,
de saint Augustin, de la Dédicace, les jours de Ténèbres, sinon lorsqu'elle en
était empêchée par maladie, ou qu'il y avait une autre supérieure ; alors
elle se tenait en son petit coin de déposée ; encore ès derniers mois de
sa vie, elle officia en notre monastère de Moulins en qualité de la plus
ancienne religieuse de la maison, ce qui est une ordonnance du Coutumier, quant
on a bonne voix. Cette Bienheureuse l'avait si bonne et si agréable, qu'elle
donnait de la dévotion de l'ouïr chanter.
Quoique l'action du lavement des pieds soit fort pénible dans les
grandes communautés, à cause qu'il faut si souvent se mettre à genoux et se
relever, notre digne Mère, malgré son grand âge, ne s'en dispensait point,
lavant et baisant les pieds des Sœurs avec une dévotion qui rejaillissait sur
son visage ; cette même dévotion et révérence paraissait en elle dans
toutes les plus petites actions de piété, comme lorsqu'elle accomplissait des
pénitences au réfectoire, où d'ordinaire, les veilles de grandes fêtes, elle
faisait une prière tout haut, les bras en croix, priant Notre-Seigneur, par les
mérites du mystère que l'Église célébrait, de pardonner les péchés de son
peuple, de lui faire miséricorde, de nous faire la grâce de nous départir la
fidélité en son saint amour et en nos observances ; et autres demandes
qu'elle faisait avec des brièves paroles, mais très-ferventes, humbles et dévotes.
Elle avait aussi un zèle particulier pour l'ornement des autels et de
l'église ; il n'y avait point d'office en la maison sur lequel elle eût
l'œil si ouvert que sur celui de la sacristaine. Sa plus ordinaire besogne
était de lascer des voiles de calices pour nos [404] maisons qui le désiraient,
ou des dentelles, dont elle a lascé une grande quantité ; en un été, elle
fît, nonobstant toutes ses affaires, un pavillon, un devant d'autel avec la
crédence, qu'elle faisait recouvrir de laine et de soie ; et se dépêchait
si fort qu'elle se retrancha sa demi-heure de repos que la règle nous permet
l'été, après midi, parce qu'elle désirait que, dans une octave de la Sainte
Vierge, l'autel fût paré de son ouvrage. Ce parement étant fort simple et
agréable, elle en lasça aussi un avec les rideaux et le dais pour le tombeau de
notre Bienheureux Père, et dit avec un profond rabaisssement : « J'ai
eu l'honneur de filer les habits de ce Bienheureux tandis qu'il était en vie,
ce m'est encore consolation de travailler pour orner son sépulcre. » Elle
fila de la serge violette pour faire un parement au tombeau de notre
Bienheureux Père et un ornement à son oratoire. Non-seulement elle avait soin
de notre église, mais encore des paroisses de villages quand elle savait qu'il y
avait de la nécessité, y faisant faire des corporaux et certaines petites
boîtes fort propres, en forme de custode, pour tenir le Saint-Sacrement.
CHAPITRE X.
de sa dévotion au
saint-sacrement, à la messe et dans la communion.
La dévotion et révérence que cette Bienheureuse Mère avait au
très-saint Sacrement de l'autel ne se pourrait exprimer ; elle portait
toujours en écrit sur soi une action de grâces à Notre-Seigneur, de l'avoir
admise à la participation journalière de son très-saint corps. Elle a persévéré
trente et un ans, par ordre de notre Bienheureux Père, à communier tous les
jours ; et tant s'en faut que la fréquence engendrât la négligence ni la
familiarité ou le mépris, son soin, son amour et sa dévotion croissaient tous
les jours. Elle dit un jour à notre chère Mère de Blonay qu'elle avait grande
envie de demander permission de se confesser tous les jours pour se purifier,
puisque tous les jours elle se mettait à la Table des anges, mais qu'elle
n'avait osé le faire, parce que notre Bienheureux Père l'avait fait communier
tous les jours sans lui ordonner de se confesser plus de deux fois la semaine,
la priant, en qualité de sa supérieure, de lui ordonner si elle devait se
confesser tous les jours ou non. Notre chère Mère lui ayant répondu qu'elle
croyait qu'elle devait suivre le train auquel notre Bienheureux Père l'avait
mise, elle s'arrêta à cet avis.
Dès le commencement de sa dévotion, elle avait eu un soin nonpareil de
se disposer, avec une préparation toute extraordinaire, à la sainte communion ;
plus tard, notre Bienheureux Père lui dressa une méthode particulière, dans
laquelle son [406] âme s'allait toujours simplifiant et épurant. Il lui donna
l'exercice de la sainte communion, que nous avons encore aujourd'hui dans
l'Institut, en notre directoire spirituel ; et enfin l'amour unique et
unissant la priva de toutes méthodes pour ce Saint Sacrement ; la seule
foi lui suffisait.
Elle avait une affection nonpareille d'assister au saint sacrifice de
la messe, et il fallait que les affaires fussent extrêmement pressées, pour
l'empêcher d'ouïr, soit en hiver, soit en été, deux messes les jours de fêtes.
Ayant appris qu'une de nos maisons était en telle pauvreté, que les Sœurs
n'entendaient messe que les fêtes, faute d'avoir de quoi payer un prêtre, Sa
Charité en témoigna une très-grande douleur de cœur, et leur envoya soudain de
quoi payer un prêtre pour un an ; avec prières que, si, l'année suivante,
elles étaient dans la même nécessité, elles l'en avertissent, et qu'elle leur
enverrait encore une somme pour avoir la messe, disant que jamais nécessité
d'aucune maison ne l'avait tant touchée comme celle-là, et qu'elle sentait une
douleur sensible de savoir des filles de la Visitation privées d'assister tous
les jours à ce sacrifice de vie et d'amour.
Écrivant à une de nos Sœurs qui allait commencer une de nos maisons,
elle lui dit les paroles suivantes : « Je vous supplie, ma très-chère
fille, que la première chose à laquelle vous mettrez ordre, dès que vous serez
arrivée, que ce soit à votre chapelle, et que vous ayez messe tous les
jours ; que si les choses ne sont pas en état, et que vous ne la puissiez
pas savoir en votre maison, allez l'entendre, avec grande modestie, en l'église
la plus proche ; c'est un grand soutien à l'âme pour tout le reste du
jour, d'avoir été le matin si près de son Sauveur réellement présent au divin
sacrifice. »
Écrivant à une directrice, elle disait : « Avant toutes
choses, ma très-chère fille, que votre soin premier et principal soit
d'apprendre à vos novices à faire le plus purement et parfaitement qu'il se
pourra l'exercice de la sainte messe et [407] communion ; ces deux actions
sont les plus hautes que nous saurions faire. Donnez-leur intelligence que,
demandant à être reçues, elles ont demandé d'habiter en la maison du
Seigneur ; cela se doit entendre de faire séjour en la même maison où le
Saint-Sacrement repose. Cette présence sacrée rend les monastères les maisons
du Seigneur ; faites-leur peser cette grâce au poids du sanctuaire ;
qu'elles fassent souvent des considérations à l'entour de ce très-Saint
Sacrement, afin qu'à l'imitation de ce bon Sauveur, elles apprennent à
s'anéantir totalement, et à vouloir vivre cachées comme il est caché. Enfin,
donnez-leur beaucoup de chaleur de ce côté-là, et je vous supplie, menez une
fois toutes ces chères filles devant le Saint-Sacrement, l'adorer à mon
intention, et lui demander pardon du mauvais usage que j'en fais. »
Elle avait en si haute estime les prières que les prêtres font pour le
prochain à la sainte messe, qu'elle n'écrivit jamais à aucun prêtre qu'elle ne
le priât de se souvenir d'elle au saint sacrifice de la messe. Une fois, un
révérend Père de l'Oratoire lui écrivant qu'il tenait fidèlement la promesse
qu'il lui avait faite de se souvenir tous les jours d'elle à la sainte messe,
elle dit avec grand sentiment que cette promesse lui était plus chère que si
tous les rois de la terre lui promettaient de la couronner et la rendre
souveraine du monde. Elle honorait extrêmement les prêtres, en parlant toujours
avec respect, et, comme elle se trouvait souvent en des rencontres où on lui
demandait sa bénédiction, jamais elle ne se laissait vaincre, sinon que le
prêtre lui commandât de la donner ; encore fallait-il qu'il se retirât un
peu, disant qu'il n'appartenait à personne de donner des bénédictions quand il
y avait un prêtre ; que cela était dû à leur dignité. Un jeune homme lui
communiquant un jour le dessein qu'il avait de se faire d'Église, elle lui
dit : « Voilà le plus grand et le plus digne dessein que vous puissiez
jamais faire ; mais prenez de fortes résolutions de ne pas vivre en homme,
[408] si vous voulez faire un office plus relevé que celui des anges ;
l'on ne peut, sans grand danger de son salut, servir le monde et
l'autel. »
Lorsqu'on l'avertissait de quelques fautes commises au chœur, ou du
manquement de tranquillité, d'ordinaire notre digne Mère alléguait où était
notre attention de faire tels défauts en la présence du Saint-Sacrement. Elle
avait une telle envie que l'on se tînt avec un respect religieux devant le
Saint-Sacrement, que même il fut un temps qu'elle avait établi le silence
devant la porte du chœur, pour nous y donner plus d'attention.
Durant les octaves du Saint-Sacrement, et toujours quand il était
exposé, cette Bienheureuse se tenait au chœur le plus qu'elle pouvait ; et
notre très-honorée Mère de Blonay étant arrivée en ce monastère, l'année 1641,
dans l'octave du Saint-Sacrement, elle était étonnée de voir cette digne Mère
si assidue au chœur, et lui dit : « Ma Mère, je vous assure que vous
me lassez seulement de vous voir tenir tant à genoux » ; la
Bienheureuse lui repartit gracieusement : « Ma chère Mère, c'est par
charité que vous vous lassez de me voir ; mais moi, je ne me lasse point,
c'est tout mon plaisir en cette vie d'être un peu devant le
Saint-Sacrement. »
Notre chère Mère admirait aussi que cette Bienheureuse, avec son
estomac faible et usé, ne manquait jamais de chanter à la communion et aux
bénédictions avec le chœur, prévoyant à l'avantage ce qu'il fallait chanter,
afin de ne pas feuilleter dans ses heures, et pour suivre en cela l'observance.
Elle avait un très-grand plaisir de répondre aux litanies du
très-Saint-Sacrement, et nous dit une fois qu'elle voudrait bien, si nous nous
trouvions à sa mort, qu'on les lui chantât devant son lit, et qu'on lui fit
répéter souvent ces deux versets : Mysterium fidei et Manna
absconditum.[79] [409]
Elle avait un grand soin qu'il y eût de belles fleurs au jardin et
qu'on les conservât pour les mettre devant le Saint-Sacrement. Tous les
dimanches et fêtes, les Sœurs jardinières avaient accoutumé de lui donner un
bouquet pour le porter en sa main, pensant la récréer, mais toujours elle
faisait appeler la Sœur sacristaine, et envoyait mettre ce bouquet dans une
fiole d'eau, et, lorsqu'on lui en donnait un nouveau, elle l'envoyait derechef
devant le Saint-Sacrement, se faisant rendre le précédent, qu'elle gardait aux
pieds de son crucifix, dans sa cellule ; et quand il était du tout flétri,
le serrait en sa layette. Quand elle en avait fait amas, elle les faisait
brûler, par respect et par crainte qu'on ne les jetât dans un lieu indécent.
Elle n'était point sans avoir de ces bouquets séchés devant le Saint-Sacrement,
c'était sa pratique constante. Une Sœur s'enhardit un jour de lui demander
instamment pourquoi elle faisait cela, cette Bienheureuse lui répondit :
« Mes pensées ne méritent pas d'être dites. » La Sœur la pressant
derechef : « Ma fille, lui dit-elle, la couleur et l'odeur sont la
vie de ces fleurs ; je les envoie devant le Saint-Sacrement où peu à peu
elles flétrissent, se passent et meurent : je désire d'être ainsi, et que
ma vie, qui se va passant peu à peu, se finisse devant Dieu, en honorant le
mystère de la très-sainte Église. » Une autrefois, cette Sœur étant
travaillée de peines intérieures, notre Bienheureuse Mère lui donna la moitié
du bouquet flétri qu'on venait de lui apporter de devant le Saint-Sacrement, et
lui dit : « Ma fille, pliez cela dans du papier et le mettez sur
votre cœur en révérence du Saint-Sacrement ; j'ai quelquefois été soulagée
en mes peines par ce remède. »
Cette Bienheureuse Mère ayant ouï chanter un cantique fait sur les
litanies du Saint-Sacrement, elle le fit souvent répéter aux récréations et se
le faisait apporter en particulier. Elle en fit copier trois couplets sur un
bout de papier, pour les apprendre par cœur, et dit que cette nuit-là elle
s'était réveillée [410] cinq fois avec douleur, répétant toujours cette reprise
d'un couplet :
Ah ! suprême bonté ! cet amoureux repas,
Me doit anéantir et je ne le suis pas !
ajoutant que c'était une grande confusion à
l'âme de recevoir si souvent son Dieu et ne point vivre conformément à la
divine viande dont elle est nourrie. Elle nous exhortait souvent à profiter de
la communion, et n'aimait point que l'on multipliât les communions générales
dans les communautés, à cause de la diversité des dispositions.
CHAPITRE XI.
de sa dévotion et
confiance envers la sainte vierge.
Jamais notre Bienheureuse Mère n'avait connu d'autre mère que la
très-Sainte Vierge, puisque étant demeurée orpheline de mère au berceau, dès
qu'elle eut l'usage de la raison, elle se voua à la Sainte Vierge pour être sa
fille, et la prit pour Mère ; aussi elle rendait tous les jours grâces à
cette Sainte Vierge des assistances et faveurs qu'elle avait reçues d'elle en
sa jeunesse, comme l'ayant conduite, détournée de plusieurs dangers, et fait
éviter de grandes occasions de se perdre.
Lorsqu'elle fut mariée, c'était une grande partie de sa dévotion de se
recommander elle, son ménage et ses affaires à la Sainte Vierge ; et après
la crainte de Dieu, elle n'avait rien tant à cœur que d'élever ses enfants en
la dévotion et confiance envers cette Sainte Mère. Lorsqu'elle fut veuve, ne
pouvant pas être sitôt religieuse, à cause de la charge de ses enfants, elle
dressa un monastère en son intérieur, duquel la très-sacrée Vierge était
Abbesse ; elle l'honorait, l'écoutait, et suivait sa direction, et l'on
voit en diverses épîtres que notre Bienheureux Père lui recommandait toujours
de se tenir bien proche de sa Sainte Abbesse au mont de Calvaire :
« Gardez-bien, ma chère fille, la clôture de votre couvent, n'en sortez
point sans la licence de Madame votre Sainte Abbesse, obéissez-lui bien, elle
ne veut autre chose de vous, sinon que vous fassiez ce que son Fils vous
dira. »
Notre Bienheureuse Mère, pour avoir une marque de [412] servitude
perpétuelle à la sacrée Vierge, s'obligea par vœu de dire tous les jours son
chapelet, c'est-à-dire la couronne de six dizaines, à quoi elle a persévéré
toute sa vie, employant à cela, chaque jour, une bonne demi-heure. En une
grande maladie qu'elle fit, en laquelle même elle ne pouvait pas dire son
Office, elle pria six de ses filles qu'après avoir dit leur chapelet, elles
ajoutassent encore une dizaine à son intention, afin que par elle, ou par
autrui, de sa part, cette couronne fût tous les jours offerte à la Reine du
ciel. Elle disait encore tous les jours la petite couronne de douze Ave
Maria, et en donna la licence générale à celles qui la voudraient dire,
pourvu que cela se fît sans obligation, ni sans scrupule quand on ne le ferait
pas.
Lorsque notre Bienheureux Père lui eut déclaré le dessein qu'il avait
de l'employer à ériger une Congrégation, il lui dit qu'il avait pensé qu'elle
se nommerait la Congrégation de Sainte-Marthe, et quand il lui écrivait, il
disait : « Sainte Marthe, notre chère maîtresse. » Quoiqu'elle
eût grande dévotion à cette sainte hôtesse de Notre-Seigneur, son cœur sentait
un peu de résistance de n'être pas entièrement sous la protection de la
très-Sainte Vierge ; mais elle n'en dit jamais mot, se tenant si
absolument à l'obéissance, qu'elle ne faisait nul état de ses propres
pensées ; mais elle pria beaucoup Dieu de découvrir sa volonté là-dessus à
notre Bienheureux Père, lequel un matin, lorsqu'elle y pensait le moins, lui
vint dire avec un visage tout gai, que Dieu lui avait fait changer d'avis, et
que nous nous appellerions les Filles de la Visitation ; qu'il
choisissait ce mystère, parce que c'était un mystère caché, et qu'il n'était
pas célébré solennellement en l'Église comme les autres, qu'au moins il le
serait en notre Congrégation ; ce qui donna une très-grande joie à notre
Bienheureuse Mère, et elle inculqua tellement la dévotion à la Sainte Vierge à
nos premières Sœurs, et en parlait si souvent aux malades qu'elle allait
visiter et servir, que par un mouvement commun des petits enfants et du peuple,
[413] l'on nous nomma les Religieuses de Sainte-Marie, nom qui nous est
toujours demeuré depuis.
Quand les fêtes de la très-Sainte Vierge approchaient, au chapitre et
aux récréations, notre digne Mère nous invitait fort à les célébrer dévotement.
Il se passait peu de fêtes de la Sainte Vierge qu'elle ne fît chanter aux
récréations quelques cantiques en son honneur, et se joignait souvent, aux
jours de ses grandes fêtes, avec les novices ou autres Sœurs, pour aller
chanter devant un tableau de la Sainte Vierge, ou le Magnificat ou l’Ave
maris Stella, ayant grande dévotion à répéter trois fois ce verset : Monstra
te esse matrem. Pour les nécessités publiques ou autres besoins, elle
faisait volontiers faire des neuvaines et des processions à la très-Sainte
Vierge ; elle recommandait aux directrices d'inculquer fort aux novices la
dévotion à la Mère de Dieu.
Entre toutes les fêtes de la Sainte Vierge, elle a témoigné une
affection incomparable à son Immaculée-Conception, et a témoigné un zèle
extraordinaire pour procurer que Monseigneur de Genève la fit chômer en son
diocèse, lui en ayant parlé diverses fois, et fait parler par des personnes
qu'elle voyait avoir crédit auprès de sa seigneurie. Voyant qu'elle ne pouvait
venir à bout de son dessein, elle pria fort humblement et instamment Monsieur
notre très-honoré Père spirituel, doyen de Notre-Dame, qu'il l'a fit célébrer
bien solennellement dans son église, ce qu'il lui promit, et cette Bienheureuse
Mère nous dit avec une joie extraordinaire : « Notre bon Monsieur le
doyen m'a toute réjouie, car il m'a dit que, quand il devrait lui-même aller
sonner la grosse cloche de Notre-Dame, qu'il fera sonner pour la fête de
l'Immaculée-Conception comme pour les grandes fêtes. »
Écrivant à un seigneur Abbé, elle dit ces mots sur la fin de sa
lettre : « Au reste, mon très-cher Frère, j'ai une grâce à vous
demander, c'est qu'il vous plaise m'accorder qu'en votre [414] abbaye et dans
les prieurés qui en dépendent, vous fassiez célébrer la fête de
l'Immaculée-Conception de la Mère de Dieu, avec la solennité que l'on observe
aux autres fêtes de Notre-Dame, et qu'il y ait sermon pour émouvoir le peuple à
révérer cette très-Immaculée-Conception : je m'estimerais heureuse de
donner ma vie pour la soutenir. » Une Sœur demanda congé à notre
Bienheureuse Mère de dire le chapelet de la Conception neuf jours avant et neuf
après la fête de l'Imma-culée-Conceplion. Cette digne Mère se le fit apprendre
et dit qu'elle le dirait aussi ces deux neuvaines, et quelquefois les fêtes
(ajouta-t-elle) quand j'en aurai le loisir. »
Assez souvent, dans les rencontres d'afflictions, cette Bienheureuse
disait : « Ayons recours à Notre-Dame ; » et en sa solitude
de 1640, elle fit écrire une oraison à cette Sainte Vierge, pour lui demander
secours en ses peines intérieures, et la dicta à une Sœur, à genoux devant son
crucifix, en ces propres termes : « Souvenez-vous, ô très-pitoyable
Vierge ! que jamais personne n'a eu recours à vous, qu'elle n'aie ressenti
les effets de vos bontés ; en cette confiance, ô Vierge des Vierges !
je me présente devant vous, avec un très-véhément désir que vous daigniez
regarder mon intérieure misère ; et dans ce regard, ô Vierge
pitoyable ! usez de votre autorité maternelle envers votre divin Fils, et
faites qu'il m'accorde non la délivrance de ma peine, si ce n'est sa volonté,
mais la grâce de vivre en sa crainte, et qu'il fasse de moi son éternel bon
plaisir, auquel, entre vos sacrées mains, je me sacrifie derechef, en union du
sacrifice que vous fîtes de vous-même au jour de votre Immaculée-Conception, de
laquelle je veux bénir à jamais le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. »
Elle demeura assez longtemps à faire écrire cette oraison, ne voulant
mettre en icelle aucune parole qui ne fut très-désintéressée ; lorsque la
Sœur l'eut mise au net, cette Bienheureuse la serra en son sein et dit :
« J'ai envie de dire cette oraison [415] neuf mois durant ; j'en
demanderai congé à Monsieur le doyen la première fois que je le verrai. »
La Sœur lui demanda si elle ne pouvait pas faire cela d'elle-même ? »
« Si une de nos Sœurs, répondit cette Bienheureuse, voulait faire quelques
prières journalières, elle m'en demanderait permission ; n'est-il pas bien
raisonnable que je le demande au Supérieur ? Possible que la Sainte Vierge
ne m'écoutera, que parce que je lui parlerai par obéissance ? » Nous
avons su de Monsieur notre Père spirituel, que notre Bienheureuse lui avait demandé
cette licence, lui disant, avec grande simplicité, que c'était pour quelques
peines intérieures sur lesquelles il ne voulut pas l'interroger pour le grand
respect qu'elle lui portait.
Une fois cette Bienheureuse Mère étant en solitude, trois Sœurs
allèrent la trouver ensemble pour lui demander quelques permissions ; elle
était les bras croisés devant une image de la Sainte Vierge : au lieu de
donner aux Sœurs le congé qu'elles lui demandaient de faire quelques austérités
corporelles, elle leur ordonna de faire un quart d'heure d'oraison, chaque jour
de leur solitude, devant une image de Notre-Dame, et tirant de sa manche un
livret qu'elle avait écrit de sa main, où étaient en français les litanies de
la Sainte Vierge, elle leur dit : « Voyez, mes filles, comme nous avons
tout en Marie, et avec quel soin et confiance nous devons recourir à
elle : si nous sommes enfants, elle est Mère ; si nous sommes
faibles, elle est Vierge puissante ; si nous avons besoin de grâces, elle
est Mère de la divine grâce ; si nous sommes en ignorance, elle est le
siège de la sapience ; si nous sommes tristes, elle est une cause de joie
à toute la terre » ; et ainsi poursuivit tous les versets des
litanies, après quoi elle renvoya les Sœurs, leur demandant qu'elles priassent fort
la Sainte Vierge pour elle. Une des Sœurs lui répondit : « Quelle
prière faut-il faire ? » « Ma fille, dit-elle, l'on fait une
prière fort agréable à la Sainte Vierge, quand on loue Dieu des grandeurs qu'il
a mises en [416] elle, et du choix qu'il a fait d'elle pour être sa digne et
vraie Mère. »
Étant si dévote à la très-Sainte Vierge, elle l'était par une
conséquence infaillible à son chaste époux, le glorieux saint Joseph ;
aussi, avons-nous trouvé en écrit que, lorsqu'elle en parlait à notre
Bienheureux Père, elle disait : « Ce cher saint que notre cœur
aime. » Cette Bienheureuse Mère se mit et nous fit mettre de l'association
de Saint-Joseph, et avait grand soin que les seconds dimanches du mois l'on fît
la sainte communion et la procession, pour les canadiens, à l'honneur de saint
Joseph ; elle avait une petite image de Jésus, Marie et Joseph, qu'elle
portait en son livre des règles ; nous la montrant une fois, elle
dit : « Tous les jours, lorsque je commence notre lecture, je baise
les pieds à Jésus, Marie, Joseph ; mais parce qu'il y a à notre image un
démon peint sous leurs pieds, et que je ne les puis baiser sans baiser cette
laide bête, je prierai Monsieur le doyen d'y passer un peu de peinture, pour
effacer celui qui nous voudrait effacer du livre de Dieu. »
Elle allait tous les jours, sans y manquer, prier devant le tableau de
saint Joseph, qui est sur l'autel du chapitre. La veille du jour qu'elle partit
pour aller en Piémont, en l'année 1638, une Sœur alla l'attendre au chapitre,
et la pria de lui dire quelles prières elle faisait tous les jours devant ce
tableau, afin que, pendant son absence, elle les vînt faire en sa place ;
cette Sainte en témoigna grande joie, et lui dit : « Je vous en prie,
ma fille, venez-y pour moi ; je dis un Laudate Dominum, omnes gentes, un
Ave Maria et un Gloria Patri, pour rendre grâces à la
Trinité éternelle de toutes les grandeurs, grâces et privilèges qui ont été
donnés à la Trinité terrestre, non que je fasse tous les jours des actes
nouveaux, mais je les ai faits une fois pour toutes, faites-en ainsi. »
La dernière fois que cette Bienheureuse Mère alla à notre monastère de
Thonon, elle pria une Sœur de lui donner la copie [417] d'un cantique qui avait
été fait en l'honneur de saint Joseph, et qu'elle le lui apportât quand elle
monterait en litière, ce que la Sœur fit, et cette Bienheureuse lui dit
amiablement : « Grand merci », ajoutant qu'elle avait
envie de faire ce petit voyage avec ce grand Saint. Elle dit une fois qu'elle
avait envie de prier, dans sa lettre commune qu'elle voulait faire et qu'elle
n'a pas faite, toutes les supérieures de procurer que chacune de leurs filles
eût une image de Jésus, Marie, Joseph, et une de notre Bienheureux Père, pour
la porter toujours sur elles ; car, disait-elle, il me semble qu'il fait si
grand bien d'avoir toujours ses bons amis avec soi. »
Une fois, approchant d'un des petits autels des oratoires de la maison,
et y voyant une image de saint Joseph tenant le petit Jésus, elle fit encore
apporter une image de la Sainte-Vierge, et dit : « Quand Jésus, Marie
et Joseph ne sont pas sur un autel, je n'y trouve pas tout ce que j'y
cherche. »
Quelques-unes de nos Sœurs les supérieures ayant écrit à notre
Bienheureuse Mère pour lui demander si elles pouvaient prêter leur église aux
associés de Saint-Joseph, pour y prêcher tous les seconds dimanches du mois, et
y faire les fonctions de la confrérie, elle répondit « que oui, et
qu'elles devaient tenir à grand honneur et faveur que leur église fût choisie
pour honorer celui que Dieu avait tant honoré ; mais qu'elles priassent
les prieurs et prieures de l'association de prendre leur temps, en sorte que,
tant qu'il se pourrait, l'on dit l'Office à l'heure ordonnée par la
constitution. »
D'ordinaire, quand on parlait de la dévotion à la Sainte Vierge, à saint
Joseph et aux saints, notre Bienheureuse Mère nous instruisait que la dévotion
qui leur était le plus agréable, c'était l'imitation, et que la Sainte Vierge
et les saints avaient plus agréable que l'on fit à leur imitation un acte
d'humilité, de support du prochain, d'oubli et renoncement de soi-même, que de
leur faire de grandes prières vocales.
CHAPITRE XII.
de sa dévotion au bon
ange et aux saints.
Comme nous avons dit ci-dessus, notre Bienheureuse Mère avait une
dévotion particulière aux Apôtres, aux Martyrs et à ces grands saints des
premiers siècles, qui ont planté et soutenu la foi par leur sang et leurs
travaux ; elle avait fait des litanies de ces saints protecteurs et
protectrices, les invoquant quelquefois l'un après l'autre, mais d'ordinaire,
elle les invoquait plutôt virtuellement qu'actuellement.
Elle avouait qu'elle n'avait pas inclination que, sous prétexte d'union
avec Dieu, on négligeai la dévotion des saints, lesquels au moins il faut
honorer par une intention générale, et qu'encore qu'il y ait des temps où l'âme
ne peut agir, ni avoir autre souvenance que de Dieu seul, il y aura aussi des
temps qu'elle aura non-seulement prou de liberté, mais prou de nécessité de
recourir aux saints et aux saintes.
Une de nos supérieures ayant une fois écrit à cette Bienheureuse Mère
qu'il y avait une novice tellement attirée à la contemplation simple de Dieu
seul, qu'elle ne pouvait pas même invoquer les saints à son exercice du matin,
cette Bienheureuse répondit « qu'il y avait de la tromperie là dedans ;
qu'il fallait bien examiner cette fille, et lui apprendre que, pour quelque
favori que l'on soit auprès du roi, il y a toujours des temps et des affaires
où l'on a besoin des officiers de la couronne » ; « nous avons,
ajouta-t-elle, une Sœur conduite par une voie des plus simples, et épurée de
tout images et actes, que j'ai vu, mais [419 je ne laisse pas de lui faire
gagner des indulgences et faire des prières aux saints, et si je lui avais dit
de réciter tous les matins la grande oraison à tous les saints, elle le ferait
sans préjudice quelconque de l'unique simplicité de son attrait. Ordonnez
quelquefois à cette novice de réciter les litanies des saints ; que si
elle dit ne le pouvoir faire, tenez-la pour bien suspecte ; remettez-la
entre les mains de quelque personne docte, et qu'on la sonde bien
profondément. » Le conseil de cette Bienheureuse fut suivi, et l'on trouva
que cette novice étant une jeune fille convertie assez nouvellement, le diable
lui donnait cet endormissement de contemplation feinte, pour la retenir dans
cette erreur qu'il ne faut pas invoquer les saints, et qu'il tenait encore son
âme par ce filet détestable qui fut rompu par les avis de notre Bienheureuse
Mère, à laquelle, quand on en écrivit derechef, elle nous dit : « Je
vous assure que je n'osais rien dire, sinon que l'on sondât et interrogeât
cette fille ; mais je sentais en mon cœur que cette âme n'était pas bien
purgée du levain des hérétiques. » Ce qui est notable, c'est que notre
Bienheureuse Mère, quand elle avait ce sentiment et fit cette première réponse,
elle ne savait pas que cette fille eût jamais été de la religion réformée. Elle
ordonna qu'on lui fit dire tout au long de son noviciat les litanies des saints
tous les jours ; par ce remède, elle fut totalement guérie de cette plaie
et est une très-vertueuse religieuse.
Comme nous avons dit ci-dessus, dans les premiers exercices que notre
Bienheureux Père donna à cette digne Mère, il lui avait appris à visiter tous
les matins l'Église triomphante ; elle a gardé cette pratique toute sa
vie, et tous les jours, après son exercice du matin, elle disait cette petite
oraison du bréviaire : Sancta Maria, et omnes Sancti, intercedite pro
nobis ad Dominum, ut nos mereamur ab eo adjuvari, et salutari, qui vivit et
regnat in secula seculorum. Elle avait écrit de sa main, dans son petit
livret, des oraisons à saint Jean-Baptiste et à saint Jean [420] l'Évangéliste,
aux deux saints François d'Assise et de Paule, et une petite à saint Bernard,
qui était son grand saint, et duquel elle se plaisait extraordinairement de
lire les écrits, singulièrement lorsque ce saint traite de la très-Sainte
Vierge, et ses sermons sur le Cantique des cantiques. Elle s'en fit apporter un
livre relié à part, pour s'en pouvoir servir plus facilement et ordonna que
l'on tint toujours céans, au chapitre, le tome où toutes les œuvres de saint
Bernard sont ensemble, afin que, les fêtes et les autres jours, pendant le
temps assigné à la lecture, les Sœurs qui voudraient y allassent lire, disant
que, « quoiqu'elle honorât grandement tous les traités de piété,
néanmoins, elle trouvait un goût et un avantage particulier à lire ou la vie
des saints ou l'ouvrage des saints, d'autant que cette lecture incite le cœur à
les imiter, à les invoquer, et la prière sollicite les saints de nous
assister. »
Quand on avait lu la vie de quelque saint à table, cette Bienheureuse
Mère en parlait aux récréations avec tant d'honneur et d'amour, qu'on eût dit
qu'elle n'aimait que celui-là d'une singulière dévotion ; ce qui faisait
que nous récréant avec Sa Charité, selon que sa sainte bonté nous en donnait la
confiance, nous lui disions qu'elle devait bien avoir du crédit à la cour
céleste, puisqu'elle y avait tant de connaissances et de bons amis ; à
quoi elle répondait par quelques courtes paroles, toujours tendantes à
l'humilité.
La dévotion qu'elle portait à son bon Ange lui fit ordonner que l'on
collât, à chaque porte des cellules, une image de l'Ange gardien, afin que les
Sœurs, entrant et sortant de leurs cellules, se souvinssent de le saluer. Elle
nous a enseigné, dans ses Réponses, de demander souvent conseil à nos
bons Anges de ce que nous devons faire en diverses occurrences, et leur
demander pardon quand on a failli.
Elle dit une fois « que nous devions, par la continuelle présence
de Dieu, avoir cette similitude avec notre bon Ange, de [421] voir toujours
présente par la foi la face du Père céleste qu'il voit à découvert au
ciel. » Allant une fois en voyage, elle dit à sa compagne : « Ma
fille, accoutumons-nous, en entrant dans nos maisons, à saluer les bons Anges
qui en ont le soin, et, en sortant, de prendre leur bénédiction et leur
recommander ces chères communautés. » Elle chantait assez souvent ces
versets de David,[80] traduits par Desportes, et les avait en
écrit dans son livret :
Aux Anges qui font ses messages
Il a fait ce commandement,
Qu'en quelque part que tu voyages,
Ils te gardent soigneusement ;
Voire de peur que d'avanture
Ton pied ne vienne à se grever,
Chopant contre la pierre dure
Leurs mains te voudront soulever.
Nous parlerons en un autre endroit de l'incomparable dévotion que cette
Bienheureuse portait à notre Bienheureux Père, mais dévotion affective et
effective, qui a fait dire à notre très-honoré Père spirituel cette belle
parole : « Que la vie de notre Bienheureuse Mère était une copie
fidèle de la vie de notre Bienheureux Père. »
CHAPITRE XIII.
de son amour à la
pauvreté
Je joins le discours de la pauvreté de notre Bienheureuse Mère à celui
de sa piété et dévotion, parce que j'ai appris d'un saint religieux que l'âme
qui est bien dénuée de tout, et qui ne tient compte des choses de ce monde,
fait une oraison très-pure.
Le désir de l'imitation parfaite de Notre-Seigneur fit quitter à notre
Bienheureuse Mère son pays, sa maison, ses richesses, pour se rendre pauvre à
l'exemple de Notre-Seigneur, et le commencement de notre Congrégation se fit
avec un tel dénûment des biens de la terre, que cela ne se saurait
exprimer ; en sorte que la pauvreté de notre Bienheureuse Mère était
vraiment une pauvreté d'élection et purement volontaire, mais conjointement,
une pauvreté nécessaire, puisqu'elle n'avait que cela, et que, suivant la
conduite de l'amour, elle s'était volontairement laissé mener dans cet état de
vie pauvre, dénuée de toutes commodités.
Avant que la Congrégation fit les vœux solennels, notre Bienheureuse
Mère, comme nous l'avons dit ci-dessus, fit en particulier vœu de pauvreté
entre les mains de notre Bienheureux Père, et elle avait accoutumé de dire
« que lorsqu'elle pensait au vœu de pauvreté, elle eût volontiers tremblé
de crainte, tant elle voyait qu'il était facile d'y commettre des
défauts ; elle avait si peur d'en commettre, qu'en tout elle était sur ses
gardes ».
Il fut un temps qu'elle gardait une montre, quelques reliques et choses
semblables qui peuvent être licitement gardées par [423] une supérieure, mais
elle en eut scrupule, et se défit tellement de tout, qu'elle ne laissa chose
quelconque en sa cellule, que comme les autres Sœurs ; même avait soin de
temps en temps de regarder dans sa chambre si la Sœur qui y couchait pour
l'assister en ses incommodités, à cause de son âge, ne tenait rien de superflu,
et trouvant quelquefois qu'elle avait deux mouchoirs blancs de réserve, parce
que souvent elle était enrhumée, cette Bienheureuse Mère en allait rendre un à
la Sœur lingère, disant : « Ma Sœur Jeanne-Thérèse n'est jamais
contente s'il n'y a quelque chose de réserve, et moi je désire que, pour moi
comme pour les autres, l'on vienne prendre à la communauté ce qui est
nécessaire. »
Cette chère Sœur avait quelques coussins et serviettes pour le service
de notre Bienheureuse Mère, lorsqu'elle se trouvait mal ; s'en étant
aperçue, elle fît porter le tout à l'infirmerie, ne voulant point ces
particularités, ains que l'infirmière lui donnât comme aux autres ce qu'elle
aurait besoin.
Elle s'aperçut aussi que l'on avait un coffre particulier, où l'on
tenait ses habits ; elle en fut mortifiée et le fit porter à la roberie,
priant pour l'amour de Dieu, et à mains jointes, qu'on lui donnât ce
contentement de tout mettre en commun. Elle disait quelquefois qu'elle avait de
la consolation à penser qu'elle était plus particulièrement vêtue, et nourrie
d'aumônes, parce que Monseigneur de Bourges, son frère, lui donnait par charité
une pension viagère, et que nos monastères lui envoyaient aussi une partie de
ses habits ; elle aimait grandement à les porter rapiécés et bien vieux,
« pourvu, disait-elle, qu'ils fussent nets. » Elle pria une fois, à
mains jointes, une robière de lui laisser encore porter son voile, où il y avait
déjà, compte fait, quatorze à quinze pièces ; elle usait d'ordinaire ce
qu'elle avait une fois commencé, jusqu'au bout. Une de nos Sœurs les
supérieures lui ayant une fois écrit si elle devait condescendre à une
religieuse qui voulait qu'on lui fît une robe d'hiver de deux en [424] deux
ans, sous prétexte qu'elles sont plus chaudes quand elles sont neuves, cette
digne Mère lui fit réponse : « Seigneur Jésus, ma chère fille, ce que
vous me dites de notre Sœur N. N. me scandaliserait volontiers ;
gardez-vous bien, ma chère fille, de condescendre à faire ainsi des habits
neufs, mais tenez-y bien ferme, et si elle a froid, qu'on lui donne une bonne
tunique. Je vous assure qu'il y a huit ans que je porte la robe d'hiver que nos
chères Sœurs de Dijon me donnèrent, et si je n'ai encore point pensé qu'elle ne
fût pas prou chaude, et espère bien que, si Dieu me donne vie, elle me fera
encore deux ou trois bons hivers. J'ai, certes, honte de voir que des filles
qui ont voué la pauvreté, aient soin de leur vêtir ; hélas ! que les
vrais serviteurs et servantes de Dieu vivent bien d'une autre sorte ! Je
lisais hier que le grand saint Paul ayant de quoi mater sa faim, et couvrir sa
nudité, était content ; hélas ! que nous sommes éloignées de cet esprit
de parfaite pauvreté ! Tâchez de la graver bien avant dans le cœur de vos
filles, et ne leur souffrez point de se rendre soigneuses d'elles-mêmes, ni de
prévoir ce qui leur est nécessaire ; cela est contre les vœux et la
règle. »
Lorsque cette Bienheureuse voyait une Sœur avec ses habits bien
rapiécés : « Voilà qui me plait tant, disait-elle, parce que cela
ressent une vraie religieuse. » Elle a ordonné aux supérieures dans ses Réponses,
d'être attentives à bien faire observer aux Sœurs le vœu de pauvreté, et de
leur donner occasion de le pratiquer ; elle disait « que nous
devrions baiser tendrement, par révérence, les habits vieux et
rapiécés » ; on lui avait vu faire cette pratique à elle-même et a
porté onze ans la robe d'hiver dont elle a parlé ci-dessus, et l'on n'eût pu la
lui faire changer, n'eût été qu'elle fut contrainte, allant à la fondation de
notre monastère de Turin, de prendre une robe de la même étoffe que les Sœurs
de la fondation, afin que tout fût égal. Une fois, la robière ayant besoin
d'une paire de pantoufles pour une [425] Sœur infirme, elle lui donna une paire
que notre digne Mère avait portée, avec dessein de lui en faire faire des
neuves ; dès qu'elle s'en aperçut, elle se les fit rendre, et ordonna que
l'on en fit des neuves à la Sœur, disant à la robière : « Ma fille,
il est bien raisonnable que moi, qui enseigne aux autres qu'il faut que chacune
use entièrement ce qu'elle a commencé, sinon qu'il plaise à la supérieure, de
son autorité, de le changer que je l'observe moi-même. » Ainsi elle porta
tout l'hiver cette chaussure, quoiqu'elle en fût incommodée ; comme elle
avoua par après, ses pantoufles lui étant trop petites. Une robière donna deux
étés de suite des bandeaux de jour à cette Bienheureuse Mère, les plus étroits
qu'elle pouvait trouver, pensant qu'ils lui étaient plus commodes ; et ils
l'incommodaient beaucoup, mais elle n'en dit jamais mot, jusqu'à une occasion
qu'elle demanda à la robière si elle ne faisait pas attention de lui donner des
petits bandeaux ; la robière lui dit que oui, lui demandant si ceux-là
l'incommodaient. « C'est à quoi, lui répondit-elle, nous ne devons pas
seulement penser, ni prendre garde, car nous avons si peu d'occasions de
pratiquer la pauvreté effective, dans la nécessité ; quand il s'en trouve
quelque rencontre, nous les devons chérir uniquement.[81]«
Lorsqu'elle alla en son dernier voyage de France, elle ne voulait
jamais souffrir qu'on lui fit des habits neufs ; et, la veille de son
départ, elle demanda à la robière des pièces pour raccommoder sa tunique, qui
était toute rompue ; elle les y faufila elle-même, et après allant trouver
la robière, la pria de les coudre, lui montrant comme cela allait bien, et
qu'il lui[426] semblait être si brave, quand elle avait quelque chose qui
sentait la pauvreté.
Étant à la fondation de notre monastère de Turin, visitant quelques
maisons pour loger ses religieuses, monsieur le marquis de Lulin dit à Madame
Royale, qui était présente, qu'elle remarquât un peu la splendeur de cette
fondatrice d'Ordre ; ses souliers avaient deux ou trois pièces en
devant, et étaient attachés avec des courroies de cuir. Cette grande princesse
fut fort édifiée de cela, et l'en estima davantage. En toutes occasions,
petites et grandes, elle avait attention à pratiquer la sainte pauvreté, et
tenait un si petit feu en sa chambre, l'hiver, qu'à peine s'y pouvait-on
chauffer, je dis du feu en sa chambre, quand elle en eut une particulière que
notre chère Mère de Châtel lui fit prendre ; car, jusqu'à l'âge de
soixante ans, elle avait toujours couché au dortoir, dans une petite cellule
comme les autres ; seulement le matin, après les Ave, la Sœur qui
couchait en la cellule plus proche entrait vers elle pour lui aider à faire son
lit, avant l'oraison. Excepté quand elle écrivait le soir, elle ne voulait
qu'une lampe en sa chambre, et encore qu'il n'y eût que trois fils de coton, ou
deux, quand il était un peu gros, et disait : « Je prends si grand
plaisir à voir cette petite lumière, cela sent si fort la pauvreté. »
Tandis qu'elle a couché au dortoir, pour l'ordinaire, elle n'allumait pas la
lampe de sa cellule, mais ouvrait sa porte, et se servait de la lampe commune,
que l'on allume au milieu d'icelui, afin que les Sœurs ne se choquent l'une
l'autre en sortant de Matines.
Madame de Toulonjon, sa fille, voulut lui faire faire une robe de raz
de Milan, parce qu'elle en portait une en voyage qui était fort pesante pour
l'été, jamais cette Bienheureuse Mère ne le voulut souffrir, et lui dit :
« Comment, ma chère fille ! si j'avais sur mes épaules une robe de
raz de Milan, pour légère que soit cette étoffe, je m'en estimerais si chargée,
que je n'aurais point de repos que je ne l'eusse mise à bas ; il faut aux
[427] pauvres ce qui sent la pauvreté : il ne m'est que bon d'avoir une
robe pesante quand j'en aurais besoin d'une légère. » Une Sœur ayant
appris à saigner, on lui voulut faire présent d'un étui de chirurgie, dont les
lancettes étaient accommodées avec un peu d'argent ; jamais cette digne
Mère ne voulut qu'elle les prît, et, parce que c'était une supérieure d'une de
nos maisons, qui était venue céans pour quelques nécessités, cette digne Mère
prit occasion de l'instruire, mortifiant la Sœur, en présence de cette
supérieure, lui disant que le désir d'avoir ces lancettes mériterait une bonne
pénitence, et lui dit ces propres mots : « Ma fille, souvenez-vous
toute votre vie que où l'argent suffira, n'y mettez pas de l'or ; où
l'étain pourra servir, n'y mettez pas de l'argent ; où le plomb pourra
être suffisant, n'y mettez pas de l'étain ; car la vraie fille de la Visitation
ne doit pas chercher les choses riches, polies et gentilles, mais les
grossières, solides, et où le seul nécessaire soit. »
CHAPITRE XIV.
suite de son amour à
la pauvreté.
Elle estimait pour une vraie pratique de pauvreté religieuse, de
travailler soigneusement ; ce qu'elle faisait elle-même avec une admirable
fidélité, même au parloir, sinon lorsqu'on lui parlait de choses fort
intérieures ; alors elle cessait l'ouvrage pour y donner toute son
attention, ou bien, quand elle parlait à des personnes qui n'étaient pas
familières ou d'extraordinaire respect. Toujours, à la fin du mois, elle
voulait voir l'ouvrage de chaque religieuse, ou qu'elle dit à quoi elle avait
employé son temps. Elle faisait une particulière estime des religieuses qui
sont soigneuses de le bien employer, et nous disait quelquefois que les dames
du monde et les riches sont ordinairement lâches au travail, mais que les
servantes de Dieu se doivent tenir comme pauvres en sa maison, et par
conséquent aimer le travail.
L'amour que cette Bienheureuse Mère avait à la sainte pauvreté
religieuse était cause qu'elle n'agréait point que l'on fît des présents de
grands prix aux personnes riches, disant qu'il n'appartenait pas aux pauvres
petites religieuses de faire des présents aux grands de ce monde, sinon quelque
chose de piété et dévotion qui fût propre et bien fait, pour leur témoigner le
respect que l'on leur porte ; qu'il fallait garder et conserver le bien
pour le distribuer aux pauvres dans leurs nécessités.
Une fois cette Bienheureuse Mère sut qu'une de nos [429] supérieures
avait fait quelques présents à un évêque d'une valeur assez notable, elle lui
en écrivit, avec son zèle ordinaire, les paroles suivantes : « J'ai
appris, ma chère fille, que vous avez fait un rare présent à Monseigneur votre
prélat ; je vous confesse naïvement que cela m'a déplu, pour être
totalement contraire à l'esprit d'humilité et de pauvreté ; non que je
désapprouve que l'on fasse quelquefois des présents aux personnes auxquelles on
doit de la reconnaissance, mais il faut que cela soit selon que le Coutumier
l'ordonne. Si vous vouliez faire quelque présent à Monseigneur votre
prélat, il lui fallait faire un beau voile de calice pour sa chapelle ou une
belle mitre ; cela nous le faisons bien céans, mais des raretés
d'orfèvrerie, certes, ma chère fille, ce sont des présents de princesses. Or
sus, une autre fois il n'y faut pas retourner, votre maison n'a pas encore son
revenu, et il y a quantité de pauvres dans l'Institut auquels l'aumône serait
bien employée. Enfin, croyez-moi, ma chère fille, mortifions bien la nature qui
a aversion à tout ce qui l'abaisse ; faisons paraître, par notre humilité,
que nous sommes pauvres, et que, par conséquent, nous n'avons pas ni le de
quoi, ni l'industrie de faire des présents de valeur aux riches, sinon de
quelque dévotion qui doit être toute notre richesse ; pour le reste,
tenons-nous petites, et mangeons notre pain avec les pauvres de
Jésus-Christ : ce sont de ces amis-là dont nous aurons affaire dans les
tabernacles éternels. Oh ! que les vrais pauvres y seront
riches ! »
Une des communautés de notre Institut envoya une fois à cette digne
Mère une bague pour offrir à feu Monseigneur de Genève, parce qu'il était frère
de notre Bienheureux Père, et que cette bague leur avait été donnée par une
prétendante, et n'était pas achetée du bien de la maison ; elle ne laissa
pas de la leur renvoyer avec une cordiale excuse, si elle ne faisait pas ce
qu'elles avaient désiré ; que, croyant que cette bague était [430] un peu
de trop haut prix, elle craindrait de contrevenir à la pauvreté et simplicité
religieuse, en faisant ce présent.
Cette Bienheureuse Mère lisait les lettres et écrivait avec une
allégresse et soin particuliers à nos monastères pauvres, et nous disait
quelquefois : « Mon Dieu, que ces filles sont heureuses d'être dans
l'occasion de pratiquer effectivement leurs vœux ! Je remarque, ce me
semble, que les pauvres monastères ont toujours une richesse particulière de
dévotion, de joie et de bonté. » Elle les encourageait fort par ses
lettres à s'enrichir de ce trésor de pauvreté, et leur répétait souvent l'avis
qu'elle a donné dans ses Réponses, que les supérieures qui sont en des
monastères pauvres ne parlent qu'à fort peu de personnes de leur pauvreté, et
seulement à ceux qui y pourront remédier ; « car, disait-elle, on ne
se plaint pas de ce que l'on aime. » Quand elle voyait de nos pauvres
maisons s'affectionner à n'importuner personne, mais à travailler pour gagner
leur vie, elle les eût voulu mettre dans son cœur, et écrivant à d'autres, elle
les leur donnait pour exemple, disant qu'il fait si bon voir les épouses de
Dieu, comme vraies pauvres, travailler à l'exemple du grand Apôtre pour gagner
leur pauvre vie. Elle priait les supérieures qui étaient dans de pauvres
monastères, que si elles s'adressaient à quelques autres pour être secourues,
et qu'on leur répondît un peu fortement et avec refus, elles en eussent une
double joie, parce que c'était une dépendance précieuse de leur pauvreté d'être
rejetées.
Elle écrivit à une supérieure un peu avant de partir pour son dernier
voyage de France, ces paroles : « Je vous conjure, ma très-chère
fille, correspondez à votre pauvreté selon toute l'étendue de cette
grâce ; faites que vos filles aiment à voir que leur sacristie, leur
dortoir, leur roberie, leur réfectoire ressentent la pauvreté ;
gardez-vous de faire des dépenses inutiles, ni des enjolivements dans votre
maison ; employez humblement votre peu à l'entretien de vos Sœurs. »
[431]
Cette digne Mère nous a dit souvent qu'elle avait de la consolation de
voir par toutes les lettres qu'elle recevait de l'état de nos maisons, que
généralement la pauvreté est dans l'Institut n'y ayant encore qu'une ou deux
maisons entièrement rentées et bâties. Elle nous a dit souvent dans l'occasion d'écrire
aux monastères plus pauvres, « que le soin que nos chères Sœurs de
Crémieux avaient eu de cacher leur pauvreté aux hommes et de travailler
soigneusement, se joignant ainsi aux desseins de Dieu qui les laissait pauvres,
avait attiré sur elle les bénédictions du ciel, et que ce monastère-là s'était
relevé insensiblement de la très-grande pauvreté où il était, et que leur
bâtiment avait été fait en partie, parce qu'elles avaient cherché
premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste leur ayant été
donné. » Elle écrivait une fois à un révérend père Jésuite :
« Nous ne nous plaignons jamais de la pauvreté, c'est le trésor le plus
précieux des servantes de Dieu. »
Cette digne Mère, jugeant que deux de nos maisons qui ne sont pas en
lieu pour faire des fondations, pouvaient commencer à pratiquer cet article de
la Constitution, quand on est bâti et renté, de recevoir les filles par
charité, elle les en avertit soigneusement avec des paroles fort
puissantes, en écrivant aussi au Père spirituel, le conjurant d'y prendre
garde, et que l'abondance des biens de la terre serait grandement contraire à
la perfection d'esprit, à laquelle les filles de la Visitation sont
appelées ; et, comme elle a mis dans ses Réponses, elle avait
grande consolation qu'en ce point cette maison eût devancé la règle, ayant reçu
bon nombre de filles sans dot. Je me souviens que, l'année 1640, cette digne
Mère écrivit trois ou quatre fois, avec une très-humble instance à nos Sœurs de
Crémieux, pour les conjurer de recevoir une vertueuse fille de Bourgogne,
réfugiée, qui n'avait rien du tout, et leur disant qu'elle leur faisait cette
demande à mains jointes, et si je ne me trompe, il y avait dans une de ses
lettres, ces paroles : « Imaginez-vous, ma chère [432] fille, que je
suis à genoux devant vous, et vous demande à mains jointes la place pour cette
pauvre fille. » La bonne Mère de Crémieux lui écrivit que son humilité
leur avait tiré les larmes des yeux, et qu'elle avait tant fait, qu'elle avait
obtenu licence de recevoir cette bonne fille ; de quoi notre Bienheureuse
Mère témoigna la joie à quelques Sœurs qui étaient dans sa chambre ; elle
fit même écrire une lettre de grand merci avec des termes du tout cordial, et
leur dit que cette pauvre fille serait chez elle la fille de la Sainte Vierge,
et un aimant pour attirer sur leur maison les bénédictions du ciel. À cette
occasion, une Sœur dit à cette digne Mère qu'elle avait eu quelque pensée de ce
que Sa Charité avait tant fait d'instances à nos Sœurs de Crémieux, pour
recevoir cette pauvre fille sans dot, et qu'elle poursuivait pour avoir celle
de notre chère Sœur de Prâ, dont le bien est aussi ruiné par les guerres. Cette
Bienheureuse Mère se mit bénignement à sourire, et répondit « qu'il
fallait considérer que ma Sœur de Prâ avait des fonds que la guerre n'emporte
pas, si bien elle les ruine pour un temps, et qu'elle avait un oncle riche à
l'abbaye de Saint-Claude ; qu'il ne fallait pas user de complaisance
envers les riches, qu'il valait mieux se tenir en pouvoir de faire la charité
aux pauvres filles qui avaient de bons talents et bonne volonté. »
Nous avons parlé ci-dessus de la pauvreté que notre Bienheureuse Mère a
pratiquée ès fondations, surtout en celles de Bourges et de Paris,
singulièrement en cette dernière ; elle dit à ce sujet qu'elle avait une
grande suavité de ne point s'embesogner ni manifester sa pauvreté ;
« nous laissions, ajoutait-elle, tranquillement croître ce rosier nouveau
avec les épines de maintes disettes qui nous piquaient assez sensiblement, mais
nous donnaient grandes espérances que les roses en seraient plus belles. »
Lorsque cette Bienheureuse Mère allait en voyage, et qu'elle [433]
était contrainte de loger en des maisons séculières, on la mettait toujours par
respect dans les plus belles chambres de parade ; même on lui disait
quelquefois qu'on la mettait dans la même chambre où le roi avait couché, et
qu'on la servait avec les mêmes meubles qui avaient servi à Sa Majesté ;
ce qui lui déplaisait extrêmement, et étant le soir dans ces chambres de
parade, elle pliait avec sa compagne les grandes couvertures de soie, et se
couvrait de ses habits ; d'autres fois, elle se couchait dans le pavillon,
faisait coucher sa compagne au grand lit, et lui disait : « Pour
Dieu, levons-nous demain de bon matin, pour nous en aller et nous ôter de parmi
cet apparat mondain. » Elle témoignait beaucoup plus de contentement, de
coucher en des méchants logis, sur la paille ou sur les feuilles, comme elle a
été parfois contrainte de faire, plutôt que de coucher dans des grandes
chambres tapissées, et sur des lits mollets. Nonobstant son âge et sa délicate
complexion, elle n'a jamais voulu souffrir qu'on lui ait porté un lit en
voyage, ni d'avoir un cheval de bagage, ains une seule petite cassette que l'on
mettait dans la litière pour tenir ses livres, papiers et un peu de linge pour
se changer, et disait : « Que les bonnes religieuses doivent, à
l'exemple de saint Paul, être contentes comme elles se trouvent. »
Elle a dit souvent que la plus grande peine qu'elle ait eue en religion
a été de se soumettre à l'obéissance de ses supérieures qui la faisaient
traiter avec quelque singularité, à cause de ses infirmités et de sa
très-délicate complexion jointe à son âge et au grand travail qu'elle
supportait. Quand elle a changé de supérieures, pour faire voir qu'elle se
tenait pour une pauvre et simple religieuse qui ne veut rien avoir sans
permission, elle leur montrait tout le peu qu'elle avait pour son usage ;
et cette dernière fois, lorsque notre très-honorée Mère de Blonay fut arrivée,
elle lui montra jusqu'aux papiers de ses protestations de foi et prières
qu'elle portait dans un petit sac pendu à son [434] cou, lui disant s'il lui
plaisait de les voir, et lui demandant permission de les garder, et une petite
image de Jésus, Marie, Joseph, qu'elle tenait toujours dans ses règles ;
et tirant la layette de sa table, elle fit voir qu'elle n'avait rien qu'un
petit bout de taffetas vert, dont elle s'essuyait les yeux quelquefois.
Allant par nos maisons, on lui préparait souvent un agenouilloir avec
des coussins, au chœur ; jamais elle ne s'en voulut servir :
« Ôtez cela, mes Sœurs, disait-elle ; où est la
pauvreté ? » et s'est toujours agenouillée à plate terre. Deux ans
avant son bienheureux décès, l'âge la rendant fort pesante, en sorte qu'elle
avait peine à se lever lorsqu'elle était assise à terre dans le chœur, on lui
voulut donner un coussin de plume, lequel elle ne voulut point souffrir, mais
condescendit à se servir d'un petit coussin de méchante toile noire, plein de
paille.
Je crois que nous avons fait voir ci-dessus, en parlant de sa charité
envers le prochain, comme quoi elle n'aimait pas seulement la pauvreté, ains
aussi les pauvres, et prenait la patience d'ouïr leurs doléances, leur faisant
tout le bien qu'elle pouvait, conduite d'une parfaite et discrète charité.
Lorsqu'à la fin des saisons elle allait voir à la roberie, étant supérieure,
les habits et souliers que les Sœurs rendaient, elle recommandait fort aux
officières de lui conserver tout ce qu'elles pourraient, sans préjudice de la
communauté, pour les pauvres, et voulait que les souliers qu'on leur donnait,
fussent raccommodés. Si on l'eût laissée faire, une fois, au gros de l'hiver,
elle voulait dévêtir sa tunique pour la donner à une pauvre femme.
D'ordinaire, avant la fête de la Présentation de Notre-Dame, jour que
nous faisons le renouvellement de nos vœux, cette digne Mère priait les Sœurs
de bien regarder si elles n'avaient rien pour leur usage que le juste
nécessaire, et faisait, en ce temps-là, la visite par toutes les cellules des
Sœurs, pour voir si elles n'avaient rien de superflu. Elle avait une telle
aversion que celles qui ont fait vœu de pauvreté eussent la moindre chose [435]
superflue, que lorsque, par son âge, elle ne put plus s'occuper à la couture,
elle rendit à la Sœur qui a le soin des ouvrages, les aiguilles qui étaient en
sa pelote, et nous savons, très-assurément, que les derniers scrupules, en la
fine extrémité de sa vie, ont été d'avoir gardé des épingles inutiles à sa
pelote.
CHAPITRE XV.
de son amour à
l'obéissance.
Saint Jean Climaque estimait grand celui qui renonçait à l'or et à
l'argent ; mais il estimait comme saint celui qui se dépouillait de sa
propre volonté ; à son dire, nous devons estimer que notre Bienheureuse
Mère est grande et sainte ; car il n'y a rien à quoi elle ait renoncé si
pleinement, si absolument et si parfaitement qu'à elle-même et à sa propre
volonté.
L'on a pu remarquer cette vérité, quasi en toute la suite de sa vie et
de ses actions ; aussi le ciel lui fit savoir, ainsi que nous l'avons dit
ci-dessus, qu'il la destinait à être une victime sacrifiée par la parfaite
obéissance. Oh ! combien le désir d'être dirigée lui a fait jeter de
soupirs et de larmes devant la divine Majesté, pour obtenir un
conducteur ! et lorsque, par une méprise innocente, elle se mit sous un
directeur qui n'était pas celui à qui Dieu avait donné ses lumières pour sa
conduite, avec quelle fidélité lui obéissait-elle, et contre tous ses attraits
intérieurs et tous ses propres sentiments ! Mais après que le ciel l'eut
rangée sous la conduite de notre Bienheureux Père, qui pourrait exprimer la
perfection de son obéissance qui a toujours été obéissance religieuse,
puisqu'elle était vouée ! Notre Bienheureux a dit qu'entre toute cette
multitude d'âmes qui demandaient sa direction et suivaient ses avis, il n'en
avait jamais trouvé une qui égalât notre Bienheureuse Mère en la perfection de
l'obéissance. [437]
Je crois avoir oublie de dire en
son lieu, qu'au second voyage que notre Bienheureuse Mère fit en Savoie, durant
son veuvage, pour venir conférer de son âme avec notre Bienheureux Père, il lui
avait marqué le jour qu'il se trouverait à Sales, où il l’allait
attendre : or, il arriva que, pour quelques légitimes et pressantes
occupations de ses affaires, elle fut contrainte de partir deux jours plus tard
qu'elle ne pensait ; étant en chemin et à cheval, elle faisait de fort
grandes journées pour regagner le temps, et voyant qu'elle ne pouvait,
nonobstant sa diligence, arriver au jour qui lui était marqué, elle marcha
toute une nuit, quoiqu'il plût et fit de grands tonnerres. Notre Bienheureux
Père fut ravi de cette obéissance, et lui demandant pourquoi elle s'était
fatiguée de la sorte : « Je ne croyais pas, dit- elle, qu'il me fût
loisible de prendre aucun prétexte pour m'exempter de ce que vous m'aviez
ordonné, d'arriver aujourd'hui. » Alors le Bienheureux lui apprit combien
il voulait que son obéissance fut libre, « et qu'elle devait plus aimer
l'obéissance que craindre la désobéissance, plus regarder à la douceur de ses
intentions qu'à la rigueur de ses paroles dans de tels rencontres. »
Une fois, notre Bienheureux Père
parlant à cette digne Mère en discours familiers, de la vertu d'obéissance, il
lui dit : « Vous ne m'avez jamais désobéi en rien que ce soit, qu'en
la condescendance que vous fîtes à nos deux premières filles » (nous en
avons dit l'histoire ci-dessus). Soudain cette digne Mère se jeta à genoux avec
abondance de larmes, disant qu'elle avait fait naufrage au port. Le Bienheureux
la fit lever et la consola, admirant combien cette âme était sensible à la
douleur pour la moindre faute contre l'obéissance.
Non contente d'écrire ès tablettes
de son cœur les avis qu'elle recevait de notre Bienheureux Père, elles les
mettait encore par écrit, et faisait, dans son petit livret, des extraits des
points principaux de ses lettres, pour les avoir toujours devant les [438] yeux, et diriger tout son extérieur et encore
plus son intérieur, par l'obéissance. Nous avons trouvé que, par une obéissance
encore inouïe, elle pria notre Bienheureux Père de faire un commandement à son
esprit, pour l'arrêter en l'oraison ; en voici les propres mots, écrits de
la main de l'un et de l'autre : « Je ne suis pas maîtresse de mon
esprit, dit-elle, lequel, sans mon congé, veut tout voir et ménager ;
c'est pourquoi je demande à mon très-cher seigneur l'aide de la très-sainte
obéissance, pour arrêter ce misérable coureur, car il m'est avis qu'il craindra
le commandement absolu. » Notre Bienheureux Père lui écrivit sur le même
feuillet ces mots : « Cher esprit, pourquoi voulez-vous pratiquer la
partie de Marthe en l'oraison, puisque Dieu vous fait entendre qu'il veut que
vous exerciez celle de Marie ? Je vous commande donc simplement que vous
demeuriez en Dieu, ou auprès de Dieu, sans vous essayer de rien faire, et s'en
vous enquérir de lui de chose quelconque, sinon à mesure qu'il vous
excitera ; ne retournez nullement sur vous-même, ains soyez là auprès de
lui. » Ne voilà-t-il pas aller bien avant dans l'obéissance ? Il
faudrait que le bon Ange de cette sainte vînt nous déclarer avec quelle
perfection elle a pratiqué ce commandement.
Cette Bienheureuse Mère a toujours été entre les mains, non-seulement
de notre Bienheureux Père, mais de ses autres supérieurs, comme le serviteur
fidèle de l'Évangile, allant et venant en tant de divers lieux, selon que
l'obéissance lui ordonnait, et lorsque les hommes y voulaient mettre des
obstacles, la force de son obéissance se jouait à les rompre. Une fois,
lorsqu'on craignait qu'une autorité souveraine la retînt, si elle allait fonder
une de nos maisons dans une certaine ville, elle dit avec une grande fermeté,
que, pour ce point, il ne fallait point y avoir d'égard, que rien ne la pouvait
jamais arrêter hors d'Annecy, que l'obéissance ; et que quand on lui
ferait bâtir une tour pour la tenir enfermée, si son supérieur lui mandait de
s'en revenir, [439] elle croyait que Dieu lui donnerait la force et l'industrie
pour rompre les murailles et aller obéir.
En tous les voyages qu'elle a faits, elle n'a jamais voulu qu'il y eût
de sa volonté, mais que, purement et simplement, l'on fit voir au supérieur la
nécessité de lui commander d'aller, afin qu'eux-mêmes jugeassent, se tenant
dans une totale indifférence de ce qu'il leur plairait d'ordonner, sans qu'elle
voulut donner aucun mouvement à leur volonté ni pour ni contre. Lorsqu'elle
était en son voyage de Lorraine, s'apercevant que l'on écrivait à Monseigneur
de Genève pour la faire passer à Paris, et craignant qu'il la remît à faire ce
qu'elle jugerait à propos, elle le prévint, le conjurant très-humblement de lui
ordonner, en paroles expresses, ce qu'il plairait à sa seigneurie qu'elle fit,
et qu'il ne la laissât point à la disposition d'elle-même. Étant une fois
demandée en quelqu'un de nos monastères, pour quelques semaines, feu
Monseigneur de Genève l'interrogea sur ce que lui disait le cœur de ce voyage,
à quoi elle répondit : « Monseigneur, je ne l'ai point consulté, et
quand je l'aurais fait, il n'a rien à me répondre, sinon que je dois obéir. »
Pour le dernier voyage de France, où elle a laissé sa précieuse vie, il ne peut
se dire avec quelle démission d'elle-même elle s'y est comportée. Elle écrivait
toujours à notre très-digne madame de Montmorency, que ce lui serait un bonheur
et joie très-grande de la revoir, mais qu'elle ne pouvait dire une seule parole
là-dessus, sinon qu'elle ferait ce qu'on lui commanderait. Et notre très-chère
Sœur Marie-Hélène de Chastellux, alors Supérieure à Moulins, l'ayant priée de
faire voir à Monseigneur de Genève la nécessité de ce voyage, cette digne Mère
lui fit réponse de l'en excuser, qu'elle n'avait garde de prévenir l'esprit de
ses supérieurs, ajoutant : « Je vous assure, ma très-chère fille, que
j'ai un désir infini que le peu de temps qui me reste de vie soit entièrement
employé et dirigé par la sainte obéissance. » [440]
Lorsqu'elle était en voyage, elle regardait fort souvent, selon les
rencontres, les paroles portées par son obédience, afin de s'y tenir ric-à-ric.
En ce dernier voyage, la compagne de cette Bienheureuse Mère, notre chère sœur
Jeanne-Thérèse Picoteau, écrivit de Paris, à notre très-honorable Mère de
Blonay, qu'elle la conjurait de s'abstenir de prier, dans ses lettres, notre
Bienheureuse Mère d'abréger son voyage le plus qu'elle pourrait, parce que, la
regardant comme sa supérieure, elle avait connu que cela faisait peine à cette
Bienheureuse, qui craignait de s'arrêter tant soit peu, contre son intention.
Dans ce même voyage, cette digne Mère écrivit de sa main, à notre très-honorée
Mère, ces paroles : Ma très-chère et toute bonne Mère, mandez-moi
clairement votre intention, et croyez que si l'obéissance veut que je m'en
retourne à Annecy, au retour de Paris, que je le ferai nonobstant l'hiver,
quoique l'œuvre pour laquelle je suis venue ne soit pas achevée ; mais,
grâce à mon Dieu, je ne veux m'attacher qu'à l'obéissance. »
L'honneur, l'amour et le respect que cette Bienheureuse portait à ses
supérieurs ne se peut exprimer, et avait une affection non pareille que
l'Institut portât une révérence toute sacrée à Messeigneurs les prélats, nos
vrais et légitimes supérieurs. Elle avait un respect de soumission et de
confiance inexplicable pour Monsieur notre très-honoré Père spirituel, ce qui
lui faisait prendre la liberté de l'importuner en plusieurs petites
occurrences. Elle disait qu'entre les bénéfices dont elle rendait grâce à
Notre-Seigneur, elle le remerciait de lui avoir donné un supérieur si bon et
d'un abord si accostable, qu'elle pouvait recourir à lui pour toutes choses un
peu extraordinaires, et qu'ainsi elle vivait avec plus de repos dans la
conduite de l'obéissance. Le respect religieux s'étendait encore envers ses
supérieures auxquelles elle rendait une déférence et respect non pareils ;
et dès qu'elle était déposée, vous eussiez dit qu'elle n'avait jamais commandé,
tant elle savait parfaitement obéir ; ne voulant point [441] de liberté
que celle qui se trouve dans la sujétion de l'obéissance, elle demandait
soigneusement congé pour tout ce qu'elle voulait faire.
Lorsque notre très-bonne et chère Mère de Châtel fut élue en ce
monastère, notre Bienheureuse la pria instamment de l'exercer en la vertu
d'obéissance, lui représentant qu'il y avait si longtemps qu'elle commandait
aux autres, qu'elle craignait de n'avoir point cette vertu qui fait les
religieuses religieuses ; elle lui disait donc : « Ma chère
Mère, voilà beaucoup de lettres auxquelles je dois répondre, ordonnez que je
fasse réponse aujourd'hui à celle-ci, et demain à celle-là, et ainsi,
donnez-moi matière de vous obéir. » Elle trouvait d'autres petites
inventions, afin qu'on lui commandât, et faisait un tel état des avis de sa
supérieure pour sa direction intérieure, qu'elle mettait en écrit ce qu'elle
lui disait pour son âme, et portait toujours sur elle quelques avis que notre
très-honorée Mère de Châtel lui avait donnés à son instante prière.
Lorsque notre très-honorée Mère de Blonay fut arrivée céans, cette
digne Mère, après lui avoir rendu un compte fidèle de son intérieur, et
singulièrement de ce qui s'était passé depuis le décès de notre très-chère Mère
de Châtel, elle la conjura à mains jointes de la diriger selon la lumière que
Dieu lui donnerait pour son bien. Avant donc de partir pour son voyage de
Moulins, elle lui dit en abrégé l'état présent de son intérieur et sa disposition,
la suppliant de lui donner une pratique spirituelle à laquelle elle se pût
attacher le long du voyage ; elle la supplia aussi de lui donner le livre
qu'elle jugerait plus à propos qu'elle lût jusqu'à son retour, afin que,
faisant ces pratiques intérieures et extérieures, elle se tînt, absente comme
présente, sous sa direction et conduite. Notre chère Mère la contenta en ses
désirs ; de quoi cette Bienheureuse témoigna un grand contentement, et que
cela était véritablement selon son besoin, et voulait que sortant de la maison,
notre chère Mère lui donnât sa [442] bénédiction ; l'en suppliant
amiablement, et en en recevant le refus avec humilité, disait : « Hé
bien ! ma chère Mère, je la recevrai en esprit. »
Cette Bienheureuse Mère désirait extrêmement que notre Congrégation fit
profession d'une très-parfaite obéissance ; elle parlait souvent de cette
vertu, et recommandait fréquemment à nos Sœurs les supérieures de grandement
affermir leurs filles en la pratique de l'obéissance, selon les conditions que
la Constitution marque. Elle écrivait une fois à notre très-honorée Mère de
Blonay : « Procurez que vos filles se rendent de plus en plus
parfaitement obéissantes. C'est en quoi nous tâchons de bien établir nos
novices ; et je pense que si je les voulais au ciel, elles s'y
élèveraient, et si je les voulais au centre de la terre, elles s'y
approfondiraient. »
Une de nos chères Sœurs d'Autun écrivit à cette digne Mère, que l'on
mettait à son choix de retourner à notre maison de Moulins, d'où elle était
professe, ou de demeurer à Autun, et qu'elle ne savait que faire
là-dessus ; qu'ayant sacrifié toute son âme à l'obéissance, elle n'avait
plus de jugement pour rien discerner pour elle-même, ni faire un choix, se
trouvant également prête d'aller et de venir. Notre Bienheureuse baisa deux ou
trois fois cette lettre, disant : « Bénite de Dieu soit cette fille,
qui n'a point de volonté ; si elle faisait maintenant des miracles,
j'y ajouterais une facile
créance. » Elle lui écrivit pour la conjurer de persévérer en cette
démission de soi-même, disant que « quiconque s'est voué à l'obéissance,
et par après se mêle de soi-même, de son emploi, de son séjour ou de sa
direction, il se retire de son vœu, et après être mort pour Dieu, se laisse
ressusciter misérablement par l'amour-propre, pour vivre en soi-même. »
Enfin cette Bienheureuse pouvait bien parler de ses victoires, car
elle a été très-obéissante en tous temps et conditions, séculière, religieuse
et supérieure, en qualité d'inférieure, saine et [443] malade, dans ses voyages
et en la maison, aux petites et aux grandes choses, en l'intérieur et en
l'extérieur, pour autrui et pour elle-même, en la vie et en la mort ; car,
comme on lui demandait ce qui lui plaisait que l'on fit de son corps après son
décès, elle répondit qu'elle n'avait rien à ordonner là-dessus, qu'elle était à
l'obéissance de ses supérieurs et du monastère d'Annecy ; et comme madame
la duchesse de Montmorency la pria de laisser à Moulins notre chère Sœur
Jeanne-Thérèse, sa compagne, elle fit la même réponse, qu'elle était sans aucun
pouvoir d'ordonner, qu'il fallait s'adresser aux supérieurs et à la supérieure
d'Annecy, d'où cette chère Sœur est professe.
CHAPITRE XVI.
de son amour à la
pureté.
Je ne sais bonnement que dire sur ce troisième vœu, hormis ce que notre
Bienheureux Père a écrit : « Que la virginité de cette sainte veuve,
réparée par l'humilité, était plus excellente qu'une virginité moins humble, et
qu'elle mérite véritablement d'être associée à cette honorable troupe de
saintes veuves, aussi dignes d'être honorées que le sacraire de Dieu. »
Pendant le temps qu'elle a été et fille et mariée, possédant une beauté et une
grâce fort attrayante, son innocence, sa modestie et la majesté de son visage,
tenaient les plus licencieux dans la retenue, proche d'elle. Dès qu'elle fut
veuve, son cœur fut le jardin clos par le sacré vœu de chasteté, et entouré
d'une haie d'épines, de mortifications et d'exercices de vertus. Notre
Bienheureux Père disait que c'était une tour d'ivoire, tant elle était pure et
propre à faire de son chaste cœur le trône du pacifique Salomon.
Demeurant veuve, jeune et belle, elle renonça à tout ce qui flatte les
sens ; le seul pourparler des seconds mariages lui était en horreur ;
toutes ses amitiés étaient franches, rondes, naïves, sincères, mais saintes et
sans familiarités. Elle avait gravé fortement en son cœur, et portait en son
petit livret, que la Sainte Vierge, Abbesse de son couvent intérieur, dont nous
avons déjà parlé, avait craint, voyant un Ange en forme humaine, parce qu'il la
louait ; à son exemple, elle eût craint un homme, encore qu'il lui eût
apparu en forme angélique, s'il l'eût louée [445] et caressée. Elle s'était
fait écrire par notre Bienheureux Père les marques pour connaître les fausses
amitiés d'avec les bonnes, et avait fort cette sentence : L'amitié de
ce monde est ennemie de Dieu. Parlant une fois en confiance avec feue notre
très-honorée Mère Favre, elle lui dit qu'elle ne se souvenait pas d'avoir
jamais eu un mot à dire en confession, touchant la chasteté, et qu'en cela elle
prenait grand sujet de s'humilier, voyant sa faiblesse ; et que sans
doute, si elle eût été forte, Dieu eût permis qu'elle eut été attaquée de cette
tentation, aussi bien que de plusieurs autres ; qu'elle avait grande compassion
aux âmes qu'elle en voyait travaillées, et un soin particulier à prier pour
elles et à les aider et consoler. Elle reconfirma la même chose, en rendant
compte à notre très-honorée Mère de Blonay, avant son départ pour Moulins, lui
disant qu'elle avait été attaquée de toutes sortes de tentations, excepté de
celles contre la pureté. Elle dit une fois ce que la cellule, la retraite, la
mortification et l'oraison sont les grands corps de garde de l'âme chaste, et
qu'une vraie religieuse ne doit regarder les plaisirs du monde, de quelques
sortes qu'ils soient, qu'au travers de la croix de son époux, c'est-à-dire avec
un œil de dédain. »
Elle ordonnait que celles qui étaient travaillées contre la pureté, en
parlassent fort peu, et qu'elles ne particularisassent aucune chose de leurs
peines qu'à leur confesseur, et cela seulement quand elles auraient quelques
scrupules. Lorsqu'il se rencontrait quelques avis pour la chasteté en ce qu'on
lisait à table, elle les faisait toujours passer, disant que ces choses-là ne
se devaient jamais lire en commun, ains seulement en particulier par celles qui
en auraient besoin. Elle dit une fois à une Sœur qui lui déclarait quelques
peines sur ce sujet : « Ma fille, prenez des ailes de colombe et
volez ès pertuis de la pierre angulaire, ès plaies de Jésus-Christ, et
tenez-vous là à recoi, sans regard, sans dispute, et sans répondre un mot à
votre ennemi. » Elle ne parlait jamais guère sur telles [446]
tentations ; mais avec sa clarté d'esprit admirable, en quatre ou cinq mots
elle comprenait l'avis dont l'âme qui lui parlait avait besoin.
La parfaite pureté et netteté de cœur de notre Bienheureuse paraissait
excellemment dans l'incomparable netteté et propreté qui reluisait en son
extérieur et en tout ce qu'elle faisait. Elle avait tellement chassé de son
cœur l'amour humain par le divin, que ce digne cœur semblait être de nature
toute spirituelle, purifié de tout ce qui n'était pas purement divin ; et
nous pouvons assurer d'avoir vu cette Bienheureuse Mère parmi nous, ne vivant,
respirant et aspirant que pour l'Époux céleste, non-seulement en toute
honnêteté et pureté, mais en toute sainteté d'esprit, de paroles, de
maintien et d'action ; ce qui rendait sa conversation immaculée et
angélique.
CHAPITRE XVII.
de son amour à
l’humilité.
Le révérend père Binel, Jésuite, ayant vu à Paris, en l'année 1619,
notre Bienheureuse Mère supporter avec douceur et constance nonpareils un
mépris et abaissement de longue durée, il dit qu'il croyait qu'elle était
professe de quatre vœux, et que le quatrième était l’humilité, demandant
si on n'en faisait pas vœu en notre Congrégation, et qu'ayant vu la retenue et
profond rabaissement de notre Bienheureuse dans des occasions piquantes
d'humiliations, il crut que l'humilité était notre quatrième vœu. Notre Bienheureuse
lui répondit, avec un doux sourire : « Mon très-cher Père, je désire
que nous pratiquions l'humilité aussi exactement que si nous l'avions
vouée ; sachant cela, nous joignons cette précieuse vertu à celles des
trois vœux.
Une âme gratifiée de Dieu en un degré éminent, depuis beaucoup
d'années, et qui mène une vie conforme à ce qu'elle reçoit de sa divine
Majesté, écrivit une fois à notre très-bonne Mère de Châtel, en réponse de
quelque chose qu'elle lui avait demandée, les paroles suivantes :
« Depuis environ vingt ans que Dieu m'a fait connaître notre très-digne
mère de Chantal, sa bonté m'a toujours fait voir, par vues d'esprit et par
expérience, qu'il l'avait singulièrement et privativement choisie pour être, en
ce siècle, un miroir et une représentation naïve de la vie cachée de
Jésus-Christ ; et pour vous parler sincèrement, ma très-chère Mère (et
avec prières très-instantes que [448]
je ne sois jamais nommée,
m'étant rendue indigne de toutes les grâces de Dieu), la première fois que
j'ouïs parler de l'Ordre Sainte-Marie, je me trouvais fort excitée à prier pour
son progrès ; et, après la sainte Communion, Jésus-Christ me fit voir que,
lorsqu'il prononça cette haute leçon : Apprenez de moi que je suis doux
et humble de cœur, il avait regardé d'un regard d'amour et d'élection
singulière notre Mère de Chantal, laquelle alors je vis en esprit avec
Jésus-Christ humanisé, dans un abîme d'humilité, cachée en Dieu. »
Voyons comme cette Bienheureuse a correspondu au regard et à l'élection
de Dieu sur elle, pour la très-sainte humilité. D'où provenait ce grand
mouvement d'esprit dès son veuvage, et ce désir incroyable d'être instruite et
guidée par un autre en la vie spirituelle et en la vertu, sinon d'une vraie et
vertueuse défiance de soi-même ? Voici ses propres termes :
« Après que Dieu m'eut ôté M. de Chantal, et que je me fus consacrée à sa
bonté, je conçus de grands regrets en mon âme, déjà fort affligée par ma
viduité, de la vanité en laquelle j'avais coulé mes jours dans le monde ; il
me sembla que ce malheur m'était arrivé, parce que j'étais maîtresse de mes
actions ; dans les désirs extrêmes que j'avais d'avoir un directeur, je
disais à Notre-Seigneur, avec abondance de larmes : Mon Dieu, cette
ignorante errera, si elle n'est instruite, et mon âme plus faible que la
faiblesse même, tombera de mal en pis, si votre Majesté ne me donne un maître
et un soutien. »
Comme naturellement notre Bienheureuse Mère avait un grand courage et,
comme dit notre Bienheureux, l'humeur impérieuse plutôt que tendante à l'impériosité,
il fallut que la grâce puissante abattît en elle ce qui était de la nature, et,
certes, il lui en coûta beaucoup ; car Dieu lui apprit, dès la première
année de son veuvage, à se rendre sujette à toutes créatures pour l'amour de
lui ; il la réduisit chez un beau-père à prendre le titre de servante de
la servante du logis, plutôt que [449] celui de belle-fille ; elle était
sans autorité quelconque, ses actions étaient épiées et censurées, ses paroles
prises à contresens et mal interprétées, ses bonnes œuvres contrôlées, ce
qu'elle faisait de plus indifférent, blâmé ; bref, comme dit un bon Père
capucin, nommé Père Mathias, de Dole, elle fit là un noviciat plus long, plus
humiliant et plus mortifié, qu'elle n'aurait fait aux Religions les plus rigoureuses
de l'Église.
Notre Bienheureux Père, comme un sage directeur, secondant les desseins
du Saint-Esprit sur cette grande âme, la tenait toujours dans une pure voie de
l'humilité, et voulait que son attention principale fût à bien enraciner son
cœur en cette vertu. D'abord, il lui apprit que la veuve chrétienne est la
petite violette au jardin de l'Église, fleur basse, qui n'a ni couleur ni odeur
éclatante ; tout est doux, tout est petit, tout est médiocre : il
disait qu'ayant perdu son mari, elle avait perdu sa couronne ; qu'ayant
perdu sa virginité, elle avait perdu sa gloire, en sorte qu'il ne lui restait
rien que sa petitesse et son abjection, et il lui ordonna de s'exercer, non aux
vertus pompeuses et éclatantes, mais aux vertus convenables à sa viduité, dont
il lui fit liste : l'humilité, le mépris du monde et de soi-même, la
simplicité, l'amour à l'abjection, les services des pauvres et malades ;
il lui assigna pour sa demeure le pied de la croix, lui écrivant que sa gloire
serait d'être méprisée, et sa couronne, sa misère, petitesse et abjection.
Des personnes fort spirituelles, voyant cette sainte veuve avec de si
hautes dispositions pour la vie spirituelle, voulaient qu'elle se poussât à la
vie suréminente ; mais notre Bienheureux Père lui dit : « Non,
non, demeurez à filer le fil des petites vertus d'humilité, douceur,
mortification, simplicité et autres convenables aux veuves ; qui vous dit
autrement, trompe et est trompé. » Ce Bienheureux voulut que cette digne
Mère eût une telle soumission à la conduite et démission de soi-même, que, lui
ayant une fois écrit sur quelques désirs qu'elle avait [450] qui étaient un peu
ardents, il lui fit réponse que Dieu ne voulait d'elle que soumission en
tout : « Laissez-moi, dit-il, la conduite de vos désirs, je vous les
garderai soigneusement, n'en ayez nul soin possible ; possible aussi, ne
vous les rendrai-je jamais, et il ne serait pas expédient que je vous les
rendisse ; assurez-vous que je ne les emploierai pas mal, j'en dois rendre
compte à Dieu. » Est-il possible de voir une disciple plus démise
d'elle-même et plus soumise, puisque son directeur gouvernait ses désirs, et,
comme nous l'avons dit ci-dessus, commandait à ses pensées ? Elle se
tenait ainsi basse, petite et humble comme un enfant faible, tenant la main de
celui qui la conduisait de la part de Dieu, sans lui demander seulement :
« Où me menez-vous ? » Elle disait plutôt, avec l'ardent saint
Paul, dans cette soumission saintement aveugle : Que vous plaît-il que
je fasse ?
Dieu ayant regardé l'humilité de sa servante, et l'ayant rendue si
honorablement mère de tant de filles, elle voulut paraître plutôt disciple que
maîtresse en cette haute leçon d'humilité, et en écrivait les paroles suivantes
à notre Bienheureux Père : « Je demande, pour l'honneur de Dieu, de
l'aide à mon très-cher seigneur pour m'humilier. Je pense me rendre exacte à ne
jamais rien dire dont il me puisse revenir quelque sorte de gloire et
d'estime. » Notre Bienheureux Père lui répondit sur le même feuillet ces
mots : « Sans doute, qui parle peu de soi-même fait extrêmement
bien ; car, soit que nous en parlions en nous accusant, soit en nous
louant, soit en nous méprisant, nous verrons que toujours notre parole sert
d'amorce à la vanité. »
Chacun sait combien l'Institut doit à cette Bienheureuse, non moins
certes qu'un enfant à sa vraie et très-bonne mère ; néanmoins, elle a
toujours voulu persuader qu'elle n'avait point de part au commencement et
fondation d'icelui, et elle a dit en diverses rencontres, qu'il ne fallait pas
faire ce déshonneur à une [451] si florissante Congrégation de l'en nommer la
fondatrice ; qu'il n'y avait qu'un unique fondateur, notre Bienheureux
Père, et partout où elle trouvait écrit le nom de fondatrice, elle
l'effaçait ou le coupait ; et nous savons que, lorsque l'on faisait les
dépositions de notre Bienheureux Père, elle prit la peine d'en lire de fort mal
écrites, parce qu'elle se doutait qu'on lui donnait ce titre, qu'elle y effaça
soigneusement. Elle n'a jamais voulu accepter d'autres qualités ès contrats, ni
au procès pour la béatification, que ceux d'humble et dévote Mère.
Quoique notre Bienheureux Père lui eût donné un plein et entier pouvoir
d'établir ou abolir dans l'Institut ce qu'elle jugerait à propos, lui disant
qu'elle était maîtresse de la famille et y devait ordonner, elle usa de ce
pouvoir avec tant d'humble modestie, qu'elle nous a dit ne s'être jamais
enhardie d'établir aucune chose dans l'Institut, qu'elle n'en eût premièrement
reçu l'ordre et le sentiment de notre Bienheureux Père. Pour cet effet, elle
portait toujours des tablettes avec soi, pour marquer ce que les occasions lui
apprenaient devoir être établi pour en parler à notre saint Fondateur, et,
depuis son décès, elle avait scrupule d'établir quoi que ce soit, si sa
conscience ne lui eût dicté que telle était la volonté de notre Bienheureux
Père ; et, comme nous nous en étonnions : « Voilà bien de
quoi ! nous dit-elle ; appartient-il aux servantes de faire, dans une
maison, autre chose que ce qui est selon l'ordre ou l'intention du
maître ? » nous faisant ainsi entendre qu'elle ne se tenait que pour
la servante de l'Institut ; ce qu'elle nous dit plus clairement en une
autre rencontre, nous racontant avec une grande naïveté une pensée qu'elle
avait eue en son recueillement : elle nous disait que, dans les premières
années de l'Institut, les fondations étant fréquentes, elle était comme ces
grosses servantes de peine, au temps de la moisson. Le Père de famille leur
dit : « Venez ici, allez là, retournez en ce champ, allez en cet autre. »
Mais quand ces pauvres paysannes sont devenues fort vieilles, [452] elles ne
peuvent plus que filer leurs quenouilles, et ne se peuvent tenir de dire aux
enfants du Père de famille, auquel elles ont survécu : « Votre Père
ne faisait pas ainsi, votre Père voulait que l'on fît de telle et telle
sorte » ; puis, s'appliquant à elle-même sa comparaison :
« au commencement, disait-elle, comme la servante de l'Institut, notre
Bienheureux Père me disait : « Allez fonder à Lyon, allez fonder à
Grenoble, revenez pour aller à Bourges, sortez de Bourges pour aller à Paris,
quittez Paris et revenez à Dijon. » Ainsi j'ai été plusieurs années que je
ne faisais qu'aller et venir, tantôt en l'un des champs, tantôt en un autre, de
ce cher Père de famille ; maintenant, je suis une pauvre et chétive
vieille de soixante-cinq ans (c'était l'âge qu'elle avait alors) ; il me
semble que je ne sers plus de rien du tout dans l'Institut, sinon un peu pour
dire les intentions du Père. » Et elle ajouta qu'elle n'avait guère eu de pensées
qui lui agréassent plus que celle-là.
Elle honorait singulièrement nos anciennes Mères et Sœurs, et ne
voulait point les appeler filles, les tenant pour ses compagnes ;
mais notre Bienheureux Père le lui commanda, et cette Bienheureuse Mère, écrivant
sur ce sujet à notre très-chère Sœur Françoise-Marguerite Favrot, elle lui dit
les paroles suivantes : « J'ai trouvé, sur la fin de votre lettre,
vos pensées de jalousie de ce que j'appelle nos Sœurs les supérieures filles, »
et non pas vous ; ô mon Dieu ! ma très-chère Sœur, vous voulez donc
que je vous appelle ma fille ; vraiment je le ferai pour vous
obéir, avec un sentiment non moins tendre que je le fais pour toutes les
autres ; c'était par respect que je m'en abstenais, et le voulais faire
aussi à l'endroit de nos premières Mères, mais elles m'en firent tant
d'instances, que notre Bienheureux Père me le commanda. Votre humilité à le
désirer accroîtra mon respect, et, en vous appelant ma chère fille, je
vous honorerai de tout mon cœur, comme ma très-chère Sœur et ma très-honorée
Mère. » Elle écrivait aussi à notre Sœur et [453] Mère Claude-Agnès de la
Roche, les paroles suivantes : « L'âge où je suis me donne moins de
difficulté qu'autrefois d'appeler filles celles dont je vois bien que je
ne suis ni ne mérite d'être Mère ; mais parce que je suis leur première
Sœur, et qu'elles sont orphelines de Père, elles veulent me nommer Mère. O mon
Dieu ! qu'elles me fassent telle, et qu'elles n'aient pas honte de
m'avouer pour servante ; certes, ma chère fille, je serais bien téméraire,
vu le peu de fruit que j'ai fait en la Congrégation, si j'y voulais autre
qualité que celle de servante, et encore servante bien inutile. »
CHAPITRE XVIII.
suite de son amour à
l'humilité.
Après le décès de notre Bienheureux Père, le chapitre de cette maison
d'Annecy, craignant que l'humilité de notre très-digne Mère ne voulût la faire
démettre du gouvernement, l'élut (en l'année 1623) supérieure générale, entre
les mains de M. de Sales, cousin germain de notre Bienheureux Père, prévôt de
l'église cathédrale de Genève et notre Père spirituel ; mais notre
Bienheureuse Mère renonça, en plein chapitre, à telle élection, et ne la voulut
jamais accepter, protestant qu'elle ne ferait jamais fonction de supérieure
sous ce titre et élection de Mère perpétuelle, quoique les Sœurs
anciennes et Monsieur le Prévôt lui assurassent de savoir, de la propre bouche
de notre Bienheureux Père, que c'était son intention, que tandis qu'elle serait
en vie, cette maison, qui est mère et matrice de l'Institut, n'eût point
d'autre supérieure, et qu'elle en étant la Supérieure, fût Mère commune de
toutes. Elle répliqua fortement que sa conscience lui dictait que, si le
Bienheureux eût été en vie, il eût approuvé son procédé et qu'elle aurait
obtenu de lui d'être élue par triennal. Elle tint ferme avec tant de profonde
et persévérante humilité, que l'on fut contraint de lui céder, et l'élection se
fit triennaire. En conséquence, à la fin de ses trois ans elle envoya sa
déposition par écrit depuis le Pont en Lorraine, où elle était allée fonder une
de nos maisons, et avait gagné sur feu Monseigneur de Genève, qu'il arrêtât,
par un commandement absolu, la résistance de notre chapitre. L'on [455] procéda
donc à l'élection d'une autre supérieure, qui fut, comme nous l'avons dit
ci-dessus, notre très-honorée Mère de Châtel ; et depuis, notre
Bienheureuse Mère a toujours, de triennal en triennal, passé par les
voix ; et non-seulement elle n'a pas voulu demeurer en la charge de
supérieure plus que le Coutumier permet ; mais, à cette dernière
élection, elle pouvait encore être élue pour trois ans, et ne le voulut point
souffrir, ayant représenté de fortes raisons à Messieurs nos supérieurs pour
cela, en sorte que contre tous nos sentiments elle les fit joindre à son humilité.
Elle nous a dit en quelques occasions qu'outre sa totale incapacité pour la
conduite, elle était bien aise, par cette entière déposition, au bout de trois
ans, d'ôter une erreur qui se glissait dans la plupart des maisons de
l'Institut, qu'il y ait quelque blâme pour celles qui ne demeurent que trois
ans en la charge de supérieure. Dès le moment que cette Bienheureuse Mère était
déposée, sans vouloir ni liberté, ni privilège, elle se tenait au dernier rang,
s'assujettissait à faire les enclins et rendre les autres petits honneurs
non-seulement aux supérieures, mais aux assistantes, tandis qu'elles tenaient
la charge.
Elle était très-soigneuse d'assister aux chapitres, et dire ses
coulpes ; on avait beau mettre des empêchements, et lui donner de
l'occupation, elle trouvait toujours moyen de s'échapper pour s'humilier, ce
qui fâchait fort notre très-honorée Mère de Blonay, de voir au chapitre cette
vraie sainte au dernier rang, et se venir humilier devant elle. Elle tâchait de
procurer qu'à l'heure du chapitre, l'on vînt demander au parloir cette
Bienheureuse Mère, qui se savait dégager bientôt ; ce qui fit que notre
très-chère Mère, une fois sur la fin de la récréation, s'en alla tenir le
chapitre, sans que l'on eût sonné l'obéissance, pensant ainsi la surprendre ;
mais ce fut en vain, elle s'en douta, et rompant compagnie au parloir, s'en
vint au chapitre. Notre chère Mère l'apercevant, la pria de se retirer, que le
chapitre était [456] commencé, que, pour cette fois, elle n'y viendrait pas,
que ce serait le samedi suivant. Cette Bienheureuse obéit et se retira, mais
avec un cœur si touché de véritable douleur, de ce qu'on ne lui laissait pas
une ample liberté de pratiquer ces actes extérieurs d'humilité, qu'elle en
pleura très-amèrement ; puis elle s'en alla, durant le reste du chapitre,
trouver une malade à l'infirmerie, à laquelle elle recommanda grandement
qu'elle priât pour elle, ajoutant que c'était une justice de Dieu sur elle, qui
lui ôtait les occasions de s'humilier comme les autres, et que, comme indigne
d'être avec la communauté, elle en était séparée ; ce qu'elle dit avec des
larmes et de tels sanglots, qu'on ne l'avait jamais vue pleurer de meilleur
cœur ; et la Sœur malade et l'infirmière ne se purent empêcher de pleurer
avec elle. Après le chapitre, elle demanda pardon à notre chère Mère, se jetant
à genoux devant elle, de ce qu'elle lui avait trop répliqué, afin d'avoir la
liberté d'aller dire sa coulpe, la suppliant de l'humilier et lui donner
pénitence de ce défaut. Cette pratique lui était familière envers ses
supérieures, et je peux assurer ne l'avoir jamais vue s'attendrir, ni pleurer
chaudement et sensiblement, que dans des occasions de louanges, ou dans le
refus et résistance qu'on lui faisait de pratiquer les actes d'humilité, comme
la dernière de la maison.
Tant que les forces le lui ont pu permettre, elle a toujours servi au
réfectoire comme les autres, en son rang, et lavé la vaisselle, et se doutant
qu'on la trompait et ne l'appelait pas à son tour, elle surveillait là-dessus,
et y allait quelquefois de surérogation. Quant à balayer comme les autres (ce
qui lui était assigné sur la carte du bon ordre de la maison), c'est de quoi
elle ne s'est jamais dispensée que par maladies ; et encore,
l'avant-veille de son départ pour Moulins, en son dernier voyage, elle balaya,
et après ramassait, selon sa coutume, la poussière avec des plumes liées
ensemble, mais avec tant de soin et de temps, afin de le bien faire, qu'une
Sœur qui l'attendait à la porte, pour quelques lettres pressées, lui dit, avec
dessein de la faire parler : « Ma Mère, il semble que Votre Charité
trouve des perles, tant elle amasse tout soigneusement. » Cette sainte lui
répondit, avec un visage le plus serein et recueilli qu'il se puisse
imaginer : « J'amasse plus que cela, ma fille, et si nous savions ce
que c'est que l'éternité, nous estimerions plus d'amasser de la poussière dans
la maison de Dieu, que des perles en celles du monde. » La Sœur
alla sur-le-champ écrire ces paroles vraiment si religieuses, tant elle eut
crainte d'en perdre une syllabe.
Elle ne se contentait pas de pratiquer l'humilité dans les rencontres
ordinaires, mais elle recevait à bras ouverts les humiliations qui ne lui ont
pas manqué, et dit une fois sur quelques rencontres, qu'elle avait de quoi se
réjouir et s'humilier en ce qu'elle ne connaissait supérieure en l'Ordre qui
fût autant contrôlée qu'elle ; et comme on lui dit qu'étant Mère de
toutes, elle devait porter le poids général : « Je ne l'ai jamais
pris dans ce sens, dit-elle, mais c'est que je fais plus mal que toutes. »
Une de nos très-bonnes supérieures, la chère Mère de Nantes,
Marie-Constance Bressand, écrivit une fois à cette Bienheureuse Mère, avec sa
parfaite confiance, qu'il y avait des personnes qui censuraient fort qu'elle
souffrit qu'on l'appelât digne Mère. Elle reçut cet avis avec une
allégresse particulière, disant que l'on avait très-grande raison, que ce
mot-là était bien digne de censure, quand on l'employait pour elle, et fit
réponse en ce sens-là à la bonne Mère, la remerciant fort de sa
sincérité ; mais, par une incomparable simplicité, elle nous dit, en nous
faisant écrire, qu'elle n'avait jamais fait attention si on la nommait digne
Mère, ou autrement, ce qui provenait de sa grande indifférence pour les
choses de ce monde et de son attention continuelle à Dieu.
Peu de semaines après ceci, elle reçut des lettres de quelques [458]
autres personnes, qui n'étaient rien moins que civiles, lui disant que cela
rnalédifiait, qu'elle se laissât appeler digne Mère, et qu'elle devrait
effacer ce mot dans les écrits de l'Institut. Cette véritablement digne Mère
lut cette lettre encore de meilleur cœur que l'autre, parce qu'elle était toute
humiliante ; et prenant garde tout de bon à ce mot de digne Mère,
elle nous fit écrire à toutes les communautés de l'Institut, pour les conjurer
de ne plus l'appeler ainsi : elle prit aussi le temps et la peine de faire
lire devant elle les vies de nos Mères et Sœurs décédées, ainsi que le livre
des fondations, afin de faire effacer ce mot de digne, ordonnant
très-expressément à la Sœur qui écrivait ces choses, de n'y plus mettre ce
mot ; lui représentant que la seule raison le lui devrait faire faire,
« étant chose honteuse d'appeler digne celle qui était,
disait-elle, si indigne. »
Une de nos supérieures lui écrivit un jour, par un excès de simplicité
et de confiance, qu'elle avait pensé que l'âge lui avait fait relâcher de la
grande et générale mortification qui reluisait autrefois en elle ; qu'elle
avait cru ainsi sur ce que, passant par son monastère, elle lui vit détacher sa
petite manche pour prendre un insecte qui l'incommodait ; qu'il lui
semblait qu'autrefois elle n'eût pas fait cela. Cette Bienheureuse Mère nous
fit lire, à trois ou quatre, les unes après les autres, cette lettre ;
elle le dit encore à la communauté, protestant qu'il n'était que trop vrai,
qu'elle s'était relâchée en son attention sur ces petites mortifications,
qu'elle voulait faire son profit de cet avis, remerciant avec des paroles
tendres, pleines d'amour et de reconnaissance, celle qui lui avait donné cette
lumière.
En quelques occasions si piquantes qu'on n'ose pas les exprimer,
certaines personnes ayant hautement médit de cette digne Mère et de ses
proches, elle n'en fit jamais semblant ; et dit à quelques personnes de
confiance qui savaient tout cela, que ce mépris et abjection lui avaient
tellement servi pour son intérieur, que, si elle n'eût craint de piquer et
jeter dans la confusion les personnes qui lui avaient fait ce bon office, elle
se fût mise à genoux pour leur en dire grand merci, à mains jointes, ce sont
ses propres mots, ajoutant qu'elle l'avait fait devant Dieu, et avait dit de
bon cœur : « Mon Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent ce
qu'ils font. Par ces paroles, ajouta-t-elle, j'entendais qu'ils ne savaient pas
le bien que m'avait apporté ce petit mépris. »
On l'a vue en des occasions souffrir les injures et reproches sans
s'émouvoir aucunement, ni vouloir faire connaître son innocence, disant
seulement : « Il faut bénir Dieu de tout, et ne se point excuser.[82]«
M. du Péron, très-grand serviteur de Dieu, nous parlant de la
débonnaireté avec laquelle il avait vu cette Bienheureuse Mère supporter une
humiliation qui lui fut peut-être la plus cuisante en toutes les parties et
circonstances, qu'elle ait jamais, souffertes, nous rapporta que jamais cette
Bienheureuse n'avait dit un mot que d'honneur, d'estime et d'affection, pour
les personnes qui lui avaient donné cette pilule, sans être seulement dorée, et
qu'il paraissait sur le visage de cette Sainte une allégresse si
extraordinaire, qu'il ne la pouvait regarder sans admiration. [460]
L'amour du mépris, en cette Bienheureuse, était suivi de la haine
mortelle des louanges, auxquelles elle n'opposait pas une multitude de paroles
d'humilité, mais en disait trois ou quatre, avec un tel poids, qu'on les voyait
venir du fond du cœur et ses yeux nager dans l'eau ; aussi l'on perdait
l'assurance de poursuivre. Elle dit une fois à notre très-honorée Mère de
Châtel, qu'après ses peines intérieures, rien sur la terre ne martyrisait son
cœur comme les louanges, par la claire vue qu'elle avait que Dieu seul mérite
d'être loué. Elle disait souvent qu'il ne faut point louer une personne en sa
présence, ni pendant sa vie, car on ne sait pas quelle sera sa fin ; elle
ajoutait aussi avec un grand sentiment, ces paroles : « Que Dieu
s’est réservé le jugement, la gloire et la vengeance » ; elle
a quelquefois entretenu fort longtemps la communauté sur ces paroles.
Définissant ce que c'était qu'être fille de la Visitation, elle écrivit
les paroles suivantes : « Être vraie fille de la Visitation, c'est
estimer le mépris, et mépriser l'honneur. » Elle disait que
« l'humilité est la clef des trésors de Dieu ; que si l'âme se
présente devant lui sans cette clef, elle n'aura rien de ce qui est dans les
coffres éternels, et demeurera misérable et pauvre. » Elle écrivit une
fois à une supérieure de notre Institut, que, hors de l'humilité solide, il n'y
a que des ombres et simples images de vertu. Souvent, en ses lettres et en ses
discours, elle recommandait l'humilité, mais la véritable, qui fait aimer
d'être tenu et traité pour ce qu'on se reconnaît devant Dieu. Elle ne voulut
pas lire l'oraison funèbre de feu son frère, Monseigneur de Bourges, parce
qu'il y avait des louanges de ses proches, et elle me dit : « Si vous
y trouvez quelque chose de dévot, apprenez-le moi quand vous l'aurez lue ;
du reste, je ne veux pas en ouïr parler. »
En une autre rencontre elle ne voulut pas que nous lui lussions une
lettre où l'on parlait des honneurs que quelques grands [461] avaient faits à
cet unique frère, et comme le roi avait voulu communier de sa main, nous disant
qu'elle aurait scrupule de s'y arrêter, et nous défendit de le dire à la
communauté.
Dieu, qui fait la volonté de ceux qui l'aiment, a contenté le désir de
son humble servante, et a permis qu'elle soit décédée dans la pure pratique de
l'humilité, n'ayant aucune charge en l'Ordre, tenant le dernier rang et la
dernière place ; mais tout ce que nous pourrions dire de l'humilité de
notre digne Mère, n'est pas comparable à la vérité qu'a comprise, en quatre
paroles, notre très-honoré Père spirituel ; que l'excellence de
l'humilité de cette sainte âme consistait à cacher son humilité même.
CHAPITRE XIX.
la douceur et
l'humilité de sa conduite.
Ces deux chères vertus de douceur et d'humilité ont été les pivots sur
lesquels toute la conduite de notre Bienheureuse Mère a toujours roulé. Elle a
écrit, en diverses rencontres, à des supérieures nouvellement élues, qui
craignaient le faix de la supériorité, que si elles étaient humbles, elles
seraient prou fortes ; entre autres, elle mandait à une, sur les derniers
mois de sa vie, que, si un bâton sec avait le pouvoir de s'anéantir et humilier
devant Dieu et qu'il fût choisi pour gouverner, que Dieu lui donnerait plutôt
l'être sensible et intelligible, que de manquer de bien conduire par lui ;
que jamais les supérieures ne manquent à bien conduire qu'elles n'aient manqué
à se bien humilier. Lorsqu'elle écrivait aux supérieures et aux Sœurs qui
allaient en fondation, elle leur recommandait toujours de fonder leur conduite
sur l'humilité, et que, comme pierres de fondement, elles se devaient poser si
bas et si très-bas, par humilité, qu'elles ne se puissent pas trouver
elles-mêmes pour remonter en haut. « Bienheureuses sont les âmes,
écrivait-elle une fois à une de nos Sœurs, qui descendent si profondément en
l'abîme de l'humilité, qu'elles en perdent toute la terre de vue ! Dieu
bénit telles âmes, en toute leur conduite et entreprises. »
Nous pouvons dire que la conduite générale et particulière de notre
Bienheureuse Mère, sur son Institut, a plutôt été par [463] douceur et humilité
que par autorité.[83] Elle n'entreprenait rien sur nos maisons que
par voie de prière, et avec une très-absolue déférence à Messeigneurs les Prélats
et Pères spirituels. Une personne de notable considération la pria une fois
fort instamment, de commander à une de nos Sœurs les supérieures de faire
quelque chose qu'elle désirait grandement ; cette Bienheureuse fit réponse
en ces termes : « Trois choses m'empêchent de faire le commandement
que vous désirez : la première parce que ce serait une moquerie de
commander où l'on n'a droit que d'obéir (elle était alors déposée) ; la
seconde, que moi, n'ayant aucun légitime pouvoir d'ordonner, nos Sœurs n'auraient
aucune obligation d'obéir ; la troisième est que, la chose étant
raisonnable, sans doute, dès que nous aurons supplié nos Sœurs, elles useront
de condescendance à notre désir. »
Le révérend Père Binet lui écrivit une fois, que l'on faisait courir le
bruit qu'elle voulait retirer nos Sœurs de la conduite de sainte
Magdeleine ; elle lui fit réponse en ces termes : « Pour la
froideur que votre Révérence me dit que plusieurs personnes de qualité ont
conçue contre moi, pensant que je voulais retirer nos Sœurs de l'exécution de
cette charité, certes, mon très-cher Père, j'embrasse cette abjection de tout
mon cœur, quoique, en vérité, je n'y aie pas pensé. Premièrement, ma témérité
ne va pas jusques à ce point, de présumer d'avoir l'autorité de le faire quand
je le voudrais, ni ne voudrais l'avoir aussi. Quand donc, dans les occasions,
l'on me demande mes sentiments, je les dis le plus sincèrement que je
puis ; si on [464] ne les suit pas, de vrai, mon très-cher Père, je ne
m'en offense pas, et aurais grand tort de le faire. Si nos Sœurs m'écrivent
pour savoir mes pensées, je les demande à Notre-Seigneur le plus sincèrement
qu'il m'est possible, et si sa bonté me daigne écouter et donner la lumière de
sa sainte volonté, je le leur dis selon la parfaite union et confiance que Dieu
a mise entre nous, leur laissant, comme de raison, l'entière liberté de faire
comme elles jugeront pour le mieux ; car, mon très-cher Père, je ne traite
ni ne dois traiter autrement avec nos maisons ; je serais justement
répréhensible par les supérieurs, si j'en usais autrement. » En ces
paroles, on voit un récit naïf et fidèle de la manière dont cette Bienheureuse
Mère s'est toujours comportée envers l'Institut.
Une autre fois, on lui écrivit qu'on la censurait fort de ce qu'elle ne
mettait pas ordre à établir une générale après elle, puisqu'elle même en
faisait la fonction ; elle fît réponse en ces termes : « Ma
très-chère fille, vous pouvez dire à N. que je vous ai mandé que si j'ai fait
quelques actions qui sentent la générale, c'était saillie de mon orgueil et
promptitude naturelle ; mais qu'au reste je ne pensai jamais à être générale ;
et si je pensais l'être, et voulais passer pour telle, je voudrais être
partout montrée au doigt, comme vaine et vide de l'esprit de vérité. Il est
vrai que l'Institut s'adresse à moi, mais c'est parce que j'ai quasi toujours
été supérieure de cette maison d'Annecy, à laquelle tous les monastères ont
autant de droit de s'adresser, que des enfants à leur maison paternelle ;
et certes, si je me suis jamais étudiée à quelque chose, ç'a été d'agir envers
les monastères qui s'adressent à nous, avec une douce et humble charité,
et sans autre pouvoir que celui de la cordiale prière.[84]« [465]
Lorsque cete Bienheureuse Mère passait par les maisons, l'on n'a jamais
pu gagner sur elle qu'elle ait fait aucun acte de supériorité, non pas même de
se mettre au chœur sur le siège de la supérieure, ni de dire le Benedicite et
les Grâces ; même, si elle avait quelque chose à dire au général de
la communauté, elle faisait assembler les Sœurs ailleurs qu'au chapitre, lequel
elle ne voulait point tenir : elle ne l'a jamais fait, que lorsqu'elle
était supérieure. Même étant dans notre monastère de Moulins, es derniers mois
de sa sainte vie, où il n'y avait point de supérieure élue parce qu'elle
n'avait point accepté la charge, comme nous l'avons dit ci-dessus, elle laissa
faire à l'assistante toutes les fonctions de supériorité, ne voulant pas même
donner la bénédiction à la fin de Compiles ; au contraire, elle s'inclinait
pour la recevoir de la Sœur assistante, laquelle lui ayant dit qu'elle
prononçait les paroles, mais sans oser faire le signe de la croix sur les Sœurs
en sa présence, elle lui dit : « Ma chère fille, eh quoi ! vous
m'avez donc privée de ce bien-là ; je vous supplie, ne le faites plus, il
faut que chacun fasse sa charge ; c'est à vous et non à moi à faire les
fonctions de supérieure. »
Lorsque cette Bienheureuse Mère trouvait quelque chose en une maison
digne d'être corrigée, elle le faisait avec une franchise humblement maternelle
et généreuse ; et de même, lorsqu'on lui donnait avis de quelques défauts,
elle ne manquait point d'en avertir par lettres cordiales et en paroles rondes,
sincères et sans flatterie, disant le mal et faisant voir le bien avec une ingénuité
admirable, se rapportant toujours aux supérieurs [466] par une déférence
très-respectueuse et soumise ; et quand les choses le requéraient, elle
écrivait elle-même à Messeigneurs les Prélats, avec une confiance et humilité
si filiale, qu'ils se rapportaient à elle de tout ce qui serait requis, lui
laissant plein pouvoir ès monastères de leur juridiction ; liberté dont
elle usait avec toute déférence, retenue et modestie.
Plus elle avançait en âge et en perfection, plus elle allait
adoucissant sa conduite ; et en la dernière année de sa vie, elle dit à
notre très-honorée Mère de Blonay : "Ma très-chère Mère, j'ai tourné
et viré de tous les côtés que j'ai su m'imaginer ; j'ai considéré et
essayé toutes les conduites, et après tout, j'ai vu que la conduite douce,
sincère et humble de support est la meilleure, et celle que les supérieures de
la Visitation doivent suivre. » Elle écrivit aussi à une supérieure ce qui
suit : « Ma chère fille, soyez ferme en votre observance ; mais
prenez garde d'être plus rigide à vous-même qu'aux autres ; je ne dis pas
seulement pour vos infirmités corporelles, car vous devez avoir en cela de la
charité et de la condescendance pour vous-même, autrement vous donnerez de
grandes inquiétudes aux filles, mais je dis pour la régularité et les petites
misères de l'esprit : plus je vais et plus je vois que la douceur est
requise pour entrer et se maintenir dans les cœurs, afin qu'ils fassent leurs
devoirs envers Dieu. Et enfin, nos religieuses sont les brebis de Notre-Seigneur ;
il nous est bien permis, en les conduisant, de les toucher de la verge de la
correction, mais non pas de les tondre ni écorcher, ou de les mener à la
boucherie, cela n'appartient qu'au Maître Souverain. »
C'était aussi une des grandes maximes de cette Bienheureuse Mère, pour
la conduite, de ne pas rendre le joug de la religion pesant par les surcharges
de nouvelles obéissances ; et disait « qu'une religieuse est assez
chargée de sa règle ; que le joug de la religion est léger, parce que Dieu
le fait aimer, mais que parce qu'il est joug, il captive et assujettit la
nature ; que les [467] supérieures doivent tenir leurs filles en force et
courage, afin qu'elles portent ce joug sans ennui toute leur vie. » Cette
Bienheureuse disait aussi que, « tandis qu'une fille marche exactement en
sa règle, il la faut voirement exercer pour la faire avancer de plus en plus à
la perfection, mais cela sans rudesse, ains avec un esprit de très-douce
charité et d'un zèle amoureux. » Quant aux défaillantes, elle voulait
qu'on les portât à demander elles-mêmes pénitence de leurs fautes, et disait
« qu'il leur en faut donner de légères, lorsqu'elles s'humilient
véritablement, d'autant que la pénitence d'un cœur contrit est grande, quand il
voit qu'on le traite bénignement. » Dans les pénitences ou corrections,
elle n'usait jamais de paroles de mépris, de reproche ou qui ressentissent tant
soi peu le dédain ; elle savait parfaitement blâmer le défaut en
soulageant la défaillante. Elle disait « qu'une des choses qui lui
pesait davantage, en la charge de supérieure, était l'obligation de conscience
de faire la correction et donner les pénitences, ce qu'elle disait néanmoins
être une des solides parties de la conservation de la religion. » En
quelque monastère, le prélat avait ordonné à une Sœur de ne boire que de l'eau
pour quelques jours ; cette Bienheureuse Mère, jugeant que l'estomac
débile de cette fille en pâtirait, elle obtint licence de mitiger sa pénitence,
et fit mettre secrètement, quelques jours durant, du vin blanc dans le pot d'eau
de cette Sœur, afin que la communauté, qui avait vu ses défauts, ne s'aperçût
pas qu'on lui levait sa pénitence.
Elle avait des supports incroyables pour les esprits faibles ; il
serait difficile de discerner qui tenait le dessus en sa conduite, ou une
gravité toute sainte et pleine de majesté, qui retranchait la mollesse, la
perte de temps, les retours d'amour-propre, ou une bonté maternelle qui la
rendait accostable, amiable et compatissante aux infirmes de corps et d'esprit,
les prévenant avec charité, les écoutant avec patience, leur parlant avec une
charitable douceur, et les assistant avec une humble persévérance. [466] Elle
disait « qu'aux petits courages, il ne faut pas les mettre de prime-abord
à la tête de l'armée, crainte de leur faire prendre l'épouvante, ni leur
montrer toutes leurs plaies, crainte qu'ils ne les croient incurables, mais il
leur faut faire faire doucement leurs pas, à l'exemple du grand Apôtre, qui se
tenait comme une débonnaire nourrice parmi ses enfants. »
Elle avait une charité vigoureuse et généreuse pour le soulagement
corporel de ses filles, et des petits soins véritablement maternels, qui
faisaient admirer comme quoi elle pouvait faire ses petites attentions parmi de
si grandes affaires ; mais beaucoup plus elle avait un soin constant,
cordial, fort et infatigable, pour le bien spirituel de ses filles ;
c'était son but principal, et quand elle voyait une âme s'avancer en la solide
vertu et en la vie intérieure, elle avait un zèle spécial pour la pousser au
bien, et disait qu'à telles filles de bonne volonté, il ne fallait qu'éclairer
leur chemin et échauffer leurs affections ; que, pour peu qu'on les
poussât, elles iraient bien avant dans la perfection.
Écrivant à une supérieure nouvellement élue, elle lui disait les paroles
suivantes : « Votre charge, ma très-chère fille, est une charge de
mère de famille ; appliquez-vous avec un saint zèle au bien de votre
maison, lequel consiste en deux parties : le temporel et le spirituel. Que
votre conduite pour le temporel soit généreuse et humble, non point rétrécie ni
splendide ; gardez d'endetter votre maison, cela donne des inquiétudes
grandes à celles qui succèdent, et des sujets de murmures. Si vous êtes
pauvres, allez doucement et petitement ; quant au spirituel, ayez-en un
soin continuel, mais doux ; rendez tant que vous pourrez vos filles fort
dévotes, de là dépend leur bien ; car, si elles se plaisent à converser
avec Dieu, elles seront fort retirées et mortifiées ; ne soyez point de
ces mères tendres qui n'osent châtier leurs enfants, ni de ces mères
bouillantes qui ne font jamais que crier ; ne flattez [469] point
l'amour-propre, procurez que vos filles vous laissent le soin d'elles-mêmes.
Vous devez savoir, ma très-chère fille, que toutes vos Sœurs n'iront pas d'un même
vol à la perfection ; les unes iront haut, les autres iront bas, les
autres mitoyennement ; servez chacune selon leur portée. Il y a certaines
bonnes petites âmes de qui l'on ne doit pas attendre autre chose que de les
voir marcher en l'observance, leur petit train, sans les vouloir presser, car
on les ferait tomber et s'embarrasser dans l'ennui et le chagrin ;
d'autres qui ont de grandes dispositions pour elles-mêmes et pour autrui ;
celles-là, il les faut pousser à la véritable vertu d'humilité et de dénuement
d'elles-mêmes, avec une constance aussi douce que forte, et ne les point
épargner. Si on loue votre conduite, humiliez-vous devant Dieu, lui référant
cette gloire due à lui seul ; si l'on blâme votre procédé, humiliez-vous
dans cette vérité, que le rien ne peut rien ; et tenez pour chose
certaine, ma chère fille, que vous ferez prou avec la grâce de Dieu, si vous
êtes humble, douce, généreuse et dévote. »
CHAPITRE XX.
combien cette
bienheureuse méprisait tout ce qui sentait l'éclat mondain.
En la vie et en la mort, notre Bienheureuse Mère nous a recommandé
l'amour de la bassesse, et à fuir comme poison mortel tout ce qui sent le
monde, et qui nous pourrait donner de l'éclat devant les yeux du monde. Une
fois, on lui disait qu'une de nos supérieures était un grand et bel
esprit ; que son monastère était dans le lustre par-dessus tous ceux de la
province ; qu'il n'y avait bonne compagnie où l'on ne parlât d'elle ;
que cette maison-là avait toute la vogue. Ce discours toucha vivement notre Bienheureuse
Mère, et elle ne fît autre réponse, sinon : « Je n'ai jamais
contentement de nos maisons, égal à celui que j'en reçois, lorsque l'on me dit
que l'humilité, la dévotion et l'amour à la solitude y ont leur règne, et que
l'esprit qui y domine, ne reluit qu'en simplicité, pauvreté, et mépris des
choses de ce monde. » Elle nous inculquait extrêmement de nous tenir
très-basses et petites devant tous les autres Ordres de religion ; elle en
a parlé dans ses Réponses en termes fort prégnants.
Écrivant à une supérieure qui se plaignait à elle de ce que quelques
autres religieuses nous contrariaient, et faisaient par-dessous main que nous
ne fussions point reçues en une ville, pour y établir plus facilement une
maison de leur Ordre, cette Bienheureuse Mère lui disait : « Il est
vrai, ma chère fille, nous remarquons que partout où les bonnes religieuses N.
N. nous [471] peuvent contrarier, elles le font ; mais, croyez-moi,
n'opposons à leur pouvoir que notre impuissance ; si elles veulent
aller fonder à N., et qu'on les y veuille, laissez-les faire, ne vous opposez
point : n'est-il pas raisonnable qu'elles passent devant ? Si nous
sommes humbles et déférentes, Dieu nous » fournira des établissements, et
meilleurs que ceux que l'on nous ôte. »
Cette Bienheureuse ne voulait pas que l'on fit haut sonner l'appui que
l'Institut pouvait avoir des rois, reines, princes, princesses, grands
seigneurs et grandes dames ; elle disait qu'il se fallait prévaloir avec
une si humble modestie de la faveur des grands, et de la bienveillance dont ils
nous favorisent, qu'eux mêmes voient que nous nous en estimons indignes et que
nous ne voulons point leur être importunes, et que chacun connaisse que nous ne
faisons point parade de notre crédit.
Une personne de très-notable condition, et à laquelle nous avions de
très-grandes obligations, vint un jour prier cette Bienheureuse d'écrire en sa
faveur à Madame Royale, pour lui faire avoir une charge de capitaine dans ses
gardes : jamais il ne le sut obtenir, elle lui dit toujours, avec un
profond rabaissement, que ce serait un sujet de risée, si elle présumait
d'avoir ce crédit ; quoiqu'il lui fâchât extrêmement d'éconduire ce
gentilhomme, elle le fit, et dit à la Sœur qui l'assistait, « qu'elle
aurait grande honte si l'on disait à la cour : un tel a une telle charge
par la faveur de la Mère de Chantal ; » elle procura que Monseigneur
de Genève écrivit à Madame Royale pour ce gentilhomme, disant « qu'elle
prierait Notre-Seigneur pour lui, et que les vraies religieuses ne doivent
estimer être en faveur qu'auprès de Dieu. »
On l'avertit une fois qu'une supérieure déposée avait acquis beaucoup
de crédit, et qu'elle écrivait fort souvent des lettres de faveur pour des
procès et autres affaires ; cette digne Mère chercha dextrement l'occasion
de l'en avertir en charité, lui [472] remontrant que cela était trop éclatant
pour notre petitesse, et lui dit avec confiance, qu'elle-même qui avait de
grandes alliances et connaissances au parlement de Dijon, ne se souvenait pas,
depuis qu'elle était religieuse, d'y avoir écrit des lettres de faveur, qu'à un
sien cousin germain, pour des affaires de piété et de charité ; que nous
nous devrions tenir indignes que nos noms fussent sus ou prononcés dans les
cours ni dans les parlements.
Cette digne Mère n'ignorait pas l'estime et l'affection que la reine
avait pour elle, ce que cette religieuse princesse témoignait, s'enquérant
souvent de ses nouvelles. Lorsque le ciel eut ouï les vœux de la France, et que
cette bonne reine fut enceinte de ce Dauphin tant désiré, Monseigneur de Bourges
lui allant donner la joie de son heureuse grossesse, Sa Majesté le chargea
d'écrire à notre Bienheureuse Mère, qu'elle se recommandait à ses prières, et
qu'elle fît prier tout son Ordre à son intention. Monseigneur de Bourges,
écrivant cela à cette Bienheureuse, la pria fort instamment d'écrire à la
reine, pour la féliciter de sa grossesse, l'assurant que Sa Majesté l'aurait
singulièrement agréable ; mais elle s'en excusa, priant ce bon prélat
d'assurer la reine qu'elle avait écrit à toutes nos maisons, afin qu'on priât
instamment pour Sa Majesté ; et comme nous l'engagions de condescendre à
Monseigneur de Bourges, et d'écrire cette lettre de congratulation, elle nous
répondit : « Non, ferai-je vraiment ; car, qui suis-je, moi, pour
me hasarder d'écrire à cette grande reine ? » Nous nous devons tenir
si basses et si cachées, que nous ne cherchions jamais inventions humaines pour
nous maintenir dans l'affection des grands ; si nous leur rendons bien nos
devoirs devant Dieu, le priant pour leur conservation, heureux succès, et
surtout pour leur salut, Dieu nous fera connaître à eux lorsque nous aurons
besoin de leur protection, et inclinera leurs affections de notre côté. »
Elle disait encore que les grands ont de grandes pensées ; c'est pourquoi,
nous, [473] qui ne sommes que petitesse, ne devons pas croire qu'ils pensent à
nous.
Elle disait une fois qu'elle croyait qu'il n'y avait guère de
congrégations plus aimées des grands que la nôtre, et que c'était un don de
Dieu, lequel nous perdrions, si nous le voulions conserver par des adresses
humaines.
Elle rompit tout à fait quelques affaires bien importantes, parce
qu'elles nous tiraient dans une grande autorité et faveur mondaine ; et
une fois, parlant de cela, elle mit la main sur ses yeux, avec une grâce
ravissante, et nous dit : « Dès que l'on m'a fait voir ce
grand éclat mondain, mes yeux ont été éblouis, et je n'ai plus vu goutte en
cette affaire, répétant souvent ces paroles : L'éclat des filles de la
Visitation est d'être sans éclat ; et leur gloire, est la petitesse.[85]«
On lui écrivit une fois que nos Sœurs de Paris pourraient beaucoup en
une affaire, d'autant qu'elles avaient grand crédit au Parlement ; elle
leur répondit : « Il est vrai qu'elles y ont grand crédit, et Dieu le
leur conserve, parce qu'elles conservent envers Dieu leur simplicité et
bassesse, et un très-grand oubli du monde. Je puis vous assurer que ces trois
vertus éclatent dans leur communauté, et cela est notre véritable éclat. »
Lorsque cette Bienheureuse allait par les champs, elle [474] évitait,
tant qu'elle pouvait, qu'on lui fît des entrées pompeuses et avec cérémonie.
Quant elle était contrainte de recevoir des harangues de ceux du clergé, ou des
magistrats, qui l'allaient visiter en corps, elle rougissait comme une jeune
fille qui reçoit une abjection, et y répondait avec peu de paroles, comme
voulant faire voir qu'elle ne savait pas correspondre à ce qui sentait la
mondanité et le faste.
Une fois, une Sœur lui dit que madame de Toulonjon, sa fille, lui avait
donné charge de l'avertir quand elle devait partir pour son voyage de France,
de l'année 1635, afin qu'elle allât l'attendre sur chemin, pour la conduire.
Cette Bienheureuse se tourna gracieusement du côté de notre chère Mère Favre,
et lui dit : « Que ferons-nous là ? Dieu sait quelle consolation
ce me serait d'avoir ma fille avec moi ; mais c'est une pitié, il faut
avoir litière, carrosse, train, tout cela me déplaît extrêmement ; quand
nous arriverions en quelques villes, on dirait : C'est la Mère de Chantal
qui va à Sainte-Marie ; cela vous sent le monde, et m'est à
contre-cœur ; j'aime tant, ajoutait-elle, mon petit train, notre litière
fermée, notre ecclésiastique et deux muletiers. »
Avec quelle force cette digne Mère a résisté que cinq ou six de nos
Sœurs, issues de grandes maisons, aient accepté de grandes abbayes qui leur
étaient offertes par leurs proches ; et combien a-t-elle su gré à notre
chère Sœur Anne-Marie de Lage, de la généreuse résistance qu'elle fit
d'elle-même à M. le duc du Puy-Laurent, son frère, pour un semblable
sujet ; elle écrivit à notre chère Mère Marie-Jacqueline Favre :
« Au reste, la chère Mère de Poitiers (c'est celle dont nous venons de
parler) est bien heureuse d'avoir tant témoigné de vertu et d'amour à sa petite
vocation, et donné cet exemple à son Institut, duquel celles-là seront
illégitimes, qui ne sauront pas d'une franche volonté préférer la bassesse à la
grandeur ! O Dieu ! que j'aurais d'aversion à voir une de nos Sœurs
s'appuyer sur une [475] crosse, et posséder le rang, le nom et le train d'une
dame ! »
Cette Bienheureuse a défini, dans ses Réponses, avec des paroles
qui semblent exagérantes, bien qu'elles ne le fussent pas selon son zèle, que
jamais nous ne devons accepter, ni posséder abbayes ni prieurés, si ce n'est
pour les transmuter entièrement en des monastères de la Visitation, et cela
avec provision de Rome ; et encore, en ceci, voulait-elle que nous
fussions extrêmement réservées.
Une fille, un peu mécontente, écrivit une fois à cette Bienheureuse
Mère, qu'elle avait quitté une abbaye et un prieuré, pour être fille de
Sainte-Marie, et qu'ayant refusé la crosse que saint Benoît lui présentait,
elle n'avait trouvé qu'une croix ès-mains de notre Bienheureux, pour elle.
Cette digne Mère lui répondit : « Ma fille, c'est votre bonheur
d'avoir trouvé la croix ; la crosse n'ouvrit jamais le ciel à personne, la
croix l'ouvre à tout le monde. En vain vient-on à la Visitation, si l'on
prétend y trouver autre chose que la vie cachée et humble de la croix ;
car, ma chère fille, ne lisez-vous pas que la Congrégation même est fondée sur
le mont du Calvaire ? »
Non-seulement cette Bienheureuse Mère haïssait le faste en ces choses considérables, mais jusques aux moindres : les contenances composées, les discours étudiés, la propreté affectée, le langage à la mode, les lettres de compliments et de mots recherchés, tout cela lui était en horreur ; et quand il venait quelque fille qui parlait mignardement, cette Bienheureuse prenait un soin incroyable de lui faire changer son langage, la reprenant à tout coup et la faisant lire devant elle, pour lui faire prononcer les mots tout à la bonne foi. Même elle ne voulait pas qu'en traitant et parlant des choses spirituelles, nous usassions des termes de doctrine et de suréminence, disant que cela est contraire à l'humilité et simplicité de vie de laquelle nous devons faire une absolue profession. [476]
Allant par nos maisons, elle trouvait d'ordinaire qu'on lui préparait
des agenouilloirs au chœur ; jamais elle ne s'y voulait mettre, ni
souffrir sur sa table un petit tapis de serge noire. « Sommes-nous
dames ? disait-elle, nous faut-il les appareils du monde ? »
Elle faisait ôter tout cela devant elle.
Une fois, il vint une religieuse céans qui était un peu musquée ;
cette Bienheureuse Mère dit que, toutes les fois qu'elle l'approchait, le cœur
lui faisait mal de cette senteur, et dit : « Je m'admire en cela, car
nos princesses viennent ici tant musquées et parfumées que tout ce qu'elles
touchent demeure odoriférant, et je ne pense pas seulement à leur senteur ;
mais à cette autre personne, cela me donne au cœur ; je crois que cela
provient de l'aversion que nous devons avoir des choses mondaines ès personnes
religieuses qui ne doivent point porter d'autre musc que celui de l'odeur de
leur piété, humilité et modestie. »
Elle détestait grandement les fredons et mignardises du chant ; et
quoiqu'elle aimât fort d'ouïr des belles voix, et des litanies et cantiques
bien chantés, elle voulait que ce fût simplement, sans ces feintes et artifices
du monde.
Elle voulait que, non-seulement en nos personnes, mais encore en nos
bâtiments, tout respirât cette humble simplicité et mépris du monde. Notre
Bienheureux Père, parlant d'elle en une épître, sur le sujet du peu de place
que nous avons en ce premier monastère, dit : « Quant à notre Mère,
elle a si bien appris à loger au mont du Calvaire, que toute habitation
terrestre lui semble encore trop belle. »
Cette Bienheureuse nous a souvent dit que les supérieures, quand on
bâtissait, se devaient tenir bien attentives, afin que les architectes ne
fissent rien faire qui ressentît la splendeur, et qu'elle était mortifiée
toutes les fois qu'elle se représentait un certain pavillon qui fait l'entrée
du logis des tourières et des parloirs, en notre maison de Tours, « parce
que, disait-elle, cela [477] sent son petit château ; mais il a été fait
avec tant d'affection et de sainte bonne foi de la part de celui qui conduisait
le bâtiment, que cela seul me le rend supportable. » Lorsque nous
écrivions la fondation de notre monastère de Troyes, en Champagne, cette
Bienheureuse Mère y fit ajouter qu'il y avait des superfluités aux bâtiments
par des embellissures que l'architecte y avait fait faire, à quoi les Sœurs
n'avaient pu avoir l'œil, parce que l'on bâtissait loin de leur séjour. En ce
dernier voyage, elle reprit nos chères Sœurs de Nevers de ce qu'il y a trop
d'embellissure au portail de leur nouvelle église, et leur ordonna d'écrire à
tous nos monastères qu'elles avaient failli en cela, tant elle craignait que
ces exemples pussent tirer à conséquence, et que d'autres voulussent faire ce
qu'elles voyaient que d'autres avaient fait.
CHAPITRE XXI.
de son amour à
l'observance régulière.
La règle et les actions de notre Bienheureuse Mère étaient tellement
ajustées l'une à l'autre, que l'on peut dire que l'une était la juste mesure de
l'autre, et qu'elle avait, selon l'enseignement qu'elle nous en a donné, à la
fin de sa vie, ajusté toutes ses inclinations à la règle, et non pas la règle à
ses inclinations.
Elle recommandait incessamment la ponctualité de l'observance, soit en
ses lettres, soit en ses discours ; mais une ponctualité sans gêne et sans
rétrécissures ; une ponctualité gaie et amoureuse, une ponctualité
provenant de l'intérieur, et nous répétait fort souvent de n'avoir point une
exactitude à l'écorce de la lettre, mais qu'il fallait pénétrer le sens et
l'esprit de la lettre. « Il est bon, disait-elle, d'observer la règle qui
dit que l'on ira promptement au son de la cloche ; mais beaucoup meilleur
d'observer, ric-à-ric, celle qui ordonne la parfaite abnégation de sa propre
volonté. » Elle nous disait souvent : « Mes Sœurs, j'ai si grand
peur que nous nous contentions de cette observance extérieure, sans nous
appliquer aux règles qui concernent purement la perfection intérieure ! nous
rendrons un compte plus exact de celles-ci que des autres. » Elle disait
qu'elle ne savait point de règles qui la pressassent de si près que
celle-ci : Elles feront toutes choses en esprit de profonde, sincère et
franche humilité ; qu'il fallait remarquer que la règle [479] dit en
esprit, et non pas en contenance, en paroles et en beau semblant.
Elle recommandait aussi, avec une affection singulière, l'exactitude
aux petites choses, et répétait souvent cette parole prononcée par l'éternelle
vérité : Celui qui rompra un de ces petits commandements et enseignera
aux autres à faire de même, sera tenu le plus petit au royaume des cieux. Cette
vérité nous porte à croire notre Bienheureuse Mère très-grande au royaume des
cieux ; car elle a observé et nous a enseigné d'observer, avec une
fidélité véritable, tous ces très-petits commandements de règle, cérémonies et
petites ordonnances, qui sont en grand nombre ès maisons religieuses, esquelles
tout se fait avec règlement et bon ordre. Plus elle avançait en âge, plus elle
se rendait ponctuelle en ces petites ordonnances et minces pratiques ;
elle ne se lut pas dispensée d'un enclin de tête, d'une cérémonie, d'une
attention à trousser sa robe en descendant un escalier.
Étant déposée, elle était des premières, la veille du jour de l'an, à
remettre, à la Sœur assistante, sa croix, chapelet et images pour les
changements, où elle tirait comme les autres Sœurs, sans vouloir de dispense.
Elle se mettait à genoux pour faire les avertissements devant la supérieure
comme les autres ; que si l'on avertissait plusieurs Sœurs ou la
communauté en général, de quelque défaut d'observance, elle était des premières
à genoux pour s'en accuser, pour peu qu'elle crût y avoir manqué ; car
elle n'approuvait pas que l'on s'accusât à la légère de toutes choses, et
disait que c'était faire une action si vénérable sans application et par
manière d'acquit.
C'était une chose admirable que l'exactitude qu'elle avait à se trouver
à tous les Offices et oraisons même extraordinaires, qui ne sont que permis par
la règle. Son âge et la multitude de ses affaires lui ayant rendu les matinées
fort utiles, elle demanda permission à feu Monseigneur de Genève de s'exempter
d'assister [480] à tierce et à sexte, où elle n'assistait guères que les fêtes ;
elle dit aussi à notre très-bonne Mère de Châtel de demander permission à
Monsieur notre très-honoré Père spirituel, pour une Sœur qu'elle occupait aux
écritures, et qui, à cause de cela, ne pouvait assister aux communautés.
Lorsque cette Bienheureuse Mère fit faire l'ornement, pour la
béatification de notre Bienheureux Père, comme c'était une besogne de longue
haleine, et qu'il fallait de nécessité que les Sœurs se levassent un peu matin
l'été, et s'absentassent des Offices, elle le dit à Monseigneur de Genève, et
nous ordonna de prendre un temps et le son d'une cloche à laquelle nous nous
rendrions promptes à partir, pour faire nos exercices, afin qu'en cela nous
nous tinssions toujours dans l'observance.
Lorsqu'elle ordonnait aux Sœurs de se trouver à quelque travail commun,
comme à porter du bois, des pierres, de la lessive et autres choses, elle ne
manquait point de s'y trouver ; même quand son âge et sa petite complexion
lui eurent diminué les forces, elle portait trois charges en l'honneur de la
sainte Trinité, ou cinq en l'honneur des cinq plaies ; puis se retirait,
disant gracieusement : « Nos Sœurs offrent à Notre-Seigneur, selon la
richesse de leur ferveur, et moi, selon ma pauvreté et faiblesse. » Ce qui
faisait qu'elle avait tant de temps pour se trouver avec la communauté, c'était
qu'elle n'en perdait point en discours inutiles ; elle écoutait
véritablement les Sœurs selon leurs besoins, avec une amiable bonté et
patience ; mais, après cela, elle coupait court aux superfluités, avec une
si sainte fermeté, que l'on n'avait pas l'assurance de s'approcher d'elle pour
cela ; même, elle reprenait et faisait avertir les Sœurs, si, faute de
prévoir à demander leurs congés aux obéissances, il fallait qu'elles parlassent
au silence.
Quant au parloir, elle avait une adresse incomparable pour s'en
dégager ; et, comme elle avait une entière charité pour y demeurer, et
souvent et longuement, lorsque la charité le [481] requerrait, pour la
consolation de quelque âme, aussi prenait-elle, avec une sainte rigidité, l'occasion
de s'en dégager lorsque les Offices sonnaient ou quelque autre communauté,
quand elle n'y était retenue que par des personnes dont elle osait se séparer,
ou par des discours indifférents. Elle disait « que notre grande civilité
est de nous montrer bonnes religieuses ; » il lui était bien plus
facile d'en user de la sorte qu'à aucune autre, plusieurs personnes se tenant
satisfaites seulement de l'avoir vue, et n'eussent osé par respect la retenir.
Elle disait encore « que la religieuse amie des discours inutiles ne sait
guère que c'est que de converser avec Dieu. »
Elle avait une affection nonpareille à la sainte lecture ;
néanmoins, les jours ouvriers, elle n'y employait que la demi-heure que la
règle ordonne ; et lorsque l'on eut conclu que celles qui ne voudraient
pas prendre leur demi-heure de repos, l'été, après midi, étaient obligées de
faire leurs ouvrages, cette Bienheureuse, qui avait jusqu'alors accoutumé de
donner cette demi-heure à la sainte récréation de son esprit, lisant dans la
Sainte-Écriture, se retrancha absolument cette petite liberté, et s'assujettit
à faire son ouvrage, comme les autres, lorsqu'elle ne reposait pas ; et,
lorsque les Sœurs la priaient de continuer à faire cette demi-heure de lecture,
elle répondit : « Il faut toujours faire ce qui est plus conforme à
la règle, quand on en a la connaissance. » Quelquefois, elle revenait du
parloir fort lassée et abattue, qu'il n'y avait plus qu'un demi-quart d'heure
de récréation, les Sœurs la priaient, pour ce peu de temps, de ne pas reprendre
son ouvrage ; elle se souriait gracieusement : « Eh ! que
ferons-nous de la règle, disait-elle, qui ordonne que les Sœurs s'entretenant
aux récréations feront leurs ouvrages ? « Cela dit, elle prenait le
sien.[86] Elle répétait [482] souvent que rien n'était
ordonné en vain dans les règles et familles religieuses, et avait grande
aversion que l'on glosât ou que l'on fit des questions qui tant soit peu
retirassent de cette entière simplicité et fermeté à l'exactitude ; et,
d'ordinaire, elle ne répondait autre chose, sinon : « Voyez ce qui
est écrit et le faites. »
Une supérieure lui proposa une certaine méthode de faire rendre compte
aux Sœurs de leur intérieur, en sorte qu'elles ne le fissent que de trois mois
en trois mois ; que les autres mois, elles iraient seulement dire un mot,
et que toutes auraient passé en une heure ; cette Bienheureuse fut touchée
tout à fait de cette proposition, et fit réponse un peu fortement, « que
si elle savait des maisons où l'on interprétât dans ces largesses-là l'observance
de la règle, qu'elle s'en plaindrait au supérieur, priant la bonne Mère, si
elle avait fait ce défaut, de s'en confesser, et de s'en imposer quelques
pénitences elle-même, en sorte qu'elle s'en ressouvînt toute sa vie. »
Quasi en même temps, une autre supérieure lui manda qu'elle faisait rendre
compte un mois à un des chœurs, et l'autre mois à l'autre, et cela, à cause
qu'elle avait des grandes occupations, tant au bâtiment qu'aux autres
affaires ; cette Bienheureuse lui répondit : « Ma chère fille, votre
grande occupation doit être d'observer [483] votre règle sans en omettre un
iota, et je vois que vous l'enfreignez en un point très-essentiel, qui est la
direction intérieure des Sœurs ; or, je vous conjure, relevez-vous de ce
défaut, mais absolument ; et demandez pardon à votre chapitre du mauvais
exemple que vous lui avez donné en donnant cette entorse à la règle, afin que
nul n'en tire conséquence ; je bénis Dieu de ce que me voici sur le
dernier triennal de ma vie, sans que je me souvienne d'avoir jamais passé un
mois sans faire rendre compte à nos Sœurs, sinon quand j'ai été absente en
voyage, et une seule fois au temps de ma grande maladie. » Cette
Bienheureuse Mère était si exacte en ce point, que, devant aller faire des
petits voyages par nécessité à nos monastères voisins, comme Chambéry et
Thonon, elle partait après avoir fait rendre compte aux Sœurs et revenait à
point nommé pour les ouïr le mois suivant.
Des conseillères, d'une de nos maisons, écrivirent à cette Bienheureuse
Mère quelques semaines seulement avant son départ pour Moulins, en son dernier
voyage, pour la supplier d'agréer que le dernier triennal de leur Mère fut de
quatre ans ou que l'on retardât sa déposition de quelques mois, et puis, qu'on
laissât écouler un an sans faire élection, en sorte que cette Mère ne fût
déposée que de nom, et que d'effet elle conduisit toujours, disant qu'elle leur
était si utile pour leur bâtiment, et autres raisons que cette digne Mère
nommait déraisonnables. Elle fut si touchée de cette proposition si fort contre
l'observance, qu'elle en pleura, et nous dit « que si Dieu l'abandonnait
jusqu'à ce point, que d'écrire ainsi, afin de procurer que l'on fît des choses
contre l'observance et les règles, qu'elle voudrait que la main lui séchât,
pour donner l'exemple à tout l'Ordre de se tenir ferme et simple à
l'observance ; que toutes ces interprétations étaient, en l'Institut,
comme ces faux traducteurs entre les juifs, qui annulaient la loi par leur
tradition » ; et, appelant notre chère Mère de Blonay, elle lui
dit : « Ma [484] chère Mère, que diriez-vous de ces filles qui m'ont
écrit telle chose ? Je vous assure que si un monastère faisait ce qu'elles
me disent, et que les supérieures n'y voulussent pas mettre ordre, j'aurais
recours à Rome ; car, après avoir fait un triennal de quatre ans, l'on
dira que le premier se peut bien faire de cinq, et ainsi l'observance s'abattra
peu à peu ; et, si je ne savais l'innocence des filles qui m'ont écrit, et
n'étais assurée qu'elles s'arrêteront à ce que nous leur dirons, je leur
procurerais une bonne mortification de leurs supérieurs, et qu'ils les
déposassent de leurs charges de conseillères.[87]« [485]
Cette Bienheureuse Mère avait cette sainte observance si à cœur,
qu'elle s'y tenait ferme, même dans les voyages, portant une montre pour faire
ses oraisons, lectures, et dire son Office à l'heure que la constitution
l'ordonne. Elle portait toujours sa Règle sur elle et y lisait chaque
jour quelque chose, la baisant d'ordinaire, après l'avoir lue, et ne se
contentait pas de lire les Constitutions une fois le mois, comme il est
ordonné ; mais il y avait certains points qui regardent la perfection
intérieure, qu'elle lisait souvent et conseillait aux Sœurs de faire le même,
disant qu'il n'y a plus excellent livre pour une religieuse, que sa Règle.
CHAPITRE XXII.
de sa douce
conversation, et de son exactitude au silence.
Comment n'aurait pas été agréable la conversation de celle qui ne
conversait en la terre que l'esprit au ciel ; je n'entends pas parler ici
de la conversation de cette Bienheureuse avant son veuvage, il ne faudrait pour
cela que décrire les entretiens d'une dame généreuse, de bon jugement, d'un
esprit agréable, d'une façon attrayante, mais naïve ; d'un bon discours,
mais sans flatterie et sans affecterie ; toujours modeste, et en tout
très-aimable et très-aimée de toute sa province.
Quand elle fut veuve, elle moula ses conversations sur les instructions
que notre Bienheureux Père donne à sa chère Philothée. Ce n'était plus qu'une
gracieuse sériosité ; qu'une aimable et suave piété, qu'une prudente et
dévote condescendance, sans gêne ni contrainte, selon les temps, les lieux et
les personnes ; mais quand elle fut entièrement retirée des cavernes des
léopards, pour entrer dans les secrets et se retirer ès pertuis de la vie
religieuse, il faut avouer que cette sainte épouse parla un nouveau
langage ; ce n'était plus que des discours de Sulamite, et nous avons
appris de nos premières Mères, qu'il n'y avait rien de plus fervent, au
commencement de l'Institut, que les conversations et récréations des Sœurs. Ces
bénites âmes étaient enivrées d'un lait meilleur que le vin, et ne pouvaient se
dilater ni se réjouir qu'au souvenir des mamelles du souverain Bien-Aimé ;
elles ne parlaient quasi d'autres choses que de la ferveur, de l'oraison, et de
la fidélité de la mortification, se [487] disant, avec une simplicité
ravissante, leurs petits biens ; de quoi notre Bienheureuse Mère leur
donnait un exemple si doux, que toutes étaient attirées à l'odeur de ce suave
parfum. Cela passa si avant, que notre Bienheureux Père ordonna que l'on ne
parlât point tant de l'oraison à la récréation, que l'on se mît d'avantage dans
l'indifférence et dans les discours moins sérieux. Pour se bien récréer, il
fallait que notre Bienheureuse Mère y fût, et quand elle manquait aux
récréations, il y manquait la meilleure partie de la joie et de la
suavité ; elle portait l'une et l'autre sur son visage, et cette digne
Mère a eu grand soin, dans ses Réponses, de bien inculquer aux
supérieures, combien l'exercice de la récréation est nécessaire aux filles,
surtout à celles, qui, comme nous, doivent faire profession d'une grande
solitude, retraite et vie intérieure.
Une fois, une de nos Sœurs les supérieures lui écrivit qu'il lui
semblait que sa charité devait donner quelques avis, afin que les récréations
se fissent avec sériosité ; que, pour elle, elle avait peine à voir rire
ses filles, quand elle pensait que saint Benoît ne riait jamais ; cette
Bienheureuse Mère lui fit réponse : « Ma chère fille, il faut honorer
tout ce que les saints ont fait ; si vous étiez Bénédictine, nous nous
mettrions en devoir de vous faire expliquer ce trait de la vie du grand saint
Benoît, mais puisque vous êtes de la Visitation, il faut comprendre l'esprit du
saint Fondateur, lequel était un saint, je vous en assure, et sa sainteté ne
l'empêchait pas, dans les temps d'une sainte récréation, de porter un esprit de
joie gracieuse, qu'il communiquait aux autres, et riait de bon cœur quand il en
avait sujet. Je lisais, il y a peu, dans l'Écriture, que Sara, sur le sujet de
la conception de son fils, disait : Le Seigneur m'a fait rire ; je
pensais que l'esprit de Dieu porte joie, et que puisque sa Providence nous a
assujettis au boire, au manger, au dormir et aux divertissements, nous devons
dire : le Seigneur me fait boire, le Seigneur me fait manger, [488] le
Seigneur me fait dormir, le Seigneur me fait rire et récréer ; et ainsi
tout se fera par l'obéissance et au nom du Seigneur. Prenez garde, ma chère
fille, à ne point retrancher à vos Sœurs la liberté que la règle leur donne, et
ne soyez point si rigide ; pourvu que les récréations se fassent selon la
règle, soyez contente. Voyez-vous, ma fille, nous autres supérieures, quand
nous avons passé une partie du jour dans les affaires, à parler aux Sœurs ou
dans le parloir, nous trouvant aux récréations, il nous semble être de loisir,
et que nous donnerions volontiers ce temps-là à un entier recueillement ;
mais nos Sœurs qui n'ont bougé du chœur et de leurs cellules, elles ont nécessité
de débander leurs arcs, comme dit notre Bienheureux Père. »
Il est vrai que cette Bienheureuse Mère, depuis quelques années, soit
par la multitude d'affaires, soit par la grandeur de son attention intérieure,
soit pour l'extrémité de ses peines d'esprit, soit par le continuel ennui
qu'elle avait de la vie, ou par l'abattement de l'âge, ne se récréait plus
autant que dans ses premières années ; mais elle nous en laissait une
entière liberté, et quand elle voyait qu'à cause d'elle nous nous taisions,
elle nous priait de parler, et que si elle ne disait mot, c'était parce que son
oppression d'estomac l'en empêchait, et pour nous donner plus de confiance,
elle faisait parfois quelques petits contes de récréations.
Elle était la surveillante de celle qui a charge de souvenir
quelquefois de la divine présence durant les récréations, et le faisait souvent
elle-même, entrejettant quelques paroles dévotes, et quand la fin de la
récréation s'approchait, elle mettait en train quelques choses de dévotion,
afin qu'on s'en allât au silence, avec une affection spirituelle. L'avent et le
carême, elle désirait que nos récréations fussent plus dévotes qu'aux autres
temps, et, quelquefois, en ces temps-là, elle nous disait (non point qu'elle en
fit coutume ni habitude générale) : « Récréez-vous [489] tant que
vous voudrez demi-heure, et l'autre demi-heure, vous me la donnerez pour parler
de Notre-Seigneur. » Tandis que nous employions notre première demi-heure,
elle se tenait les yeux fermés en filant doucement sa quenouille ; mais
quand le temps de parler de Notre-Seigneur était venu, elle trouvait bien sa
langue et son estomac.
Quant à ses conversations en particulier ou au parloir, elle était
sage, sainte, gravement suave ; elle avait en singulière recommandation de
ne point demeurer inutilement au parloir, ne voulant point savoir les nouvelles
du monde, et quand elle en savait quelques-unes, jamais elle ne les apportait
dans la communauté.
De son amiable conversation nous devons passer à sa grande fidélité et
amour du silence. Quant à celui de l'après-dîné, comme elle a quasi toujours
été supérieure, et obligée de parler aux Sœurs et traiter d'affaires, jamais
nous ne lui en avons vu faire scrupule ; mais pour le grand silence, il
faut avouer qu'elle y était saintement austère et rigide, et, sans une vraie
nécessité, elle n'eût pas dit un seul mot ; elle reprenait fort les Sœurs
lorsqu'en ce temps-là, on lui allait dire quelque chose qu'on pouvait prévoir
ou retarder. Étant en notre monastère de Grenoble, son exactitude au grand
silence fit faire un agréable équivoque : elle s'était retirée pour dire
Matines en sa cellule, ou ne trouvant point d'Heures, elle fit signe à sa
compagne, lui disant par un demi-mot : heu,
au lieu de dire entièrement : Donnez-moi des Heures. La
compagne crut que cette digne Mère se trouvait mal, ayant fort peu soupé, et
qu'elle demandait un œuf. Elle va trouver la supérieure, et le lui dit ;
l'on s'en mit d'autant plus en peine que jamais cette Bienheureuse ne faisait
de telles demandes ; le bon du jeu fut qu'il ne se trouva point d'œufs
frais dans la maison, il fallut envoyer une Sœur tourière à la maison voisine
en chercher. Avant qu'ils fussent venus et cuits, notre Bienheureuse Mère [490]
eut bien à attendre, seule en sa chambre, à genoux, devant son crucifix. Enfin
voici la supérieure, sa compagne, et quelques autres Sœurs, qui apportèrent ces
œufs, et venaient savoir comme cette digne Mère se portait. Quand elle vit cet
équivoque, elle rit de si bon cœur, que jamais œufs ne lui firent plus de bien ;
mais par une sainte austérité à garder sa résolution de ne point parler au
grand silence que pour les choses nécessaires, elle se contenta de dire :
« C'est des Heures que je demande », et remit au lendemain à faire en
détail ce conte à la récréation, donnant le bonsoir à la supérieure et aux
Sœurs, par un sourire gracieux et un enclin. Cet équivoque et encore quelques
autres furent cause qu'elle ordonna qu'il valait mieux écrire ce qu'on voulait,
au silence, ou dire cinq ou six courtes paroles pour la vraie nécessité, que de
faire des signes peu intelligibles, et qui mettent en peine ou excitent à rire.
Feu madame la baronne de Thorens, fille de notre Bienheureuse Mère,
demeurait souvent dans le monastère, vu même, qu'outre qu'elle était fille de
notre Fondatrice, nous n'avions pas alors la clôture absolue. Tous les matins,
cette aimable fille, lorsque l'on sonnait l'oraison, se mettait sur le seuil de
la porte de sa chambre, pour donner le bonjour à sa chère mère, laquelle, sans
dire mot, lui rendait le bonjour en silence, par un regard amiable et un petit
enclin de la tête.
Cette Bienheureuse Mère nous parlait fort souvent de la vertu du
silence non-seulement extérieur, mais intérieur ; ordinairement, elle ne
parlait point de l'un sans l'autre, et disait qu'elle avait remarqué, en
passant par plusieurs de nos maisons, que celles où le silence était le mieux
observé, les Sœurs y avaient plus de grâces extraordinaires. Elle nous
recommandait extrêmement le peu parler, et disait « que comme nous devions
avoir aux récréations une sainte joie et allégresse, qu'aussi hors de là nous
devions être fort retenues, pour nous appliquer sérieusement à Dieu. »
Elle nous répétait souvent : [491] Mes chères filles, il faut servir Dieu sérieusement, et faire grand
état du saint deuil ; car bienheureux sont ceux qui mènent deuil en ce
monde, ils auront une éternelle consolation et allégresse en l'autre. »
Depuis quelques années, elle nous parlait beaucoup de ce saint deuil et de
cette vertueuse tristesse qui fait opérer le salut avec crainte et tremblement,
et disait que le silence en est un grand moyen.
Quand elle trouvait quelque chose dans les livres qui traitent du trop
parler, ou de l'utilité du silence, elle en faisait d'ordinaire la répétition à
la communauté, nous témoignant un grand désir que non-seulement par obligation
nous fussions très-exactes au silence, mais que, par dévotion et désir de
perfection, nous fussions très-zélées à retrancher toutes paroles inutiles,
hors le temps des récréations. Quant à elle, elle disait toujours beaucoup en
se taisant ; son admirable modestie, un signe de ses yeux colombins, la
gravité, sagesse et tranquillité de ses actions, parlaient plus que sa langue.
Elle disait « qu'une religieuse qui aime fort le silence, est
toujours très-soigneuse de toutes sortes de petites pratiques d'observance et
de vertu, parce qu'elle est chez elle en recueillement, lorsque les occasions
se présentent. » Cette Bienheureuse Mère avait une si parfaite affection
que l'on ne négligeât aucune de ces choses qui semblent petites, qu'elle nous
en parlait souvent ; nous faisant voir qu'elles semblent petites, mais que
l'amour les doit agrandir, et elle-même s'y rendait si soigneuse, que nous en
étions en admiration.
CHAPITRE XXIII.
on commence à parler
de l'intérieur de notre bienheureuse mère, et 1° de l'honneur et obéissance à
son conducteur.
Il n'est pas mal à propos, ce me semble, d'entrer par la porte du
silence dans l'intérieur de notre Bienheureuse Mère. Nous ne voulons pas
rappeler ici l'honneur et le respect que cette Bienheureuse rendit à ce premier
Père spirituel, duquel nous avons parlé ci-dessus ; mais quand cette
obéissante Tobie eut trouvé l'angélique Ananie pour la conduire au voyage de la
perfection et vie intérieure, elle l'aimait comme son Père, mais elle le
révérait comme son Ange : « Je ne savais quelquefois, dit-elle, quand
je regardais ce saint Prélat, si je devais croire que c'était un Ange que Dieu
avait envoyé vivre parmi les hommes où si c'était un homme qui s'était rendu
Ange par la grâce divine. » Elle s'estimait indigne de lui filer ses
habits, et d'accommoder de sa propre main les petites choses qui servaient à
son usage. Dieu lui faisait voir ce sien fidèle Serviteur si élevé en
perfection, que souvent elle trouvait son cœur hors d'espérance d'y pouvoir
atteindre, et il fallait parfois qu'elle encourageât son âme par ces paroles du
Sauveur : « Soyez parfait comme votre Père céleste est
parfait. » Toutes les paroles que ce saint évêque proférait pour
l'instruction de cette sienne chère fille, étaient des grains d'amour qu'elle
enterrait dans la bonne terre de son cœur, et les arrosait d'un continuel désir
et fidélité, qui faisaient sortir en effet des fruits de toutes vertus.
Elle s'engagea, l'an 1604, à obéir à ce saint Prélat par un vœu fait de
tout son cœur et écrit de sa main, comme nous [493] avons dit ci-dessus. Le
Bienheureux s'engagea aussi par vœu à la conduite spirituelle de cette
Bienheureuse Mère ; voici les propres termes que cette bénite Mère a
portés le reste de ses jours sur elle, et qu'elle a désiré être enterrés avec
elle : « Je, François de Sales, évêque de Genève, accepte, de la part
de Dieu, les vœux de chasteté, obéissance et pauvreté, présentement renouvelés
par Jeanne-Françoise Frémyot, ma très-chère fille spirituelle, et après avoir
moi-même réitéré le vœu solennel de perpétuelle chasteté, par moi fait à la
réception des Ordres, lequel je confirme de tout mon cœur ; je proteste et
promets de conduire, aider et servir, et avancer ladite Jeanne-Françoise
Frémyot, ma fille, le plus soigneusement, fidèlement et saintement que je
saurai en l'amour de Dieu et perfection de son âme, laquelle désormais je
reçois et tiens comme mienne, pour en répondre devant Dieu notre Sauveur, et
ainsi je le voue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, un seul vrai Dieu, auquel
soit honneur, gloire et bénédiction, ès siècles des siècles. Amen. Fait en
élevant le très-saint et très adorable Sacrement de l'autel, en la sainte
messe, à la vue de sa divine Majesté, de la très-Sainte Vierge, Notre-Dame, de
mon bon Ange et de celui de ladite Jeanne-Françoise Frémyot, ma très-chère
fille, et de toute la cour céleste ; le vingt-deuxième jour d'août, octave
de l'Assomption, de la même glorieuse Vierge, à la protection de laquelle je
recommande de tout mon cœur ce mien vœu, afin qu'il soit à jamais ferme, stable
et inviolable. Amen. François de Sales, évêque de Genève. »
De ces vœux réciproques, est venue cette parfaite et très-pure liaison
et union des cœurs de ce Saint et de cette Sainte ; et cette entière
communication de leurs biens intérieurs, en sorte que c'était bien des deux ce
que dit saint Luc du commencement de l'Église : « Un seul cœur et
une seule âme. » Aussi, ne parlaient-ils que ce langage entre eux.
[494]
Après que notre Bienheureux Père fut décédé, notre digne Mère, sur le
papier du vœu de ce Bienheureux, écrivit de sa main les paroles
suivantes : « O très-adorable et souveraine Trinité, qui de toute
éternité, par votre incompréhensible miséricorde sur moi, m'avez destinée au
bonheur d'être conduite par votre très-humble et très-saint serviteur, le
Bienheureux François de Sales, mon vrai Père très-cher, faites, ô très-douce
bonté, que ce vœu ne soit point terminé et fini par son départ de cette vie
mortelle, mais qu'il me continue ses soins et sa direction paternelle, jusqu'à
ce qu'il m'ait conduite et introduite dans vos célestes tabernacles, après
lesquels je soupire incessamment, par le mérite de la Passion de mon
Sauveur ! Que si cette prière n'est convenable et agréable à votre divine
Majesté, je veux ne l'avoir point faite, reconfirmant aujourd'hui, en la
présence du divin Sacrement de votre vrai corps, les vœux que j'ai faits à la
très-sainte Trinité, entre les mains de ce mien Père, et l'entier dépouillement
de moi-même, ainsi que je le fis sans aucune réserve, mercredi, devant la fête
du Saint-Esprit, 1616. » Après cela, cette Bienheureuse Mère ajoute une
longue prière, le tout écrit de sa bénite main, se dédiant de nouveau à
observer tout ce qu'elle avait appris de ce Bienheureux, et finit en ces
termes : « O mon Sauveur ! n'ai-je point fait contre la
révérence que je dois au caractère de notre Saint, d'avoir osé insérer ceci,
dessus ? Hélas ! s'il vous déplaît, je vous supplie de l'effacer, et
me pardonner, comme aussi toutes mes offenses et les manquements d'obéissance
et de respect que j'ai tant commis, quoique non volontairement, contre votre
serviteur, mon Bienheureux Père. »
C'est porter un grand honneur et avoir une grande soumission à celui
qui dirige, de suivre si constamment sa direction, que même la mort n'y met
point de bornes. Cette Bienheureuse Mère a dit souvent qu'elle élirait plutôt
de mourir, que de manquer à ce qu'elle savait être des intentions de notre
[495] Bienheureux Père, ni pour son particulier, ni pour l'Institut, et si elle
lui a continué son obéissance, il lui a aussi continué sa direction ; car,
non-seulement elle trouvait tout ce qu'elle avait besoin dans ses Écrits, mais
aussi elle a dit en confiance, que pendant plusieurs années elle avait
fréquemment une vue intellectuelle de ce Bienheureux Père, à son côté droit,
comme un second bon Ange qui l'aidait, instruisait intérieurement, et la
fortifiait dans les rencontres difficiles. Qui ne croira facilement que ce bon
pilote, étant arrivé au port, ne retournât souvent, par une assistance
invisible et autant sensible à l'esprit que cachée aux sens, pour conduire
celle qui s'était si absolument abandonnée à voguer sous sa conduite en la
pleine mer de la perfection ! Comme dit Monseigneur de Sens, cette Bienheureuse
Mère était si humble, qu'elle estimait et voulait faire croire aux autres que
ce qu'elle recevait d'extraordinaire n'était que songes et simples
pensées ; c'est dans ces bas sentiments d'elle-même qu'elle a écrit de sa
main les paroles suivantes : « Notre Bienheureux Père, dit-elle,
depuis son décès, m'a apparu trois fois en songe ; la première fois, il
me dit : Ma fille, Dieu m'a envoyé à vous, pour vous dire que son
dessein sur vous est que vous soyez extrêmement humble ; la seconde
fois, il me dit : Dieu m'a envoyé à vous, pour vous rendre une
parfaite colombe ; la troisième fois : Ma fille, ne vous
plaignez jamais d'aucun manquement que l'on puisse faire contre vous ; ne
vous courroucez point aussi de ceux qui se feront dans le monastère, mais dites
seulement : Quoi ! les servantes de Dieu doivent-elles faire telles
et telles choses ? Ne vous empressez point, mais faites toutes choses en
esprit de repos et d'amoureuse tranquillité. »
Le jour des Innocents, 1632, dans un de ces songes mystiques, cette digne
Mère vit notre Bienheureux Père vêtu pontificalement, assis dans une haute
belle chaise, ayant une grande majesté et clarté ; soudain elle se jeta à
genoux devant lui, et lui [496] dit : « Mon Père, dites-moi ce
qu'il vous plaît que je fasse, pour parvenir à la perfection où
j'aspire ? » Ce Bienheureux lui répondit : « Faites
toujours bien ce que vous avez commencé à bien faire. » — « Mais, mon
vrai Père, lui répliqua-t-elle, enseignez-moi la volonté de mon Dieu, afin que je
l'accomplisse. » Le Bienheureux lui répondit : « Ma fille, Dieu
veut que vous paracheviez avec amour et courage ce que l'amour vous a fait
commencer. » Quantité de fois, ce Bienheureux l'a visitée par des odeurs
très-suaves, par des paroles intérieures, par une assistance continuelle ;
et elle, de son côté, a suivi ce bon maître avec une fidélité aussi parfaite,
un amour aussi constant et une dévotion autant véritable que l'on n'en saurait
guère trouver en ce monde.
Le soin qu'elle a eu de faire ramasser et imprimer tout ce qu'elle a pu
des écrits et paroles de ce Bienheureux ; son travail continuel et ses
soins admirables pour faire travailler aux informations de sa sainte vie et
miracles ; la continuelle allégation qu'elle faisait en toutes rencontres
des intentions et paroles de ce Bienheureux, sa vigilance à faire parer son
tombeau, et à pourvoir des ornements pour sa béatification ; sa dévotion à
distribuer ses reliques : tout cela, et mille autre choses qui se
pourraient alléguer, sont des preuves irréprochables de l'incomparable fidélité
de cette Bienheureuse Mère envers son saint et parfait Directeur, et cette
fidèle constance à suivre sa guide, est une très-grande marque du grand et
heureux voyage qu'elle a fait en la vie intérieure, puisque jamais elle ne s'y
est fourvoyée ni amusée à demander autre chemin que celui que son Raphaël lui
montrait de la part de Dieu.
CHAPITRE XXIV.
de ses voies
d'oraison.
Commençons d'entrer dans cette maison et oraison, puisque nous
en avons trouvé le chemin et le maître.
De tout temps, Dieu donnait de grands attraits à cette bénite âme, pour
s'appliquer à la prière et à l'oraison ; mais les complaisances autour de
son mari, le souci de sa maison, l'amour de ses enfants, le divertissement des
compagnies, divisaient ce pauvre cœur, lequel Dieu voulant posséder seul, il la
sépara elle-même de toutes choses, tant par le décès du baron de Chantal, que
par le dégoût universel qu'il lui donna des choses du monde. Dès qu'elle fut
veuve, elle fut entièrement dévote, et avait de tels attraits à vivre d'une vie
toute pure, toute dégagée et toute contemplative, que, comme nous avons
rapporté ci-dessus, elle eût abandonné son pays, si le lien de ses enfants ne
l'eût retenue, pour aller vivre d'une vie retirée et cachée aux yeux du monde.
Sans savoir ce qu'elle faisait, ni sans connaître ce que Dieu opérait en elle
(n'ayant jamais été instruite en la spiritualité), elle eût bien passé les
nuits en prières, à genoux ; ses femmes de chambre veillaient l'une après
l'autre pour avoir soin de la faire recoucher, parce qu'elle se levait au
milieu de la nuit pour jouir plus à souhait de son Dieu, dans une oraison
tranquille, favorisée des ténèbres et du calme de la nuit.
Lorsqu'elle se fut mise sous la conduite de ce premier directeur dont
nous avons déjà tant parlé, il lui donna des méthodes [498] d'oraison mentale
fort pénibles, des longues imaginations, des pénibles ratiocinations, à quoi
elle s'appliqua avec autant de fidélité et de soin que si elle y eût eu grande
suavité, quoique, en vérité, par telles méthodes, son cœur fût grandement gêné
et hors de son attrait et de son centre. Étant sous la conduite de notre
Bienheureux Père, il lui semblait de nager en pleine eau, par la méthode douce
et suave qu'il lui donna pour la méditation ; mais surtout parce qu'il la
mettait en liberté de suivre l'attrait intérieur et lui enseignait que souvent,
par nos industries humaines, nous contrarions l'esprit de Dieu et les
opérations de sa grâce dans nos âmes.
Elle fut sept ans entiers dans le train ordinaire des méditations et
considérations ; mais après ces sept ans de fidèles et pénibles services,
sans être trompée ni déçue, son cœur fut marié à la belle Rachel de la sainte
contemplation, à laquelle elle n'a jamais présumé de pouvoir atteindre, ni ne
s'est en façon quelconque ingérée d'elle-même en aucun genre d'oraison
extraordinaire ; même plusieurs fois, parlant des choses spirituelles avec
une très-grande servante de Dieu qui lui conseillait fort de s'appliquer à une
manière d'oraison mentale fort spirituelle et séparée des objets sensibles,
cette digne Mère, qui n'avait garde de faire un pas sans sa guide, en conféra
avec notre Bienheureux Père, qui lui écrivit qu'elle se tint encore dans les
vallons à y cueillir l'hysope ; qu'elle n'avait pas les bras assez longs
pour atteindre les cèdres du Liban. « Cueillons, dit-il, les basses
fleurettes au pied de la croix ; contentons-nous de baiser les pieds de
notre époux ; il sait bien le temps où il nous doit appeler au baiser de
sa bouche. »
Durant les sept ans que notre Bienheureuse Mère demeura en l'oraison
active, elle ne laissa pas d'y recevoir de grandes faveurs du ciel et d'être
souvent tirée hors d'elle-même par l'attrait divin, comme il se peut voir en ce
que nous avons dit ci-dessus en diverses visions et ravissements Mais quand
cette [499] sainte Amante eut longuement moissonné la myrrhe, elle fut
introduite au cellier à vin, elle fut endormie par ce doux charme, et retenue
en une manière d'oraison très-pure et séparée de toute autre action, que d'un
très-simple délaissement d'elle-même à la volonté divine. Comme elle avait
l'entendement prompt et fertile, les parties inférieures de son âme eurent des
grandes résistances à condescendre à ce paisible repos et très-sainte oisiveté,
voulant toujours faire et agir, quoique la vérité de son attrait et de sa voie
fût d'être totalement passive. Notre Bienheureux Père lui disait, pour
l'affermir en ce chemin : « Vous êtes comme le petit saint
Jean ; tandis que les autres mangent de diverses viandes à la table du
Sauveur, par diverses considérations et méditations pieuses, vous vous reposez
par ce sommeil amoureux sur sa sacrée poitrine ; cet amour de simple
confiance et cet endormissement amoureux de votre esprit entre les bras de son
Sauveur, comprenant excellemment tout ce que vous allez cherchant, çà et là,
pour votre goût. » Ce Bienheureux Père et très-expert directeur, lui
écrivit une autre fois : « Demeurez, ma chère Mère, en cette simple
et pure confiance filiale auprès de Notre-Seigneur, sans vous remuer nullement pour
faire des actions sensibles, ni de l'entendement, ni de la volonté ; non,
n'ayez point de soin de vous-même, non plus qu'un voyageur qui s'est embarqué
de bonne foi sur un navire, qui ne prend garde qu'à se tenir et vivre dans
icelui, laissant le soin de prendre les vents, tendre les voiles et faire
voguer au pilote sous la conduite duquel il s'est remis ; c'est Jésus qui
est votre pilote, laissez-lui gouverner votre âme, et puisqu'il vous veut
oisive, soyez-le pour le temps qu'il lui plaira. »
Dans les grandes traverses que la partie inférieure de notre
Bienheureuse Mère donnait à la partie supérieure, pour la retirer de cette voie
simple et épurée des espèces et images sensibles, elle prenait un soin
extraordinaire de se bien faire [500] instruire, et parmi plusieurs demandes
que nous avons trouvées écrites de la main de notre Bienheureuse Mère, et
réponses de notre Bienheureux Père, elle dit les paroles suivantes :
« Souvent j'ai été en peine, voyant que tous les prédicateurs et bons
livres enseignent qu'il faut considérer et méditer les bénéfices de
Notre-Seigneur, sa grandeur, les Mystères de notre Rédemption, spécialement
quand l'Église nous les représente ; cependant, l'âme qui est en cet état
d'unique regard et oisiveté, voulant s'essayer de le faire, ne le peut en façon
quelconque, dont souvent elle se peine beaucoup ; mais il me semble
néanmoins qu'elle le fait en une manière fort excellente, qui est un simple
ressouvenir ou représentation fort délicate du Mystère, avec des affections
douces et savoureuses ; Monseigneur l'entendra mieux que je ne pourrais le
dire. »
Le Bienheureux répond : « Que l'âme s'arrête aux Mystères en
la façon d'oraison que Dieu lui a donnée, car les prédicateurs et livres
spirituels ne l'entendent pas autrement. » « Mais donc, dit notre Bienheureuse,
l'âme ne doit-elle pas, spécialement en l'oraison, s'essayer d'arrêter toutes
sortes de discours, industries, répliques, curiosités et semblables ; et
au lieu de regarder ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fera,
regarder à Dieu, et ainsi simplifier son esprit et le vider de tout soin de
soi-même, demeurant en cette simple vue de Dieu et de son néant, toute
abandonnée à sa sainte volonté, dans les effets de laquelle il faut demeurer
contente et tranquille, sans se remuer nullement pour faire des actes, ni de
l'entendement, ni de la volonté ; je dis même, qu'en la pratique des
vertus, et aux fautes et chutes, il ne faut bouger de là, ce me semble ;
car Notre-Seigneur met en l'âme les sentiments qu'il faut, et l'éclairé parfaitement ;
je dis pour tout, et mieux mille fois qu'elle ne pourrait être par ses discours
et imaginations. Vous me direz donc, pourquoi sortez-vous de là ? O
Dieu ! c'est mon malheur et malgré moi, car [501] l'expérience m'a appris
que cela est fort nuisible ; mais je ne suis pas maîtresse de mon esprit,
lequel, sans mon congé, veut tout voir et ménager ; c'est pourquoi je
demande à mon très-cher seigneur l'aide de l'obéissance pour arrêter ce
misérable coureur, car il m'est avis qu'il craindra le commandement absolu. »
Notre Bienheureux Père répond : « Puisque Notre-Seigneur, dès
il y a si longtemps, vous a attirée à cette espèce d'oraison, vous ayant fait
goûter les fruits très-désirables qui en proviennent, et connaître les
nuisances de la méthode contraire, demeurez ferme et avec la plus grande
douceur que vous pourrez ; ramenez votre esprit à cette unité et
simplicité de présence et abandonnement en Dieu ; et d'autant que votre
esprit désire que j'emploie l'obéissance, je dis ainsi : Mon cher esprit,
pourquoi voulez-vous pratiquer la partie de Marthe en l'oraison, puisque Dieu
vous fait entendre qu'il veut que vous exerciez celle de Marie ? Je vous
commande donc que simplement vous demeuriez ou en Dieu ou auprès de Dieu, sans
vous essayer d'y rien faire, et sans vous enquérir de lui, de chose quelconque,
sinon à mesure qu'il vous excitera ; ne retournez nullement sur vous-même,
ains soyez-là auprès de lui. »
Elle fit encore une demande : « Si cette âme, ainsi remise
entre les mains de Dieu, ne doit pas demeurer sans désirs et sans élection
propre. » Le Bienheureux lui répond : « L'enfant qui est entre
les bras de sa mère, n'a besoin que de laisser faire, et de s'attacher à son
col. » « Mais, dit-elle, Notre-Seigneur n'a-t-il pas un soin particulier
d'ordonner tout ce qui est requis et nécessaire à cette âme ainsi abandonnée à
lui ? » Notre Bienheureux Père répond : « Les personnes de
cette condition lui sont chères comme la prunelle de son œil. »
Dans les derniers avis que notre Bienheureux Père donna à cette digne Mère,
il dit les paroles suivantes : « Ce sixième jour [502] de juin, dédié
à l'honneur de saint Claude, et sanctifié par l'octave du Saint-Sacrement, jour
mémorable à votre Congrégation, je ramasse ainsi tous les avis que je vous ai
donnés jusqu'à présent : Soyez fidèlement invariable en cette résolution
de demeurer en une très-simple unité et unique simplicité de la présence de
Dieu, par un entier abandonnement de vous-même en sa sainte volonté. Ne vous
divertissez jamais de votre voie, souvenez-vous que la demeure de Dieu est
faite en paix ; suivez la conduite de ses mouvements divins, soyez souple
à la grâce ; soyez active, passive ou pâtissante, selon que Dieu le voudra
ou vous y portera ; mais de vous-même, ne sortez point de votre place,
souvenez-vous de ce que je vous ai tant dit et que j'ai mis dans Théotime,[88] qui est fait pour vous et vos
semblables ; vous êtes la sage statue, le maître vous a posée dans votre
niche, ne sortez de là que lorsque lui-même vous en tirera. »
Sur ces avis, et plusieurs autres que notre Bienheureux Père lui donna,
elle s'affermit tellement en son chemin, qu'elle y était inébranlable ; et
quand elle y a commis quelque défaut, c'est-à-dire quand elle a voulu agir pour
la recherche de son propre goût, l'amour l'en a corrigée, ainsi que nous
l'avons vu écrit de sa chère main, en ces termes : « Au sortir de la
sainte communion, m'étant voulu mouvoir à faire des actes plus spécifiés que
ceux de mon simple regard et entière remise et abîmement en Dieu, sa bonté m'en
reprit et me fit entendre que ce n'était que par amour de moi-même que je
voulais faire tels actes, par lesquels je faisais autant de tort à mon âme, que
l'on en fait à une personne faible et languissante, à laquelle on rompt son
premier sommeil, et qui ne peut, par après, trouver son repos. »
CHAPITRE XXV.
suite de ses voies
d'oraison.
Le cœur de cette Bienheureuse Mère était vraiment cette maison
d'oraison que l'éternelle Sapience s'est édifiée pour soi ; et comme
j'ai ouï dire à un grand spirituel, la divine Sapience présentait en cette
sienne maison, de deux sortes de mets pour la nourriture de sa
Bien-Aimée : l'un ferme et solide, l'autre liquide et coulant. Le solide,
c'était cette constante et généreuse dévotion séparée de toute tendreté,
mignardise et recherche propre, et, au contraire de cela, appliquée à toute
vertu, par une attention admirable, jusqu'à la plus petite. Et, si son oisiveté
à l'oraison ne lui eût apporté une parfaite activité à la mortification et aux
actions vertueuses, elle se fût sans doute détournée de cet amusement. La
nourriture liquide c'était un écoulement de la grâce divine en l'âme de cette
Bien-Aimée, une connaissance simple, tranquille, douce et expérimentale de la
bonté de Dieu et de son amour, pur, ardent et consumant tout ; et d'autant
que l'amour veut le réciproque, la grâce s'étant infusée et écoulée dans ce
cœur aimant, il sortait de soi-même et faisait un total écoulement et perte en
Dieu, de ses désirs, ferveurs, lumières et affections, bref de tout.
Dans ce silence sacré, cette âme, saintement enfantine, tirait de son
Bien-aimé un lait nourrissant qui faisait croître son cœur en son divin amour,
comme l'enfant de son amour ; elle y recevait un vin délicieux qui
l'échauffait, la ravigorait en ses travaux, et qui la récréait dans ses
langueurs. En ce banquet de [504]
l'Époux, le miel des suavités
qu'elle y mangeait était plutôt pour purifier son âme que pour l'amuser aux
sentiments de ses douceurs. Dans ce silence sacré, où elle ne disait mot, elle
entendait beaucoup de choses, non-seulement de l'ouïe du cœur qui passe toute
intelligence humaine, mais quelquefois d'une voix distinctement ouïe des
oreilles du corps, ainsi que nous avons déjà dit et comme nous dirons ci-après.
Dans ce silence et sommeil amoureux, avec ses yeux fermés, elle voyait des
lumières très-claires, et était enseignée par une divine intelligence des
choses mystiques et secrètes ; et, ne voyant rien que par la foi nue et
simple, elle recevait des expériences savoureuses de ce qui ne se peut ni
toucher ni voir.
Dans cette voie sacrée, malgré ses tentations continuelles, son
entendement était tout simplifié ; et, s'il faut ainsi dire, cette fidèle
Épouse s'était laissé bander les yeux humains du voile de la foi, par les mains
de l'amour, cet amour l'ayant tirée hors des sens et de l'opération de
l'entendement : et elle, par une sortie absolue hors d'elle-même et de
toutes choses, s'étant dépêtrée de tout, elle possédait au-dessus de tout Celui
pour l'amour duquel elle avait mis, et elle, et toutes choses sous ses pieds.
Dans cet état passif, elle ne laissait pas d'agir en certains temps, quand Dieu
retirait son opération ou qu'il l'excitait à cela ; mais toujours ses
actes étaient courts, humbles et amoureux.
Elle écrivait une fois à feu notre très-honorée Mère Favre, qui lui
avait demandé si elle ne faisait point d'actes en l'oraison : « Oui,
ma très-chère fille, toujours, quand Dieu le veut, et qu'il me le témoigne par
le mouvement de sa grâce, je fais quelques actes intérieurs, ou prononce
quelques paroles extérieures, surtout dans le rejet des tentations ; et
Dieu ne permet pas que je sois si téméraire que je présume n'avoir jamais
besoin de faire aucun acte, et je crois que ceux qui disent n'en faire en aucun
temps ne l'entendent pas ; je crois même [505] que notre Sœur N. en fait
qu'elle ne discerne pas ; du moins, je lui en fais faire
d'extérieurs. »
Cette Bienheureuse Mère savait bien qu'il n'y a point d'union si serrée
en ce monde qui n'ait besoin de l'être davantage, ni de sommeil si tranquille
qui ne soit parfois éveillé, même contre la défense de l'Époux, et que, pour
pure et habile que soit une colombe, elle a quelquefois besoin de redoubler ses
tire-d'ailes ; c'est ce que notre Bienheureuse faisait par ses simples
retours, comme fermant la porte de son cœur sur soi, ainsi que dit l'Évangile,
pour être là, en secret, en silence et en repos avec l'Époux céleste. Et,
quoique dans cet état son cœur fut assez souvent, surtout ès dernières années
de sa vie, nu, sans consolation et comme insensible au bien, sans goût d'aucune
saveur spirituelle, sans ouïe ni intelligence, sans vue ni lumière, elle ne
sortait point de son silence ; cette sainte statue ne se remuait point de
sa niche ; il lui suffisait que le Maître l'avait mise là, et qu'il l'y
voyait, et encore n'avait-elle, ni la vue, ni le sentiment de cette volonté du
Maître, que par la force de l'esprit supérieur, où sa foi résidait toujours
ferme, quoique nue et combattue.
Ce qui lui servait de quelque appui, c'est qu'elle savait, par une
science que l'expérience de la conduite des âmes lui avait apprise, que cette
destitution des sentiments, en cette voie de la sainte oisiveté de Marie, qui
vaut mieux que tous les soucis de Marthe, est une épreuve que l'amour fait
subir à l'âme amante ; et que, par cette voie, elle arrive à la parfaite
nudité, pauvreté, patience, et résignation d'esprit, et que c'est par là
qu'elle est conduite au trépas de la volonté propre et en la perte de tous ses
intérêts particuliers.
En cet état d'amour constant, simple et nu, la très-bonne part de Marie
demeurait à cette âme, seulement les choses sensibles lui étaient retranchées,
parce qu'elle vivait d'une vie plus épurée et plus parfaite ; et semblait
que dans ces privations [506] l'Époux lui dît, comme à cette autre
amante : « Ne me touchez point », et cet amour séparant faisait
en secret une union de volonté à volonté admirable, et c'était pour ce sujet
que notre Bienheureuse Mère avait écrit en son livret le couplet suivant,
qu'elle aimait fort :
Je sais, cher objet de ma flamme,
Que dépouillant ainsi mon âme,
Tu ne méprises pas les ardeurs que je sens ;
Mais tu veux que d'âme plus pure,
Passant par dessus la nature,
J'apprenne à aimer sans les sens.
Nous pouvons assurer que l'oraison de cette Bienheureuse Mère était
continuelle, selon l'avis de saint Paul ; et rien ne se présente à mes
yeux pour mieux faire voir quel était son attrait, et sa vie intérieure, que de
dire que c'était un continuel et simple regard de Dieu en toutes choses, et de
toutes choses en Dieu, une perpétuelle adhérence à Dieu, un fiat voluntas indiscontinué.
Si la sécheresse lui ôtait la tendreté et la suavité, elle ne s'en mettait pas
en peine ; si les plus rudes privations, si les peines et les tentations
lui livraient la guerre, sa fidélité était toujours inébranlable, cette maison
d'oraison était imprenable. Soit que les mamelles de l'Époux fussent
meilleures que le vin, au goût de cette Bien-Aimée, ou qu'il la nourrît du pain
de tribulation et de l'eau d'angoisse, elle ne sortait point du lieu secret de
sa retraite intérieure, pour aller chercher d'autre nourriture ; elle
adhérait à cette conduite de Dieu sur elle, et la chaleur de son amour la
soutenait sans qu'elle s'affaiblît spirituellement.
Elle avait écrit de sa bénite main, à une âme attirée à cette bonne
voie de la sainte simplicité, les paroles suivantes : « Si vous
suiviez les desseins de Dieu sur vous, quand le ciel et la terre se
renverseraient, vous ne désisteriez point de le regarder. » C'était sa
véritable pratique, regarder Dieu et ne pas éplucher ce qu'il fait en nous, se
tenir dans une simple attente [507] de tout ce qu'il lui plairait ; et,
quand les choses étaient arrivées, n'avoir qu'une amoureuse acceptation de ce
qu'il avait ou voulu ou permis. Cette manière simple l'avait conduite à une si
grande habitude de prier, qu'en tout lieu elle était en recueillement, et
depuis quelques années, dans un recueillement si profond, qu'à tout coup et en
toute occasion elle avait les yeux fermés, et l'on voyait bien que c'était avec
très-grande peine qu'elle sortait tant soit peu de cette sainte solitude
intérieure pour vaquer aux choses de ce monde. Elle nous disait que, pour faire
l'oraison, il ne faut pas toujours être à genoux ; que puisque l'Époux a
dit : Je dors, mais mon cœur veille, c'est-à-dire, mon cœur prie,
mon cœur aime, une bonne religieuse peut dire en toutes sortes de diverses
actions : Je fais la récréation, mais mon cœur prie ; je travaille,
mais mon cœur est en repos.
Une fois, cette Bienheureuse, durant que l'on parlait de quelques
affaires proche d'elle, tint quasi toujours les yeux fermés, notre chère Mère
de Châtel lui dit : « Dites-moi, je vous prie, ma Mère, ce que vous
venez de dire à Notre-Seigneur » ; elle lui répondit :
« Hélas ! ma chère Mère, vous savez bien que je ne lui dis mot, mais
je désire bien que mon silence intérieur révère et adore sans cesse la Parole
éternelle. »
Notre chère Mère de Blonay lui ayant dit qu'elle avait lu en quelque
part, que tout ce que l'on demandait à Notre-Seigneur en certains temps, il
l'accordait, elle lui répondit : « Pour moi, ma très-chère Mère, je
ne demande aucune chose à Notre-Seigneur. » Elle se contentait de dire son
Pater pour toutes choses, sinon quelquefois qu'elle lisait dans ses
Heures tout exprès des oraisons vocales, comme les trente demandes à
Jésus-Christ pour les nécessités publiques ; et cela pour honorer la
sainte Église, qui ordonne et approuve telles prières.
Étant une fois interrogée, comment elle faisait pour tenir parole à
tant de personnes qui se recommandaient à ses prières, et auxquelles elle le
promettait ; elle répondit qu'elle les mettait [508] dans son intention
générale, ou bien qu'elle allait dire son Pater pour eux, demandant à
Dieu que sa volonté fût faite en cela, et que son nom y fût sanctifié.
Cette grande cessation d'opérations intérieures lui fit trouver cette
invention et intelligence d'amour ; elle écrivit de sa main et signa de
son sang une grande oraison qu'elle avait faite elle-même, de toutes les
actions de grâces, louanges, prières, que sa dévotion et ses devoirs lui
suggérèrent pour les bénéfices généraux et particuliers, pour ses parents et
autres, pour les vivants et pour les morts ; et ce papier elle le portait
nuit et jour sur elle pendu à son col, avec la protestation de foi, ayant fait
cette convention amoureuse avec Notre-Seigneur, qu'elle voulait et entendait
que toutes les fois qu'elle serrerait sur son cœur la petite boursette où elle
portait lesdits papiers (qu'elle mettait tous les matins en s'habillant au
droit de son cœur), ce cœur avait dessein de faire tous les actes de foi, de
remercîments et de prières contenus en cet écrit.
Par ainsi, son simple retour, son regard unique, son action dévote
était une grande et longue oraison actuelle dans son intention, quoiqu'en effet
son cœur demeurât passif, calme et en silence, sans dire une seule
parole ; c'est que l'amour parle d'un langage muet, par les yeux ou par
les simples signes, comme il plaît à l'Amant de prendre des diverses
intelligences avec ses amantes. Nous parlerons en autre lieu des maximes et des
avis de cette Bienheureuse Mère, pour cette manière d'oraison, qui n'est pas
pour toutes sortes d'âmes.
CHAPITRE XXVI.
de ses peines
intérieures.
Se confier en Dieu et lui être fidèle emmy la douceur des prospérités
intérieures, cela est très-facile, mais lui être également fidèle emmy les
orages, tempêtes, travaux et délaissements, c'est le propre d'un cœur vraiment
amant, épuré et sans intérêt, comme celui de notre Bienheureuse Mère, laquelle
nous avons vue d'une fidélité toujours croissante au service de Dieu, d'un
visage toujours serein et doux, d'une constance en sa voie sans chanceler. Mais
l'on pourra nous dire que son attrait et sa voie étant le simple regard,
l'amoureux repos, la totale remise d'elle-même à Dieu et le sacré silence
intérieur, si cela ne diminuait pas ses souffrances ? C'était tout au
contraire, ainsi que cette Bienheureuse Mère le dit une fois en confiance à une
de ses filles, en ces propres termes : « Dans les destitutions et
privations de toutes grâces sensibles, ma voie simple m'est une nouvelle croix,
et mon impuissance d'agir m'est un surcroît de toutes privations, comme serait,
quand une personne est affligée au corps de quelques grandes douleurs, et
qu'elle est privée de se pouvoir tourner de côté et d'autre, qu'elle est muette
et ne peut exprimer ce qu'elle sent ; aveugle, ne voyant pas si ceux qui
se présentent à elle sont des médecins ou des empoisonneurs, tellement que
l'âme, dans cette angoisse et privation, aime mieux demeurer là souffrante et
impuissante. » Oh ! combien d'années notre [510] Bienheureuse Mère a
été dans cet état, et encore de plus pénibles, comme nous le dirons tantôt.
Elle disait, en pleurant à grosses larmes, qu'elle se voyait sans foi,
sans espérance et sans charité, pour celui qu'elle croyait, espérait et aimait
si souverainement. Notre Bienheureux Père lui disait : « C'est une
vraie insensibilité qui vous prive de la jouissance de toutes les vertus que
vous avez pourtant en fort bon état ; mais vous n'en jouissez pas, ains
vous êtes comme un enfant qui a un tuteur qui le prive du maniement de ses
biens, en sorte que tout étant à lui, vraiment il ne manie rien, ni semble
posséder, ni avoir rien que sa vie, et, comme dit saint Paul : maître
de tout, et n'être en rien différent du serviteur ; et en cela,
ma fille, Dieu ne veut pas que le maniement de votre foi, de votre espérance,
de votre charité et autres vertus, soit à vous, ni que vous en jouissiez sinon
pour vivre intérieurement, et vous en servir aux occasions de la pure
nécessité. Hélas ! que vous êtes heureuse d'être ainsi serrée et tenue de
court par ce céleste Tuteur ! et ce que vous devez faire, n'est que ce que
vous faites, qui est d'adorer en silence votre Tuteur, vous jeter entre ses
bras et en son giron. »
Qui pourrait exprimer la langueur et le martyre des âmes amantes,
lorsque le Bien-Aimé s'en va, se cache, et leur fait voir et sentir qu'il les
traite comme si, en effet, elles étaient ses ennemies ; elles se
repaissent de larmes nuit et jour, tandis qu'on leur dit : Où est ton
Dieu ? La seule satisfaction d'un prince présent, ou de quelques
personnes fortement aimées, rend les travaux délicieux et les hasards
désirables ; mais il n'y a rien de si fidèle, ni de si triste, que de
servir un maître qui n'en sait rien, ou, s'il le sait, ne fait nul semblant d'y
prendre garde ni d'en savoir gré ; et faut bien que l'amour soit puissant,
puisqu'il se soutient lui seul et sans être appuyé d'aucun plaisir ni d'aucune
prétention ; c'était en cet état qu'était notre Bienheureuse Mère, lorsque
notre saint Fondateur lui écrivait les paroles suivantes : « Je
travaille à votre livre neuvième de l'Amour de Dieu, et aujourd'hui, priant
devant mon crucifix, Dieu m'a fait voir votre âme et votre état par la
comparaison d'un excellent musicien, né sujet d'un prince qui l'aimait
parfaitement, et qui lui avait témoigné se plaire passionnément à la douce
mélodie de son luth et de sa voix ; ce pauvre chantre devint comme vous,
sourd, et n'oyait plus sa mélodie, son maître s'absentait souvent, et il ne
laissait pas de chanter, parce qu'il savait que son maître l'avait pris pour
chanter. Toute cette comparaison est mise fort au long dans le livre de l'Amour
de Dieu.
Le cœur de notre Bienheureuse Mère, dans ses longues privations, était
donc ce chantre sourd, qui ne savait pas même s'il chantait, et, outre cela,
était pressé de mille craintes, troubles, tintamarres et ennuis, l'ennemi lui
suggérant que possible n'était-elle point agréable à son divin Maître ;
que son amour était inutile, voir même faux et vain. Son travail lui était
ennuyeux, ne voyant ni le bien de son travail, ni le Bien-Aimé pour qui elle
travaillait ; et ce qui augmentait son mal, dit notre Bienheureux Père,
c'est que la suprême pointe de sa raison ne lui pouvait donner aucune sorte
d'allégement ; car, sa partie supérieure était tellement environnée des
suggestions de l'ennemi et si alarmée elle-même, qu'elle se trouvait assez
affairée de se garder d'aucun consentement au mal, de sorte qu'elle ne pouvait
plus faire, comme elle avait fait autrefois, des sorties par la porte de la
volonté, pour détruire les ennemis qui attaquaient son entendement ; car,
en cette nouvelle manière de souffrances, la volonté même ne pouvait pas sortir
pour dégager la partie inférieure ; et, bien qu'elle n'eût pas perdu le courage,
elle était si furieusement attaquée et si délaissée, que si elle était sans
coulpe, elle n'était pas sans peine, et, pour comble de son ennui, elle était
privée de la générale [512] consolation qui reste aux plus malheureux de
ce monde, qui est que l'on en verra la fin.
Notre Bienheureux Père, la consolant sur cette impuissance d'espérer la
fin de ses travaux intérieurs, lui écrivit dans son livret : « Ma
chère Mère, ne craignez point, la foi réside toujours en la cime et pointe de
votre esprit ; et cela vous assure que ces troubles finiront, et que vous
jouirez du repos désiré au sein de Dieu ; mais la grandeur du bruit et des
cris que l'ennemi fait dans le reste de l'âme et raison inférieure, empêche que
les avis et remontrances de la foi ne sont presque point entendues ; mais
de tout cela, ma chère Mère, je ne m'en mets nullement en peine, au contraire,
je bénis Dieu dans la nuit de votre souffrance, et rends grâces à Celui qui
vous montre combien il faut souffrir pour son nom. »
Cette Bienheureuse Mère, parmi tant de ténèbres, allait quelquefois
chercher de la lumière vers celui auquel Dieu l'avait départie pour sa
conduite ; elle écrivit une fois à ce Bienheureux Père en ces
termes : « Je vous écris et ne m'en puis pas empêcher, car je me
trouve ce matin plus ennuyée de moi qu'à l'ordinaire ; je vois que je
chancelle à tout propos dans l'angoisse de mon esprit, qui m'est causée en
partie par mon intérieure difformité, laquelle est bien si grande, que je vous
assure, mon bon seigneur et mon très-cher Père, que je me perds quasi dans cet
abîme de misère ; la présence de mon Dieu, qui autrefois me donnait des
contentements indicibles, me fait maintenant toute trembler et frissonner de
crainte. Où je ne vois aucune faute, l'œil de mon Dieu y en voit un nombre
horrible et quasi infini ; il m'est avis que cet œil divin, lequel j'adore
de toute la soumission de mon cœur, outreperce mon âme comme un glaive, et
regarde avec indignation toutes mes œuvres, mes pensées et paroles, ce qui me
tient en une telle détresse d'esprit, que la mort ne me semble point si pénible
à supporter que toutes ces choses. Il m'est avis que tout [513] a pouvoir de me
nuire ; j'appréhende tout, non que je craigne que l'on me nuise à moi,
quant à moi, mais je crains de déplaire à mon Dieu, et que sa divine assistance
soit bien éloignée de moi ; ce qui m'a fait passer cette nuit dans des
grandes amertumes, et n'ai fait que répéter : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
me délaissez-vous ? Je suis vôtre, faites de moi comme de chose vôtre. Au
point du jour, Dieu m'a fait goûter, » quoique imperceptiblement, une
petite lumière en la très-haute et suprême pointe de mon esprit ; tout le
reste de l'âme demeurait dans son trouble, et encore elle n'a pas duré l'espace
d'un demi Ave Maria, qu'un nouveau trouble s'est jeté à coups perdus sur
moi, et m'a toute offusquée et obscurcie. Dans la langueur de cette pénible
déréliction, je dis toujours quelquefois à Notre-Seigneur, au moins de bouche,
qu'il coupe, tranche et brûle, que je suis à lui. »
Ce Bienheureux, sur cet état, donnait d'excellentes leçons à sa sainte
disciple, lui disant qu'elle était au vrai temps de servir le Sauveur purement
pour l'amour de sa volonté, non-seulement, ajoutait-il, « sans plaisir,
mais parmi ces déluges de tristesses, d'horreurs, de frayeurs et d'attaques,
comme firent la Sainte Vierge et saint Jean au jour de la Passion, demeurant
fermes en l'amour, lors même que le divin Sauveur, ayant retiré toute sa joie
dans la cime de son esprit, ne répandait ni allégresse, ni consolation
quelconque en son divin visage ; et que ses yeux, couverts des ténèbres de
la mort, ne jetaient plus que des regards de douleur. » Comme notre
Bienheureux Père enseignait encore à cette bénite âme, l'amour la privait des
lumières et sentiments, afin que Dieu seul la possédât et l'unît à soi, volonté
à volonté, et cœur à cœur immédiatement, et sans l'entremise d'aucun
contentement ou prétention, pour spirituelle qu'elle fût.
Dans cet amour privant et séparant, comme une autre Madeleine, elle
recevait des faveurs et des paroles intérieures de [514] Dieu sans qu'elle s'en
aperçût, la grandeur de sa douleur amoureuse lui rendant son Amant
méconnaissable. Nous avons trouvé dans les papiers de notre Bienheureux Père
plusieurs petits billets, écrits de la main de cette chère Mère, qu'elle
n'avait pas pu retirer pour brûler. En l'un d'eux, elle dit ces mots :
« Je crois que je ne vous verrai pas aujourd'hui, mon très-cher
Père ; c'est pourquoi je vais vous demander ce que je dois faire ces
fêtes. Il y a trois jours, c'est-à-dire vers le jeudi-saint, que je me vois
seule de toutes les créatures, abandonnée et privée des mérites de la Passion
de mon Sauveur ; et ma tentation me martyrise avec des tourments si
cruels, que je n'ai point de termes pour les exprimer. »
Il lui semblait quelquefois que toutes ses facultés et puissances
avaient dressé une garnison rebelle en son cœur, pour l'empêcher de rentrer
dans ce sacré cabinet intime, où autrefois elle avait si savoureusement pris
son repas et son repos au midi des saintes faveurs, avec l'Époux céleste. Notre
Bienheureux Père la comparait à une abeille malade, qui n'a point d'autre
remède que de s'exposer au soleil, étant dans l'impuissance d'aller à la
cueillette sur les fleurs. Il la comparait encore à David, sortant de sa ville,
tout roi qu'il était, pleurant, pieds nus et la tête voilée, chacun l'ayant
abandonné. « Il est roi pourtant, dit ce Bienheureux, et enfin il régnera
et rangera tout à son obéissance. C'est Absalon, qui a troublé le royaume et
l'a fait soulever contre l'esprit chrétien ; c'est l'esprit humain et
l'âme sensuelle qui s'élèvent en vous, qui troublent et inquiètent l'esprit
chrétien et l'âme spirituelle. » Il la comparait encore à un navire en
pleine mer, battu de toutes sortes d'orages. Une autre fois, il lui
disait : « Il me semble, ma fille, que votre âme soit comme le
Prophète, quand l'Ange le portait en l'air par l'un de ses
cheveux ; » et, passant plus avant, ce Bienheureux ajoute :
« Votre déréliction ressemble à celle que Notre-Seigneur voulut sentir en
sa Passion, où son [515] âme était triste jusqu'à la mort et
très-délaissée ; mais vous n'avez qu'à continuer doucement votre remède,
remettant entièrement votre esprit entre les mains paternelles de Dieu. »
Notre Bienheureuse avait tiré d'un beau et grand cantique de
l'Indifférence, fait par un dévot serviteur de Dieu, les quatre couplets
suivants, qu'elle disait être tellement faits pour elle, qu'à peine
pouvait-elle s'empêcher de croire que son bon Ange ne les eût dictés à celui
qui les avait faits.
Mon âme adhère intimement
A son Dieu seul
sans connaissance.
J'endurerai
fidèlement ;
Croire et
souffrir c'est ma science.
Si l'amour est
ardent,
L'âme se trouve en se perdant.
Cette pauvre âme est sans pouvoir ;
Ce qu'elle fait elle l'abhorre,
Mais il lui semble le vouloir :
C'est un tourment qui la dévore.
Si l'amour, etc.
Elle a plutôt haine qu'amour,
Plus de dédain que d'espérance ;
Elle se perd cent fois le jour,
Et croit être sans conscience.
Si l'amour, etc.
Oh ! quel tourment, quelle douleur,
De vivre en cet état, privée
D'espoir, d'amour, vers mon Seigneur,
Ainsi qu'une âme réprouvée.
Si l'amour est
ardent,
L'âme se trouve en se perdant.
Mais dans cet état d'angoisses, de travaux et de pertes, nous [516]
devons ajouter un cinquième couplet pour cette âme affligée et dire :
Dieu la soutint secrètement,
Dans une foi très-simple et nue ;
Ayant consenti pleinement,
Elle vit de vie inconnue ;
Mais son amour
ardent
La fit trouver en se perdant.
CHAPITRE XXVII.
de ses tentations.
Si notre Bienheureuse Mère a pu dire qu'elle n'a jamais eu à combattre
contre la chair et le sang, quant à cet infâme tentation, qui combat
quelquefois si violemment les plus saints, qu'elle en a fait jeter quelques-uns
dans les épines et quelques autres dans les glaçons, nous pouvons bien dire
qu'en contre-échange elle a eu à lutter contre toutes les malices
spirituelles ; et cette Bienheureuse Mère, parlant à une de ses filles, la
veille de son départ pour son dernier voyage de France, lui dit, sur quelques
sujets d'appréhension de la continuation d'une peine : « Et moi, ma
fille, qu'il y a maintenant quarante et un ans que les tentations me
poursuivent, faut-il pour cela que je perde courage ? Non, je veux espérer
en Dieu, quand bien il m'aurait tuée et anéantie pour jamais. »
Très-fidèle Israélite d'avoir cheminé quarante et un ans par le désert, sans
avoir détourné son cœur du Seigneur !
Notre Bienheureux Père lui écrivit, avant qu'elle se fit religieuse,
une parole qu'elle avait recueillie dans son petit livret, et qu'elle avait
fréquemment devant les yeux : « Il vous faut résoudre à sentir
presque toute votre vie les tentations, et à n'y point consentir et ne vous
étonner point ; car, qui n'est pas tenté, que sait-il ? » Ç'a
été une grande marque de l'impuissance de l'ennemi contre cette cité de
Dieu, cette maison d'oraison, qu'il l'ait tant assiégée et jamais
surprise, ni seulement attirée au pourparler. Cette Bienheureuse Mère, parlant
de [518] ses tentations, disait : « Mon âme était un fer si enrouillé
de péchés, qu'il a fallu ce feu de la justice de Dieu pour un peu la
nettoyer. »
Tous les travaux, toutes les peines et toutes les tentations que cette
Bienheureuse Mère avait souffertes dès le temps de son veuvage, ne lui
semblaient pas comparables à celles qu'elle a souffertes les huit ou neuf
dernières années de sa vie ; et son tourment était d'autant plus grand,
que les matières sur lesquelles elle était tentée étaient plus subtiles,
spirituelles et divines.
Elle a dit diverses fois à quelques-unes de ses filles, en ses
dernières années, ces propres paroles : « Voyez-vous, ma chère fille,
en la violente continuation de mes tentations et peines d'esprit, je suis
maintenant réduite à tel point, que rien de tout ce monde ne me peut donner
aucun soulagement, sinon ce seul mot : la mort ! et je furète partout
dans mon esprit, pour regarder combien mes père, grand-père et aïeux ont vécu,
afin de donner quelque soulagement à mon âme, par la pensée que je n'aurais
plus guère à vivre ; je suis pourtant prête à vivre tant que Dieu
voudra. » Elle goûtait fort cette parole d'une personne spirituelle :
Que, n'étant plus dans les persécutions de l'Église, il faut
maintenant nous sacrifier à la vie, comme les martyrs se sacrifiaient à la
mort. Une fois, elle dit à une de ses filles : « Je ne veux plus
penser quand je mourrai ; j'ai eu scrupule de perdre le temps à considérer
que mon père n'a vécu que soixante-treize ans, et que je ne vivrai pas plus que
lui ; cela n'est que soulagement inutile. » Une autre fois, elle dit
en la même confiance, que l'horrible et continuel tourment que les tentations
lui faisaient souffrir, était si grand, qu'elle n'avait ni faim, ni soif, et
qu'elle ne se souviendrait de prendre aucune de ses nécessités corporelles, si
l'on ne l'en eût fait souvenir : « Ce sont des assauts si furieux,
dit-elle, que je ne sais où mettre mon esprit ; il me semble que la
patience me [519] va échapper, que je suis prête à tout perdre, à tout laisser
là ; ce que je dis aux autres ne me sert de rien, je ne parle point de mes
souffrances, non pas même à Dieu ; il me suffit de savoir que sa bonté
sait tout et voit tout. »
Elle dit aussi, que plus elle était combattue intérieurement, plus elle
avait de force et de vigueur corporelle, ce qui lui était un nouveau martyre.
Une de ses filles lui demanda si elle ne se confessait point de ces tentations
et peines intérieures ; elle lui répondit que non, n'ayant nulle
connaissance qu'elle y consentît ; que tout l'effet que de telles peines
faisaient en elle, était de la faire souffrir, et que, quand elle était
supérieure, elle ne parlait point du tout de ses tentations, excepté à quelques
bonnes âmes, pour leur instruction, et le soulagement des leurs ; qu'elle
s'était appuyée sur cette parole de la règle, qui dit, après l'Écriture : Qui
néglige sa voie mourra ; que sa voie était de toujours regarder Dieu
et le laisser faire, sans se regarder, ni examiner curieusement ce qui se
passait en elle ; que lorsqu'elle avait une supérieure, elle avait
toujours soulagement de suivre sa direction ; hors de là elle ne cherchait
rien que dans les instructions de notre Bienheureux Père.
Elle dit une fois, avec un esprit de maternelle confiance, à une de ses
filles : « Dieu m'a donné, dès mon enfance, de si grands
sentiments d'amour pour la foi, que mille fois je lui ai offert mon sang et ma
vie pour le soutien d'icelle ; sa bonté ne m'en a pas trouvée digne, mais
sa justice a laissé venir en moi un tyran de tentations si cruel, qu'il n'y a
heure au jour que je ne le voulusse changer avec la perte de ma vie ; et
avant que de rencontrer notre Bienheureux Père, et d'être sous sa sainte
conduite, je croyais que j'en perdrais l'esprit parce que, m'en mettant
beaucoup en peine, je perdais le boire, le manger et le dormir. »
Notre chère Mère Péronne-Marie de Châtel avait écrit, parmi quelques
copies de lettres de notre Bienheureuse Mère, les paroles [520]
suivantes : « Toutes les filles de cette digne Mère, dit-elle,
auraient été en grande appréhension et peine, si elles eussent su le martyre
intérieur par lequel elle passait ; et que, jour et nuit, dans la prière
et hors d'icelle, dans le travail et dans le repos, son cœur était sous la
presse d'un martyre intérieur, que la seule supérieure savait entièrement, et
duquel elle ne pouvait ouïr parler sans s'attendrir d'extrême compassion ;
quoique, d'autre part, elle fût dans de grands sentiments intérieurs du dessein
de Dieu sur l'âme de cette digne Mère, la faisait passer par une voie si
étroite. » Étant dans une si grande pressure de tentations et de mauvaises
pensées, elle eut crainte que son esprit, ennuyé de la durée de ses travaux,
n'y commît quelques fautes ; c'est pourquoi elle demanda conseil à notre
Mère de Châtel, si elle trouvait bon qu'elle fit vœu de ne s'arrêter point, ni
volontairement ni autrement, à regarder ou à répondre à ses tentations. Notre
chère Mère de Châtel a laissé par écrit qu'elle ne lui voulut pas permettre de
faire ce vœu pour toute sa vie, mais qu'elle le pourrait faire le matin pour
tout ce jour-là ; et tous les matins, à son exercice, elle faisait ce vœu.
Ceci était en l'année 1636 ; nous ne savons pas si la Bienheureuse Mère a
continué de faire, tous les matins, ce vœu le reste de ses jours. En l'année
1637, pendant l'octave du Saint-Sacrement, notre Bienheureuse voulant rendre compte
de son intérieur à notre bonne Mère de Châtel, cette chère Mère, dans sa
franchise, et parce qu'elle était bien aise de tirer de notre Bienheureuse tout
ce qu'elle pouvait, lui dit : « Ma Mère, je n'ai pas le loisir
maintenant, mais je vous supplie de me mettre sur un bout de papier en quelle
disposition est votre cœur. » Notre Bienheureuse Mère obéit tout
simplement, et mit sur un dos de lettre, que nous gardons précieusement, les
paroles suivantes[89] : « J'écris » de Dieu, j'en
parle comme si j'avais tout sentiment ; et cela [521] parce que je veux et
crois ce bien-là au-dessus, ce me semble, de ma peine et affliction, et ne
désire autre chose que ce trésor de foi, d'espérance et de charité, et de faire
tout ce que je pourrai connaître que Dieu veut de moi. Depuis Pâques, ce
travail m'a laissé quelquefois, cela s'entend des angoisses et si fréquentes
mauvaises pensées, et que j'ai plus de goût en cette simple vue de Dieu et de
repos ; car pour le sujet du travail, je le vois toujours en moi, et
toujours de temps en temps, l'angoisse retourne, et mon esprit est là, en sa
simple retraite, où les coups lui tombent tout autour, comme grêle, tandis
que Dieu le tient là, l'empêchant de rien regarder ; il demeure paisible,
mais las, quelquefois il s'épouvante et veut voir s'il pourrait apporter
quelques remèdes, il n'en trouve point ; or, jusqu'à ce qu'il se soit mis
dans son Dieu, et entre ses bras miséricordieux, sans acte, car je n'en
puis faire ; ce qui peine fort est de retrancher les réflexions, jusqu'à
ce que, par quelque petite lumière, mon esprit reprend le dessus ; c'est
un tourment inexplicable, lequel, pourtant, ne m'empêche pas de m'appliquer,
d'écrire, de parler d'affaires et autres choses, nonobstant que, quand le mal
est grand, il est quasi toujours devant mes yeux ; cela me fait désirer la
mort, craignant que la longueur de ma peine ne me fasse trébucher. »
« Je voudrais être en purgatoire, pour ne point offenser, et être
assurée d'être à Dieu éternellement ; je ne seconde point ce désir, car,
pourvu que Dieu ne soit point offensé en tout ceci, et que ce soit son bon
plaisir que je souffre toute ma vie, j'en suis contente, pourvu aussi que je
sache ce qu'il désire que je fasse, et que j'y sois fidèle. Quelquefois et
souvent, c'est une confusion de ténèbres et impuissances de mon esprit, des
pensées, soulèvements, doutes, rejets et toutes autres misères. Quand le mal
est à son extrémité, elles sont quasi continuelles, ce qui me cause une
affliction [522] inconcevable, et ne sais ce que je ne voudrais pas faire et
souffrir pour être affranchie de ce tourment ; d'un côté la peine me
presse, et d'ailleurs j'ai un amour pour cette sainte foi, que je voudrais
mourir pour le moindre article d'icelle. Quand je vois tout le monde qui
savoure ce bonheur, ce m'est un martyre de m'en sentir privée, et de la
confiance et repos que je savourais autrefois dans un parfait abandonnement
entre les mains de Dieu et de sa Providence. Quand je regarde ces privations,
pour peu que ce soit, cela me met dans un labyrinthe ; si Dieu ne me
tenait, il me semble que je suis sur le bord du désespoir, sans pouvoir
pourtant me désespérer, ni vouloir être hors de mon tourment, si l'on m'assure
que Dieu m'y veut, et je suis de même dans l'impuissance d'accepter le mal que
la tentation me présente ; mais cette impuissance ici, je ne la connais
pas, tandis que le mal dure ; ains après que je vois que Dieu m'a tenue,
quelquefois je ne laisse pas de jouir de certaine paix et suavité intérieure
fort mince, d'avoir d'ardents désirs de ne point offenser Dieu, et de faire
tout le bien que je pourrai. »
Voilà comme cette Bienheureuse Mère s'est exprimée à quoi elle avait
toujours facilité, soit pour les grâces et jouissances, soit pour les peines et
souffrances qui ont été si grandes et si longues. Notre chère Sœur qui couchait
proche d'elle, a dit que quelquefois l'entendant tourner et soupirer la nuit,
elle allait voir si elle se trouvait mal : « Non, disait cette
Bienheureuse Mère, quant au corps, mais priez Dieu pour moi, je suis dans de
grandes transes et peines d'esprit. » Parmi la perte de toutes ses autres
consolations, lumières et soutiens intérieurs, il lui était toujours resté une
douce affection pour la lecture spirituelle ; mais Celui qui voulait
posséder cette bénite âme toute nue, la dépouilla encore de cette satisfaction,
et permit qu'elle eût un si grand dégoût et aversion à la lecture, qu'elle dit
en confiance à une de ses filles, « que seulement de l'ouïr à [523] table,
il lui semblait que c'était des dards qui lui transperçaient le cœur. »
Par cette nouvelle affliction, elle fut tellement destituée de tout
contentement, qu'elle dit que son âme était comme une personne toujours en
l'agonie, faute de pouvoir manger de chose quelconque. Lorsqu'en l'année 1641,
dernière de sa vie elle procurait sa déposition de la charge de supérieure, une
de ses filles lui demandant pourquoi elle faisait cela, cette Bienheureuse Mère
lui dit : « Ma fille, je dirai en commun les raisons
extérieures ; mais en voici une qui est particulière et qui vous doit faire,
par compassion, agréer que je me dépose ; c'est que j'ai mon esprit en une
si mauvaise et douloureuse disposition, que de toutes les tentations
spirituelles, peines et aversions dont les filles me parlent, j'en suis soudain
attaquée ; Dieu me donne de quoi leur dire et les consoler, et moi je
demeure dans la misère ; ne dois-je pas désirer d'être entre les mains
d'une bonne supérieure, qui me conduise dans cet état caduque et de
très-pénible aveuglement ? »
Lorsque notre chère Mère Marie-Aimée de Blonay fut arrivée en ce
monastère, après l'élection, voulant parler de son intérieur à cette
Bienheureuse Mère, elle tomba sur le propos de quelques peines d'esprit qu'elle
avait eues autrefois. Cette Bienheureuse lui dit à mains jointes et les larmes
aux yeux : « Ma très-chère Mère, je vous supplie, ne poursuivez
pas ; je serai accablée de cette tentation, je la vois déjà venir, la
voici qu'elle m'attaque. » Elle avait écrit de sa main en deux lieux pour
les lire plus souvent, ces paroles du cardinal Bellarmin : Il n’y a
point de plus ferme et assuré repos, ni de plus vraie assurance de son salut,
qu'en l’exécution de la volonté de Dieu, qui nous est signifiée par nos
supérieurs ; que s'il plaît à notre Créateur et Rédempteur de nous mettre
en des angoisses et périls, qui sommes-nous pour oser lui dire : Pourquoi
nous avez-vous ainsi traités ? [524]
Cette Bienheureuse Mère aimait grandement ces paroles, et nous pouvons
dire de sa fidélité, sans pourtant vouloir faire des comparaisons, ce qui est
dit de ce saint patient Job, qu’il n'offensa et ne pécha point en ses
souffrances ; ce qui est si vrai de notre Bienheureuse Mère, que, elle
qui avait la conscience si pure, n'a jamais su remarquer en toutes ses
tentations le moindre consentement qu'elle eût osé, en vérité, porter en la
sainte confession, qui est le vrai lieu de simplicité et de vérité.
CHAPITRE XXVIII.
faveurs et grâces
surnaturelles et extraordinaires que reçut notre bienheureuse.
Il n'est printemps si gaillard et si frais, qui ne soit suivi d'un été
plus ardent, ni si agréable automne, qui n'ait un hiver mal plaisant à sa
suite : je ne pense pas que l'on trouve guère d'âmes qui ne sachent ce que
c'est de la spiritualité, qui ignorent que l'on n'est pas toujours en même
état ; ceux de notre Bienheureuse Mère ont été fort différents, et nous
pourrions dire qu'elle a eu de grands biens et de grands maux ; mais que
tout lui a réussi à bien, parce qu'en tout, elle a constamment aimé et
travaillé.
Nous ne voulons pas ici rappeler en détail toutes les grâces extraordinaires
que cette Bienheureuse a reçues de la divine libéralité, comme le ravissement
dans lequel elle vit notre Bienheureux Père, la vision de la porte de saint
Claude, et celle de cette multitude de filles et de femmes, qu'elle vit qui
venaient à elle, et que Dieu rangeait sous sa conduite ; celle de ces
trois pèlerins qui disparurent après qu'elle leur eût donné sa bague, qu'elle
gardait pour l'amour de feu son mari ; le ravissement qu'elle eut, dans
lequel elle vit le plaisir de Dieu dans l'âme pure.
Nous parlerons de quelques autres grâces que nous n'eussions pas fait
facilement couler dans l'histoire : ce grand don de contemplation si pure
mérite bien d'être considéré ; cette cessation d'opération intérieure, par
un submergeaient de son âme dans [526
la Divinité, ce feu d'amour qui
la soutenait ; en sorte qu'elle a dit en plusieurs rencontres, à des âmes
de confiance et notamment à notre Mère de Châtel, à laquelle elle parlait comme
à sa supérieure, qu'elle avait reçu une grâce de Dieu qui la rendait vigoureuse
d'esprit parmi les faiblesses du corps ; en sorte qu'il lui semblait, dans
ses premières années de religion, que son corps était un étranger associé avec
elle, et que si elle n'y eût fait attention, par une charité bien ordonnée à
ses nécessités, elle n'y eût pas pensé.
Elle lui dit aussi que, depuis l'année 1615 jusques en l'année 1619,
elle avait à toutes les communions qu'elle faisait journalières, une chaleur
intérieure autour du cœur si grande, qu'elle avait peine à la supporter, et
qu'elle avait premièrement reçu cette grâce en communiant, entre Annecy et
Lyon, lorsqu'elle y allait faire la fondation. « Alors, dit-elle, j'étais
dans les sentiments de mon vœu de faire toujours ce que je connaîtrais le plus
parfait ; il me semblait qu'à chaque communion ce feu brûlait et consumait
quelque chose de mes imperfections intérieures. « : — Notre Mère de Châtel
lui répliqua : « Ma Mère, Notre-Seigneur faisait envers Votre Charité
comme un bon Père de famille qui met le feu à son champ pour brûler les épines,
afin qu'il ne porte que du bon grain. » — « Il est vrai, dit cette
Bienheureuse, mais avec cette différence, que les épines pétillent et font du
bruit en se brûlant, et le feu intérieur que je sentais agissait fort
tranquillement et suavement. »
Elle a souvent ouï, même des oreilles du corps, une douce et agréable
voix, qui en peu de mots l'instruisait. La première fois que nous sachions, fut
lorsqu'elle priait Dieu de lui donner un conducteur, il lui dit : « Persévérez,
et je vous le donnerai » y elle persévéra à le demander avec ardeur et
larmes, et il lui fut montré en vision, avec ces paroles : « Voilà
l'homme entre les mains duquel tu dois remettre ta conscience. [527]
Une autre fois, il lui fut dit dans un ravissement : « Comme
mon Fils m'a été obéissant, je vous destine à être obéissante. »
Priant à Grenoble pour notre Bienheureux Père (il était déjà décédé, et elle
n'en savait rien), elle ouït une voix qui lui dit distinctement : Il
n'est plus.
L'année après le décès de ce Bienheureux, priant devant son tombeau, la
même voix lui dit : « Vos cœurs sont toujours unis, quant à
l’objet de leur union. mais l’un jouit, et l'autre doit
souffrir ; » par où elle eut une grande intelligence de la gloire
et félicité de notre Bienheureux Père, et une vue que pour elle elle avait
encore beaucoup à souffrir.
À la fin d'une neuvaine qu'elle avait faite à la Très-Sainte Vierge,
pour la peine où elle était de son impuissance intérieure d'agir, il lui fut
dit : « Ce n'est plus à vous à travailler dans votre intérieur,
mais d'y laisser travailler le divin Maître, qui n'a pas besoin que vous lui
aidiez en son ouvrage. » Ensuite, de cette faveur, elle avait écrit
les paroles suivantes : « O Dieu ! je m'abandonne à vous, faites
qu'avec vérité je puisse dire : Ce n'est plus moi qui travaille en moi,
mais c'est mon Sauveur entre les mains duquel je me suis livrée. »
Le huitième juin 1637, priant dans l'oratoire de notre Bienheureux
Père, avec grande angoisse, à cause de ses tentations, elle ouït clairement
cette amiable voix qui lui dit : « Regardez Dieu, et lui laissez
faire » ; et trois ou quatre jours après, priant sur le même
sujet dans le même oratoire, la même voix lui dit : « Lisez le
livre huitième des Confessions de saint Augustin. » Nous avons trouvé
cela écrit de la main de notre Mère de Châtel, qui ajoute qu'en cette lecture,
notre Bienheureuse Mère trouva de la consolation et divertissement à ses
peines.
Après la mort de notre Mère de Châtel, comme notre Bienheureuse Mère
était fort angoissée, se voyant destituée de cet appui qui lui était si cher,
la même voix lui dit, un matin [528] qu'elle était bien éveillée : « Lisez
le chapitre trente-septième du troisième livre de l'Imitation de
Jésus-Christ. »
Nous avons trouvé écrit de la main de notre Mère de Châtel dans ses
Mémoires, « que, le vendredi-saint de l'année 1637, notre Bienheureuse
Mère, priant avec grande instance, que si faire se pouvait, sans contrevenir à
la divine volonté, le calice de ses travaux intérieurs fût transporté hors
d'elle ; la voix lui dit fermement : Quoi ! l’homme de
douleurs n'a pas été exaucé, ne prétendez pas l'être. Or, quelle était
cette voix, c'est ce que je ne sais pas exprimer.[90]
Quelques âmes, à l'instant de leur décès, lui sont allées dire adieu.
Avant que l'on sût la mort de M. le commandeur de Sillery, cette Bienheureuse
Mère en fut avertie, car elle sentit que par deux fois on lui pressa les
lèvres, et soudain il lui vint en vue que c'était ce bon serviteur de Dieu qui
lui venait donner le baiser de paix et lui dire adieu, ce qui se trouva vrai.
CHAPITRE XXIX.
son abandonnement à
dieu et à sa sainte providence.
C'était la moelle et le suc de tout l'intérieur de notre Bienheureuse
Mère que ce grand abandonnement d'elle-même entre les mains de Dieu ; dès
son commencement, ce fut son attrait, et elle fit des exercices spirituels tout
exprès pour faire cet entier sacrifice de son franc arbitre et dépouillement de
soi-même, dont elle avait fait une oblation si solennelle qu'elle en faisait,
comme de ses autres vœux, une reconfirmation tous les ans, par l'avis de notre
Bienheureux Père qu'elle lui demanda par écrit, en ces termes :
« Premièrement (dit-elle sur un petit cahier de papier), tu dois demander
à ton très-cher seigneur, s'il trouvera à propos que tu renouvelles, tous les ans,
en reconfirmation, tes vœux, ton abandonnement général entre les mains de Dieu.
Qu'il spécifie particulièrement ce qu'il jugera qui te touche le plus, pour
enfin faire cet abandonnement parfait et sans exception, en sorte que tu
puisses vraiment dire : Je vis, non pas moi, mais Jésus-Christ vit en
moi ; que pour cela ton bon seigneur ne t'épargne point, et qu'il ne
permette pas que tu fasses aucune réserve, ni de peu, ni de prou ; qu'il
te marque les exercices et pratiques journalières requises pour cela, afin
qu'en vérité et réellement l'abandonnement soit fait. »
Notre Bienheureux écrivit au bas du même feuillet : « Je
réponds, au nom de Notre-Seigneur et de Notre-Dame, qu'il sera bon, ma
très-chère fille, que vous fassiez le renouvellement [530] proposé, et que vous
rafraîchissiez le parfait abandonnement de vous-même entre les mains de
Dieu ; pour cela, je ne vous épargnerai point, et vous, vous retrancherez
des paroles superflues qui regardent l'amour, quoique juste, de toutes les
créatures, notamment des parents, maisons, pays, et surtout du Père, et, tant
qu'il se pourra des longues pensées de toutes ces choses-là, sinon ès occasions
esquelles le devoir oblige d'ordonner ou procurer les affaires requises, afin
de parfaitement pratiquer cette parole : Ouïs, ma fille, et
entends ; penche ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton
père. Devant dîner, devant souper, et le soir s'allant coucher, examinez
si, selon vos actions du temps présent, vous pouvez dire : Je vis, mais
non pas moi, ains Jésus-Christ vit en moi. »
Elle a fidèlement pratiqué et continué cet exercice, et enfin est
parvenue au point que notre Bienheureux Père lui avait prédit, de la parfaite
et entière nudité. Dieu y a mis la main pour la dépouiller, et dénuer de tout
ce qui pouvait lui donner satisfaction et appui, tant intérieur qu'extérieur,
pour la faire suivre nue Jésus-Christ nu. Plus elle acquérait de vertus par une
constante et fidèle pratique, plus Notre-Seigneur l'en dépouillait, en sorte
que, comme si elle n'eût rien fait ni rien acquis, elle se voyait toujours
pauvre et nue, et ainsi abandonnait à Dieu, et elle, et sa perfection même.
Plus cette sainte âme faisait des choses grandes pour Dieu, et plus sa
bonté permettait que sa perfection éclatât aux yeux de tout le monde ;
plus il la cachait à elle-même, mais la cachait si absolument, que lorsque tout
le monde la voyait et la croyait Sainte, elle se voyait nue de toutes vertus,
et tremblait sur les jugements de Dieu, se croyant indigne de ses miséricordes.
Dieu, comme un maître amoureux, pour éprouver l'amour fidèle de sa Servante,
après lui avoir donné beaucoup de grâces, de jouissances et de suavités, lui
ôta tout, comme si elle eût été une mauvaise ménagère, et en cela, elle
s'abandonnait à sa [531] conduite. Nous avons trouvé en écrit, de sa chère
main, ces paroles : « Après l'oraison du soir, dit-elle, j'ai eu
cette vue que Dieu avait retiré à soi toutes les vertus et grâces que sa bonté
m'avait autrefois données, qu'il me fallait aussi retirer en lui. » Elle
demeurait là, retirée en Dieu, en sa manière simple, constante au bien et
contente en la volonté de Dieu, dans son abandonnement et remise de tout. Elle
portait sur soi, pendant sa vie, et les a voulu emporter, après sa mort, les
paroles suivantes, écrites de sa main et signées de son sang :
« Je vous supplie, ô mon Père Éternel ! au nom de votre Fils
Jésus, de prendre, entre vos bénites mains, ma volonté, et le franc arbitre que
vous m'avez donné, duquel je me dépouille ; je le remets avec ma volonté
entièrement et sans réserve à votre sainte disposition, à ce qu'il vous plaise,
et je vous en supplie, par le sang précieux de votre Fils, qu'il ne soit jamais
à ma disposition de faire jamais aucune chose contre votre volonté. Je vous
renouvelle de tout mon cœur l'entier abandonnement et dépouillement que je fis
en vos bénites mains, de tout ce que je suis et de toutes choses, sans aucune
réserve, pour ce que Votre Majesté sait, l'ayant tant de fois renouvelé et
particulièrement ce vendredi-saint dernier, 1637 ; délaissant et remettant
derechef, dans le sein de votre divine protection, et au plus secret de la
fidélité de votre saint amour, le précieux trésor de foi, d'espérance et de
charité que votre grâce m'a conféré comme aussi le soin de mon salut éternel,
de ma vie et de ma mort, du repos et paix intérieure de mon âme ; mes
consolations et satisfactions, vues et réflexions sur ce qui se passe en moi,
le désir d'être délivrée de ma peine intérieure ; bref, tout, sans
exception, désirant de me perdre et abîmer tout à fait dans le sein de votre
Providence paternelle, et de me délaisser tout à fait aux soins de votre divin
amour ; désirant, moyennant votre sainte grâce, ne plus voir, ni regarder,
ni chose aucune qui se passe en moi, ains, vous, seulement, [532] pour m'y
reposer et confier simplement ; non pour le bonheur qu'il y a de se
confier en vous, mais parce que c'est votre sainte volonté que vous m'avez fait
connaître, par vos divins attraits et par les conseils de mon Bienheureux Père,
auquel, moyennant votre sainte grâce, je rendrai fidèle obéissance. Je remets
dès maintenant tout ce qui m'arrivera ci-après à votre soin, et dès maintenant,
comme alors, les choses plus scabreuses et épouvantables, je les recommande au
plus secret de votre Providence, ne les voulant nullement approfondir, mais y
faisant doucement ce que je pourrai ; vous laissant le soin de tout,
m'abandonnant pour le temps et l'éternité à votre volonté divine. Et puisqu'il
vous plaît, ô mon Dieu ! que je n'aie plus de bras pour me porter, ni plus
de sein pour me reposer, que le vôtre et votre Providence, conduisez-moi
vous-même, mon cher Maître, en cette sainte voie ; veuillez, pour moi,
tout ce qui vous plaira, et que je meure à moi-même et à toutes choses, pour ne
vivre plus qu'à vous seul, mon unique vie ; et accomplissez en moi vos
desseins éternels, sans que j'y mette empêchement. » Cette prière est un
peu longue, mais elle est si dévote, qu'il m'aurait fâché de l'omettre.
Son abandonnement était entier et véritable, et son amour à la
Providence divine, réel et solide ; le discours de cette sainte Providence
lui était extrêmement doux ; elle avait souvent en bouche cette parole de
l'Écriture : Père éternel, votre Providence gouverne toutes
choses ; et sous ce gouvernement, elle demeurait en paix. Elle avait
prié le révérend Père Bertrand, vice-recteur du collège de la sainte Compagnie
de Jésus de Chambéry, de lui écrire les principales sentences de l'Écriture,
touchant la Providence divine, ce qu'il fit, et cette Bienheureuse en fit un
petit extrait de sa chère main, car elle aimait les choses abrégées ; elle
l'avait conclu par cette pensée, qui lui était extrêmement familière, en son
discours : « La Providence céleste nous conduit avec toute sa
sagesse, puissance et bonté ; [533] je crois donc que l'âme qui s'y confie
entièrement ne périra jamais par faiblesse, car le Tout-Puissant la
soutient ; ni par ignorance, car l'Éternelle Sagesse l'enseigne ; ni
par malice, car la Bonté même la dirige.[91]«
Cette Bienheureuse n'était point curieuse de sonder les choses ni de
prévoir ce qui devait arriver ; et quelquefois, lorsque dans le discours
l'on disait que telle et telle chose pourrait arriver, si telle chose était
faite, elle disait fort gracieusement : « Je suis si aise, que les
prévoyances de l'homme soient incertaines, et qu'il ne se faut fier qu'en Celui
dont la Providence est infaillible. » Quasi en toutes choses elle prenait
occasion de parler de cette sainte Providence, comme des arbres, des herbes,
des fleurs, etc.
Du temps que la peste était en cette ville, l'on voulut arracher
quantité de lis blanc qui étaient au jardin du cloître, parce qu'on dit que
l'odeur en est trop forte pour les temps soupçonnés de contagion ; notre
Bienheureuse Mère pria qu'on ne les arrachât pas tous, « d'autant,
dit-elle, que lorsqu'on passe par le cloître, il y a de la consolation à se
ressouvenir que la Providence de notre Père céleste tient ces lis plus lestes
et mieux agencés que Salomon et toute sa glorieuse cour ne l'était. »
Dans les bons succès, dans les douloureux événements, dans [534] les
nouvelles fâcheuses, bref, en toutes rencontres, cette Bienheureuse Mère avait
toujours en bouche : Providence ; Providence et volonté de
Dieu ; ce qu'elle répétait plusieurs fois sans rien ajouter de plus,
et l'on voyait que son cœur s'anéantissait et adorait avec une profonde
soumission cette divine Providence. Elle n'épargnait ni soin, ni peine, ni
sainte prudence, pour éviter le mal, les périls, les pertes temporelles, mais
si quelqu'une de ces choses arrivait contre sa volonté humaine, elle s'arrêtait
si absolument dans l'ordonnance divine, qu'elle y abîmait sa pensée ; et
c'était une leçon qu'elle pratiquait et enseignait continuellement, de ne
jamais regarder la cause seconde en ce qui nous arrive, mais uniquement cette
cause première et universelle.
Notre chère Sœur, la supérieure de Turin, Madeleine-Élisabeth de
Lucinge, qui l'a souvent accompagnée dans ses voyages, nous a écrit que
quelquefois elle était tout étonnée de voir cette Bienheureuse Mère ne
s'épouvanter point dans les chemins scabreux et sur des précipices étranges, et
qu'elle lui disait : « Ma Mère, comment pouvez-vous vous empêcher de
trembler ! je frémis d'appréhension de voir ces chemins-là. »
Cette Bienheureuse se mettait à sourire et lui disait : « Ma fille,
un petit passereau ne tombe point dans les filets du chasseur sans la
Providence de notre Père céleste ; à plus forte raison, une créature
raisonnable ne tombera pas au précipice sans son ordre ; s'il l'a ordonné,
qu'y a-t-il à dire ?[92]«
La toute présence de Dieu en tout lieu et sa continuelle [535]
Providence sur ses créatures, étaient en son cœur comme les deux yeux qui la
conduisaient en toutes ses actions.
Elle avait une affection nonpareille à ces deux psaumes de David :
Domine, probasti me, etc., et Dominus regit me, etc. Elle les
disait quelquefois, les fêtes, par dévotion, en latin, dans ses Heures, et les
chantait fréquemment en vers, selon la version de Desportes ; elle avait
écrit dans son livret les vers suivants :
Dieu gouverne cet univers
Par sa très-sage Providence,
Et par des conseils fort divers
Surpassant notre intelligence.
À Dieu seul convient d'arrêter
Ce qu'il veut pour sa créature,
Laquelle aussi doit supporter
Tout ce qu'il lui plaît qu'elle endure.
De notre vie tout le bien
Est en la volonté divine ;
Et lorsqu'elle s'accomplit bien,
Là, notre bonheur se termine.
Il me vient cette pensée : le cœur de notre Bienheureuse Mère
était cette maison que la divine Sapience avait édifiée pour soi, soutenue de
sept colonnes, qui sont les sept vœux qu'elle avait faits : pauvreté,
chasteté, obéissance ; obéissance particulière à notre Bienheureux Père
pour son intérieur, faire toujours le plus parfait, dire tous les jours son
chapelet et honorer la Sainte Vierge, enfin, ne s'arrêter jamais ni peu ni prou
aux tentations.
CHAPITRE XXX.
combien elle était
éclairée et solide en la conduite des âmes,
Dieu qui avait élu notre Bienheureuse Mère pour être conductrice de
plusieurs âmes en son saint amour et en la pure vie spirituelle, afin qu'elle
le sût mieux faire, il lui fit savoir, par sa propre expérience, ce qu'elle
devait enseigner aux autres ; aussi va-t-on avec une certitude tout autre,
sous la conduite d'un guide que l'on sait avoir déjà fait le même chemin, que
sous un qui ne l'aurait appris que par des cartes et descriptions des pays.
Il y a de très-saintes âmes qui ont été élues à la perfection par une
prompte et pure grâce, en sorte que la possédant, elles ne sont pas propres
pour guider les autres, ainsi que je l'ai ouï dire à notre Bienheureuse Mère,
et que ces âmes-là sont simplement pour Dieu et pour elles ; mais cette
digne Mère, qui était encore destinée pour le prochain, Dieu la fit passer
elle-même par presque tous les états intérieurs, en sorte qu'il n'y a voie si
secrète, chemin si reculé, sentier si étroit et obscur en la vie intérieure,
qu'elle ne sût parfaitement. Nous avons appris d'un grand serviteur de Dieu,
que de quelque degré d'oraison d'union sublime, d'amour épuré, de souffrance
intérieure, que l'on parlât à cette Bienheureuse Mère, on voyait que l'œil
pénétrant de son esprit illuminé de Dieu allait au devant de la proposition, et
en avait une parfaite intelligence ; en sorte que, d'ordinaire, l'âme qui
lui parlait sentait, par une [537] correspondance intérieure, que, non-seulement
elle parlait et donnait des avis par une science infuse du ciel, mais aussi par
propre expérience. Elle disait qu'il y a deux secrets pour bien conduire les
âmes : le premier, de bien connaître l'attrait de Dieu en chaque âme, et
le leur faire connaître ; le second, de n'agir sur les âmes que l'on
conduit que pour l'intérêt de Dieu seul, sans vouloir faire goûter nos maximes,
estimer notre procédé, ou lier d'affection particulière ; que Dieu lui
avait fait cette grâce, de n'avoir aucun dessein ni désir d'acquérir les
affections des créatures, d'autant qu'il doit suffire que Dieu a commandé à
tous d'aimer son prochain. Elle disait un jour, instruisant une de ses filles,
que l'on avait demandée pour supérieure en quelque part, qu'elle la conjurait
sur toutes choses de s'appliquer avec grand soin, quand elle serait en charge,
à la conduite intérieure de sa communauté. « Fuyez, dit-elle, un
manquement que j'ai connu ; quelques supérieures veulent conduire les
filles par leur propre voie, en sorte que celle qui va par le chemin des
colloques intérieurs veut y porter toutes ses filles ; celle qui va par la
simplicité et dénùment intérieur, y fait ingérer ses filles ; celles qui
vont par la considération, veulent que toutes agissent, ce qui est plutôt
détourner les âmes que de les conduire. » « J'ai connu, dit-elle en
quelques autres rencontres, des esprits immortifiés et imaginaires qui se
figurent être dans des états où ils ne sont nullement ; je ne me fais
point de scrupule de les détourner de là, encore qu'elles me veulent faire
croire que c'est leur attrait et leur voie, car c'est les détourner
d'elles-mêmes pour les porter à Dieu ; comme, au contraire, quand on voit
une fille vertueuse et solide, si l'on lui veut changer sa voie, c'est la
détourner de l'opération de Dieu, et la contourner à sa propre opération, en
quoi l'on lui fait grand tort. »
Pour tenir les âmes plus encouragées, elle ne témoignait point faire
grand cas des choses extraordinaires, ni qui [538] semblent plus élevées, ni ne
témoignait non plus moins d'estime d'une voie plus basse, disant que c'est une
grande ignorance en la conduite des âmes, de faire tant d'état d'une voie et si
peu des autres ; que, pour elle, elle n'appelait point d'états bas, que
celui du péché et de l'imperfection.
Une fois, une Sœur lui dit que quelques personnes spirituelles lui
avaient conseillé de se détourner d'une conception fort bonne qu'elle avait
eue, et qu'elle se devait appliquer plus immédiatement à Dieu ; cette
Bienheureuse Mère répondit : « Dieu lui pardonne ce conseil, il n'en
faut jamais donner de tels, que l'on ne connaisse grandement les âmes à
fond ; il ne faut pas dire indifféremment ces choses-là à toute âme, parce
que l'on s'en fait facilement accroire ; c'est à Dieu à tirer les âmes dans
les états surnaturels, et non aux hommes de les y pousser. » Elle disait
« que la voie des bonnes pensées et saintes conceptions n'est nullement
contraire aux oraisons de quiétude et simple repos ; que quand Dieu les
donne à l'âme, sans qu'elle se peine à les forger, c'est comme s'il lui
présentait une facile planche pour arriver au port du sacré repos intérieur,
où, après avoir loué Dieu en son ouvrage, l'on s'arrête à l'ouvrier ; que
celles qui seraient éclairées en la voie intérieure de notre saint fondateur,
verront que c'était la sienne ; toutes choses le portaient à Dieu, et ses
saintes pensées sur les rencontres étaient très-fréquentes. » Elle avait
écrit les paroles suivantes à une de ses filles : « Suivez votre
attrait, ne bouchez point les oreilles de votre cœur à cette douce voix de
toutes les créatures raisonnables, irraisonnables, ni de celles qui n'ont que
l'être ; quand vous entendrez leur langage muet, penchez-y votre
oreille ; leur harmonie passe, mais l'intelligence demeure et sert beaucoup
à plusieurs âmes. »
Une chose que l'on admirait en cette grande directrice des cœurs, c'est
qu'étant arrivé à un si haut degré de contemplation, et de vue de Dieu si
simple et séparée des images et actes [539] sensibles, elle donnait aussi
facilement des avis pour les premiers rudiments des commençants et pour
l'acheminement des profitants, que pour la perfection de ceux qui croissaient
de perfection en perfection.
Elle avait une admirable clarté pour discerner les voies de Dieu sur
chaque âme, et pour connaître quand les attraits étaient de Dieu ou de
l'amour-propre, et les clartés que l'on disait recevoir de l'ange de lumière ou
de l'ange des ténèbres. Elle disait aux âmes, sans flatterie, le défaut ou la
tromperie qu'elle trouvait en elles ; et ne faisait estime que de ce qui
apporte de l'humilité dans l'âme, et qui la rend vertueuse et unie à Dieu.
Son zèle était ardent pour le bien et avancement des âmes, mais elle ne
les chargeait pas d'avis, ni ne les pressait que suavement ; elle disait
que, « quelquefois, à force de presser les cœurs, on les oppresse en leurs
voies. »
Une bonne âme disait un jour que, regardant notre Bienheureuse Mère, à
laquelle, de tous côtés, toutes sortes de personnes s'adressaient pour être
dirigées en la perfection, qu'il lui semblait qu'elle était comme une personne
qui, du haut d'une tour, voit de tous côtés venir les voyageurs demander le
chemin, et que, sans bouger de sa place, cette personne dit : « Allez
au levant ; vous, au couchant ; cet autre, au midi » ;
qu'ainsi cette Bienheureuse Mère était, par beaucoup de grâces divines, de
travaux et fidélité de sa part, parvenue au sommet de la haute tour de la
très-sainte perfection ; que de là, sans bouger de son lieu, elle voyait,
par une vue très-épurée, les divers chemins de ceux qui la venaient consulter,
et répondait à chacun convenablement.
Je me souviens qu'une fois une personne spirituelle avait donné à une
autre à lire le livret de l'abnégation intérieure, cette digne Mère nous
dit : « Cela est très-mal ordonné ; dans l'état où est cette
âme-là, cette lecture la mettra en peine et en [540 trouble, parce que de tels avis ne sont pas
pour l'affermir en la voie par laquelle Dieu l'attire » ; ce qui
arriva comme elle l'avait dit, et cette personne se vint débrouiller et
éclaircir auprès de cette Bienheureuse Mère, ce qu'elle eut bientôt fait, ayant
reçu grâce de Dieu pour cela.
Elle discernait soudain quand une fille marchait simplement ou allait
par artifice ; j'en sais plus d'exemples que je n'en veux dire, ceux-ci
suffiront. Dans une maison, une fille feignait d'avoir certain mal, que les
démons l'empêchaient de manger, sinon à mesure qu'avec cérémonies l'on lui
appliquait des reliques, ce que l'on faisait soigneusement et de bonne
foi ; mais notre Bienheureuse Mère connut soudain la tromperie, et dit
qu'elle voulait elle-même appliquer la relique. Elle plia un morceau de bois
dans du papier, puis le mit sur le chef de la fille, qui faisait la pâmée,
laquelle revint soudain, disant que la relique faisait fuir le démon, se leva
et mangea fort bien ; d'où notre Bienheureuse Mère lui fit connaître
qu'elle était découverte en son artifice, dont elle se châtia du tout.
Entrant dans un monastère, une fille lui dit : « Ma Mère,
j'ai vu votre bon Ange qui m'a guérie d'une tentation que j'avais d'être
employée ès charges relevées. » À même instant, notre Bienheureuse Mère
connut que cette fille parlait par artifice, et lui dit : « Ma fille,
suivez donc la grâce, demandez à votre supérieure de n'être jamais employée
qu'aux petites charges ; je me fais forte qu'on vous
l'accordera » ; réponse qui piqua si avant la pauvre fille, qu'elle
fit bien voir que son humilité était feinte et non sainte.
Elle a souvent connu, seulement en lisant les lettres des filles qui
faisaient les tentées et peinées, que c'étaient des dissimulations, et mandait
à leurs supérieures de les bien éprouver et ne pas se fier en ce qu'elles lui
iraient dire, et que surtout elles leur fissent des interrogats différents, et
prissent garde [541] si elles se piqueraient, qu'elle les humiliât et leur
témoignât ne pas vouloir perdre du temps après elles.
Combien de personnes a-t-elle désabusées, tant pour les grâces qu'elles
croyaient avoir, que pour les peines où elles feignaient d'être, les unes
trompées par ignorance, les autres par malice !
Quand les peines étaient véritables, elle avait un soin et une charité
inimaginable pour soulager les âmes ; aussi savait-elle combien ce poids
est pesant. Elle a avoué en diverses rencontres que lorsque les âmes se
communiquaient à elle, Dieu lui faisait ressentir envers celles qui allaient
sincèrement, une certaine ouverture de cœur par laquelle elle connaissait mieux
l'état de ces âmes que par leurs discours mêmes ; mais que, quand on
allait avec artifice et duplicité, elle le sentait, parce que Dieu retirait son
attention ailleurs, et ne lui donnait presque rien pour dire à ces âmes-là.
CHAPITRE XXXI.
ses avis et maximes,
surtout pour l'oraison.
Notre Bienheureuse Mère ne faisait état de rien du tout en la vie
spirituelle, que de la solide vertu, et disait : « J'ai tant connu de
vanité en l'esprit humain, tant de sensualité, tant de facilité à s'imaginer,
et tant de faiblesse à croire, que je ne suis pas facile à m'émouvoir pour les
choses extraordinaires, si je ne vois une vertu vraie et solide. »
Une supérieure lui manda une fois un long narré de quelques grâces
extraordinaires qu'une de ses filles avait reçues ; cette digne Mère lui
écrivit : « Vous m'avez envoyé des feuilles de l'arbre, mandez-moi un
peu de son fruit, afin que j'en juge, car, quant à moi, je ne m'arrête point
aux feuilles ; or, les fruits d'un bon cœur que Dieu arrose et fait
fleurir par sa grâce, c'est un oubli profond de son intérêt propre, un amour
grand de l'anéantissement de soi-même, et une joie universelle des biens et bonheur
que l'on voit au prochain, sans exception. »
Une autre de nos sœurs les Supérieures lui écrivit qu'elle avait une
novice qui tombait pâmée en l'oraison, qui ne pouvait se récréer ni travailler
par la grandeur des attraits qu'elle disait sentir ; notre Bienheureuse
lui fit réponse en ces termes : « Je viens de communier pour votre
novice, ma très-chère fille, et vous dirai sincèrement que cette fille s'amuse
elle-même ; tenez cette maxime pour inviolable : ces grâces si
extraordinaires sont des transformations amoureuses en Dieu, où l'âme [543]
doit dire : Je vis, non pas moi, c'est Jésus qui vit en moi ; or,
si Jésus vit dans l'âme, il y apporte infailliblement, simplicité et humilité,
car il est Dieu et homme ; en tant que Dieu, c'est un acte tout pur et
tout simple ; en tant qu'homme, il n'est qu'humilité et bassesse, et tant
plus il joint l'âme à lui, plus elle paraît basse à ses yeux, et désireuse de
vivre inconnue et méprisée. »
Cette Bienheureuse Mère ne voulait point que l'on s'ingérât de soi-même
aux oraisons surnaturelles, et donnait d'excellentes marques pour connaître
quand cet état était donné de Dieu, et non de l'amour-propre ; en voici
huit, écrites de sa chère main, à une religieuse de notre Congrégation :
« Oui, de bon cœur, ma très-chère fille, je tâcherai de vous
donner quelques marques par lesquelles vous verrez si votre repos et quiétude
est bon et de Dieu.
1° Voyez, ma très-chère fille, si, quoique, comme la communauté, vous
préparez votre point, néanmoins, vous ne vous en pouvez servir, ains sentez
que, sans artifice de votre part, ni de celle des personnes qui vous
conduisent, votre cœur, votre esprit, l'intime de votre âme est tirée suavement
à ce sacré repos, jouissant paisiblement de celui que vous avez tant désiré par
la grâce divine, il y a plusieurs années.
2° Si vous remarquez que cet attrait vous porte à la petitesse et au
ravalement de vous-même.
3° Si vous apprenez, parmi ces suavités et saint repos, à n'être qu'à
Dieu, à lui obéir et à vos supérieurs, sans exception d'aucune chose ; si
vous y apprenez à ne dépendre que de la Providence divine, et à ne vouloir que
sa sainte volonté.
4° Si ce repos vous ôte et vous fait quitter toute affection d'attache aux créatures et choses terrestres, pour vous unir et conjoindre seulement à l'amour du Créateur ; car, ma fille, il n'est pas raisonnable que l'âme qui se plaît à goûter Dieu, se plaise plus au goût des choses basses, et au-dessous de Dieu. [544]
5° Si cela vous porte à vous mieux découvrir, à être très-simple,
sincère, véritable et candide, bref, comme un petit enfant.
6° Si, nonobstant la suavité que vous recevez de ce doux repos, vous
n'êtes pas prête de retourner aux imaginations, considérations, voire aux
sécheresses, quand Dieu voudra.
7° Si vous n'êtes pas plus patiente et humble à souffrir vos
infirmités, même si vous n'êtes pas désireuse de souffrir davantage, sans vous
soucier d'autres soulagements ou contentements, que de contenter votre Époux.
8° Voyez brièvement, simplement et généralement, si votre attrait et
sommeil amoureux vous rend plus méprisante le monde, les vanités propres, les
intérêts ; bref, s'il ne vous semble pas qu'il met le monde, toute sa
gloire, et vous-même sous vos pieds, et vous fait estimer plus que toutes
choses les mépris, la simplicité, la bassesse, les travaux et la croix.
Au surplus, ma très-chère fille, je tiens en vérité votre attrait bon,
et de Dieu, et ne vous mettez point en peine de vouloir nourrir votre
âme ; car, ce sommeil vaut mieux que toute autre viande, et je vous dis
qu'encore qu'il vous semble que votre âme dorme, elle ne laisse pas de prendre
nourriture et de manger, voire de fort bonnes et délicates viandes ; mais
c'est qu'elle est si fort attentive à l'amoureux Jésus qui la fêtoie, qu'elle
ne s'amuse pas aux festins qu'il lui fait ; et c'est ainsi qu'il faut
faire, car autrement, l'âme se mettrait en danger de perdre sa place. »
Cette Bienheureuse Mère disait et redisait quasi en toutes rencontres,
que le seul moyen de la présence de Dieu et le retranchement de toutes réflexions
inutiles, pouvaient, en peu de temps, perfectionner une âme.
Écrivant à une supérieure, elle dit : « Enseignez fidèlement
à vos filles la préparation, la méditation, les affections et résolutions de
l'oraison, puis laisser faire à Dieu ; si sa bonté veut [545] qu'elles
sachent quelque autre chose, elle le leur apprendra. »
« Quiconque est fidèle à retirer sa pensée de toutes choses pour
s'occuper de Dieu, qu'il s'assure que Dieu est fidèle, et qu'il l'occupera
lui-même. »
« Une des choses qui me causent beaucoup de douleurs, c'est de
voir que tant et tant de personnes parlent de l'oraison, des faveurs
intérieures, des grâces extraordinaires, et l'on ne parle point avec tant
d'ardeur de la pure vertu et des solides mortifications. L'âme qui s'applique plus
à s'élever en de belles pensées, et à jouir du repos intérieur qu'à s'abaisser,
et à être parfaitement obéissante et pauvre, ne sait que c'est d'imiter
Jésus-Christ. Qui ne pratique les vertus dans les rencontres, les anéantit en
soi ; qui pourrait opérer des miracles, si l'on n'opère les vertus, l'on
n'est point servante de Dieu. »
« J'ai vu plusieurs personnes spirituelles qui se riaient de moi,
de quoi je recommandais à nos Sœurs la sainte crainte de Dieu ; c'est une
vertu que j'estime tant, que si je me croyais, j'en parlerais à toute rencontre
et à toute âme, pour élevée qu'elle soit en la vie spirituelle ; car, si
elle ne craint filialement, elle s'abaissera, sans doute, dans le péché. »
Sur quelque rencontre de louanges, elle dit : « Si je savais
que la vanité entrât dans un tel monastère, et que l'on fit parade des
puissances de ce monde, et que l'on s'enflât pour la faveur des grands, je
serais tentée de demander à Dieu le feu du ciel pour brûler cette maison, et en
nettoyer l'Institut ; on dira que je ne sais quel esprit me pousse, mais
si l'on savait l'humilité que Dieu requiert des filles de cette Congrégation,
et combien celles qui s'élèvent et font parade de mondanité contrarient
l'esprit de Dieu, on se mettrait de mon parti. »
« Rien ne serait plus capable d'abréger mes jours, que de [546]
voir de la vanité et de la désunion entre les filles de Sainte-Marie. »
« J'ai toujours remarqué que Dieu ne communique point les secrets
du ciel, ni les solides délices de son amour, à l'âme qui se plaît à savoir les
nouvelles du monde, et qui s'attache à l'affection des créatures. »
Très-souvent cette Bienheureuse Mère parlait de ce trait de
l'Évangile : « La voie qui conduit à la vie est étroite ;
oh ! combien peu y entrent ! » Il n'y a rien, disait-elle, qui
nous dût rendre si exactes que cette pensée. Et elle pesait et répétait avec
grande attention ces mots : « Oh ! combien peu y
entrent ! »
Elle disait : « On me demande de toutes nos maisons mes avis,
mes désirs ; pour moi, je ne sais rien, ni n'ai point d'autres désirs,
sinon que l'on soit fidèle à l'observance ; c'est le désir et le dessein
de Dieu sur nos âmes. Il me prend parfois de grandes appréhensions, que par
cette grande multitude de maisons que l'on établit, l'esprit se relâche, pour
n'avoir pas des filles et des supérieures solidement vertueuses ; mais
j'abandonne tout à la sainte Providence. Certes, si l'on n'y prend garde, et
que l'on ne considère bien s'il y a de quoi fonder des maisons, on fera
plusieurs colombiers, où nos colombes mourront de faim, et pour le spirituel et
pour le temporel. Ne nous réjouissons pas humainement des bons accueils que
l'on fait à notre Congrégation, mais humilions-nous et en glorifions
Dieu. »
« Je n'ai pas tant de plaisir à ouïr beaucoup louer notre
Bienheureux Père, comme à voir des personnes qui imitent ses vertus : les
paroles s'envolent, mais les actions vertueuses sont permanentes. »
Sur l'occasion de quelques élections de supérieures, elle dit :
« Jésus ! que j'ai d'aversion à cette recherche inquiète, que les
filles font des Mères capables et de si grande expérience ; voyez-vous,
cette imaginaire croyance des grandes et extraordinaires [547] capacités aux
supérieures ruine du tout la pure perfection de l'obéissance ; car il est
facile d'obéir à un Ange et difficile d'obéir à un homme. Il faut bien choisir
une bonne supérieure, mais en quitter plusieurs bonnes qui ont des bons
talents, pour s'empresser à en aller chercher bien loin de plus excellentes et
attrayantes, c'est ce qui me déplaît. Si l'on me donnait pour supérieure la
plus jeune de nos professes, je l'aimerais de cœur. »
Écrivant à une de nos supérieures, elle lui disait : « Ma
chère fille, ayez courage ; si vous êtes humble et dévote, Dieu fera des
merveilles en vous et en vos filles. Tenez ces trois maximes en la conduite
pour indispensables : que les exercices spirituels s'observent fidèlement,
et que la lettre de la règle soit vivifiée par l'esprit ; ne soyez ni
chicaneuse, ni prodigue pour le temporel, mais soyez soigneuse et très-discrète,
mais charitable aux pauvres.
Pour la conduite de vos Sœurs, soyez égale en affection, mais traitez
en particulier chacune selon le don de nature et de grâces que Dieu leur aura
données, et employez-les aux charges selon cela, et non selon leurs désirs et
fantaisies. »
Cette Bienheureuse Mère avait une grande aversion que l'on désirât les
charges, et disait « qu'une fille ne saurait donner une plus grande marque
de son incapacité, que quand elle se croit capable, parce que personne n'est
digne de servir en la maison de Dieu, s'il n'est humble, dévot et
mortifié. »
« L'humilité, ajoutait-elle, nous fait tenir pour insuffisantes à
tout ; la dévotion nous fait aimer nos cellules et notre silence ; la
mortification nous fait fuir le divertissement cl le plaisir des sens. »
« J'ai parlé à des grandes reines, à des grandes princesses, à des
grands seigneurs et à des grandes dames, mais je n'en ai jamais vu qui
n'eussent de poignantes épines au cœur, sous leurs habits couverts d'or et
d'argent, ni qui jouissent de cet [548] absolu calme et très-douce paix, que je
trouve ordinairement dans nos pauvres petites religieuses. »
« J'ai pensé ce matin que rien n'est si heureux sous le soleil
qu'une religieuse qui aime Dieu, sa supérieure et sa cellule. Les filles de la
Visitation ne manqueront jamais faute d'instruction ; car notre
Bienheureux Père a dit tout ce qu'il nous faut, il a bien équipé notre
vaisseau ; mais si le vent de la vanité entre dans nos esprits, c'est ce
qui nous fera périr. »
« Je voudrais pouvoir écrire de mon sang, par toutes nos maisons,
ce que notre bon Père spirituel nous a dit : Que la Générale de notre Ordre, c'est l'humilité ; que si tous les
monastères obéissent bien à cette Générale, elle maintiendra tout l'Institut en
union et uniformité. Si par tout on est humble il ne nous faut que cela.
Qu'importe-t-il à un cœur qui aime Dieu de souffrir ou de jouir, pourvu que la
volonté de Dieu se fasse ? Que plût à Dieu que l'on perçât mes lèvres d'un
fer rouge, et qu'à jamais la bouche des filles de la Visitation fût fermée à la
moindre parole contre la charité, l'union et la suavité qui doivent être parmi
elles. »
Cette Bienheureuse Mère avait aussi écrit de sa main grande quantité de
sentences de l'Écriture, surtout du Nouveau Testament, de celles qui portent l'âme
à la sérieuse pratique des vertus, à la crainte et vénération des jugements de
Dieu, au compte qu'il lui faudra rendre, et de sa très-sainte Providence, et
disait qu'en toute lecture, en tout discours, nous nous devions attacher au
solide plutôt qu'au doux. Les livres du révérend Père Rodriguez et du révérend
Père Dupont, lui plaisaient extrêmement, et nous disait : « Ce sont
là mes livres, après ceux de notre Bienheureux Père et la Vie des
Saints. »
Elle avait une pratique admirable de ne point confondre le temps,
faisant toutes choses en temps et lieu. Nous avons vu quelquefois des douze et
quinze jours, dans sa chambre, des lettres toutes cachetées des personnes qui
lui étaient plus chères [549] et proches ; nous lui demandions pourquoi
elle ne les lisait pas : « J'attends, disait-elle, qu'il y faille
répondre ; il me les faudrait aussi bien relire ; tout cela n'est que
satisfaction propre et perte de temps. »
Elle disait « que les supérieures soient soigneuses de bien
cultiver les filles qui ont des talents de nature et de grâce ; Dieu ne
fait pas tous les jours des miracles ; quand il en donne à un sujet, c'est
signe que si l'on correspond par vertu, il veut être servi
très-particulièrement et aux choses principales, par de telles âmes ; les
filles de bon jugement, de bonne observance et de bonne humilité, sont plus
précieuses que l'or. »
CHAPITRE XXXII.
conclusion.
Enfin, je m'arrête de considérer en détail les perfections de cette épouse,
pour dire qu'elle était toute belle. L'on n'oubliera pas, je pense,
ce grand don de recueillement qui la tenait toujours également retirée en
elle-même, soit qu'elle jouît ou qu'elle pâtît ; ce grand don, pour toutes
sortes d'affaires quelles qu'elles fussent, et cela avec telle promptitude, que
quelquefois nous étions trois qu'elle faisait écrire, en même temps, des choses
diverses. Elle dictait des lettres très-importantes, avec autant de facilité
qu'elle parlait d'autres choses ; et après, si la secrétaire y avait
manqué tant soit peu ou ajouté du sien, elle disait : « Ce n'est pas
ici mon style, mais le vôtre est meilleur. » Elle a consumé et prodigué sa
vie au service de Dieu et du prochain, singulièrement de ses filles. Qu'on se
souvienne aussi de cette constance toujours égale en tout événement, de ce
visage toujours enflammé, toujours doux, toujours recueilli, en sorte que
jamais, pour grands qu'aient été ses travaux et ennuis intérieurs, personne ne
s'en est aperçu que celles de ses filles, auxquelles, par une sainte bonté,
elle en voulait dire quelque chose pour leur bien et instruction. Qu'on se
rappelle cette modestie aussi grande en son âge qu'en une jeune vierge ;
cette fuite et haine des louanges et de tout éclat et nouvelles du monde, ce
très-grand amour de la pauvreté, humilité et simplicité de vie ; cet oubli
général de toutes choses et d'elle-même, par le continuel souvenir de
Dieu ; cette exactitude [551] indispensable à toutes petites pratiques de
vertus et d'observances ; ce soin de conduire son troupeau, comme dit le
révérend Père Fichet, dans les entrailles du désert de la vie intérieure ;
cette union qu'elle a conservée en l'Ordre, et avec quelle humilité elle a agi
et tenu tout joint à elle, demeurant dégagée de tout pour son
particulier : voilà les miracles opérés en elle, à savoir une vertu accomplie ;
reste à voir ceux qu'elle a opérés en autrui, et l'estime que l'on a fait
d'elle.
dieu
soit beni.
jésus.
marie. joseph.
APPENDICE
Nous donnons ici comme complément
des Mémoires de la Mère de Chaugy, le Bref de béatification et la Bulle
de canonisation de notre sainte Fondatrice. Ces deux pièces sont
précédées d'un exposé rapide de la cause et des lenteurs qu'elle eut à
subir ; elles seront suivies de quelques mots sur le culte et les reliques
de la Sainte.
Après la mort de notre Bienheureuse
Mère, le Seigneur ne tarda pas à faire connaître par des prodiges la sainteté
de sa fidèle Servante. D'autre part, l'admiration provoquée par ses vertus se
produisit par une grande confiance en sa protection, par les éloges que lui
décernaient à l'envi les fidèles et les membres les plus élevés du clergé. Le
nom de l'illustre défunte était sur toutes les lèvres, il retentissait dans les
chaires chrétiennes. L'héroïque veuve était comparée à sainte Paule et à sainte
Mélanie ; la fondatrice de la Visitation était proclamée la sainte Thérèse
de son siècle.
Dans un discours prononcé pour
l'anniversaire du décès, Charles-Auguste de Sales affirmait que, dans les
communications qu'il avait eues avec la Mère de Chantal, il avait découvert des
merveilles qu'il ne pouvait dépeindre, tant elles étaient spirituelles et
approchaient de la pureté des Anges. Et il concluait, en exprimant la
conviction où il était, que Jeanne-Françoise Frémyot habitait le céleste
séjour, que l'Église la proclamerait sainte
et la placerait sur les
autels.
Cette conviction de Charles-Auguste
de Sales était partagée par un grand nombre d'ecclésiastiques et de prélats qui
avaient eu l'occasion de connaître la Mère de Chantal et de la voir à l'œuvre.
Mgr de Sens qui avait été dépositaire de ses sentiments intimes, eut, après
[556] le décès de la Sainte, révélation de sa gloire. Après le témoignage des
évêques, citons celui du pape Urbain VIII. Ce pontife, qui avait en très-haute
estime notre digne Fondatrice, demandait souvent au Provincial des capucins si
madame de Chantal persévérait en sa sainte vie. Lorsqu'il apprit les détails de
sa mort, il s'écria : J'ai toujours pris goût à entendre parler de
cette vertueuse femme, et ce que vous me dites de sa mort est l'écho de sa vie.
Saint Vincent de Paul et le Bienheureux Pierre Fournier, si bons juges en
matière de sainteté, témoignèrent de la vénération qu'ils professaient pour la
Mère de Chantal.[93]
En effet, miracles, admiration
universelle, confiance en la protection de cette femme héroïque, tout semblait se
réunir pour appeler sur sa tête les honneurs de l'Église. Mais plus d'un siècle
devait s'écouler avant que le nom de la Mère de Chantal fut inscrit au
catalogue des Saints. Dans tous les monastères de la Visitation, si intéressés
à cette cause, bien des prières montèrent vers le ciel, à l'effet de hâter le
jour où notre sainte Fondatrice serait placée sur les autels. À ce propos, il
est un souvenir qu'on nous saura gré d'évoquer en passant : À Paray, dans
la chapelle aujourd'hui si fréquentée de la Visitation, une humble religieuse,
notre Bienheureuse Sœur Marguerite-Marie, s'adressait au Cœur de Jésus à cette
même intention.
Le dix-septième siècle tout entier
s'écoula, avant qu'on eût commencé les opérations préliminaires du procès. La
fausse interprétation donnée à une Bulle d'Urbain VIII paralysa tous les
efforts, arrêta toutes les démarches. Cette Bulle défend de procéder à la
béatification et canonisation des serviteurs de Dieu avant que cinquante ans se
soient écoulés depuis la mort de ces derniers. Or, cette prohibition regarde la
Congrégation des Rites et nullement les Ordinaires ; elle est applicable à
l'action juridique de la Congrégation romaine, et nullement aux informations
préliminaires que les évêques sont appelés à faire sur les vertus et les
miracles des personnes mortes en odeur de sainteté. On croyait faussement que
la défense était générale : de là les lenteurs et les retards. [557]
Le plus fâcheux effet de ces
retards fut de priver la cause de notre sainte Fondatrice de ses meilleurs éléments.
En effet, durant les cinquante années et plus qui s'écoulèrent entre sa mort et
l'ouverture du procès, ses contemporains, ceux qui avaient été témoins de ses
vertus et des prodiges opérés par elle, moururent les uns après les autres.
Tous avaient disparu, lorsque commencèrent les informations juridiques.
Heureusement la Congrégation des Rites admit, comme preuves suffisantes, les
dépositions des témoins auriculaires qui se présentaient comme de fidèles échos
des témoins oculaires, et aussi les témoignages écrits des contemporains.
En l'année 1704, une bonne nouvelle
arrivait à notre digne Mère P. R. Greyfié : Dans un Bref qu'il adressait à
ce 1er monastère d'Annecy, le pape Clément XI s'exprimait
ainsi : « Quant à l'ouvrage de la Canonisation de la pieuse et
dévote Mère de Chantal, laquelle a été votre première Mère et Fondatrice, et
qui vous a laissé de si belles maximes et des exemples d'une singulière piété,
nous ne doutons pas que vous ne sachiez qu'il faut mettre une cause si belle en
bon état, afin que, quand il en sera temps, on puisse l'achever selon la
lumière et le mouvement du Saint-Esprit duquel tout dépend. »
Des paroles parties de si haut
ranimèrent les espérances, inspirèrent de nouveaux efforts. L'élan était
donné ; du diocèse d'Annecy il s'étendit aux pays voisins : lettres
des évêques, des archevêques, instances des princes catholiques, des membres du
sacré collège, pétitions adressées de toute part au Saint-Siège, tant de vœux
réunis communiquèrent à la cause une impulsion décisive.
Enfin, en 1715, les procédures
s'ouvrirent à Annecy, grâce aux soins des zélées supérieures Péronne-Rosalie
Greyfié et Françoise-Madeleine Favre de Charmette. Les procédures arrivèrent à
Rome en 1719. Mais alors surgit un autre genre de difficultés, qui entrava la
marché du procès. Les rapports de la vénérable Servante de Dieu avec la mère
Angélique Arnauld de Port-Royal et l'abbé de Saint-Cyran furent allégués devant
les juges. On s'en prévalut pour faire planer des nuages sur l'orthodoxie de
notre digne Fondatrice, nuages sans consistance qui devaient s'évanouir à la
lumière d'un [558] sérieux examen ; mais encore fallait-il du temps pour
les dissiper.
Le pape Benoît XIV devait éclaircir
et écarter toutes les difficultés. Ce pontife qui avait suivi la cause dès son
début, comme promoteur de la foi, en fit son affaire personnelle et tint à
honneur de la terminer heureusement. Le 21 août 1751, il rendit un décret dans
lequel il faisait l'histoire de cette difficile procédure. Cette pièce,
monument remarquable de science ecclésiastique, était comme le prélude du Bref
de Béatification qu'attendait l'univers chrétien.
Ce Bref parut le 13 novembre 1751.
En voici la traduction :
BREF
De la Béatification de la
vénérable servante de Dieu Jeanne-Françoise
Frémyot de Chantal, Fondatrice de l'Ordre des religieuses, dites de
la Visitation de Sainte-Marie.[94]
BENOÎT XIV,
PAPE.
pour
la mémoire éternelle de la chose.
Pendant qu'au seizième siècle, l'un
des plus orageux qui ait suivi notre Rédemption, quantité d'hérésies pernicieuses,
comme autant de monstres déchaînés, infestaient l'Europe entière et la
désolaient par leurs ravages ; le Père des miséricordes, résolu d'essuyer
les larmes de son Église affligée, et d'effacer l'opprobre de son peuple, fît
en sorte, par un effet de sa bonté, que là où il y avait eu une abondance de
péché, là il y eût aussi une surabondance de grâces. Car dès ce temps
malheureux, où les erreurs, les séditions, les divisions excitaient les plus
furieuses tempêtes, voulant empocher que les portes de l'enfer ne prévalussent
contre la principale pierre de l'angle, il déploya la force de son bras, et
suscita un grand nombre de ses élus, capable de faire luire aux yeux de
l'univers les plus sublimes et les plus rares vertus, propres par la pratique
de tous les [559] devoirs du Christianisme, et par une ferveur digne des
premiers temps, à produire de nouveaux germes de sainteté, destinés également
par la force de leurs exemples et par le poids de leur autorité, à ranimer la
piété des fidèles, à réprimer les efforts des révoltés, à secourir l'Église
chancelante, d'une manière conforme à ses besoins, et à soulager son Épouse
dans l'extrême douleur, où la plongeait le péril de ses enfants.
Ce fut dans le sexe même le plus
fragile, que le Père Tout-puissant, qui choisit ce qu'il y a de plus faible
dans le monde, pour confondre ce qu'il y a de plus fort, daigna prendre le
principal instrument, par lequel il voulait donner des marques de sa Providence
bienfaisante, lorsqu'il répandit avec abondance, sur sa servante Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal, les
richesses de sa bonté et de sa grâce. Issue de parents d'une noblesse
distinguée, elle parut au monde précisément dans le temps, et à peu près dans
les lieux où les apostats voisins signalaient le plus leur cruelle rage, et
leur audace effrénée. Cependant, Jeanne-Françoise,
que Dieu avait choisie pour son héritage, qu'il avait prévenue de ses
douces bénédictions, et puissamment enrichie de la charité la plus éclairée,
releva dès ses premières années la gloire du Nom de Dieu, en s'armant contre la
malice du monde et du démon : et dans les différents âges de sa vie, dans
les différents états par où elle passa, elle crût tellement en grâce, et dans
la science de Dieu, que Saint François de Sales, qui s'est acquis tant de gloire
par le discernement des esprits, n'a pas fait difficulté d'assurer que cette
Servante de Jésus-Christ était parvenue à un si haut point de vertu et de
sainteté que, selon la mesure des grâces dont Dieu l'avait comblée, personne ne
pouvait atteindre à une plus éminente perfection.
Et certes, après avoir montré,
d'abord dans la virginité, ensuite dans le mariage, la vertu la plus accomplie,
se trouvant enfin dégagée et rendue à elle-même par le veuvage, elle se jeta
avec tant d'ardeur dans le chemin étroit de la sainteté, elle courut avec tant
de vitesse dans la voie des Commandements, qu'entre autres dons extraordinaires
du Ciel, elle s'obligea par un vœu, dont l'exécution est si pénible, de faire
toujours ce qui lui paraîtrait plus parfait et [560] plus agréable à Dieu.
Méditant ensuite de nouveaux moyens de s'élever à lui, par les conseils et sous
la sage conduite du même saint François de Sales, elle établit un nouvel Ordre
de religieuses, dites de la Visitation de Sainte Marie, qu'elle affermit solidement
dans la pratique de toutes les vertus, et qu'elle opposa courageusement, comme
une armée rangée en bataille, aux ennemis de la chasteté et de la foi : en
sorte que, pendant que ces audacieux faisaient les derniers efforts pour ruiner
le vœu religieux du célibat, et pour anéantir les lois salutaires de la
Pénitence, secondée de Dieu qui donnait l'accroissement à l'exécution d'un
dessein qu'il lui avait inspiré, elle rendait l'Église mère d'un peuple
nouveau, caractérisé par la pureté de sa foi, et par l'innocence de ses mœurs.
C'est ce qui nous fait penser qu'on
peut appliquer avec justesse à cette illustre Veuve, ce qui est rapporté de
Sainte Olympiade et de Sainte Paule, dans les anciens monuments de l'Histoire
Ecclésiastique. En effet, comme ces femmes célèbres s'attachèrent à Saint
Chrysostôme et à Saint Jérôme, pour se former à l'école de ces hommes consommés
en sagesse et en sainteté, et pour apprendre à fortifier leur foi, et à porter
des fruits de piété ; de même, Jeanne-Françoise,
par ses prières, par ses veilles, par ses travaux, fut la fidèle
coopératrice de Saint François de Sales, qui se dévouait avec un zèle
incroyable à l'agrandissement et à l'affermissement de la Religion. Car tout ce
qu'après une longue étude, et de profondes méditations, il avait pu imaginer,
comme pouvant servir à procurer la gloire de Dieu et le salut du prochain, elle
le goûta, elle s'en remplit, elle l'exécuta.
Ayant donc été un spectacle
d'admiration pour le monde, pour les Anges et pour les hommes ; après
s'être fait le plus grand nom pendant sa vie, elle a conservé dans le tombeau
même une réputation singulière de sainteté, qui ne lui a été contestée par
personne : et tous les Corps qui admiraient la doctrine de Saint François
de Sales, donnaient à une Veuve si distinguée mille bénédictions.
Les préventions de quelques
personnes ayant toutefois retardé plus qu'il ne fallait les procédures
ordinaires, et occasionné plusieurs difficultés, qui arrêtaient la
Béatification de la Servante de [561]
Dieu, et qui pendant plusieurs années ont suspendu le jugement de cette
affaire, comme Nous l'avons dit plus en détail dans le Décret que Nous avons
rendu le 21 du mois d'août dernier ; enfin, moyennant le secours
d'en-haut, après une discussion exacte de tout ce qui faisait obstacle à la
conclusion, les vertus de la Servante de
Dieu ont été reconnues pour héroïques, et les quatre miracles que Dieu a
opérés par son intercession, après avoir été plusieurs fois proposés dans la
Sacrée Congrégation des Rites, ont été approuvés par les suffrages des
Cardinaux et des Consulteurs.
Nous, donc, écoutant favorablement
les prières et les vœux qui Nous ont été adressés, tant en commun qu'en
particulier, par les Princes chrétiens, par les évêques, les Chapitres, les
Villes, et par les Religieuses de la Visitation de Sainte-Marie ; de
l'avis et du consentement desdits Cardinaux, en vertu de l'autorité
apostolique, Nous permettons, par la teneur des présentes, que cette même
Servante de Dieu, Jeanne-Françoise
Frémyot de Chantal, soit désormais appelée Bienheureuse ; que son Corps et ses Reliques soient
exposés à la vénération des Fidèles (pourvu cependant qu'on ne les porte point
dans les processions) ; que l'on expose aussi ses images ornées d'un
cercle de lumière ou de rayons ; que tous les ans, le vingt et unième jour
du mois d'août, on en récite l'Office, qui sera double, et qu'on dise la Messe
d'une Sainte, ni Vierge, ni Martyre, selon les Rubriques du Bréviaire et du
Missel romain.
Au reste, Nous ne permettons cette
récitation de l'Office, et cette célébration de la Messe, que dans les lieux
ici marqués, dans la ville de Dijon, où ladite Servante de Dieu a pris
naissance ; dans celle de Moulins, où elle est décédée ; dans celle
d'Annecy, où son corps a été inhumé, et dans tous les Monastères des
religieuses dudit Ordre : et, quant aux Messes, elles pourront être dites,
même par tous les Prêtres qui s'y rendront à cette effet.
De plus, Nous octroyons le pouvoir
de célébrer (mais seulement dans l'année, à compter de la date des Présentes)
la solennité de la Béatification de
cette Servante de Dieu, avec
l'Office et la Messe, dont le Rit sera double majeur, dans les Églises des
lieux et Monastères ci-dessus désignés, au jour qui aura été fixé par les [562]
Ordinaires ; après néanmoins que cette Solennité aura été célébrée à Rome
dans la Basilique du Prince des Apôtres, pour laquelle Nous assignons le vingt
et un du présent mois de novembre. Nonobstant toutes Constitutions, Ordonnances
apostoliques, Décrets publiés sur le culte permis et défendu, et toutes choses
à ce contraires.
Nous voulons aussi qu'aux copies
des Présentes, même imprimées, signées de la main du secrétaire de la susdite
Congrégation des Cardinaux, et scellées du sceau du Préfet de la même
Congrégation, ou de son Vice-Gérant, par tous et par tout, tant en jugement
qu'ailleurs, même foi soit ajoutée qu'aux Présentes, si elles étaient fournies,
ou montrées en original.
Donné à Rome, à Sainte
Marie-Majeure, sous l'Anneau du Pêcheur, le treizième jour de novembre, de l'an
mil sept cent cinquante et un, de notre Pontificat le douzième.
Le
cardinal Passionei.
La Béatification de notre glorieuse
et bien-aimée Mère fut célébrée, à Rome, avec une grande magnificence. L'année
suivante elle fut solennisée à Annecy, et dans toutes les maisons de l'Ordre
avec une joie d'autant plus grande que l'attente avait été plus longue.
Ce premier honneur décerné à notre Bienheureuse Mère en appelait un autre,
celui de la Canonisation. Par un Décret, donné en 1754, Benoît XIV
permit l'introduction de la cause finale. Il ne fut pas donné à ce grand
pontife d'inscrire la Bienheureuse au catalogue des Saints, d'étendre son culte
à l'univers entier. Cette gloire était réservée à Clément XIII, son successeur.
Le cardinal duc d'York fut nommé rapporteur de la cause. Cet auguste prélat, en
qui devait s'éteindre la maison royale des Stuarts, devint, à partir de cette
époque, l'ami le plus illustre de notre Ordre.
Enfin, le 16 juillet 1767, fête de
Notre-Dame du Mont-Carmel, notre digne Mère, la Bienheureuse
Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal, était proclamée sainte par Clément XIII. Voici la bulle
de Canonisation donnée par ce Pontife : [563]
BULLE DU PAPE CLÉMENT
XIII
Pour la Canonisation de la
Bienheureuse Jeanne-Françoise-Frémyot
de Chantal, Fondatrice de l'Ordre des Religieuses dites de la
Visitation de Sainte-Marie.[95]
CLÉMENT, ÉVÊQUE,
serviteur des serviteurs de dieu.
pour la mémoire éternelle de la chose.
Ainsi qu'on vit autrefois, par un
dessein admirable de la Providence divine, la force et la splendeur, qui sont
l'ornement de l'Église militante, éclater dans les Judith, dans les Débora,
dans la mère des sept Machabées, et dans toutes celles qui à leur exemple
montrèrent un courage vraiment mâle dans un sexe faible et fragile ; de
même encore depuis l'avènement du Sauveur Jésus-Christ, les voit-on briller,
ces éminentes qualités, non-seulement dans ces héroïnes de la Foi, qui ont
mérité d'être immolées pour la Religion Chrétienne, par le fer des tyrans et
des bourreaux, mais aussi dans ces illustres femmes qui se sont volontairement
sacrifiées à Dieu comme des hosties vivantes en odeur de suavité, par un
parfait renoncement à elles-mêmes, et à toutes choses créées. Par ce moyen, et
tout à la fois, la grâce du Tout-puissant se signale et triomphe par les
instruments les plus faibles et les moins éclatants dans le monde ; et la
vérité, la sainteté de l'Église Catholique, dans laquelle seule on peut espérer
le salut, acquièrent, par des preuves frappantes, une évidence toujours plus
vive. Or entre toutes les femmes fortes et illustres, la Bienheureuse Jeanne-Françoise Frémyot de
Chantal mérite un des premiers rangs, et ses actions héroïques le
prouvent. En effet, cette femme généreuse, oubliant en quelque [564] sorte la
tendresse maternelle pour se donner tout entière à Jésus-Christ dont elle avait
gravé l'adorable Nom sur sa poitrine avec un fer brûlant, n'hésita point de
franchir la barrière qui s'opposait à la rapidité de sa course vers l'Époux
céleste qu'elle avait choisi, en foulant aux pieds le corps d'un fils le plus tendrement
aimé, qui s'était étendu sur le seuil de la porte ; et se lia ensuite par
un vœu aussi sublime qu'il est difficile à remplir, de faire toujours ce
qu'elle croirait être le plus parfait. Ces traits, et beaucoup d'autres
semblables que nous allons tracer dans une légère esquisse de sa vie, chacun
pourra les reconnaître, et en les reconnaissant rendre gloire à Dieu, et
s'exciter à l'imitation d'une si haute vertu. Ainsi Dieu par une bénédiction
spéciale, ayant doué sa Bienheureuse
Servante des vertus les plus héroïques pendant sa vie, et l'ayant
glorifiée par des miracles après sa mort, afin que toutes celles qui se sont
consacrées, ou qui sont dans le dessein de se consacrer à lui, eussent un
nouveau modèle à imiter, Nous, en conséquence, après l'examen le plus exact et
le plus sévère de ces vertus et de ces miracles, comme il est de coutume, de
l'avis de nos vénérables frères les Cardinaux de la Sainte Église Romaine, des
Patriarches, et d'un grand nombre d'Archevêques et d'Évêques : statuons et
décidons que cette Bienheureuse
Jeanne-Françoise est digne du culte public de tout l'Univers Chrétien,
et qu'elle doit être mise au nombre des Saints.
Jeanne-Françoise
Frémyot de Chantal naquit à Dijon en Bourgogne, de parents
très-illustres. Douée dès sa naissance d'un naturel heureux et porté à la
vertu, elle tira le fruit le plus abondant de la pieuse et sainte éducation
qu'elle reçut ; elle montra même dès ses plus tendres années un zèle si
enflammé pour la Religion Catholique, que n'étant encore âgée que de cinq ans,
elle reprit avec autant de sagesse que de force, et couvrit de confusion un
hérétique qui raillait de la présence réelle du corps de Jésus-Christ dans
l'Eucharistie.
Attaquée quelques années après par
les artifices et la séduction d'une femme intrigante et corrompue, qu'elle
avait auprès de sa personne, elle conserva son innocence dans toute sa pureté
par le secours spécial de la Sainte Vierge, qu'elle avait prise pour sa mère
après la mort de la sienne ; par la même protection elle échappa [565]
ensuite à un péril peut-être encore plus grand. Elle était sur le point
d'épouser un gentilhomme très-riche, lorsque consultant Dieu par l'entremise de
sa Très-Sainte Mère, une lumière divine lui fit connaître que cet époux qu'on
lui destinait était infecté de l'hérésie de Calvin, quoiqu'il le dissimulât : ce danger qu'elle avait couru fit tant d'impression sur elle,
qu'elle n'y pouvait penser sans frémir d'horreur. Rendue à son père par sa
sœur, chez laquelle elle avait demeuré quelque temps, elle se conduisit à son
égard avec un respect, une docilité, une douceur, et une déférence sans égales.
Rien en elle qui ressentît le faste, le luxe, ou la légèreté d'esprit. Une rare
piété envers Dieu et la Sainte Vierge, le plus grand goût pour la prière, la
plus tendre compassion pour les pauvres furent ses vertus spéciales. Son
attrait la portait au célibat, elle préféra à son désir la volonté de son père,
qui la maria au baron de Chantal, homme
très-distingué dans le monde. Les vertus qu'elle avait apportées à ce nouvel
état devinrent encore plus éclatantes, et utiles aux autres. Sa vie toujours
active se passait à gouverner sa famille avec clémence, à attirer son époux à
l'imitation de sa piété, à visiter les malades, à secourir les pauvres, à
soulager ses vassaux, à s'occuper de Dieu et de son salut. Par ses soins, régna
dans sa maison la paix la plus profonde, et la plus heureuse tranquillité.
Il survint des adversités, sa vertu
n'en reçut que plus d'éclat. Son époux, qui lui était infiniment cher, fut
blessé à la chasse, et mourut peu de temps après de sa blessure ; elle
ressentit la douleur la plus vive de ce triste événement, mais y découvrant le
dessein de Dieu, qui voulait se l'arracher tout entière, elle se soumit à sa
sainte volonté ; et par un vœu de chasteté perpétuelle qu'elle fit devant
un autel de la Sainte Vierge, elle s'engagea à lui comme au plus parfait des
époux. Elle couronna le pardon qu'elle avait accordé de bon cœur à celui qui
sans le vouloir avait donné le coup mortel à son mari, par un trait de
bienveillance particulière, en nommant son fils sur les Fonts sacrés du
Baptême. Exemple admirable d'une perfection héroïque, au jugement du plus
équitable appréciateur des vertus : Saint François de Sales.
Quelque sainte que fût sa vie, elle
en méditait une encore plus [566] parfaite.
Pour remplir ce dessein, elle se décharge, au moins, en partie, du fardeau de
ses affaires domestiques, elle emploie à la décoration des Temples et au
soulagement des pauvres tout ce qui avait servi à sa parure. Elle réduit son
corps en servitude par les jeûnes, les cilices, les veilles. Elle distribue
tout son temps entre les devoirs de la Religion et ceux de la charité. Les
occasions de pratiquer l'humilité et la patience ne lui manquèrent pas, et elle
ne manqua pas à ces occasions. Il serait difficile de dire combien elle eut à
souffrir de mauvais traitements de la part d'une servante. On ne saurait croire
jusqu'à quel degré se portèrent l'insolence de l'une et la douceur de l'autre.
Dans ces entrefaites, son père lui propose un nouveau mariage, elle le refuse
avec fermeté ; et pour resserrer davantage les liens qui l'attachent à son
Dieu, elle a recours au plus admirable et au plus rigoureux des moyens, elle
grave sur sa poitrine, avec un fer chaud, le Nom adorable de Jésus. Tandis que
son courage la fait avancer ainsi dans le chemin de la perfection évangélique,
Dieu accorde enfin à la persévérance de ses prières le très-sage et très-saint
Directeur de sa conscience, saint François de Sales. Dès qu'elle l'eût aperçu,
ils se reconnurent mutuellement, quoiqu'ils ne se fussent jamais vus
auparavant. Avec le consentement d'un si grand maître, elle fît le vœu, si
difficile dans l'exécution, de pratiquer toujours ce qui lui paraîtrait le plus
parfait, et le plus agréable à Dieu.
Il ne lui fallait pas moins de
grandeur d'âme, pour exécuter les vues de son saint guide sur le nouvel Ordre
qu'il voulait établir par son moyen. Que d'obstacles n'eût-elle pas à
vaincre ! Entre tous, le plus grand fut peut-être celui qu'elle rencontra
lorsqu'au moment de partir pour Annecy où Dieu l'appelait, son fils, pour
s'opposer à ce qu'elle sortît de la maison, s'étendit sur le seuil de la porte.
Cette femme forte, se rappelant sans doute alors cette parole de saint
Jérôme : Pour aller à Dieu foule aux pieds ton propre père, passa
sur le corps de son fils le plus chéri. Un amour si enflammé pour Dieu était
capable d'opérer les plus grandes merveilles. Aussi bientôt, sous la conduite
de François de Sales comme sous la conduite d'un habile architecte, la Sainte
jeta-t-elle les premiers [567] fondements de l'Ordre de la Visitation, et, par
d'immenses travaux, parvint-elle, malgré les ruses du démon et la perversité
des hommes, à l'étendre en tant de différents endroits, qu'il y eut jusqu'à
quatre-vingt-quatre Monastères fondés par ses soins et par son zèle.
L'esprit de cet Institut n'a rien
de difficile ni d'austère à l'extérieur, mais il retranche tout, sans
exception, à la volonté et aux inclinations naturelles. Il ordonne, avec autant
de douceur que de force, l'entier renoncement à soi-même ; et, par cet
admirable moyen, avec le secours de Dieu, qui donne l'accroissement, il conduit
à la plus haute perfection, ainsi que nous le voyons jusqu'à ce jour avec la
joie la plus parfaite.
Outre ses travaux, la Bienheureuse
Mère visite, par ordre des évêques, d'autres maisons qui n'étaient pas de son
Ordre, et y remit la règle en vigueur. Partout où elle ne pouvait ni se
transporter, ni se faire entendre de vive voix, elle instruisait surtout les
vierges sacrées, par des lettres dont il nous reste encore un grand nombre. La
mort lui enleva ensuite ses propres parents, entre autres son fils bien-aimé et
saint François de Sales lui-même, dont les avis et la volonté faisaient son
unique règle ; mais ces coups redoublés ne l'empêchèrent pas de se livrer,
avec autant de courage qu'auparavant, aux entreprises les plus difficiles, et à
s'appliquer à les faire réussir ; et c'est ce qui lui acquit une
réputation de sagesse et de sainteté si universelle, que les personnages les
plus distingués dans tous les Ordres, et même dans l'Ordre Épiscopal, venaient
la consulter, que les Rois se recommandaient à ses prières, et que saint
Vincent de Paul lui-même lui donna les règles de son Institut à examiner et à
corriger.
Une vertu si éminente qui, quoique
démontrée au dehors par d'éclatantes actions, annonçait encore quelque chose de
plus grand dans l'intérieur (ainsi que l'admirait François de Sales, cet homme
si habile à discerner), s'éleva par degrés à une telle perfection, qu'elle
devint mûre pour le Ciel. Déjà l'événement le vérifie : la Servante de Dieu, en revenant de Paris
où l'avait appelée Anne d'Autriche et l'Évêque de Genève, tombe malade à
Moulins ; sentant approcher son heure dernière, elle y reçoit les
Sacrements de [568] l'Église avec la plus rare piété. Elle écrit à tout son
Ordre, une lettre pleine de sagesse et de charité. Enfin après avoir souhaité
les bénédictions du Ciel à toutes les Religieuses de la Visitation, présentes,
absentes et futures, au milieu des actes les plus fervents de foi, d'espérance
et de charité, elle vole vers son divin Époux le jour des Ides de décembre de
l'an 1641. La gloire dont Dieu couronna Jeanne-Françoise
fut révélée à saint Vincent de Paul. Il vit un globe de lumière se
joindre à un globe plus lumineux encore, et tous les deux se réunir et s'abîmer
dans un troisième globe infiniment plus éclatant. L'homme de Dieu, éclairé
d'une lumière surnaturelle, comprit que le premier globe désignait Jeanne-Françoise, le second saint
François de Sales, et le troisième Dieu lui-même qui habite une lumière
inaccessible.
Quoique la haute réputation de
sainteté de Jeanne-Françoise se
fût répandue presque universellement, cependant la fausse opinion où l'on était
qu'il n'était pas permis d'informer à son sujet avant cinquante ans après sa
mort, fut cause qu'on laissa écouler le temps le plus favorable pour cet objet.
Enfin, en l'année 1715, on commença à traiter de sa béatification. Alors donc,
après l'examen des évêques et celui du Saint-Siège, après l'exhibition et
l'approbation des actes de l'un et de l'autre, on agita dans la Congrégation
des Rites sacrés les questions ordinaires ; il fut clairement prouvé par
le témoignage des plus illustres écrivains, contemporains de la Servante de Dieu, et, en particulier,
par ceux de saint François de Sales et de saint Vincent de Paul, que les vertus
de Jeanne-Françoise avaient été
héroïques : mais comme après un si long espace de temps depuis sa mort, il
ne se trouvait plus de témoin oculaire, notre prédécesseur, Benoît XIV,
d'heureuse mémoire, ordonna sagement que, pour suppléer à ce défaut et afin de
terminer cette affaire, outre les deux miracles requis, on s'étayât encore de
deux autres opérés par l'intercession de la Servante de Dieu après sa
mort.
Les quatre miracles qui,
préférablement aux autres, ont été trouvés dignes d'approbation sont : 1°
Celui qui a éclaté dans la personne de Gabrielle-Angélique Morel, du Monastère
de la Visitation d'Avallon, diocèse d'Autun, qui, s'étant recommandée à la Servante [569] DE Dieu, obtint que sa jambe droite, plus
courte que l'autre d'une demi-palme et presque destituée de chaleur et de vie,
fut rétablie dans une parfaite égalité avec la gauche.
Le second miracle, est la guérison
surnaturelle d'Élisabeth Dro-nier de la Pérouse, professe du Monastère du même
Ordre, dans la ville de Saint-Amour, diocèse de Lyon. Une longue maladie
l'avait conduite aux portes de la mort, elle était abandonnée des médecins et
depuis trois mois sans aucun mouvement dans son lit ; mais ayant eu recours
à la Bienheureuse Jeanne-Françoise, tout
à coup elle recouvra une pleine santé, elle se leva sans secours et se trouva
en état de remplir tous ses exercices.
Le troisième miracle s'est opéré en
faveur d'une jeune Romaine nommée Claire de Rubeis ; une phthisie,
contractée depuis longtemps, l'avait réduite à l'extrémité ; elle avait
reçu les derniers Sacrements, elle était non-seulement aux portes du tombeau,
mais souvent on la regardait comme morte ; cependant ayant entrepris une
neuvaine à la Bienheureuse
Jeanne-Françoise pour obtenir son secours, depuis le troisième ou
quatrième jour jusqu'au neuvième, elle fut radicalement guérie ; la santé,
la couleur, l'appétit et les forces lui revinrent, et, à la vue de tout le
monde, elle sortit de sa maison et parut en public.
La quatrième guérison miraculeuse
est celle d'Eugénie Tronchon, professe de l'Ordre de la Visitation, dans la
ville de Saumur, diocèse d'Angers. Depuis la quinzième année de son âge,
pendant l'espace de huit ans, cette fille était presque suffoquée par un asthme
violent ; il lui survint en outre une paralysie qui la rendit percluse
d'un bras et d'une jambe. Après avoir passé environ quarante jours dans la plus
cruelle douleur, sans le secours d'aucun médecin, implorant seulement celui de
la Bienheureuse Jeanne-Françoise par
une neuvaine ; à la fin du dernier jour et en un instant, ses membres
paralysés ayant repris leur mouvement, elle se lève en parfaite santé, pleine
de vigueur et de force, et reprend, sans la plus légère faiblesse, ses emplois
et ses fonctions.
À ces miracles, notre prédécesseur
Benoît XIV a cru devoir en ajouter un cinquième qui, quoique revêtu de
l'autorité de l'Évêque d'Orléans, n'étant pas muni de celle du Saint-Siège, ne
pouvait être mis au nombre des miracles approuvés. Ce pontife, pour le rendre
authentique, l'a ratifié et confirmé. Cette guérison miraculeuse est celle de
Suzanne Bienfait, professe de l'Ordre de la Visitation. Un squirre monstrueux
lui causait les plus vives douleur d'entrailles ; de plus, une paralysie
cruelle privait de tout mouvement et presque de sentiment ses jambes, dont
l'une (la droite) était entièrement desséchée. Dans cet état, elle cesse
d'employer tous les remèdes et secours humains ; elle fait une neuvaine à
la Bienheureuse, et, à la fin du
neuvième jour, en un seul moment, le mouvement et le sentiment sont rendus à
ses jambes : celle qui était desséchée revint dans son état naturel. Enfin
la malade, pleine de force et de vie, se trouve en état de s'acquitter, et
remplit en effet les mêmes fonctions qu'exercent les autres religieuses qui
jouissent d'une santé parfaite.
Les vertus et les miracles de la Servante de Dieu ayant été ainsi
confirmés par l'autorité du Saint-Siège et ne restant plus de doute qui
empêchât de procéder à la Béatification de
Jeanne-Françoise, le même Benoît
XIV, notre prédécesseur, par ces lettres en forme de Bref, du 13 novembre 1751,
la déclara en effet Bienheureuse, et
lui en décerna le culte par l'Office et la Messe qu'il permit de célébrer tous
les ans en son honneur dans quelques lieux, le 21 du mois d'août, jour
anniversaire de son couronnement.
De nouveaux miracles ont suivi la
Béatification de Jeanne-Françoise
et nous ont fait clairement connaître que Dieu veut qu'on lui défère de plus
grands honneurs ; pour cet effet ayant fait examiner et discuter ces
miracles, ayant fait constater la validité des procès-verbaux qui en ont été
dressés, dans la Congrégation de nos vénérables frères les Cardinaux de la
sainte Église Romaine, qui président les Rites, et dans la Congrégation
générale tenue en notre présence le 28 janvier de l'année dernière ; les
deux que nous allons rapporter ont, entre un nombre d'autres, paru
particulièrement dignes d'approbation, ainsi qu'on le voit par notre décret du
9 mars suivant.
Le premier de ces miracles est
celui-ci : Marie Droz, religieuse [571] du Monastère de Pontarlier, de
l'Ordre de Saint-Bernard, diocèse de Besançon, étant tombée en phthisie, avait
inutilement employé tous les remèdes possibles pendant trois ans ; ses poumons
étaient gâtés, sa maladie était venue à son dernier période, tous les symptômes
annonçaient une mort prochaine, et les médecins ne lui laissaient aucune lueur
d'espérance ; mais la Bienheureuse
Jeanne-Françoise opéra ce que n'avaient pu les remèdes humains ;
invoquée avec la plus grande confiance par la religieuse qui, quoique à la
dernière extrémité, lui fit une neuvaine, elle lui rendit en un instant la
santé, et la lui rendit si parfaitement, qu'il ne lui resta aucune suite d'une
maladie si désespérée.
L'autre guérison surnaturelle est
celle d'une pauvre fille nommée Floride, ou, selon les français, Fleuries
Coing ; étant malade à l'Hôtel-Dieu de Lyon, un chirurgien inepte lui
ouvrit la veine du bras droit, et, pour en faire sortir le sang qui ne coulait pas,
il enfonça avant dans la piqûre une aiguille de fer ; son bras s'enfla et
devint si raide, qu'on ne pouvait plus le plier, ce qui fit conjecturer qu'un
nerf quelconque, ou le tendon du biceps avait été attaqué ou lacéré. Pour
guérir cette partie malade, on la perça plusieurs fois, mais il arriva que la
partie inférieure du bras se retira, et qu'elle s'attacha fortement à la partie
supérieure ; il arriva même que les doigts, retirés aussi vers le poignet,
serraient tellement la paume de la main, qu'on fut obligé de mettre, entre
deux, quelque chose qui empêchât que la paume de la main ne fût déchirée par
les ongles des doigts. Cette infortunée traîna ainsi sa vie avec un bras mort,
car il était entièrement privé de sentiment, de mouvement et de nourriture. Enfin,
étant partie pour Annecy, afin d'obtenir au tombeau de la Bienheureuse Jeanne-Françoise ce dont
elle n'avait pu être favorisée deux ans auparavant dans un pareil voyage ;
après s'être confessée et avoir communié, elle fit toucher au sépulcre de la Bienheureuse cette partie inutile de son
corps, et, subitement, ce bras mort recouvra le sentiment, le mouvement, la
carnation, la force et l'embonpoint.
Ces miracles ayant été approuvés
selon toutes les formes juridiques, on demanda, dans la même Congrégation des
Rites sacrés, [572] le 23 septembre de la même année, si on pouvait procéder
légitimement à la Canonisation solennelle de la Bienheureuse
Jeanne-Françoise ; personne ne douta que toutes les formalités
préalables n'eussent été scrupuleusement observées suivant la pratique
constante du Saint-Siège et de nos prédécesseurs : Nous, cependant, afin
de pouvoir implorer l'assistance divine, Nous avons voulu différer encore de
donner notre Décret. Mais, enfin, le 12 octobre de l'année dernière, après avoir
adressé à Dieu les plus instantes prières, adoptant l'avis de la susdite
Congrégation, Nous avons porté le Décret de
ladite Canonisation pour être
icelle faite avec les solennités requises dans le temps qui sera désigné.
Ainsi, comme l'avaient fait
prudemment, par diverses lettres écrites à nos prédécesseurs, pour l'avancement
de la canonisation de la Bienheureuse
Jeanne-Françoise, Charles VI, de glorieuse mémoire, roi et empereur des
Romains, Philippe V, roi catholique des Espagnes, Jacques III, roi d'Angleterre,
et autres princes chrétiens et électeurs de l'Empire romain, vivants
alors ; plusieurs Archevêques, évêques, les Assemblées du Clergé de
France, les chefs de différents Ordres réguliers, les chapitres des Églises,
les magistrats des villes, et surtout Victor-Amédée, aussi de glorieuse
mémoire, roi de Sardaigne ; de même encore nos chers fils en Jésus-Christ,
Louis, roi de France, très-chrétien, et Charles-Emmanuel, illustre roi de
Sardaigne, ne cessant de Nous demander le même objet par des instances réitérées,
particulièrement nos chères Filles de l'Ordre institué par la Bienheureuse même, Nous sollicitant avec
bien plus d'ardeur encore par d'humbles et de continuelles prières.
À ces causes, Nous avons jugé, avec
nos vénérables frères les Cardinaux de la sainte Église romaine, dans le
Consistoire sacré du 27 avril dernier, qu'il fallait enfin mettre à exécution
le Décret déjà porté ; et tous étant du même avis que Nous, Nous avons
appelé à cette affaire importante nos vénérables frères les Archevêques et évêques
de presque toute l'Italie, et Nous avons ordonné, afin qu'ils pussent juger
sainement, que toute la suite de la cause leur fût exposée par ordre avec
toutes les preuves des vertus et miracles de la Bienheureuse
Jeanne-Françoise, soit de vive voix, dans le Consistoire [573] public du
9 mai dernier, tenu par-devant Nous, dans lequel notre cher fils Paul-François
Antamore, avocat de Notre Cour Consistoriale, a parlé dans la cause de la Bienheureuse, soit par écrit, en faisant
délivrer à chacun d'eux une relation détaillée de tous les faits, dressée avec
exactitude d'après les actes authentiques de la Congrégation même. Ensuite Nous
avons convoqué pour le 10 du présent mois de juillet, un autre Consistoire
auquel, outre le Sacré Collège, Nous avons appelé les Patriarches, Archevêques,
évêques qui se sont trouvés à la Cour romaine, pour dire leurs avis au sujet de
la Canonisation demandée, en présence des notaires du Saint-Siège, dits
protonotaires, et les deux plus anciens auditeurs des causes de notre Palais ;
tous unanimement y ayant non-seulement souscrit par les raisons les plus
fortes, mais l'ayant aussi sollicitée eux-mêmes avec ardeur, Nous en avons fait
dresser un acte public, et, de plus, Nous avons ordonné que leurs suffrages
signés de chacun d'eux fussent recueillis et déposés au greffe de la sainte
Église romaine.
Cependant, avant que de Nous
déterminer à porter en dernier ressort notre jugement sur une affaire de cette
importance, Nous avons indiqué des jours de jeûne dans notre ville, Nous avons
accordé des indulgences à tous ceux qui uniraient leurs prières aux Nôtres, en
leur marquant pour les stations, les trois Églises Patriarchales ; Nous
avons fait faire des prières publiques à Dieu, le père des lumières, afin qu'il
voulût Nous accorder le secours de sa grâce et diriger nos démarches selon sa
voie.
Enfin, aujourd'hui, jour de la fête
de Notre-Dame du Mont-Carmel, anniversaire de notre couronnement, Nous étant
transporté solennellement avec les Cardinaux de la sainte Église romaine, les
Patriarches, Archevêques et évêques, dans l'Église du Vatican, précédé de tous
les Ordres du Clergé séculier et régulier, et de tous les Officiers de la Cour
romaine, afin d'obtenir auprès du Médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ, dont Nous sommes le Vicaire sur la terre, de nouveaux
intercesseurs qui Nous aidassent à porter le pesant fardeau du Souverain
Pontificat, sous lequel Nous gémissons, Notre cher fils Charles Rezzonico,
Prêtre, Cardinal, du titre de Saint Clément, et Camérier de la sainte Église
romaine, [574] Procureur établi à l'effet d'obtenir la Canonisation, Nous
ayant, avant que Nous célébrassions solennellement le saint Sacrifice,
représenté fortement les demandes, les prières et les vœux des Princes
chrétiens, des Évêques, des Chapitres, des Magistrats et de l'Ordre de la
Visitation, pour la Canonisation solennelle de la Bienheureuse Jeanne-Françoise, ainsi que celles des
bienheureux Jean Cantius, Joseph Cala Sanctius de la Mère de Dieu, Joseph de
Cupertin, Jérôme Émilien et Séraphin Dumont Granarius d'Asculum, après
avoir imploré auparavant l'intercession des esprits bienheureux et de tous les
Saints ; après avoir invoqué l'Esprit-Saint par l'hymne spécial que
l'Église lui adresse, en l'honneur de la sainte et indivisible Trinité, pour
l'exaltation de la Foi catholique et l'accroissement de la Religion chrétienne,
en vertu de l'autorité apostolique, Nous avons décerné et décidé que la Bienheureuse Jeanne-Françoise Frémyot de
Chantal, Fondatrice de l'Ordre de la Visitation, comblée de toutes les
vertus évangéliques et glorifiée par des miracles éclatants, est Sainte, ainsi que Jean Cantius,
Joseph Cala Sanctius, Joseph de Cupertin, Jérôme Émilien et Séraphin Dumont
Granarius d'Asculum, et qu'il faut l'inscrire au catalogue des
Saints : Avons ordonné que sa mémoire, que Nous avons révérée à la sainte
Messe qui a été ensuite par Nous, sera religieusement honorée tous les ans, par
toute l'Église, le 21 du mois d'août : Avons aussi accordé par la
miséricorde Divine, une indulgence plénière à tous les Fidèles qui sont venus à
cette grande solennité et à tous ceux qui iront tous les ans au jour susdit
visiter le corps vénérable de Sainte
Jeanne-Françoise, une indulgence de sept ans, et d'autant de
quarantaines, dans la forme accoutumée de l'Église.
Voici donc par la souveraine
Providence de Dieu, dans la seule Sainte
Jeanne-Françoise, un modèle parfait, non-seulement pour toutes les
femmes, mais pour tous les états et toutes les conditions des personnes du
sexe. Les vierges, les femmes mariées, les veuves et les religieuses trouveront
en elle un motif d'admiration et un objet d'imitation. Elle fut la gardienne la
plus fidèle de la virginité ; si elle consentit au mariage, ce fut pour
souscrire à la volonté de son père [575] aux dépens de la sienne qui s'y
opposait. Dans l'état du mariage, elle attira à la pratique de ses vertus,
non-seulement ses enfants, mais même son époux. Veuve, elle embrassa un genre
de vie plus saint, et préluda ainsi à l'institution de l'Ordre qu'elle devait
fonder. Lorsqu'elle eut obéi avec joie à l'ordre de Dieu qui l'appelait à un
état plus sublime, elle montra et aplanit, à tant de Monastères qu'elle fonda
et qui devaient être fondés dans la suite, le chemin, tout à la fois pénible et
doux, de la perfection évangélique, moins encore par les règles excellentes
qu'elle donna, que par les actes héroïques et les monuments durables de toutes
les vertus qu'elle montra.
Or, afin que ceci parvienne à la
connaissance de l'Église universelle et que la mémoire en demeure à jamais pour
la gloire de Dieu et l'exemple des Fidèles, Nous avons voulu le renfermer dans
ces présentes Lettres apostoliques, ordonnant qu'aux copies d'icelles, même
imprimées, signées de la main d'un notaire et munies du sceau d'une personne
constituée en dignité dans l'Église, même foi soit ajoutée qu'aux présentes, si
elles étaient fournies ou montrées en original.
Que nul donc, quel qu'il soit,
n'ait la témérité d'enfreindre ou de contrevenir à cet acte de notre décision,
décret, inscription, commandement, statut, concession et volonté. Et, si
quelqu'un l'osait, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu
tout-puissant et des bienheureux Apôtres saint Pierre et saint Paul.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, l'an
de l'Incarnation de Jésus-Christ 1767, le 17 des Calendes d'août, la dixième
année de notre Pontificat.
Clément, évêque de l'Église Catholique.
Et ont signé trente-trois cardinaux.
C.
Cardin, Prodataire, A. Card. Nigronus. [576]
Tous les vœux étaient comblés. Les
fêtes de Rome auxquelles présida le Souverain Pontife, revêtirent un éclat
inaccoutumé ; elles furent répétées, dans les maisons de notre Ordre, avec
toute la magnificence qu'il fut possible de déployer.
Cependant des symptômes menaçants
pour l'Église et la société commençaient à se montrer ; bientôt allait
s'ouvrir une époque de bouleversement et de ruines. La révolution, issue des
doctrines les plus fausses et les plus perverses, s'étendit de la France à la
Savoie. À Annecy, comme ailleurs, les portes des couvents furent brisées ;
nos chères Sœurs furent arrachées de leurs pieux asiles, et réduites à se
retirer sur une terre étrangère. Toutefois, elles ne voulurent point partir
sans emporter avec elles le corps de saint François de Sales et celui de sainte
de Chantal, trésor sacré auquel leur piété tenait plus qu'à tous les autres.
Déjà elles avaient atteint le château de Duingt, alors propriété de la famille
de Sales, lorsqu'on s'aperçut, dans la ville, de la disparition des Corps
saints. Les habitants d'Annecy, s'émurent et, par l'organe de la municipalité,
ils réclamèrent des Reliques auxquelles leur foi, toujours vivace, attachait le
plus grand prix. Il fallut faire droit à ces demandes. Chose étonnante !
pendant que les religieuses de la Visitation fuyaient devant la tourmente
révolutionnaire, les restes précieux de leur saint Fondateur et de leur sainte
Fondatrice rentraient en triomphe à Annecy, au son des cloches, aux
acclamations d'une foule pieuse et attendrie.
Le clergé, d'accord avec les
autorités locales, fit déposer les deux châsses dans la cathédrale. Puis, comme
les temps devenaient plus mauvais, il fallut les retirer de cette église et les
établir en un lieu plus sûr. Quatre habitants d'Annecy, dont il faut conserver
les noms :MM. Burquier, Amblet, Rochette et Balleydier, conçurent et exécutèrent
le projet de soustraire ces Reliques à tout danger de profanation. Pour cela,
ils enlevèrent secrètement les deux Corps saints et les déposèrent dans la
maison de l'un d'eux, M. Amblet, où ces restes précieux demeurèrent cachés
jusqu'en 1804. En cette année, Mgr de Mérinville, évêque de Chambéry, procéda
canoniquement à l'examen de ces saintes Reliques et en reconnut la [577]
parfaite authenticité. Mgr de Soles, son successeur, les ayant reconnues de
nouveau le 26 mai 1806, les rendit solennellement au culte public. Le corps de
saint François de Sales fut exposé dans la cathédrale, celui de sainte
Jeanne-Françoise dans l'église paroissiale de Saint-Maurice.
Dix-huit ans après, en 1824, ce
monastère d'Annecy étant restauré, grâce à la munificence du roi et de la reine
de Sardaigne,[96]
et à la générosité de nos chers monastères, nos vénérées sœurs professes de ce
premier monastère, qui avaient survécu à la tourmente révolutionnaire, furent
installées dans leur nouvel asile. Bientôt après les Corps de nos saints
Fondateurs étaient restitués à leurs légitimes possesseurs, au milieu d'un
concours immense de peuple. Ces Reliques, enfermées dans deux belles châsses,
dons de la reine Marie-Christine et de la famille de Sales, furent portées en
grande pompe dans l'église de notre monastère. Onze évêques assistaient à cette
cérémonie touchante, que les princes et les princesses de Savoie relevaient de
leur royale présence et de leur tendre piété.
Afin de perpétuer le souvenir de
cette grande manifestation, Mgr de Thiollaz, évêque d'Annecy, obtint du
Saint-Siège une indulgence plénière, à gagner, dans notre église de la
Visitation, pendant la retraite qui s'y donne tous les ans du 21 au 30 août.
Chaque année, durant ces jours de bénédiction, nous sommes heureuses de voir
des flots de pèlerins affluer dans notre sanctuaire, assiéger les tribunaux de
la pénitence, se presser à la Table Sainte. Notre chapelle est alors trop
petite pour recevoir les innombrables fidèles qui viennent se recommander à la
protection de nos grands Saints.
La châsse de saint François de
Sales est placée au-dessus du maître-autel ; c'est là qu'il repose, revêtu
des ornements épiscopaux. Le corps de notre sainte Fondatrice est placé dans la
chapelle de droite. Elle est dans sa châsse, revêtue du costume religieux de
notre Ordre. Trente lampes brûlent autour de ces précieux Corps. [578] les unes
fondées à perpétuité, les autres entretenues par la dévotion des fidèles et des
pèlerins.
Et nous, qui avons l'insigne
avantage de posséder les Corps de notre Bienheureux Père saint François de
Sales, et de notre bienheureuse Mère sainte Jeanne-Françoise de Chantal,
puissions-nous, semblables à des lampes ardentes, brûler et nous consumer
d'amour à l'ombre du sanctuaire, au pied du saint autel !
Textes latins
Breve beatificationis
Ven. Servæ Dei Jo. Franciscæ Fremyot de Chantal, Ordinis
Monialium a Visitatione Sanctæ Mariæ nuncupatarum Fundatricis.
BENEDICTUS PAPA XIV
Ad
perpetuam rei memoriam.
Cum sexto decimo salutis nostræ turbulentissimo seculo tot per
universam Europam, tamque nefaria haeresum monstra longe, lateque omni impetu
irruerent, et grassaretur ; maerentis Ecclesiæ lacrymas, et opprobrium
Populi sui ut Pater misericordiarum abstergeret, fecit in bona voluntate sua,
ut, cum abundaverit delictum, superabundaret et gratia. Per illa enim tempora,
dum omnia maximis errorum, seditionum, et discordiarum fluctibus, et procellis
jactabantur ; ne contra summum angularem lapidem Portæ Inferi
praevalerent, in brachio extento suscitavit quamplurimos Electorum suorum, qui
eximiis, clarissimisque virtutibus Orbi Terræ illucescerent, et per illustria
veteris disciplinæ exempla, in quibus Christianæ legis partes omnes
exprimerentur, nova Sanctitatis germina procrearent, quorum ope, et
auctoritate, Fidelium pietate aucta, et Perduellium conatibus fractis, atque
compressis, inclinatis Ecclesiæ rebus, opportunum adhiberetur auxilium,
Sponsæque suæ acerbissimi luctus tanto in discrimine allevarentur.
Beneficentissimæ hujus Providentiae præcipuum specimen, etiam in sexu fragili
Pater Omnipotens, qui infirma Mundi eligit, ut fortia quæque confundat,
ostendere dignatus est, dum in Famulam [580] suam Joannam Franciscam Fremyot de Chantal divitias bonitatis et
gratiæ suæ uberrime effudit. Haec enim nobilissimis orta Parentibus, ea
potissimum tempestate in lucem prodiit, iisque in locis prope versata est in
quibus transfugarum finitimorum immanis rabies, et furens audacia in Catholicam
Fidem magis efferata videbatur ; nihilominus Joanna Francisca a Deo sibi in hæreditatem electa,
benedictionibus dulcedinis præventa, et luminosissimae charitate efficaciter
ditata, vel a primis temporibus contra Mundi, et Diaboli nequitias Domem Domini
exaltavit, et per nomes ætates, variasque vitæ vicissitudines adeo crevit in
gratia, et scientia Dei, ut Sanctus Franciscus Salesius spirituum probatione
longe clarissimus pronunciare non dubitaverit, eo Sanctitatis, et virtutis
processisse Ancillam Christi, ut pro ratione, et modo gratiarum, quibus a Deo
erat locupletata, nemini unquam assurgere altius liceret. Et sane, quæ tum in
virginitate, tum Viro conjuncta egregia summæ perfectionis indicia præbuerat,
in solitudine demum, ac viduitate posita, tanta spiritus alacritate artissimum
Sanctitatis iter arripuit, et in via mandatorum cucurrit, ut præ cæteris
Divinis Charismatibus arduum illud emiserit Votum, semper faciendi, quidquid
perfectius, Deoque gratius, et acceptius fore intelligeret : Hinc novas in
corde suo ascensiones disponens, eodem Sancto Francisco Salesio optimo duce, et
Auctore, novum instituit Sanctimonialium ordinem a Visitatione Sanctæ Mariæ
nuncupatarum, quas, alte jactis omnium Virtutum fundamentis, Castitatis, et
Fidei hostibus impudentissimis, velut aciem ordinatam in conspectu inimicorum
fortiter opposuerit, ut, dum illi fumma vi, impetuque contenderent, quo
Religiosum Christiani cœlibatus propositum funditus everterent, et paenitentiae
saluberrimas leges penitus abnegarent, nova integritatis, et innocentiæ prole,
Deo afflante, et incrementum præbente, Ecclesiam fœcundaret. Quapropter
praestantissimae huic Viduæ satis convenire arbitrandum est, quod de Sanctis
Olympiade, et Paulla veterum [581] sacrarum rerum literis tradita monumenta
testantur. Quemadmodum enim Chrysostomo, et Hieronymo, sapientissimis et
sanctissimis Viris nobilissima ? hujusmodi Fœminæ ad Fidei praesidium, et
pietatis fructum et aemulatione instituendae adhaeserunt ; sic Sancto
Francisco Salesio augendae et confirmandæ Religionis studiosissime ; Joanna Francisca precibus, vigiliis, et
laboribus praesto fuit. Quidquid enim ille longo studio, et diuturna
meditatione in Dei cultum, et Proximorum salutem complecti poterat, hoc illa
libavit, didicit, atque perfecit. Facta igitur spectaculum Mundo, Angelis, et
Hominibus, quæ, dum viveret, magnum sibi nomen comparaverat, postquam cessit e
vita, singularem Sanctitatis famam undcquaque est consecuta, universique
hominum coetus, qui Sancti Francisci Salesii doctrinam admirabantur,
probatissima ! » hanc Viduam benedicentes benedicebant. Verum, cum
inani quorumdam opinione diutius, quam par erat, ordinum processus dilati
essent, hinc quamplurimæ difficultates subortæ sunt, quæ Famulae Dei
Beatificationi maxime obsistebant, quæque ipsius causam per plures annos sunt
remoratæ, ut in Nostro Decreto, quod die xxi. Augusti proxime elapsi emisimus,
latius apparet, nihilominus divina tandem ope, quæ contra faciebant,
accuratissime enodatis, famulae Dei Virtutes in gradu heroico, et quatuor
Miracula a Deo ipsius intercessione edita in Sacrorum Rituum Congregatione
pluries proposita, tum Cardinalium, tum Consultorum Suffragiis approbata
fuerunt. Nos itaque communibus, et peculiaribus Christianorum Principum,
Episcoporum, Capitulorum, Civitatum, ac Sanctimonialium a Visitatione Beatae
Mariæ nuncupatarum precibus, et votis annuentes, nec non de memoratorum
Cardinalium consilio, et assensu, auctoritate Apostolica tenore praesentium
indulgemus, ut eadem Serva Dei Joanna
Francisca Fremyot de Chantal in posterum Beatæ
nomine nuncupetur, ejusque Corpus, et Reliquae venerationi Fidelium,
(non tamen in processionibus circumferendæ) exponantur ; [582] Imagines quoque radiis, seu splendoribus exornentur, ac de ea sub ritu
duplici recitetur Officium, et Missa celebretur nec Virginis, nec Martyris
singulis annis, juxta Rubricas Breviarii, et Missalis Romani die vigesima prima
Augusti. Porro recitationem Officii, ac Missae celebrationem hujusmodi fieri
concedimus in locis tantum infra scriptis, in Civitate Divione, in qua dicta
Serva Dei ortum habuit, ac in Oppido Molinis, in quo efflavit Animam, nec non
in Oppido Annecii, in quo ejus Corpus humatum remansit, ac in singulis
Monasteriis Monialium dicti Ordinis ; et quantum ad Missas attinet, etiam
a Sacerdotibus confluentibus. Praeterea primo dumtaxat anno a datis hisce
litteris inchoando in Ecclesiis locorum, ac Monasteriorum praedictorum solemnia
Beatificationis ejusdem cum Officio, et Missa sub ritu duplici majori, die ab
Ordinariis constituta, postquam tamen in Basilica Principis Apostolorum de Urbe
celebrata fuerint ejusmodi solemnia, pro qua re diem xxi. mensis Novembris
currentis assignamus, pariter celebrandi facimus potestatem. Non obstantibus
Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, ac Decretis de, et super non
cultu editis, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut ipsarum praesentium
Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu Secretarii
supradictae Congregationis Cardinalium subscriptis, et sigillo Praefecti, seu
Pro-Præfecti ejusdem Congregationis munitis eadem prorsus fides ab omnibus, et
ubique tam in judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis praesentibus
haberetur, si forent exhibitae, vel ostensæ. Datum Romae apud Sanctam Mariam
Majorem sub Annulo Piscatoris die. xiii
Novembris mdccli. Pontificatus
Nostri Anno Duodecimo.
D. Card. Passioneus
Litteræ decretales
CLEMENTIS XIII
litteræ decretales
Super Canonisationem Beatæ Joannæ Franciscæ Fremyot de Chantal, Ordinis Monialium a Visitatione Sanctæ Mariæ
nuncupatarum Fundatricis.
CLEMENS EPISCOPIS
servus servorum dei
Ad perpetuam rei memoriam.
Fortitudo et decor indumentum militantis
Ecclesiæ, admirabili sane divinæ providentiae consilio, quemadmodum se prodidit
in Juditha, in Debora, in Matre septem Machabaeorum, et siquæ aliæ extiterunt
similes harum, quæ fœmineæ cogitationi masculinum animum inseruerunt ; ita
et post Christi Salvatoris adventum elucet maxime, non modo in iis fœminis, quæ
pro christiana Religione per Tyrannos, et Carnifices mactari meruerunt, sed in
illis etiam, quæ ipsæ se, perfecta sui rerumque omnium abdicatione, vivas
hostias in odorem suavitatis immolaverunt. Hoc pacto nimirum, et Omnipotentis
Dei gratiæ virtus per ea, quæ ignobilia, atque infirma sunt mundi,
splendidissime apparet, et Catholicas Ecclesiæ, in qua unica salutis spes est,
sanctitudo, et veritas argumentis minime obscuris pulcherrime confirmatur.
Atque in hac profecto illustrium, ac fortium Fœminarum classe collocandam vel
in primis esse, Beatam Joannam Franciscam
Fremyot de Chantal. singularia illius strenue gesta declarant. Illa enim
materni veluti affectus [584] immemor, ut Christo Jesu, cujus adorandum nomen
candente ferro pectori impresserat, totam sese dicaret, per filium, quem unice
diligebat, in ostio domus strato corpusculo haerentem ad electum sibi cœlestem
Sponsum pergere non dubitavit, et voto se arduo, ac perdifficili obstrinxit, ut
ageret ea semper, quæ perfectiore esse intelligeret. Quæ quidem, atque alia id genus in subjecta
ipsius vitæ compendiaria descriptione recognoscere quivis faciie poterit, tum
ad Dei Omnipotentis laudem et gloriam, tum ad imitationem, tam eximiae,
consummatæque virtutis. Itaque quum singularis Dei Benedictio Beatam hanc
famulam suam heroicis virtutibus apprime insignem, et consequentibus obitum
ejus miraculis valde gloriosam reddiderit, ut iis potissimum fœminis, quæ se
Deo dicaverunt, vel in ejusmodi deliberatione versantur, nova semper suppetant
ad imitandum exempla ; Nos propterea post eam, quæ praemitti solet, tum
virtutum illius, tum miraculorum severam, ac sedulam disquisitionem, adscitis
in consilium Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus, praeterea
Patriarchis, plurimisque Archiepiscopis, et Episcopis eamdem Beatam Joannam Franciscam publica totius
Christiani Orbis veneratione dignam, asserimus, et Sanctorum fastis
adscribendam decernimus.
E clarissimis Parentibus, Divione in Burgundia, Joanna Francisca Fremyot de Chantal ortum habuit. Piæ
sanctæque educationis fructum tulit, quem debuit, a puellae indole ad virtutem
nata. Catholicae Religionis jam inde teneris annis tanto erat incensa studio,
ut quintum aetatis annum nondum excedens haereticum quemdam adversus veritatem
Corporis Christi in Eucharistia cavillantem sapienter, atque animose redarguens
pudore suffunderet. Tentata dolosis artibus a vaferrima, quæ domi erat,
muliere, innocentiam non sine peculiari ope Deiparæ Virginis, quam defunctae
Genitricis loco Matrem delegerat, incontaminatam servavit. Aliud quoque gravius
fortasse periculum ejusdem B. Virginis auxilio evasit incolumis. Quum enim
[585] de connubio illius ageretur cum Equite nobili sane, atque opulento, Deum Joanna Francisca per Matrem ejus
Sanctissimam consulens, Calviniana, illum, tametsi dissimulata, hæresi
infectum, Deo illustrante, cognovit ; quo illa periculo ita commota est,
ut vel recordationem illius refugeret animus, ac perhorresceret. A sorore, apud
quam aliquandiu fuerat, Patri reddita, ita se illi obsequentem, docilem,
suavem, morigeram praebuit, ut nihil supra. Nihil in ea quod delicias, quod
luxum, quod levitatem animi redoleret. Pietas in Deum, ac Deiparam eximia,
summum precandi studium, misericordia in pauperes singularis. Voluntati suæ,
qua libentius ad vitam cœlibem ferebatur, paternam præponens nobilissimo viro
in temporalibus Domino de Chantal nuptui
se dari non recusavit. Præclaræ illæ, quas ad matrimonium attulerat, virtutes
magis magisque in aliorum quoque utilitatem redundarunt. Clementer enim
familiam regere, filios sancte educare, virum ad pietatis suæ imitationem
adducere, invisere ægros, egentibus subvenire, subditis opitulari, Deo, et sibi
vacare, hæc illius erat vitæ ratio laboriosa semper, numquam otiosa. Cujus
quidem solicitudinis fructus erat summa in domo pax, summa tranquillitas.
Sed adversæ res inciderunt, quibus tam præclara
ista in secundis virtus longe splendidior effulsit. Vulnerato enim inter
venandum, et paulo post extincto viro, quem carum imprimis habebat, casum
quidem acerbissimum dolenter tulit, sed in eo consilium Dei, qui totam sibi
deposceret, animo reputans, sanctissimae illius voluntati acquievit, ac
præterea, ad Aram Beatissimæ Virginis, Deo, meliori utique Sponso, votum
nuncupans perpetuæ castitatis, se obstrinxit. Illi autem, qui viro ipsius,
tametsi imprudens, lethale vulnus inflixerat, non modo veniam libenter
indulsit, sed in argumentum eliam peculiaris benevolentiæ illius Filium e sacro
fonte suscepit. Qua quidem in re, æquissimo virtutum aestimatore S.
Francisco Salesio teste, heroicæ perfectionis exemplum edidit plane admirandum.
[586]
Quum autem perfectius adhuc, atque excellentius
meditaretur vitæ genus, rei familiaris sarcina magna ex parte deposita, mundi
muliebris quidquid erat pretiosum, partim in levamen pauperum, partim in
ornatum Templorum convertit. Ad redigendum in servitutem corpus jejunia,
cilicia, vigilias adhibet. Tempus omne Religionis inter, ac misericordiae
officia partitur. Demissionis,
ac patientiæ neque illi occasio, neque occasioni ipsa defuit. Dici vix potest,
quot quantasque ab Ancilla injurias pertulerit. Summa erat prorsus, ac
pene incredibilis in altera contumacia, in altera mansuetudo. Novis inter hæc
oblatis a Patre nuptiis constantissime recusatis, ut propositum, quo totam se
Deo mancipaverat, magis magisque firmaret, pulcherrime quidem, sed asperrimo
invento, adorabile Jesu nomen candente ferro pectori impressit. Tam strenue in
suscepto evangelicæ perfectionis itinere progredienti datus est tandem, quem
diuturnis a Deo precibus expetiverat, sapientissimus item, et sanctissimus
conscientiæ moderator Sanctus Franciscus Salesius, quem ut primum aspexit,
mutuo sese agnoverunt, quum antea de facie non nossent. Probante itaque tanto
Magistro votum illud maxime arduum edidit, semper id exequendi, quod
perfectius, atque acceptius Deo esse intelligeret. Neque vero minus firma opus
erat fortitudine animi, ut ea perficeret, quæ de novi Ordinis fundatione a
Salesii Magisterio didicerat. Multæ enim, et graves superandæ fuerunt
difficultates : quas inter fortasse illa maxima, quod quum Filius strato
per januam corpore intercludere aditum Matri tentasset, ne Annecium profectum,
quo divinitus vocabatur, domo pedem efferret, strenua mulier recogitans forte
illud Hieronymi : Per calcatum perge patrem : super Filium transiit,
quem eximie carum habebat. Quid autem incensa caritas possit efficere statim
apparuit. Salesio enim velut Architecto prima jecit fundamenta Ordinis
Sanctimonialium a Visitatione Beatæ Mariæ Virginis nuncupati, quem obnitente
frustra Dæmonum, perversorum hominum fraude, [587] tametsi non sine magnis
exantlatis laboribus, multis ac diversis in locis ita propagavit, ut quatuor
supra octoginta monasteria ipsius opera, et studio fundata numerarentur. Hujus
autem Ordinis institutio, tametsi nihil austerum præseferat, dum tamen
voluntati, atque humanis affectionibus nihil quidquam, quod libitum fuerit,
indulget, rerumque omnium abdicalionem, et omnimodam sui abnegationem fortiter
simul, et suaviter praecipit ; ad perfectionem summam, quemadmodum, Deo
incrementum dante, ad hanc usque diem non sine animi nostri jucunditate
conspicimus, mira quadam ratione perducit. Jussu praeterea Episcoporum alia non
sui Ordinis Monasteria visitans labentem in iis disciplinam restituit. Ubi autem præsens voce non poterat, per
litteras, quæ extant bene multæ, sacris potissimum Virginibus praesto erat. Mors deinde
consanguineorum, in iisque Filii dulcissimi, sed Francisci Salesii potissimum,
a cujus nutu, consiliisque pendebat, virilem illius animum adeo non fregit, ut
nihilo secius quam antea ardua quæque adoriri, ac perficere conaretur. Quibus
rebus in eam sapientia ;, et Sanctitatis opinionem apud omnes venit, ut ex
ordine quovis, eliam Episcopali, Joannæ
Franciscæ consilia expeterent principes Viri, ac Reges illius se
precibus commendarent, et Sanctus ipse Vincentius de Paulo Instituti sui leges
eidem examinandas, et corrigendas traderet.
Tam excellens virtus, quæ quamvis per tot præclare
gesta sese prodiderat, majus tamen aliquid, quam quod exterius patebat, latere
intus indicabat (ita quidem, ut Salesio ipsi optimo rerum æstimatori
admirationi esset) ad eum perfectionis apicem pervenerat, ut matura jam cœlo
esset. Itaque quum Famula Dei Parisiis rediens, quo jussu Episcopi Gebennesis,
ab Anna Austriaca expetita, sese contulerat, Molini in morbum incidit, e quo
instare sibi supremam diem intelligens, Sacramenta Ecclesiæ pie sancteque
suscepit. Epistolam mox dedit ad omnes sui Ordinis Alumnas, caritatis, ei
sapientiae [588] plenam. Cunctis demum præsentibus, absentibus, futuris etiam
Instituti sui Monialibus a Deo fausta omnia precata fervidos inter fidei, spei,
caritatis actus ad amplexum sponsi sui cœlestis, quem unice semper dilexerat,
feliciter convolavit, Idibus Decembris Anni MDCXLI. Eximiam Joannæ Franciscæ gloriam declaravit
visus a S. Vincentio de Paulo splendescens globus alteri mox adjunctus
splendidiori, atque alius demum longe supra quam dici potest lucidissimus, qui
utrumque sibi commixtum excepit. Intellexit enim superno lumine perfusus Vir
Dei, in primo illo globo Joannam
Franciscam, in altero Sanctum Franciscum Salesium, in tertio vero Deum
ipsum, qui lucem inhabitat inaccessibilem, designari.
Tametsi autem de Joannæ
Franciscæ sanctimonia fama esset percelebris, ex inani tamen opinione
quadam, quod ante quinquagesimum annum inquiri de ea non liceret, factum est,
ut tempus ad eam rem opportunius elaberetur : donec tandem anno mdccxv. coeptum est agi de illa in
Beatorum numerum referenda. Instituto igitur ex eo tempore duplici examine,
Episcopali scilicet, et Apostolico, atque utriusque actis exhibilis, et
approbatis in Congregatione Sacrorum Rituum, quaestiones, quæ solent, habitæ
sunt. Testimonio deinde clarorum Scriptorum, qui coœvi erant Servæ Dei, ac potissimum S. Francisci
Salesii, et S. Vincentii a Paulo, heroicas fuisse Joannæ Franciscæ virtutes satis aperte probatum est. Sed
quum testis illarum de visu, tam longo post ab obitu illius intervallo, nemo
unus reperiretur, ad rem expediendam felic. record. Benedictus XIV. Prædecessor
Noster sapienter præcepit, ut accederet adminiculum ex aliis duobus præter duo
requisita miraculis per invocationem Servæ
Dei post mortem patratis.
Et quidem quatuor præ ceteris probatu digna reperta sunt. Primum exhibuit
Gabriella-Angelica Morel in monasterio Visitationis Abalonensi Diœcesis
Augustoduni, cui, quum Servæ Dei se
commandasset, crus dexterum semipalmo brevius altero, ac [589] pene
succi, et caloris expers, ad omnimodam cum sinistro æqualitatem redactum fuit.
Secundam divinitus factam
sanationem experta fuit Elisabeth Dronier de Ia Perousse professa ejusdem
Ordinis Visitationis in Oppido de Saint Amour, quod est in Dioecesi Lugdunensi,
quæ ex diutini morbi vi semimortua, atque a medicis destituta, cum per tres
menses immobilis in lectulo decumberet, ad Beatam
Joannam Franciscam confugiens, momento temporis sospes, integra, et
consuetis omnibus ministeriis apta e lecto prosiluit.
Tertium miraculum patratum est in
Clara de Rubeis puella Romana, quæ contracta phtisi eo deducta, ut munita
extremo Sacramentorum praesidio jamjam moritura videretur, immo etiam aliquando
haberetur pro mortua, sed, quum proposito sibi dierum novem obsequio Beatæ Joannæ Franciscæ opem posceret, a
tertio, vel quarto usque ad diem nonum, depulsa vi morbi, convalescens, colore,
orexi, viribus redditis, domo egressa in conspectum omnium prodierit.
Quarta miraculosa sanatio contigit
Eugeniæ Trochon Professæ Ordinis Visitationis in Civitate Salmuriensi
Andegavensis Diœcesis. Hæc a quintodecimo ætatis anno gravissimo per octo annos
asthmate pene præfocata, dein correpta paralysi, quæ brachio, et cruri motum
ademit, et magna ex parte sensum imminuit, post dies ferme quadraginta infestæ
hujus ægritudinis, nulla adhibita Medicorum ope, Beatæ Joannæ Franciscæ novendiali cultu sese commendans,
postrema nundum elapsa, die, momento temporis affectorum membrorum motu
redintegrato, sana surgit, ac vigens, et munia facile repetit, quæ solebat.
Sed quintum etiam miraculum
addendum duxit laudatus Prædecessor Noster Benedictus XIV, quod quidem quamvis
satis testatum esset auctoritate Episcopi Aurelianensis, quum tamen Sedis
Apostolicæ auctoritate destitueretur, adeoque idoneum non esset, ut probata
inter miracula referretur, idem Pontifex, hoc vitio sublato, ratum habuit, et
confirmavit. [590] Sanatio porro
ita se habuit. Susanna Bienfait
Professa Ordinis Visitationis scirroso tumore non sine acri dolore, et cruciatu
viscerum laborabat. Huc accessit paralysis, quæ cruribus, quorum dexterum etiam
ex atrophia exaruerat, motum omnem, et sensum penitus intercepit. Humanis
itaque per menses duos remediis abstinens Beatæ
Joannæ Franciscæ consueta novem dierum prece implorat auxilium. Labente
adhuc die nona puncto temporis, motu, sensu, et carne praeterea cruri arido
restitutis, vivida, et vigens ministeriis omnibus fungi potuit, quibus cæteræ
Moniales bene valentes, atque integra ? fungebantur.
Quum itaque virtutibus et miraculis auctoritate Apostolica confirmatis
nullum jam dubium superesset, quin ad formalem Servæ
Dei Joannæ Franciscæ Beatificationem procedi posset, idem Benedictus
Prædecessor die xiii. Novembris
Anni Domini mdccli, per suas
litteras in forma Brevis illi tanquam Beatæ
cultum decrevit, Officio, et Missa quotannis die xxi, mensis Augusti, qua solemnia Coronationis suæ
recurrebant ad ejus honorem certis in locis concessa.
Nova post indultam Joannæ
Franciscæ venerationem miracula sequuta sunt, quæ manifestam de augendo
eidem cultu voluntatem Dei declararunt. Quibus, cognita prius Processuum
validitate, in Congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romanæ
Ecclesiæ Cardinalium, quæ Sacris Ritibus præest, ad examen vocatis, atque
discussis, ex aliis pluribus, quæ ferebantur, in generali simili Congregatione
coram Nobis die xxviii. Januarii
anni proxime praeteriti coacta, duo haec quæ sequuntur speciali approbatione
digna comperta sunt, prout ex Decreto Nostro die ix. subsequentis mensis Martii apparet.
Miraculum primum ejusmodi est. Maria Droz Sanctimonialis in Monasterio
Pontis Aurelii Bisuntinæ Diœcesis, Ordinis S. Bernardi, phtisi laborans,
tentatis frustra per triennium remediis ad eam depellendam, eo jam devenerat,
ut ob vitiatos [591] pulmones, morbumque, ut ajunt, jam confirmatum,
indicia ferme omnia lethalem exitum proderent mox imminentem, ac propterea
Medicorum judicio recuperandae valetudinis spes nulla relinqueretur. Sed quæ ab
humaniis remediis obtineri non poterat, B. Joanna
Francisca, cui Monialis magna cum fiducia tametsi morti proxima se
commendarat, peracta novendiali supplicatione, momento temporis ei valetudinem
reddidit, atque ita reddidit, ut nulla prorsus deplorati jam morbi vestigia
superesset.
Altera supra vires naturae sanatio
contigit in paupercula quadam Virgine, cui nomen Florida, sive, ut Galli
loquuntur, Fleuries Coing. Huic enim, dum in Lugdunensi Nosocomio im peritus
Chirurgus brachii dexteri venam incidit, atque ad lieciendum sanguinem e
foramine non fluentem acum ferream profundius immittit ; laeso, aut
scisso, ut opinio fuit, bicipiti nervo, vel alio quopiam, protinus brachium
intumuit, obriguitque ita, ut flecti nullo modo posset. Huic incommodo occursum
est forata miseræ Virgini non semel affecta parte, sed eo factum est, ut
brachii pars inferior contracta superiori velut affixa cohaereret, itemque
digiti in pugnum coacti palmam arctius premerent, ut proinde medium aliquid
interponi oportuerit, ne palma digitorum unguibus laederetur. Per quinquennium
infelix vitam traxit emortuo brachio, sensus quippe omnis, et motus, et
nutritionis experte, donec Annecium profecta, ut ad Beatæ Joannæ Franciscæ tumulum, quod biennio ante eodem
itinere frustra emenso obtinere nequiverat, accederet, ubi ut primum expiata
Sacramento Pœnitentiæ, et Sanctissimo Christi Corpore refecta, ac spei plena
inutilem illam corporis partem B. Joannæ
Franciscæ admovit Sepulchro, protinus emortuum brachium revixit momento
temporis, sensu, motu, carne, viribus restitutis.
His igitur rite approbatis, quum in eadem generali Sacrorum Rituum
Congregatione die xxiii.
Septembris ejusdem anni [592] habita, proposita fuerit quæstio, an tuto ad
solemnem Beatæ Joannæ Franciscæ Canonizationem
procedi posset, nemini dubium fuit, quin juxta constantem praxim Apostolicæ
Sedis, et Prædecessorum Nostrorum, decreta omnia ad hujusmodi effectum abunde
suppeterent, Nos vero Decreti editionem, ut divinam imploraremus opem, differre
voluimus, sed demum die xii. Octobris proxime præteriti post fusas ad Deum
humillimas preces, eorum sententiam ratam habentes, Decretum protulimus de
eadem Canonizatione servatis servandis quandocumque peragenda.
Quemadmodum autem alias clare memoriae Carolus VI.
Romanorum Rex in Imperatorem electus, et Philippus V. Hispaniarum Rex
Catholicus, ac Jacobus III. Rex Angliæ, aliique tunc in humanis agentes
Christiani Principes, Romanique Imperii Electores, ac plurimi Archiepiscopi, et
Episcopi, Comitia præterea Cleri Gallicani, Ordinumque aliorum Regularium
Præsides, Capitula quoque Ecclesiarum, et Civitatum Magistratus, præcipue vero
clarae etiam memoriæ Victorius Amedeus dum viveret Sardiniæ Rex, datis
propterea litteris apud Prædecessores Nostros, progressum Causæ Canonisationis Beatæ Joannæ Franciscæ enixe
poscentibus : ita quoque Charissimi in Christo Filii Nostri, Ludovicus
Galliarum Rex Christianissimus, et Carolus-Emanuel Sardiniæ Rex Illustris iteratis
ob eam rem votis instare non desierunt. Dilectæ vero in Christo Filiae
instituti ab Joanna Francisca Ordinis
Alumnæ multo enixius assiduis, demissisque precibus postulabant.
Quocirca visum est Nobis cum Venerabilibus etiam
Fratribus Nostris ejusdem S. R. E. Cardinalibus in Consistorio Secreto die xxvii, proxime præteriti mensis Aprilis
habito editum Decretum exequutioni tandem esse mandandum : iisdemque
omnibus in affirmantem sententiam convenientibus, Venerabiles itidem Fratres
Nostros Archiepiscopos, et Episcopos ex tota ferme Italia ad gravissimum hoc
negocium advocavimus, [593] eorumque judicio seriem Caussæ, atque omnia, quæ de
virtutibus et miraculis Beatæ Joannæ
Franciscæ probata fuerant, tum oretenus in Consistorio publico die ix. mensis Maji proxime elapsi coram
Nobis coacto, in quo Dilectus Filius Paulus Franciscus Antamorus Nostræ
Consistorialis Aulæ Advocatus in ipsius Beati ;
caussa peroravit, tum etiam in scriptis exponi mandavimus, tradita nempe
singulis distincta gestorum omnium relatione, ex authenticis Documentis ipsius
Congregationis religiose desumpta ; quibus praemissis aliud Consistorium
sub die x. currentis mensis Julii convocavimus, in quo praeter S. R. E.
Cardinalium præfatorum Collegium, Patriarchas, Archiepiscopos, et Episcopos in
Romana Curia præsentes sedere jussimus, ut adstantibus Apostolicæ Sedis
Notariis, Prothonotariis nuncupatis, et duobus antiquioribus Causarum Palatii
Nostri Auditoribus super expetita B. Joannæ
Ffanciscæ Canonizatione sententiam suam aperirent. Cumque omnes unanimes
pro Suprema ipsius Beatæ glorificatione
non assensum modo validis rationibus roboratum, sed enixa etiam studia, et vota
obtulissent, Nos quidem ea de re ab Apostolicæ Sedis Notariis publica
Instrumenta confici, ac præterea prolatorum suffragiorum exempla a singulis
subscripta colligi, et in Tabularium S. R. E. referri mandavimus.
Priusquam tamen ad ferendam tanti momenti
sententiam adduceremur, indiciis per Urbem generalium jejuniorum diebus,
designatisque ad supplicationes tribus Patriarchalibus Urbis Basilicis cum
Indulgentia ab iis consequenda, qui Suas cum Nostris obsecrationibus
jungerent ; publicas Ecclesiæ preces apud Deum Patrem luminum
interponendas curavimus, ut ad dirigendos sensus nostros juxta viam suam,
gratiæ suæ opem, et auxilium Nobis impediretur.
Demum hac die Beatæ Mariæ Virgini de Monte Carmelo
dicata, qua Coronationis Nostræ
solemnia redeunt, ut ad impositum Nobis gravissimum Supremi Pontificatus
onus, quo valde [594] premimur, sustinendum, novos adhuc apud mediatorem Dei et
hominum Jesum Christum, cujus Vicarias vices gerimus in terris, Intercessores
obtineremus ; in Vaticana Basilica, ad quam solemni ritu Nos praecesserunt
omnes Cleri Sæcularis, et Regularis Ordines, omnia Officialium Romanæ Curiæ
Collegia, cum S. R. E. Cardinalibus, Patriarchis, Archiepiscopis, et Episcopis,
antequam Sacrosanctum Sacrificium solemniter celebraremus, exhibitis Nobis
iterum iterumque a dilecto filio nostro Carolo Tituli Sancti Clementis S. R. E.
Presbytero Cardinali Rezzonico nuncupato ipsius S. R. E. Camerario, pro
Canonisatione impetranda Procuratore constituto, Christianorum Principum,
Antistitum, et Capitulorum Ecclesiarum, Magistratuumque, ac Ordinis
Visitationis postulationibus, precibus, et votis pro ipsius Beatæ Joannæ Franciscæ, quemadmodum
etiam pro Beatorum Joannis Cantii,
Josephi Calasanctii a Matre Dei, Josephi a Cupertino,
Hieronymi Æmiliani, et Seraphini a Monte Granario, ab asculo denominati, solemni
Canonisatione ; et implorata prius cælestium Spirituum, et Sanctorum
omnium intercessione, atque speciali Hymno Paraclyto invocato Spiritu ; ad
honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catholicæ, et
Christianæ Religionis augmentum, de concessa Nostræ humilitati Apostolicæ
auctoritatis plenitudine, ipsa Beatam
Joannam Franciscam Fremyot de Chantal Ordinis Visitationis Beatæ Mariæ
Virginis nuncupati Fundatricem, omnibus evangelicis virtutibus cumulatissimam,
et miraculorum testimonio gloriosam, una cum dictis Joanne Cantio, Josepho Calasanctio, Josepho Cupertino, Hieronymo
Æmiliani, et Seraphino a monte Granario ab Asculo denominato, Sanctam esse decrevimus, et definivimus,
ac Sanctorum Cathologo adscripsimus, ejusque memoriam, quam in subsequenti
Missae celebratione Nos ipsi solemniter venerati sumus, ab universa Ecclesia
quotannis dicta die xxi. Augusti religiose coli mandavimus. Cunctis
quoque Christifidelibus, qui ad tantam celebritatem confluxerant, [595]
plenariam, iis vero, qui singulis annis prædicta die ad ejusdem Sanctæ Joannæ Franciscæ Corpus venerandum
accesserint, septem annorum, et totidem quadragenarum Indulgentiam in forma
Ecclesiæ consueta misericorditer in Domino elargiti fuimus.
En igitur sapientissimo Dei consilio in una Sancta Joanna Francisca non uni dumtaxat mulierum cætui, sed
cujusvis illarum conditioni, ac numeris omnibus absolutum exemplar. Habent hic
virgines, habent nuptæ, habent viduæ, habent Sacræ Deo Moniales quod
admirentur, quod imitentur. Illa enim virginitatis custos integerrima, si
nuptiis consensit, non suæ, quæ illis adversabatur, sed paternae obsecuta est
voluntati. In matrimonio non filios modo ad imitationem pietatis suæ, sed virum etiam
adducere sedulo studuit. Vidua porro sanctius vitæ genus aggressa instituendo
ab se Ordini egregie prolusit. Ubi vero ad altiora vocanti se Deo alacriter
paruit ; fundatis opera sua Monasteriis tam multis, ac fundandis in
posterum, non tam optimis ab se constitutis legibus, quam pulcherrimis virtutum
omnium operibus, ac monumentis, arduum simul, et suave ad evangelicam
perfectionem iter ostendit, atque explanavit.
Ut autem præmissa omnia ad universæ per Orbem
Ecclesiæ notitiam perducantur, eorumque memoria perpetuis futuris temporibus ad
Dei gloriam, et fidelium exemplum perseveret. Nos ea præsentibus Apostolicis
Litteris complecti voluimus, mandantes eorum transumptis etiam impressis, manu
alicujus Notarii publici subscriptis, et Sigillo Personæ in ecclesiastica
dignitate constitutae munitis eamdem adhiberi fidem, quæ ipsis præsentibus
adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.
Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc
nostræ definitionis, decreti, adscriptionis, mandati, statuti, concessionis,
relaxationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contrarie ;
si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem [596] Omnipotentis
Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno
Incarnationis Dominicæ mdcclxvii.
decimo septimo Kalendas Augusti, Pontificatus Nostri Anno Decimo.
Ego Clemens, Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.
C. Cardin.
Prodatarius,
A. Cardin. Nigronus.
Registrata in Secretaria Brevium.
FIN DE L'APPENDICE.
TABLE DES MATIÈRES
......................................................................................................................... Pages
Approbation...................................................................................................... 5
Lettre de Mgr Mermillod........................................................................... 7
Lettre du Monastère.................................................................................. 10
Préface............................................................................................................... 13
Avant-propos des Mémoires de la Mère de Chaugy................................ 18
PREMIÈRE PARTIE.
ses
années passées au monde.
CHAPITRE
PREMIER. — De la vertu des aïeux et du père de notre Bienheureuse Mère 19
Chapitre II. — De la naissance de notre Bienheureuse Mère, et
de la fidélité du président Frémyot, son père, à l'Église et au roi....................................................................................................................................... 22
Chapitre III. — Comme elle se comporta en son état de fille,
et son mariage avec le baron de Chantal 26
Chapitre IV. — De sa demeure à la campagne, où elle prend le
soin de son ménage 30
Chapitre V.— Comme elle se comportait en son ménage, et le bon
ordre qu'elle mit en sa maison 32
Chapitre VI. — Combien vertueusement elle se comportait en
l'absence de son mari 36
Chapitre VII. — Comme le baron de Chantal fut blessé à la
chasse, et de son heureuse mort 40
Chapitre VIII. — De la grandeur de son affliction, et comme
elle se comportait en son veuvage 43
Chapitre IX. — Du véhément désir qu'elle avait d'être dirigée
à la perfection, demandant un conducteur à Dieu 46
Chapitre X. — De diverses visions sacrées qu'elle eut, tant de
notre Bienheureux Père, que des desseins que Dieu avait sur elle...................................................................................................................................... 47
Chapitre XI. — Comme elle se mit sous la direction d'un
personnage qui n'était pas celui que Dieu lui avait choisi 50
Chapitre XII. — De l'admirable patience ; qu'elle
pratiquait chez son beau-père 52
[598]
Chapitre XIII. — Des premières conférences qu'elle eut avec
notre Bienheureux Père, et comme ces deux saintes âmes se connurent sans s'être
jamais vues................................................................................ 55
Chapitre XIV. — Comme cette Bienheureuse fut consolée par deux
grands serviteurs de Dieu, sur la peine qu'elle avait de changer de directeur........................................................................................................ 58
Chapitre XV. — Du voyage de Saint-Claude, où notre Bienheureux
Père accepta la charge spirituelle de cette Bienheureuse............................................................................................................................................ 64
Chapitre XVI. — Comme elle fit vœu d'obéissance à notre
Bienheureux Père, et de ses tentations 67
Chapitre XVII. — Comme, en son premier voyage en Savoie, elle
fit sa confession générale à notre Bienheureux Père............................................................................................................................................ 70
Chapitre XVIII. — Du règlement qu'elle observait en sa
personne, et de ses emplois de charité 76
Chapitre XIX. — Deux exemples notables de son incomparable
charité à servir les malades 80
Chapitre XX. — Comme elle voulut, par révérence, filer les
habits de notre Bienheureux Père, et comme elle fut guérie d'une maladie............................................................................................................................... 85
Chapitre XXI. —De son second voyage en Savoie, où notre
Bienheureux Père lui donna résolution à quel genre de vie Dieu la destinai.......................................................................................................................... 88
Chapitre XXII. — Proposition du mariage de mademoiselle de
Chantal avec M. le baron de Thorens, et de la mort de la jeune sœur de notre
Bienheureux Père.................................................................................... 92
Chapitre XXIII. — De son troisième voyage en Savoie, et de ses
résistances à s'engager au monde 97
Chapitre XXIV. — Comme elle déclara sa résolution de quitter
le monde au président son père 102
Chapitre XXV. — Comme notre Bienheureux Père bénit le mariage
de M. le baron de Thorens et de mademoiselle de Chantal, et tira le
consentement des parents de notre Bienheureuse Mère pour sa retraite 105
Chapitre XXVI. — Comme Dieu appela nos premières Mères et
Sœurs pour commencer l'Institut, et de quelques autres points notables sur ce
sujet......................................................................................... 109
Chapitre XXVII. — Comme l'une des plus jeunes filles de notre
Bienheureuse mourut, et comme elle sortit de chez son père.......................................................................................................................................... 113
Chapitre XXVIII. — Avec quelle générosité notre Bienheureuse
Mère quitta son pays et ses parents pour aller où Dieu l'appelait.......................................................................................................................... 116
Chapitre XXIX. — Les dernières résolutions et assignations du
temps pour commencer notre Institut de Sainte-Marie.......................................................................................................................................... 119
DEUXIÈME PARTIE.
les
actions de sa vie religieuse.
CHAPITRE
PREMIER. — Commencements de la Visitation...................... 123
Chapitre II. — De la ferveur et des accroissements de la
petite Congrégation 127
[599]
Chapitre III. — De la préparation et de l'amour que notre
Bienheureuse fondatrice et ses compagnes apportèrent à la profession religieuse..................................................................................................... 131
Chapitre IV. — De la mort de M. le président Frémyot ; du
voyage de notre Bienheureuse à Dijon, et de quelques grâces qu'elle reçut en
chemin.................................................................................................. 134
Chapitre V. — De son incomparable charité au service et visite
des malades 138
Chapitre VI. — De la petitesse et de l'humilité où se tinrent
nos premières Mères 142
Chapitre VII. — De diverses maladies de notre Bienheureuse
Mère, de sa résignation et de son abandon dans la souffrance.......................................................................................................................................... 145
Chapitre VIII. — De la mort du beau-père de notre Bienheureuse
et de son voyage à Montelon ; de sa grande patience et débonnaireté dans
la conduite de ses affaires.......................................................... 149
Chapitre IX. — Notre dévote Mère fonde une maison de notre
Institut à Lyon ; elle reçoit alors quelques grâces miraculeuses................................................................................................................... 153
Chapitre X. — Notre Bienheureuse fait une nouvelle fondation à
Moulins ; sa constance sur la mort de sa fille ; elle éprouve
quelques peines d'esprit sur le baptême de son petit-fils........................................ 158
Chapitre XI. — Notre Bienheureuse Mère est guérie par miracle d'une
grande maladie ; elle fonde deux maisons : Grenoble et Bourges........................................................................................................................... 163
Chapitre XII. — Notre Bienheureuse Mère vient fonder à
Paris ; son humilité et patience dans les difficultés qu'elle y rencontre......................................................................................................................... 168
Chapitre XIII. — Notre Bienheureuse Mère visite plusieurs
maisons religieuses, se rendant dans les fondations d'Orléans, de Bourges,
Nevers et Moulins. Chemin faisant, elle s'arrête chez sa chère fille, madame de
Toulonjon, elle en sort pour aller fonder à Dijon................................................................................................................................ 172
Chapitre XIV. — Entrevue à Lyon de notre Bienheureuse avec
notre saint Fondateur ; elle va à Grenoble, où elle reçoit la nouvelle de
sa mort ; son admirable résignation à la volonté de Dieu.................. 178
Chapitre XV. — Le corps de notre saint Fondateur est apporté
de Lyon à Annecy ; notre Bienheureuse Mère lui rend ses devoirs et fait
ensuite un voyage à Moulins............................................................. 184
Chapitre XVI. — Notre Bienheureuse Mère travaille, avec plusieurs
de nos Mères, à notre Coutumier, d'après les usages et selon les paroles de
notre saint Fondateur ; sa fermeté dans les affaires de l'Institut 187
Chapitre XVII. — Les fondations continuent ; grands
honneurs et applaudissements que notre dévote Mère reçoit à Besançon........................................................................................................................ 191
Chapitre XVIII. — Notre digne Mère est déchargée de la
supériorité ; elle entreprend plusieurs voyages qu'on la pressait de faire.................................................................................................................................. 196
Chapitre XIX. — Notre digne Mère fait travailler aux
informations de la vie de notre Bienheureux Père ; son admirable constance
eu la mort de son fils.................................................................................. 200
Chapitre XX. — Notre Bienheureuse Mère est élue, à Orléans,
supérieure ; deux miracles de cette digne Mère, avec plusieurs choses
remarquables en son voyage......................................................................... 209
[600]
Chapitre XXI. — Notre digne Mère, de retour à Annecy ;
elle y passe le temps de la peste à travailler pour l'Institut.......................................................................................................................................... 215
Chapitre XXII. — Notre digne Mère assiste à l'ouverture du
tombeau de notre Bienheureux Père François de Sales ; nouvelles
afflictions qui lui arrivent........................................................................... 219
Chapitre XXIII. — Notre Bienheureuse Mère établit un second
monastère à Annecy 224
Chapitre XXIV. — Déposition de notre digne Mère ; décès
de Mgr Jean-François ; nouveau voyage en France 229
Chapitre XXV. — De la mort des premières Mères de l'Institut,
et des peines intérieures de notre Bienheureuse 235
Chapitre XXVI. — Nouvelle fondation que va faire notre
Bienheureuse Mère à Turin 239
Chapitre XXVII. — Notre Bienheureuse Mère met tous ses soins à
procurer et établir en Savoie les révérends Pères de la Mission........................................................................................................................... 246
Chapitre XXVIII. — De la mort de Mgr de Bourges................................ 250
Chapitre XXIX. — Notre digne Mère est de nouveau déchargée de
la supériorité ; sa parfaite humilité et charité 254
Chapitre XXX. — De son élection à Moulins, et de ses derniers
adieux au premier monastère d'Annecy 259
Chapitre XXXI. — De son dernier séjour à Paris, à Nevers et à
Moulins 264
Chapitre XXXII. — De son heureux décès............................................... 268
Chapitre XXXIII. — Des honneurs qu'on a rendus à sa mémoire......... 277
TROISIÈME PARTIE.
les
pratiques de ses héroïques vertus.
CHAPITRE
PREMIER. — De la foi de notre Bienheureuse....................... 286
Chapitre II. — De son espérance................................................................ 291
Chapitre III. — De son amour envers Dieu............................................... 294
Chapitre IV. — Suite du même sujet ; de son amour envers
Dieu......... 300
Chapitre V. — De son amour et charité à l'égard du prochain............... 305
Chapitre VI. — Suite du même sujet : de son amour et
charité à l'égard du prochain 313
Chapitre VII. — De sa patiente charité à supporter le prochain............ 320
Chapitre VIII. — Comment elle pratiqua les quatre vertus
cardinales.. 328
Chapitre IX. — De sa piété et de son zèle au culte divin........................ 333
Chapitre X. — De sa dévotion au Saint-Sacrement, à la Messe et
dans la Communion 338
Chapitre XI. — De sa dévotion et confiance envers la
Sainte-Vierge.. 343
Chapitre XII. — De sa dévotion au bon Ange et aux saints.................. 349
Chapitre XIII. — De son amour à la pauvreté........................................... 353
Chapitre XIV. — Suite de son amour à la pauvreté................................. 357
[601]
Chapitre XV. — De son amour à l'obéissance.......................................... 364
Chapitre XVI. — De son amour à la pureté............................................... 370
Chapitre XVII. — De son amour à l'humilité............................................. 372
Chapitre XVIII. — Suite de son amour à l'humilité................................... 378
Chapitre XIX. — La douceur et l'humilité de sa conduite....................... 384
Chapitre XX. — Combien cette Bienheureuse méprisait tout ce
qui sentait l'éclat mondain 391
Chapitre XXI. — De son amour à l'observance régulière....................... 397
Chapitre XXII. — De sa douce conversation et de sou exactitude
au silence 404
Chapitre XXIII. — On commence à parler de l'intérieur de notre
Bienheureuse Mère, et 1° de l'honneur et obéissance à son conducteur...................................................................................................................... 409
Chapitre XXIV. — De ses voies d'oraison................................................ 413
Chapitre XXV. — Suite de ses voies d'oraison........................................ 418
Chapitre XXVI. — De ses peines intérieures............................................ 424
Chapitre XXVII. — De ses tentations........................................................ 430
Chapitre XXVIII. — Faveurs et grâces surnaturelles et
extraordinaires que reçut notre Bienheureuse 436
Chapitre XXIX. — Son abandonnement à Dieu et ù sa sainte
providence........... 440
Chapitre XXX. — Combien elle était éclairée et solide en la
conduite des âmes 446
Chapitre XXXI. — Ses avis et maximes, surtout pour l'oraison............. 451
Chapitre XXXII. — Conclusion.................................................................. 458
Appendice........................................................................................................ 460
fin de la table des matières.
paris.
— typographie de e. plon et cie, 8. rue garancière.
[1]
Dans ce billet, adressé à M. Pioton,
avocat au souverain Sénat de Savoie, à Chambéry, et daté de 1623, il s'agit de
la fondalion du monastère de la Visitation de Chambéry.
La Sainte signe toujours avec le nom de Frémyot.
[2] Inutile de faire remarquer que cette préface n'est pas l'ouvrage des humbles filles de Sainte Chantal. Elle est due à une plume habile qui bientôt se fera connaître par la publication de la Vie de la Mère de Chaugy elle-même.
[3] Quand ces misérables huguenots vinrent à Dijon, comme il était en charge au Conseil, il fut le premier qui tint bon pour leur résister et les chasser de la ville. (Dépositions des contemporaines de la Sainte.)
[4] Marguerite de Berbisey était d'une maison des plus nobles et des plus anciennes de la Bourgogne, alliée à la famille de saint Bernard par Perrenot de Berbisey, qui avait épousé en 1378 Oudette de Normand, de la maison de ce saint.
[5] Le père du baron de Chantal, nomme Guy, était fils de Christophe de Rabutin, né vers le commencement du seizième siècle, en 1500 ou 1501, et mort en 1569 ; ce Christophe était fondateur de la chapelle de Bourbilly, et père de cinq enfants. Guy de Rabutin, son troisième fils, né en 1532, et beau-père de sainte Chantal, fut le premier de sa race qui porta le titre de baron de Chantal. C'était un homme d'un caractère singulièrement hardi, et remarquablement sévère.
[6] Christophe de Rabutin-Chantal avait une valeur calme et modeste. Sa douceur était inaltérable. Sous les yeux de Henri IV, il se couvrit de gloire à la rencontre de Fontaine-Française (1595), où il reçut plusieurs blessures. Son dévouement à la cause du Roi légitime l'avait mis en relation avec Bénigne Frémyot, président au parlement de Dijon.
[7]
Le vieux château de Bourbilly était
dans la paroisse de Vic-Chassenay, entre le bourg d'Époisses et Semur, capitale
de l'Auxois. La terre de Bourbilly, renommée pour son aspect riant et
pittoresque et pour l'abondance de ses récoltes, était affectée aux enfants
mâles de la branche aînée des Rabutin. Cette terre relevait de celle
d'Époisses, dont les comtes de Guitaut étaient propriétaires. Bourbilly est
dans un vallon tapissé de prairies, et de toutes parts environné de coteaux,
que couvrent des bois et des vignes. Du sommet d'un rocher, une petite rivière
(le Senain) se précipite en cascade dans le vallon, le traverse, s'y
divise, y répand la fraîcheur, et de ses eaux limpides alimente un ancien
moulin. Le château, composé de tours et de murailles gothiques, formait un
carré, dont le centre était une grande cour. Dans des salles immenses, on voit
encore d'antiques cheminées, chargées de sculptures, ainsi que des plafonds
remplis de peintures à demi effacées, qui représentent l'écusson des Rabutin.
Un bon portrait à l'huile de la pieuse madame de Chantal a résisté seul aux
ravages du temps. L'entrée du château était fermée par un pont-levis que
dominait une tour.
(M. de Saint-Surin.)
Depuis quelques années, ce château vient d'être restauré avec soin par M. le comte de Franqueville.
[8] Elle travailla incessamment à payer les créanciers, à rappeler les domestiques à la crainte de Dieu, leur faisant elle-même des instructions et les obligeant d'assister à la prière du soir et matin. (Dépositions de la Mère Fr., Madeleine Favre de Charmette.)
[9] Le miracle suivant paraît être arrivé une autre année : « Après avoir fait distribuer tout son grain, jusque-là même qu'une domestique avait balayé le grenier pour donner le reste aux pauvres, par ordre de la servante de Dieu, qui ne laissa pas de lui ordonner de nouveau de faire l'aumône à deux ou trois pauvres qui se présentèrent au château, et comme cette domestique lui dit qu'elle était sûre qu'il n'y avait plus rien au grenier, elle lui répliqua : « Allez-y pour l'amour de Dieu, » et aussitôt elle y alla pour lui obéir. Mais elle fut extrêmement surprise, lorsque, voulant ouvrir la porte du grenier, elle le trouva si plein de grains, qu'elle eut peine d'y entrer. » (Dépositions de la Mère Fr., Madeleine Favre de Charmette.)
[10] Ce furent les derniers combats contre la Ligue et les triomphes d'Henri IV qui arrachèrent le baron de Chantal au foyer domestique. « Il se signala particulièrement au combat de Fontaine-Française, où il fut fort blessé à la vue du roi Henri IV, et, au témoignage de ce prince, il ne contribua pas peu à la victoire. La manière dont le Roi parla de Chantal, au sortir du combat, lui fit plus d'honneur dans l'esprit des justes estimateurs de la gloire que les bâtons des maréchaux de France n'en firent pendant ce règne à quelques particuliers. En ce temps-là, comme en celui-ci, ces récompenses d'honneur n'étaient pas toujours pour les plus dignes, mais seulement pour les plus heureux. (Bussy-Rabutin.)
[11] Il ordonna que son pardon fût écrit sur les registres de la paroisse. (Dépositions de la Mère Fr., Madeleine Favre de Charmette.)
[12] Dans les différentes Vies que l'on a publiées de sainte de Chantal, on assure que la mort de son mari fut l'effet d'une méprise causée par la couleur ventre-de-biche de son habit ; mais voici comment le comte de Bussy-Rabutin, son proche parent, la raconte dans sa Généalogie manuscrite de la maison de Rabutin : « Étant revenu chez lui malade d'un flux hépatique, il en guérit avec assez de peine ; et, commençant à se bien porter, il allait assez souvent à la chasse. Un jour qu'il y était avec d'Anzely, sieur de Chaselle, son voisin, son parent et son bon ami, chacun une arquebuse sur l'épaule (car on se servait encore alors fort rarement de fusils), la détente de celle de Chaselle s'en alla et blessa Christophe au ventre, ce dont il mourut huit jours après, avec une fermeté et une résignation aux volontés de Dieu dignes du mari d'une sainte. » (M. de Saint-Surin.)
[13] Depuis cette funeste mort, la baronne de Chantal nomma, sur les fonts baptismaux, un enfant de celui que le meurtre de son mari devait lui rendre odieux.
[14] Prenait des disciplines et se couvrait même d'un cilice. (Dépositions de la Mère Fr., Madeleine Favre de Charmette.)
[15]
Avant que de quitter Bourbilly, où elle
ne vint plus qu'en passage, « la servante de Dieu fit distribuer aux
pauvres tous les grains et autres effets qui étaient au château. Dans ledit
temps, trois filles orphelines du village de Corcelles, appelées les Fondardes,
étant venues trouver ladite dame pour avoir quelques aumônes, elles demeurèrent
en chemin à cause de la rigueur et des injures du temps. Ladite dame l'ayant
appris, elle envoya au-devant d'elles, et les ayant fait venir, eut soin, avant
son départ, d'en placer deux et emmena la troisième dans son carrosse.
Or, lors de la sortie de cette dame, il y avait un grand nombre de pauvres, tant veuves, orphelins qu'autres, qui pleuraient et gémissaient d'une manière pitoyable, suivant son carrosse, et disant qu'ils perdaient leur bonne Mère. » (Déposition de Jeanne Poutiot.)
[16] Cependant la servante de Dieu, quoique naturellement vive et impérieuse, reçut tous ces traitements avec une patience inaltérable, soit envers le baron son beau-père, qui écoutait trop les mauvais rapports et médisances de cette servante au préjudice de sa belle-fille, soit envers cette domestique même, à qui elle faisait d'autant plus de bien qu'elle en recevait de mal. (Déposition de la sœur F. B. d'Orlyer de Saint-Innocent.)
[17]
Or la vertu de la Servante de Dieu jeta
en ce temps-là un tel éclat que les révérends Pères Capucins tinrent à honneur
de l'affilier à leur ordre, comme il appert par l'acte d'affiliation, datée de
Lyon du 6 avril 1603.
Quelques historiens se sont trompés en croyant que, par cet acte, la sainte devint membre du tiers-ordre de saint François. Ce ne fut qu'un simple acte d'agrégation qui rendait madame de Chantal participante aux bonnes œuvres de l'Ordre séraphique. Tous les ordres religieux délivrent des lettres semblables comme gage de reconnaissance ou d'estime aux personnes de singulière piété qui ont obligé le monastère.
[18] Sainte de Chantal n'oublia jamais cette heureuse journée (5 mars 1604), et chaque année, assure la Mère de Chaugy, elle faisait une dévote commémoraison de cette première vue, repassant devant Dieu, avec beaucoup de reconnaissance, tous les bienfaits qu'elle avait reçus de Lui par le ministère de son Bienheureux Directeur. (Année Sainte, troisième volume).
[19]
Thonon, première conquête de saint François de Sales
sur l'hérésie, petite ville de la Savoie et capitale du Chablais. Le monastère
de la Visitation d'Évian, fondé en 1625 par les soins de sainte
Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal, y fut transféré en 1627. Depuis la
révolution française, il avait cessé d'exister jusqu'en 1837, qu'il a été
rétabli dans le même local.
Gex, autrefois capitale du bailliage de ce nom, fut cédée à Henri IV par le duc de Savoie, en l'an 1600. C'est aujourd'hui une des sous-préfectures du département de l'Ain ; il s'y trouve un monastère de la Visitation.
[20] Saint-Claude, petite ville de l'ancienne Franche-Comté, et aujourd'hui l'une des sous-préfectures du département du Jura, était célèbre depuis 1243 par un pèlerinage au tombeau de saint Claude, évêque de Besançon, qu'on croit avoir vécu en 481. Cette ville n'était autrefois qu'une abbaye nommée Saint-Ouen, fondée par saint Romain ; saint Claude en fut abbé, et parla suite la ville prit son nom, s'étant formée par le concours du peuple qui accourait au tombeau du saint.
[21] Saint François de Sales était accompagné de madame de Boisy, sa respectable mère, et de sa jeune sœur Jeanne de Sales. Notre Bienheureuse Mère avait pour compagnes madame la présidente Bruslart et l'abbesse du Puy d'Orbe. (Les Épîtres du Saint le prouvent.)
[22] L'estime et la vénération que notre sainte Mère avait déjà conçue à Dijon pour son angélique Conducteur, allaient toujours croissantes. « Je puis assurer, déposa-t-elle plus tard, que, dès que j'eus l'honneur de connaître ce Bienheureux, environ dix-huit mois après son sacre, je conçus une si haute estime de sa vertu et piété, que je disais souvent : Cet homme-ci ne tient rien de l'homme. Je ne le pouvais regarder qu'avec admiration, surtout son maintien et la sagesse de ses paroles, qui étaient saintes et brèves, mais si moelleuses et résolutives, qu'il satisfaisait et arrêtait court les esprits les plus pénétrants ; certes, dès ce temps-là, je recevais avec un respect non-pareil les paroles qu'il me disait ; je ne pouvais retirer mes yeux de dessus lui, tant ses paroles et ses actions saintes me tiraient à l'admiration, et n'estimais aucun bonheur comparable à celui d'être auprès de lui pour voir ses actions et ouïr les paroles de sapience qui sortaient de sa bouche. Si ma condition me l'eût permis, je me fusse estimée trop heureuse d'être la moindre de ses domestiques, pourvu que j'eusse pu ouïr ses paroles saintes. Cette estime crût toujours, en sorte que je ne pouvais m'empêcher de le nommer Saint, ce qu'il me défendit. Quand je recevais de ses lettres, je les baisais par grand respect, et je les lisais souvent à genoux, et recevais ce qu'il me disait comme procédant de l'esprit de Dieu ; je n'ai jamais laissé perdre la moindre lettre qu'il eut formée. Cette estime m'a continué invariablement, et je l'avais en tel degré en mon esprit, que tout ce que j'en dis ou pourrais dire à la louange de ce Bienheureux et des excellentes vertus dont Dieu avait enrichi sa chère âme, ne me peut contenter, car ce que j'en ai connu, ce que j'en vois et sens, est tout à fait au-dessus de ce que j'en puis dire, et ne crois pas que nulle créature de ce monde en puisse parler approchant de ce que Dieu avait mis en lui. » (Paroles de la Sainte citées par la Mère de Marigny.)
[23] Le château de Sales était situé à trois lieues d'Annecy ; c'était une espèce de forteresse composée de trois corps de bâtiment, flanqués de six hautes tours et de trois tourelles. On ne connaît pas l'époque à laquelle le château de Sales fut bâti ; mais toujours est-il qu'il existait en l'an 1000, sous Gérard, seigneur de Sales. Aujourd'hui, il ne reste de ce château que la chambre où est né saint François de Sales.
[24] Je lui ai ouï dire, assura la Mère de Marigny, qu'étant encore séculière, notre Bienheureux Père la mortifiait bien sensiblement sur de petites occasions en apparence, mais qui lui coûtaient beaucoup... Une fois, étant à la table de ce Bienheureux, il savait qu'elle avait une naturelle aversion à manger des olives ; c'est pourquoi il lui en servit avec la signification de sa volonté qu'elle en mangeât, ce qu'elle fit avec un extrême répugnance. Il lui fit de même une autre fois pour des limaces fricassées, de quoi son estomac se souleva. « Lorsque j'avais l'honneur de manger à sa table, nous disait-elle encore, lui (le Bienheureux) qui savait mes répugnances et aversions en de certaines viandes, quand il y en avait, me demandait tout doucement si je mangeais bien de cela, comme s'il eût ignoré ma répugnance. Je lui répondis : Monseigneur, je n'en ai jamais mangé. » Et il m'en servait sur-le-champ. (Déposition de la Mère L. D. de Marigny.)
[25] C'est bien l'aurore de la dévotion au Cœur de Jésus qui semble vouloir jeter ses premières clartés.
[26] Dans la suite, saint François de Sales fit présent de cet ouvrage au premier monastère de la Visitation, où il est encore précieusement conservé.
[27] Ce volume se conserve encore comme une grande relique au premier monastère de la Visitation d'Annecy.
[28] Annecy, ville de Savoie (département de la Haute-Savoie), à sept lieues de Genève, huit de Chambéry, au bas d'un lac qui a trois lieues de long sur une et demie de large. La population (en 1874), 12,000 âmes. Les hérétiques s'étant rendus maîtres de Genève, au seizième siècle, et en ayant chassé leur évêque, le siège épiscopal fut transporté à Annecy. Saint François de Sales est le second évêque de Genève qui y ait résidé.
[29] Ce saint nom était gravé à l'endroit du cœur, de la hauteur d'un pouce, bien formé, excepté la lettre S, qui n'était pas bien achevée. La croix était du côté d'en bas. (Lettre de la Mère de Musy, écrite du monastère de Moulins, le 10 janvier 1642.)
[30] La sainte grava le nom de Jésus sur son cœur devant un grand crucifix qu’elle apporta ensuite à la Visitation. Là, il était exposé sur l'autel du noviciat. Vers 1614, la vénérable Sœur Anne-Marie Rosset, collant ses lèvres sur cette sainte image, y fut gratifiée de la première vision sur le Sacré-Cœur de Jésus. D'après les indications de l'ancien inventaire des meubles du premier monastère d'Annecy, ce crucifix paraît être le même qui se conserve encore sur l'autel du Chapitre de ce même monastère.
[31] Joachim était natif du bourg de Celico, près de Cosenza en Calabre. Il prit l'habit de Cîteaux, au monastère de Corazzo, dans la même île, et en fut prieur et abbé. Il quitta son abbaye avec la permission du pape Luce III, vers 1183, et alla demeurer à Flore, où il fonda une célèbre abbaye, dont il fut le premier abbé. Il eut sous sa dépendance un grand nombre de monastères qu'il gouverna avec sagesse, fit fleurir dans son ordre la piété et la régularité, et mourut, en 1202, à l'âge de soixante-douze ans, laissant un grand nombre d'ouvrages. On a encore de lui des prophéties qui firent beaucoup de bruit, et que dom Gervaise, dans l'Histoire de l'abbé Joachim, 1745, 2 vol. in-12, dit avoir été accomplies.
[32] 4 avril 1610.
[33] Selon le Père Ménétrier, cette dame était la baronne de Cusy ; dans une lettre du 2 mai 1610, saint François de Sales la conjure de bien examiner si elle a assez d'affection, de force et de courage pour embrasser ainsi absolument Jésus-Christ crucifié et pour dire le dernier adieu au monde.
[34] La Bienheureuse, en quittant ses enfants, s'était fait scrupule de rien emporter que le strict nécessaire, n'ayant pris que trente écus pour son voyage, quelques linges et quelques nippes, avec le matelas dont le baron de Chantal, son défunt mari, se servait pour son lit de camp lorsqu'il allait à l'armée. (Déposition tirée du procès de canonisation de la Sainte.)
[35]
Cet article a donné lieu, dans notre
siècle, à une fausse interprétation de la pensée des saints Fondateurs de la
Visitation. On a avancé qu'ils avaient voulu former une espèce de Congrégation
de Sœurs de charité ; mais les constitutions mêmes que saint François de
Sales donna à ses filles prouvent que cette visite des malades n'était, selon
lui, qu'une œuvre secondaire : « Cette Congrégation, dit-il, a été
érigée en sorte que nulle grande âpreté ne puisse divertir les faibles et
infirmes de s'y ranger pour y vaquer à la perfection du divin amour. »
Voilà son but : attirer au festin du Père de famille, à l'union la plus
intime avec Dieu, les âmes fidèles et généreuses, mais faibles de corps. Aussi,
assure la Mère de Changy : « Le principal soin et les plus chères
affections de notre Bienheureuse Mère étaient de bien fonder ses filles à la
vraie vie intérieure et de l'esprit, à quoi toutes étaient fort attirées, en
sorte qu’elles ne cherchaient que mortification, récollection, silence et
retraite en Dieu. »
Ce but de saint François de Sales fut compris même du public, ainsi que le prouvent les Mémoires du temps ; et le Père Armand, jésuite, répondant au Saint qui lui avait demandé son jugement sur cette réunion de madame de Chantal et de ses premières filles, écrivait (ainsi qu'il se voit en la page 146) : « Votre Compagnie s'élève pour imiter la vie cachée, la vie contemplative, la vie bénigne de Jésus... » Il ne faisait nullement ressortir les œuvres de charité, car il savait que la visite des malades était une pratique accessoire, et non une des fins de la Congrégation. On s'en convaincra plus encore si on remarque que deux Sœurs seulement étant nommées pour faire cette visite durant un mois, le tour de chacune arrivait à peine une fois l'an, de sorte que la Communauté s'employait uniquement aux exercices de la vie intérieure et contemplative. Il n'y a donc pas de comparaison à établir entre la Visitation naissante et les Congrégations fondées pour l'éducation de la jeunesse, ou les Congrégations de charité qui sont dans un contact journalier avec les pauvres de Jésus-Christ.
[36] Partant de la sincérité avec laquelle nos premières Sœurs agissaient avec elle en ces commencements, la Sainte dit : « J'en faisais de même avec notre Bienheureux Père quand il venait ; toujours après lui avoir parlé de nos affaires, je lui disais ce que j'avais à lui dire de moi. Or, il arriva qu'une fois, après lui avoir bien dit ce qui me faisait peine, je ne fus pas satisfaite, comme j'avais accoutumé, Dieu ne le permettant pas pour m'apprendre à chercher en lui ce que je pensais trouver au Bienheureux qui, cette seule fois, par aucune parole, ne me put donner de l'allégement, bien qu'il me parlât beaucoup ; mais voyant que cela n'y faisait rien, il me laissa en ma peine et s'en alla. Moi qui ne savais que faire, voyant que ce Saint ne m'avait pas guérie, ne sus que faire autre que de m'en aller devant le Saint-Sacrement pour me guérir avec Notre-Seigneur ; et là j'appris ce que je n'avais encore jamais bien su, qu'il ne fallait pas attendre toute sa consolation des créatures, ains de Dieu, et que le vrai moyen de se guérir était de se remettre et abandonner à la miséricorde divine sans aucune réserve. Le Bienheureux m'écrivit le lendemain un billet pour savoir comment j'avais passé la nuit, car il savait que quand j'étais en tel état, je ne dormais point, et il avait tant de charité, que cela le tenait en peine ; mais je lui mandais que j'avais été guérie vers Notre-Seigneur avant que me bouger de la place. » (Dépositions des Contemporaines de la Sainte.)
[37] À la mort de cette chère Sœur, il arriva à nos premières Sœurs de jeter sur son corps des fleurs, crainte de quelque mauvaise odeur ; mais comme elles l'avaient fait sans ne avoir la permission, notre sainte Mère les en reprit et les fit manger au réfectoire à sa place, tandis qu'elle prit son repas à leurs pieds. (Archives de la Visitation d'Annecy.)
[38]
La servante de Dieu aima tendrement ses
ennemis (déposa sœur Marie-Joseph de Musy, professe du second monastère de la
Visitation d'Annecy), et leur faisait du bien, lorsque même ils lui disaient
des paroles désagréables, comme elle fit particulièrement paraître à l'égard de
la servante de son beau-père, qu'elle caressa et obligea par plusieurs
bienfaits, et entre autre se chargea d'une de ses filles qu'elle amena avec
elle de Montelon à Annecy, où elle lui procura un mariage convenable, et qui
passa depuis à Talloires (près Annecy). Ce que la déposante sait pour
l'avoir ouï dire aux religieuses anciennes. (Procès de canonisation.)
La sœur M.-Jeanne Grandis déposa le même fait, ajoutant que la Vénérable ayant appris la mort dudit baron (son beau-père), a singulièrement caressé cette même ingrate (servante), amena même avec elle en Savoie une de ses filles qu'elle pourvut, la mariant dans une honnête et commode famille, comme la déposante le sait pour avoir vu ladite fille. (Procès de canonisation.)
[39] Monseigneur de Marquemont admira fort la sainteté de cette vénérable Mère, si bien qu'il s'écriait en une rencontre : « Que dirons-nous à l'oreille de celle à qui Dieu parle toujours au cœur ! » La renommée de la servante de Dieu était déjà même arrivée à Rome, car, comme vers cette époque madame de Gouffier y sollicitait les dispenses nécessaires pour passer de l'Ordre du Paraclet à la Visitation, le cardinal Bandiné lui dit dans sa réponse : « Vous serez bien heureuse si vous pouvez devenir la fille de Monseigneur de Genève et de cette perle des dames, la Mère de Chantal. » (Dépositions de la Mère Françoise-Madeleine Favre de Charmette.)
[40] Il n'y avait pas encore de clôture qui empêchât l'entrée et le séjour des personnes du monde dans le monastère, c'est ce qui explique le fait dont il est question.
[41] Monseigneur de la Croix de Chevrière.
[42] Ce fut cette année de 1618, avant le départ de la sainte pour Bourges, que saint François de Sales, conformément à la bulle de Paul V, érigea la Congrégation de la Visitation en ordre religieux, ayant les vœux solennels et observant la clôture. « Notre Bienheureux Père, écrivit sainte Chantal, vint nous signifier cette bulle, que nous acceptâmes de grand cœur, Dieu nous ayant gratifiées d'un esprit d'une entière soumission à ses volontés ; outre que sa divine bonté nous donne une grande disposition et attrait intérieur pour vivre dans l'absolue clôture avec une entière consolation de nos âmes. » Cette cérémonie se fît le 16 octobre 1618. (Archives de la Visitation d'Annecy.)
[43] Monnaie d'argent, frappée en France sous Louis XII, sur laquelle était gravée la tête du roi.
[44] Il paraît hors de doute que ce fut madame de Gouffier dont il est question. Pour s'en assurer, on n'a qu'à lire avec attention les lettres de sainte Chantal. Cette dame décéda en 1621.
[45] La Bienheureuse Sœur Marie de l'Incarnation, fondatrice des Carmélites en France, naquit à Paris, le 1er février 1565. Elle était fille unique de Nicolas Avrillat, seigneur de Champlatreux et de Marie Lhuillier. Elle épousa M. Acarie, à l'âge de 18 ans. Après la mort de son mari, elle fit profession au couvent des Carmélites d'Amiens, en qualité de Sœur converse, et mourut à celui de Pontoise, le 18 avril 1618. Son tombeau devint dès lors célèbre par les miracles dont Dieu l'honora. Pie VI béatifia la Mère de l'Incarnation, le 29 mai 1791. Les reliques échappées aux profanations de la révolution française furent solennellement réintégrées en 1822, dans la chapelle des Carmélites de Pontoise.
[46] Durant un des voyages de la Sainte, elle s'arrêta dans un château, des premiers de la province. Descendant au jardin avec la dame du lieu et lui parlant doucement, elle lui dit : « Ma petite baronne, qu'y a-t-il que vous êtes triste ? — C'est, lui répondit-elle, ma Mère, il y a sept ans que j'ai l'honneur d'être céans, où je serai à mépris si je n'ai point d'enfant. » Alors la Sainte, élevant ses yeux et son cœur à Dieu, fît un petit signe de croix au front de la dame, disant : « J'espère en Notre-Seigneur que vous en aurez, je vous le promets de sa part... En effet, peu après, elle fut enceinte et a eu quatorze enfants ; deux de ses filles ont été religieuses de la Visitation. (Archives de la ville d'Annecy.)
[47] Ce fut Gabrielle qui épousa dans la suite le comte de Bussy-Rabutin. Voir la vie de leur fille, la sœur J.-Th. de Bussy-Rabutin, au premier volume de l’Année sainte.
[48] Mon père et ma mère m'ont abandonné ; mais le Seigneur m'a pris sous sa protection.
[49] Saint François de Sales mourut d'apoplexie à Lyon, le 28 décembre, fête des Saints Innocents, 1622, dans la cinquante-sixième année de son âge et la vingt et unième de son épiscopat.
[50] L'amour de Dieu lui fit supporter le coup mortel qu'elle reçut de la mort de notre Bienheureux Père, adorant le divin vouloir à travers de ses cuisantes douleurs, disant des paroles de soumission entremêlées de soupirs et de larmes pitoyables, assurant qu'elle ne le voudrait pas avoir racheté par un seul cheveu de sa tête, puisque c'était la volonté de Dieu, et que maintenant elle dirait bien sûrement : « Notre Père, quiètes aux cieux », puisqu'elle n'en avait plus sur terre, et ne se voulut priver d'assister ce même jour à la communauté... Ma sœur la supérieure de Belley la voulut faire aller reposer, voyant qu'elle était si oppressée d'affliction ; mais elle la renvoya en disant que cela appartenait à des femmes du monde, et non à des religieuses... Un an durant, sa douleur lui tira des larmes des yeux toutes les fois qu'elle s'arrêtait un peu à parler du Bienheureux ; mais nonobstant ce, son esprit demeura toujours en son entière résignation, et remise de toutes choses et d'elle-même à Dieu. On n'apercevait aucun chagrin ni trouble en son maintien, ni en son esprit et paroles, et presque sans cesse élançait son cœur et ses soupirs en son bien-aimé Sauveur. (Dépositions de la S. F.-A. de la Croix de Fésigny.)
[51] En les faisant brûler en sa présence, elle ne se put tenir de dire : « Ah ! les belles choses qui brûlent ! » (Dépositions de la Sœur de F.-A. de la Croix de Fésigny. Procès de canonisation.)
[52] Dans un de ses voyages à Grenoble, elle trouva une Sœur qui ne pouvait prendre de nourriture, ou si peu que rien. Elle lui porta un potage et en mangea un peu pour la faire manger, ce qu'ayant fait, soudain elle fut guérie. (Déposition de la sœur F.-A. de la Croix de Fésigny.)
[53] Pour les détails de cette fondation, voir la vie de cette très-honorée Mère, au cinquième volume de l’Année sainte.
[54] Notre Sœur Madeleine Elisabeth de Lucinge.
[55] Durant ces longues poursuites en cour romaine, la Sainte disait souvent au R. P. Dom Juste : « Mon cher Père, n'épargnons rien, n'oublions rien de tout ce qui sera nécessaire pour cette œuvre, puisque Dieu le veut ; rendons ce devoir à ce Bienheureux ; mais pour ce qui en doit arriver, laissons-le à la divine Providence de Dieu. Pour moi, je me résous de n'y épargner chose quelconque, à ne nous laisser rien jusqu'à vendre tout ce qui sera à notre sacristie, s'il est nécessaire. Je ne me mets nullement en peine pour le temporel ; j'ai une si grande confiance en Dieu et qu'il y pourvoira, que je ne saurais mettre le contraire en mon esprit. » (Dépositions des contemporains de la Sainte.)
[56] Mademoiselle de Coulanges ; elle devint mère de Marie de Rabutin, qui épousa, en 1644, Henri, marquis de Sévigné.
[57] Ce fut là qu'elle trouva mademoiselle de Changy, nièce de son beau-fils, le comte de Toulonjon. Elle persuada à la jeune fille, alors sous l'impression d'une affection brisée, de l'accompagner en Savoie pour se distraire de ses ennuis, ce qu'elle accepta volontiers.
[58] Lorsqu'en 1630-31, la Savoie fut occupée par les Français, la Sainte donna une forte preuve de sa fermeté pour maintenir la clôture. La nouvelle Gouvernante du pays lui envoya un gentilhomme pour lui annoncer qu'elle désirait passer les fêtes prochaines dans le monastère. La Bienheureuse répondit que cette permission ne s'accordait qu'aux princesses souveraines. Le messager, bien étonné, lui dit que cette dame tenait rang de princesse ; mais la Sainte tint ferme dans son refus, quoique la Gouvernante, très-mécontente, fît éclater partout ses plaintes contre le monastère et allât jusqu'à calomnier ouvertement la Servante de Dieu. (Dépositions des contemporaines de la Sainte.)
[59] Marie de Rabutin, depuis marquise de Sévigné.
[60] Ce prévôt de Sales est Charles-Auguste (né en 1606), propre neveu de saint François-de-Sales. Ce fut vers 1634 qu'il publia la vie de son saint Oncle. Les contemporains purent donc lui fournir les plus riches mémoires ; mais les plus précieux de tous furent ceux de sainte de Chantal qui examina elle-même l'ouvrage. C'est à cette surveillance de la Sainte qu'il faut attribuer le silence que garda Charles-Auguste sur tout ce qui a rapport à la Visitation et à sa Bienheureuse Fondatrice.
[61] Monseigneur Jean-François de Sales vint recevoir la déposition de la Sainte, qui dit ses coulpes selon que cela est marqué en telle occurrence : « Monseigneur, dit-elle, je dis très-humblement ma coulpe d'avoir souvente-fois rompu le silence, même celui du soir sans nécessité ; de m'être dispensée des communautés sans urgentes occasions et de n'avoir pas servi nos Sœurs selon que je devais, dont je leur en demande très-humblement pardon, et à vous, Monseigneur, des mécontentements que je vous ai donnés. » Monseigneur repartit qu'il n'y avait pas sujet de tant faire de ressentiment ; que, grâce à Dieu, il ne s'était pas aperçu qu'il n'y eût rien dans la maison qui n'allât pas bien ; mais pour suivre les bonnes coutumes de l'Ordre, elle aurait pour sa pénitence trois Pater et Ave. Après quoi, elle se retira en la dernière place, où elle a voulu demeurer pour sa consolation. Et dès ce jour, elle s’est tenue dans un si grand rabaissement et respect envers la Sœur assistante, qu'il ne se peut dire. (Dépositions des contemporaines de la Sainte.)
[62] Ce trépas arriva le 8 juin 1635.
[63] Sainte-Baume est le nom d'une vaste et profonde grotte, située dans un des plus beaux sites de la France méridionale, à une égale distance (32 kil.) des villes d'Aix, Marseille et Toulon, creusée dans le flanc d'une montagne taillée à pic, et que l'on croit avoir été habitée, pendant trente-trois ans, par sainte Marie-Madeleine, sœur de saint Lazare.
[64] Le comte de Toulonjon est mort gouverneur de Pignerol.
[65] Vincent de Paul.
[66] « Pour moi, quand je serai déposée, dit un jour cette digne Mère, je me tiendrai si bien dans mon devoir, que je ne me mêlerai d'aucune chose. Si l'on me dit les affaires de la maison, je les écouterai ; si on ne me les dit pas, je ne les demanderai pas, ni ne m'en mettrai pas en peine ; ains en laisserai le soin à celle qui en aura charge. Ne faisais-je pas ainsi lorsque ma sœur Péronne-Marie de Châtel était supérieure ? Certes, elle faisait toutes les affaires sans m'en rien dire ; elle recevait les filles, traitait de leurs dots, faisait des réparations sans que j'en susse aucune chose ; je ne lui demandais pas aussi. J'espère que je ferai bien encore ainsi, quand je serai déposée ; et s'il plaît à Dieu, je tâcherai de donner en cela exemple. Il y a encore une chose qui me déplaît grandement pour ces supériorités, c'est que dès qu'on n'est pas supérieure six ans de suite en une maison, l'on s'en offense, l'on prend cela au point d'honneur ; on ne le peut souffrir, il semble que l'on nous fait un grand tort. Oh ! que ces vanités sont éloignées de l'esprit de la Visitation ! pour moi, elles me déplaisent tout-à-fait. » (Dépositions des contemporaines de la Sainte.)
[67]
Voici un fragment remarquable de ces
Dépositions :
« Il me
serait malaisé d'exprimer en quelle douceur, quelle tranquillité, quel amour
pour Dieu, quelle conformité et désir d'union avec lui était cette sainte âme
qui s'exhalait à Dieu en holocauste, comme une verge de fumée, d'encens de
myrrhe, de toutes sortes de parfums et de saintes odeurs, et cela à diverses
reprises. Et même en nous séparant, elle me tira à part pour me demander :
Dites-moi encore (mon père) en quel état et en quelle disposition je dois
mourir : car je ne le veux pas oublier. »
Après le décès de la sainte Fondatrice, cet illustre prélat en rendit le témoignage suivant : « Je n'aurais jamais fait, si je voulais discourir de toutes les vertus que je lui ai vu pratiquer : l'humilité et l'obéissance étaient en elle en un degré très-éminent, et plus encore la charité, tant à l'égard de Dieu qu'à celui du prochain, spécialement de son Ordre, lui témoignant tant d'amour qu'il me semblait voir saint Paul dans ce transport d'esprit, qui lui faisait dire : Que je sois anathème pour mes frères. Comme Dieu lui était toute chose, elle ne s'amusait point à jouir ni à prendre de la complaisance des grâces qu'il lui faisait, mais regardait l'usage qu'elle en devait faire, et hors cela les oubliait, ou même par une vraie simplicité de grâce et d'humilité profonde, ne les connaissait pas. »
[68] O Mère de Dieu ! souvenez-vous de moi.
|
[69] O Marie, mère de grâce, Mère de miséricorde, Défendez-nous contre nos ennemis, Et recevez-nous à l'heure de notre mort. |
Maria, mater gratiæ, Mater misericordiæ, Tu nos ab hoste protège, Et hora mortis suscipe. |
(Strophe d'une hymne de l'Office de la Sainte Vierge.)
[70]
Le corps de cette Bienheureuse Mère
arriva à Annecy le 30 décembre 1641 ; il fut porté à l'église du premier
monastère de son Ordre, et déposé dans l'oratoire du Bienheureux Fondateur,
jusqu'à ce que tout fût préparé dans ladite église pour sa sépulture, qui fut
faite avec beaucoup de solennité.
À la fin de l'année, on fit célébrer un anniversaire magnifique, et la persuasion où l'on était de la béatitude dont jouissait cette sainte âme était si universelle, qu'on n'y put souffrir d'appareil funèbre ; l'église où reposait son saint corps fut tendue de blanc et ornée comme pour un jour de fête. La solennité de cet anniversaire commença le 11 décembre et fut continué le 12 et le 13 ; chaque jour l'office y fut solennel, et le panégyrique de la servante de Dieu y fut prononcé par Charles-Auguste de Sales, qui fut depuis évêque de Genève.
[71]
Il s'agit ici de saint Vincent de Paul,
dont voici la remarquable déposition :
« Moi,
Vincent de Paul, Supérieur général de la Congrégation des Prêtres de la
Mission, certifions qu'il y a environ vingt ans que Dieu nous a fait la grâce
d'être connu de la très-digne Mère de Chantal, Fondatrice du saint Ordre de la
Visitation-Sainte-Marie, par de fréquentes communications de paroles et par
écrit qu'il a plu à Dieu que j'aie eues avec elle, tant au premier voyage
qu'elle fit à Paris, il y a environ vingt ans, qu'aux autres qu'elle y a faits
depuis, en tous lesquels elle m'a honoré de la confiance de me communiquer son
intérieur, qu'il m'a toujours paru qu'elle était accomplie en toutes sortes de
vertus, particulièrement qu'elle était pleine de foi quoiqu'elle ait toute sa
vie été tentée de pensées contraires, qu'elle avait une très-grande confiance
en Dieu, et un amour souverain de sa divine bonté ; qu'elle avait l'esprit
juste, prudent, tempéré et fort en un degré très-éminent ; que l'humilité,
la mortification, l'obéissance, le zèle de la sanctification de son saint Ordre
et du salut des âmes du pauvre peuple étaient en elle à un souverain
degré ; en un mot, je n'ai jamais remarqué en elle aucune imperfection,
mais un exercice continuel de toutes sortes de vertus, que quoiqu'elle ait joui
en apparence de la paix et tranquillité d'esprit dont jouissent les âmes qui
sont parvenues à un si haut degré de vertu, elle a néanmoins souffert des
peines intérieures si grandes, qu'elle m'a dit et écrit plusieurs fois qu'elle
avait l'esprit si plein de toutes sortes de tentations et d'abominations, que
son exercice continuel était de se retourner du regard de son intérieur, ne
pouvant se supporter elle-même en la vue de son âme si pleine d'horreur qu'elle
lui semblait l'image de l'enfer ; que, néanmoins, quoiqu'elle souffrît de
la sorte, elle n'a jamais perdu la sérénité de son visage, ni ne s'est relâchée
de la fidélité que Dieu demandait d'elle dans l'exercice des vertus chrétiennes
et religieuses, ni dans la sollicitude prodigieuse qu'elle avait de son saint
Ordre, et que de là vient que je crois qu'elle était une des plus sainte âmes
que j'aie jamais connues sur la terre et qu'elle est maintenant bienheureuse
dans le ciel. Je ne fais pas de doute que Dieu ne manifeste un jour sa sainteté
comme déjà il l'a fait en plusieurs lieux de ce royaume. Voila ce qui arriva à
une personne digne de foi et qui aimerait mieux mourir que de mentir. Cette
personne m'a dit qu'ayant nouvelle de l’extrémité de la maladie de notre
défunte, elle se mit à genoux pour prier Dieu pour elle et que la première
pensée qui lui tomba dans l'esprit fut de faire-un acte de contrition des
péchés qu'elle avait commis et commettait ordinairement, et qu'immédiatement
après il lui apparut un petit globe, comme de feu, qui s'élevait de terre et
allait s'unir dans la région supérieure de l'air à un autre globe plus grand et
plus lumineux, et que les deux réduits en un, montèrent plus haut, entrèrent et
s'abîmèrent dans un autre globe infiniment plus grand et plus resplendissant
que les autres, et qui lui fut dit intérieurement que ce petit globe était
l'âme de notre digne Mère, le second celui de notre Bienheureux Père et l'autre
l'essence divine ; que l'âme de notre digne Mère s'était réunie à celle de
notre Bienheureux Père, et toutes les deux à Dieu leur suprême principe.
« Il dit
de plus que dans la célébration de la Sainte Messe pour notre digne Mère,
aussitôt qu'il eut appris la nouvelle de son heureuse mort, et étant au second Mémento,
où l'on prie pour les morts, il pensa qu'il ferait bien de prier parce
qu'elle pourrait bien être en Purgatoire à cause de certaines paroles qu'elle
avait dites il y avait peu de temps, et qui lui paraissaient tenir du péché
véniel, et dans le même moment il revit la même vision, les mêmes globes et
leur union et qu'il lui resta un sentiment intérieur que cette âme était
bienheureuse et n'avait pas besoin de prières. Ce qui est resté si bien imprimé
dans l'esprit de cet homme que le même le voit dans le même état toutes les
fois qu'il pense à elle. Ce qui peut faire douter de cette vision, c'est que
cette personne a une si grande idée de la sainteté de cette âme bienheureuse
qu'elle ne lit jamais ses réponses sans pleurer par l'opinion qu'elle a que
Dieu est celui qui a inspiré à cette Bienheureuse âme ce qu'elles contiennent,
et que conséquemment cette vision est l'effet de son imagination ; mais ce
qui fait penser que c'est une vraie vision, c'est que le même n'est pas habitué
d'en avoir et qu'il n'a jamais eu que celle-là. En foi de quoi j'ai signé de ma
propre main et scellé de notre sceau. »
Vincent de Paul.
L'humilité du saint lui a fait raconter sa vision à la troisième personne ; mais les réflexions qui terminent le récit, inspirées par une humilité plus grande encore, suffisent seules à trahir son secret. Cette faveur, du reste, lui est attribuée par tous les auteurs contemporains.
[72] Les voies de Sion pleurent, etc., etc. (Thr, c. I, v. 1-5).
[73] Ps. 24, v. 1. 2. (Traduction Desportes)
[74] Ces deux livrets se trouvent au commencement du deuxième volume de cette publication.
[75] Dans une semblable rencontre, je lui ai ouï dire avec un grand zèle (déposa une contemporaine de la Sainte), sur la crainte qu'on avait pour l'âme d'une personne qui ne croyait pas d'être aimée de notre digne Mère, qu'elle donnerait de très-bon cœur un de ses yeux, voire tous deux, pour le salut de cette âme-là. Et que s'il fallait répandre son sang pour cela, qu'elle le ferait aussi fort volontiers. Elle disait ceci la larme à l'œil, tant son cœur était touche du malheur de cette personne.
[76] On voit dans la vie de la Mère Françoise-Madeleine de Chaugy, que ce trait de grande charité, tant loué par la Sainte, lui était arrivé à elle-même.
[77]
Une contemporaine de la Sainte dépose ce
qui suit : J'ai vu quelquefois la dépensière et l'économe lui demander, au
sortir de table, si ce qu'elle avait mangé était bien cuit ou mal
accommodé : « Certes, répondait-elle, je ne sais ce que c'est »,
montrant bien qu'elle n'avait pas l'esprit à ce qu'on lui servait au
réfectoire. « Aussi, ajoutait-elle, les filles de la Visitation doivent
avoir le seul corps à table et l'esprit en Dieu ou à la lecture qui se fait
selon notre sainte règle, et pour cela il est bon, pendant les repas, de
tremper quelquefois sa pitance dans le sang du Sauveur qui tombait sur le mont
de Calvaire, parce que cela a deux effets, l'un de faire trouver excellent ce
qui nous répugne, l'autre d'empêcher la sensualité que l'on pouvait prendre à
la nourriture, chose indigne d'un cœur religieux. »
Une autre fois, parlant à un Père de religion auquel les médecins disaient que l'air d'un certain lieu n'était pas bon, elle dit : « L'on m'a aussi toujours assuré que l'air de cette ville m'était fort contraire à cause qu'il est humide, mais je ne m'en mets pas fort en peine. Qu'il me soit bon, ou qu'il me soit mauvais, cela m'est égal, puisque Dieu veut que j'y sois. Et qu'importe-t-il aux personnes religieuses, qui ont donné leur corps et leur santé à Dieu, d'être malades ou en santé, pourvu qu'en l'un et l'autre état, elles accomplissent la volonté divine. Pour moi, il me paraît que selon l'esprit, cela doit être fort indifférent, car j'aime autant l'un que l'autre. » Ce bon Religieux lui répondit que cela était bien difficile et propre seulement à sa révérence, à quoi elle repartit que non et qu'elle croyait que tous les bons religieux en devaient être là. (Dépositions des contemporaines.)
[78] Le jour de la Pentecôte 1631, notre très-digne Mère se trouva le matin si absorbée en Dieu, qu'après que l'on eût lu le point de l'oraison, elle se mit à dire tout haut, sans savoir, au moins sans penser, qu'elle était avec la communauté, au chœur : Venez, ô très-saint Esprit ! Les Sœurs furent bien étonnées et bien consolées tout ensemble. M. Michel Favre lui demanda plus tard : « Ma Mère, que pensiez-vous alors ? » — « Hélas ! mon Père, dit-elle, je ne pensais point que j'étais au chœur, je pensais à appeler le Saint-Esprit. Je l'ai crié en français ! » (Dépositions des contemporaines de la Sainte.)
[79] Mystère de foi, Manne cachée.
[80] Psaume 90 ; v. 10, 11 et 12.
[81] Il se rencontra une fois (déposa une contemporaine de la Sainte) qu'on avait donné à cette unique Mère quelques linges, pour son usage, assez grossiers, et comme quelques Sœurs s'en aperçurent, elles lui dirent que sans doute la Sœur lingère s'était méprise. « Je l'ai bien pensé (répondit-elle avec un visage gai), mais qu'importe ! je serais bien aise qu'elle se méprît souvent ainsi, car ne vaut-il pas autant que je l’aie qu'une autre ? »
[82]
La Sainte profitait de toute occasion
pour s'humilier. Un jour, recommandant un malade aux prières des Sœurs ;
elle ajouta : « Je me recommande aussi à vos prières, mes
chères Sœurs, j'ai une fièvre bien plus dangereuse, qui est celle de mon
amour-propre. J'ai prou de quoi sentir la puanteur en moi. »
Une autre fois, elle assura qu'elle voudrait être inconnue à tout le monde. « Sans me comparer à sainte Thérèse, dit-elle, je dis bien que je voudrais être en quelque lieu inconnu, s'entend dans quelque monastère de la Visitation, car je ne voudrais pas être hors de là, pour que l'on ne sût ce que je suis et que l'on me laissât là en repos. » Et comme les Sœurs lui dirent que cela ne se pouvait pas faire, Sa Charité répondit : « C'est pourtant ce que je désirerais, d'être là une pauvre Sœur allassée et vile qui n'est propre à rien. » (Déposition des contemporaines.)
[83] Elle donna une grande preuve de démission d'elle-même lorsqu'on la supplia de faire imprimer le livre de ses Réponses, car elle le fit lire à la communauté, et supplia les Sœurs de lui dire tout naïvement ce qu'elles jugeraient devoir y être ajouté ou retranché. Même elle ordonna de lui faire ces observations par écrit pour ne pas s'en oublier. La Sainte fit aussi examiner ce livre par le révérend Père Dom Juste Guérin. (Dépositions des contemporaines.)
[84] Cette digne Mère dit un jour à la communauté, qu'elle avait fait en sorte, dans son gouvernement, de prendre l'avis des Sœurs en tout ce qu'elle faisait, et de leur condescendre en tout ce qu'elle pouvait ; mais néanmoins si son opinion ne se trouvait pas conforme à la leur, et qu'elle jugeât qu'il fût mieux de faire comme elle pensait, elle le faisait librement ; quoique au partir de là en tout ce qu'elle pouvait s'accommoder à l'avis dis autres, elle le faisait. « Et vous savez assez, mes Sœurs, que je dis vrai », dit-elle. Ce qui est, en effet, connu de toutes celles qui ont eu le bonheur de la connaître un peu particulièrement. Pour moi, je l'ai remarqué en beaucoup d'occasions, l'ayant vu céder à l'opinion des Sœurs avec une extrême douceur sans faire semblant de rien. (Dépositions des contemporaines de la Sainte.)
[85] Une autre fois, ayant reçu des nouvelles de quelques prospérités temporelles advenues à une maison de notre Ordre, elle dit le soir toute pensive : « J'ai été tout le jour toute craintive et en appréhension qu'avec le temps les filles de la Visitation n'aiment l'éclat, ce qui me toucherait le cœur d'une douleur incroyable. Je crains que l'on se jette trop dans des petites gentillesses mondaines, qui ruineront notre humilité et notre simplicité ; mais d'autre part, je me suis sentie cette espérance, que si jamais fille de la Visitation est si téméraire que de vouloir paraître, Dieu la ravalera jusqu à l'abîme de son néant, et la rabattera jusqu'aux profondeurs de la terre. Je l'en supplie de tout mon cœur ; oui, c'est de tout mon cœur que je l'en supplie. (Dépositions des contemporaines de la Sainte).
[86] Une autrefois, cette digne Mère étant extrêmement accablée d'affaires et de mal, elle n'avait dîné que fort longtemps après les autres, et quand elle fut venue à la récréation, elle prit promptement, selon sa très-louable coutume, son ouvrage ; une Sœur lui dit : Ma Mère, Votre Charité est prou lasse ; s'il lui plaisait de ne prendre pas son ouvrage, l'on ira sonner à cette heure la fin de la récréation, « Vraiment, dit cette âme très-pure, il est vrai que je suis un peu lasse, mais je me confesserais si je perdais du temps peu ou prou ; il le faut employer afin de n'en, rendre pas compte ; tant que je me pourrai traîner, je désire ne point manger le pain de la religion en vain, car notre temps, ni nous, ne sommes plus à nous-même ; je vous assure qu'il se fait plus de péché en la Religion de ce côté-là que l'on ne pense. Perdre le temps en la Religion c'est larcin ; nous sommes à Dieu et à la Religion, mes Sœurs ; le corps n'ôte que trop à l'esprit : faisons que l'esprit lui arrache des griffes tout ce qu'il pourra ; pour peu qu'il ait, c'est assez. » (Dépositions des contemporaines de la Sainte.)
[87]
Elle appréhendait fort que la prudence
humaine se glissât dans l'Institut, et un jour, sur quelques petites
interprétations, inspirées par la sagesse ou pour mieux dire l'esprit du monde,
au sujet de quelques points d'observance, cette Bienheureuse dit :
« que rien ne l'affligerait en sa vie que de voir la prudence humaine en
nos maisons, laquelle nous tire hors du train de la simple observance. »
« Oh ! ces sagesses humaines, s'écria la Sainte, mais plutôt ces
têtes faibles qui veulent opposer leur sagesse et leur jugement à celui du
Saint-Esprit qui a dicté leur Règle et leur Coutumier ! Qu'elles se
retirent de moi ; car, sans mentir, je n'ai pas assez de force pour les
supporter. Dieu veuille que je meure devant qu'elles fassent pratiquer leurs
interprétations. Ce sont des traditions comme celles des pharisiens !
Oh ! Dieu nous en préserve ! Que s'il doit nous arriver du
relâchement, de la désunion, du détraquement de nos observances dans cet
Institut, je prie Dieu qu'il tire tout d'un coup en paradis toutes celles qui
sont en l'Ordre, et puis qu'il l'anéantisse et qu'il ne soit plus question de
nouvelles choses. J'aimerais plus en voir l’exterminement et
l'anéantissement total, que d'y voir la dissolution, le détraquement, la
désunion et l'inobservance. Mes Sœurs, ne faisons point les philosophes,
suivons simplement ce qui est marqué et commandé, glorifions notre saint
Fondateur et nous ennoblirons les lois de son Institut, qui est la chose qu'il
avait le plus à cœur. Comment lui accroîtrons-nous sa gloire accidentelle, si
nous ne faisons pas ce qu'il nous enseigne ? Je crie toujours humilité,
simplicité, Dieu veuille que je sois bien entendue, car en cela consiste la
conservation de ce pauvre Institut !... »
Quand on demandait à notre Sainte Mère de se dispenser de quelque exercice ou observance à cause de sa santé, elle répondait : « Hélas ! si l'on n voulait se dispenser de ce à quoi l'on est obligé et de tout ce qui peut incommoder, l'on n'observerait jamais ni la Règle, ni les communautés. Il ne faut pas être si facile à se dispenser de son devoir, et quand bien nous saurions que pour suivre la communauté nous vivrions un peu moins, à cause de l'incommodité que nous en recevons, nous ne devrions pas laisser de le suivre ; à plus forte raison ne se faut-il pas dispenser pour de légères incommodités. Quiconque étant obligé à une Règle la penserait observer sans peine, il se tromperait ; car l'on ne fait pas le bien sans qu'il en coûte toujours quelque chose. (Dépositions des contemporaines de la Sainte.)
[88] C'est le Traité de l'Amour de Dieu, où saint François de Sales s'adresse à Théotime ; admirable livre que le saint évêque avait écrit en faveur de ses chères filles de la Visitation.
[89] Cette lettre est datée des premiers jours de 1637.
[90]
On lit encore, dans un manuscrit de
l'ancien monastère de la Visitation de Compiègne, la relation de la grâce
suivante dont la Sainte fut gratifiée.
« Un jour,
après la Sainte Communion (dit la Servante de Dieu), Notre-Seigneur me fit
connaître que si une âme se veut conserver extérieurement et intérieurement à
LUI, il ne faut autre chose que se mettre en la pratique de la sainte
constitution de la chasteté. Les paroles, me dit-il, sont toutes divines ;
il n'y a rien d'humain, tout est sorti de mon Cœur amoureux. Je veux que mes
Épouses soient si pures, innocentes et humbles, quelles n'aient autre regard ni
vue que sur Moi, et purement pour Moi, et non pour se contenter
elles-mêmes. Je veux qu'elles soient attachées toutes nues à la croix, sans
autre appui que mon amour tout pur. »
« Je voudrais que jamais elles refusassent aucune humiliation, mortification et rebut, ni aucune chose qui les pût tant soi peu avilir devant les créatures. En tout cela j'ai de grands desseins pour les faire avancer dans mon amour ; et si elles faisaient cela, elles me contenteraient infiniment, et je serais toujours en attention pour les contenter. Mon cœur est tout plein d'amour pour les âmes qui m’aiment et se donnent à Moi en sincérité de cœur, et je me donne à elles avec l'abondance de mes faveurs qui sont pour mes Épouses que j'aime chèrement. »
[91]
Une fois la Sainte dit : « La
perfection que Dieu demande des filles de cette petite et humble Congrégation,
c'est une entière fidélité à toutes les observances, un abandonnement entier
entre les mains de la divine Providence et une suite absolue de toutes les
divines volontés. »
Sur une autre rencontre elle disait : « J'aime uniquement cette parole : Tout homme est vanité et mensonge. » Et celle que le prédicateur dit l'autre jour : Jusques à quand, fils des hommes, jusques à quand courrez-vous après la vanité ? « Jusqu'à quand, mes chères Sœurs, serons-nous après nos propres recherches et nos satisfactions ? Jusqu'à quand désirerons-nous quelque chose hors de Dieu ? Ah ! je vous prie, faisons ferveur pour chercher à bon escient ces vrais biens. C'est le dessein de Dieu en nous tirant à lui et nous séquestrant du monde, » (Dépositions des contemporaines de la Sainte.)
[92] Une des contemporaines de la Sainte déposa qu'elle lui a souvent ouï dire : « Mes Sœurs, je vous assure que l'âme qui est si heureuse de se reposer en Dieu par une entière confiance, n'est jamais ébranlée de rien, tout lui succède bien, tout ce qui est au gré de Dieu est au sien ; l'âme qui a jeté toute sa confiance en Dieu, n'a jamais besoin de rien, parce que celui sur lequel elle se confie en a un tel soin, qu'il a toujours l'œil sur elle pour son bien. Il me fâche que nous nous appuyons trop sur les créatures, les filles de la Visitation doivent être tellement remises et abandonnées à Dieu, et avoir une telle confiance en ce bon Sauveur, que quand tout le monde leur manquerait, elles ne s'en doivent point troubler ni affliger. Mes chères Sœurs, je m'en vais, mais Dieu vous demeure, ce Père céleste a soin de tous, pourquoi craindre et appréhender ? Les créatures ne peuvent rien, leur service est inutile aux âmes sans le secours de Dieu. »
[93] Procès de canonisation.
[94] Voir page Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! Signet non défini. le texte du Bref de béatification.
[95] Voir page Erreur ! Signet non défini. le texte de la Bulle du pape Clément XIII.
[96] Charles-Félix et Marie-Christine.